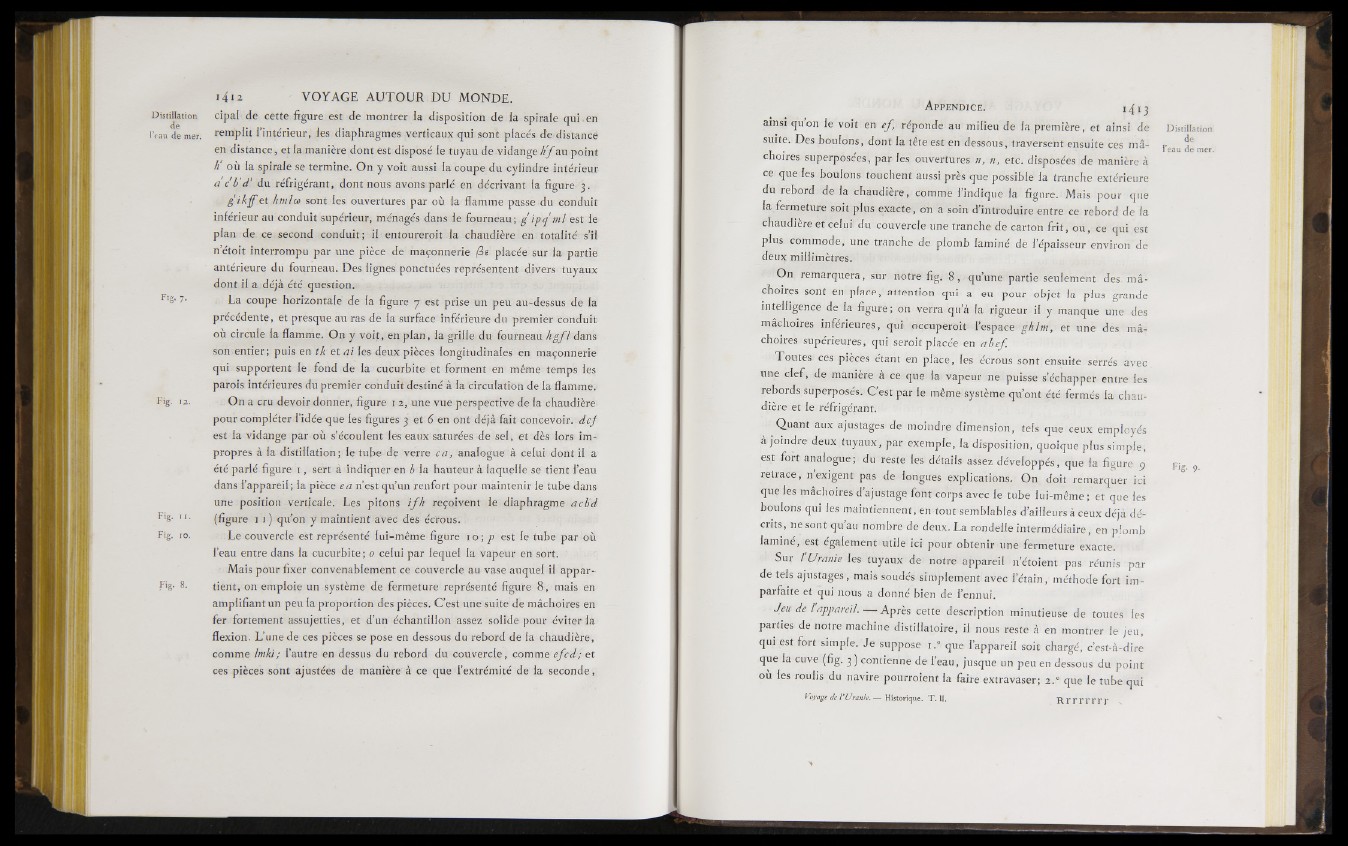
F'g- 7 -
F'g-
F ig . I I .
Fig. 10.
F ig . 8.
cipal de cette figure est de montrer la disposition de la spirale qui en
remplit l’intérieur, les diaphragmes verticaux qui sont placés de distance
en distance, et la manière dont est disposé le tuyau de vidange ///au point
// où la spirale se termine. On y voit aussi la coupe du cylindre intérieur
d c b 'd ' du réfrigérant, dont nous avons parlé en décrivant la figure 3.
g ik ffe t hmlu) sont les ouvertures par où la flamme passe du conduit
inlérieur au conduit supérieur, ménagés dans le fourneau; g ipq ml est le
plan de ce second conduit; il entoureroit Ja chaudière en totalité s’il
n’étoit interrompu par une pièce de maçonnerie /3e placée sur la partie
antérieure du fourneau. Des lignes ponctuées représentent divers tuyaux
dont il a déjà été question.
La coupe horizontale de la figure 7 est prise un peu au-dessus de la
précédente, et presque au ras de la surface inférieure du premier conduit
où circule la flamme. On y voit, en plan, la grille du fourneau h g fl dans
son entier; puis en tk et ni les deux pièces longitudinales en maçonnerie
qui supportent ie fond de la cucurbite et forment en même temps ies
parois intérieures du premier conduit destiné à la circulation de la flamme.
On a cru devoir donner, figure i 2, une vue perspective de la chaudière
pour compléter l’idée que les figures 3 et 6 en ont déjà fait concevoir, d c j
est la vidange par où s’écoulent les eaux saturées de sel, et dès lors impropres
à la distillation; le tube de verre ca, analogue à celui dont il a
été parlé figure i , sert â indiquer en b la hauteur à laquelle se tient i’eau
dans l’appareil; la pièce ea n’est qu’un renfort pour maintenir ie tube dans
une position verticale. Les pitons i f h reçoivent le diaphragme achd
(figure I ] ) qu’on y maintient avec des écrous.
Le couvercle est représenté iui-même figure 10 ; 3; est le tube par où
l’eau entre dans la cucurbite ; 0 celui par lequel la vapeur en sort.
Mais pour fixer convenablement ce couvercle au vase auquel il appartient,
on emploie un système de fermeture représenté figure 8, mais en
amplifiant un peu la proportion des pièces. C’est une suite de mâchoires en
fer fortement assujetties, et d’un échantillon assez solide pour éviter la
flexion. L’une de ces pièces se pose en dessous du rebord de la chaudière,
comme Imki; l'autre en dessus du rebord du couvercle, comme efcd ; et
ces pièces sont ajustées de manière à ce que l’extrémité de ia seconde,
ainsi quon Je voit en ef, réponde au milieu de la première, et ainsi de
suite. Des boulons, dont la tête est en dessous, traversent ensuite ces mâchoires
superposées, par les ouvertures n, n, etc. disposées de manière à
ce que les boulons touchent aussi près que possible la tranche extérieure
du rebord de la chaudière, comme l’indique la figure. Mais pour que
la fermeture soit plus exacte, on a soin d’introduire entre ce rebord de la
chaudière et celui du couvercle une tranche de carton frit, ou, ce qui est
plus commode, une tranche de plomb laminé de l’épaisseur environ de
deux millimètres.
On remarquera, sur notre fig. 8 , qu’une partie seulement des mâchoires
sont en place, attention qui a eu pour objet la plus grande
intelligence de la figure; on verra qu’à la rigueur il y manque une des
mâchoires inférieures, qui occuperoit l’espace ghlm, et une des mâchoires
supérieures, qui seroit piacée en a h e f
Toutes ces pièces étant en place, les écrous sont ensuite serrés avec
une clef, de manière à ce que la vapeur ne puisse s’échapper entre les
rebords superposés. C’est par ie même système qu’ont été fermés la chaudière
et le réfrigérant.
Quant aux ajustages de moindre dimension, tels que ceux employés
à joindre deux tuyaux, par exemple, ia disposition, quoique plus simple,
est fort analogue; du reste les détails assez développés, que la figure 9
retrace, n exigent pas de longues explications. On doit remarquer ici
que les mâchoires d’ajustage font corps avec ie tube lui-même ; et que les
boulons qui les maintiennent, en tout semblables d’ailleurs à ceux déjà décrits,
ne sont qu au nombre de deux. La rondelle intermédiaire, en plomb
laminé, est également utile ici pour obtenir une fermeture exacte.
Sur l ’Uranie les tuyaux de notre appareil n’étoient pas réunis par
de tels ajustages, mais soudés simplement avec l’étain, méthode fort imparfaite
el qui nous a donné bien de l’ennui.
Jeu de lappareil. — Après cette description minutieuse de toutes les
parties de notre machine distillatoire, il nous reste à en montrer le jeu,
qui est fort simple. Je suppose i .° que i’appareil soit chargé, c’est-à-dire
que la cuve (fig. 3 ) contienne de l’eau, jusque un peu en dessous du point
où les roulis du navire pourroient la faire extravaser; 2.° que le tube qui
Voyage de l ’Uranie.— Historique. T . II. R r m ' m '
Dis iilia tion
de
l’eau de mer.
Fig. 9.