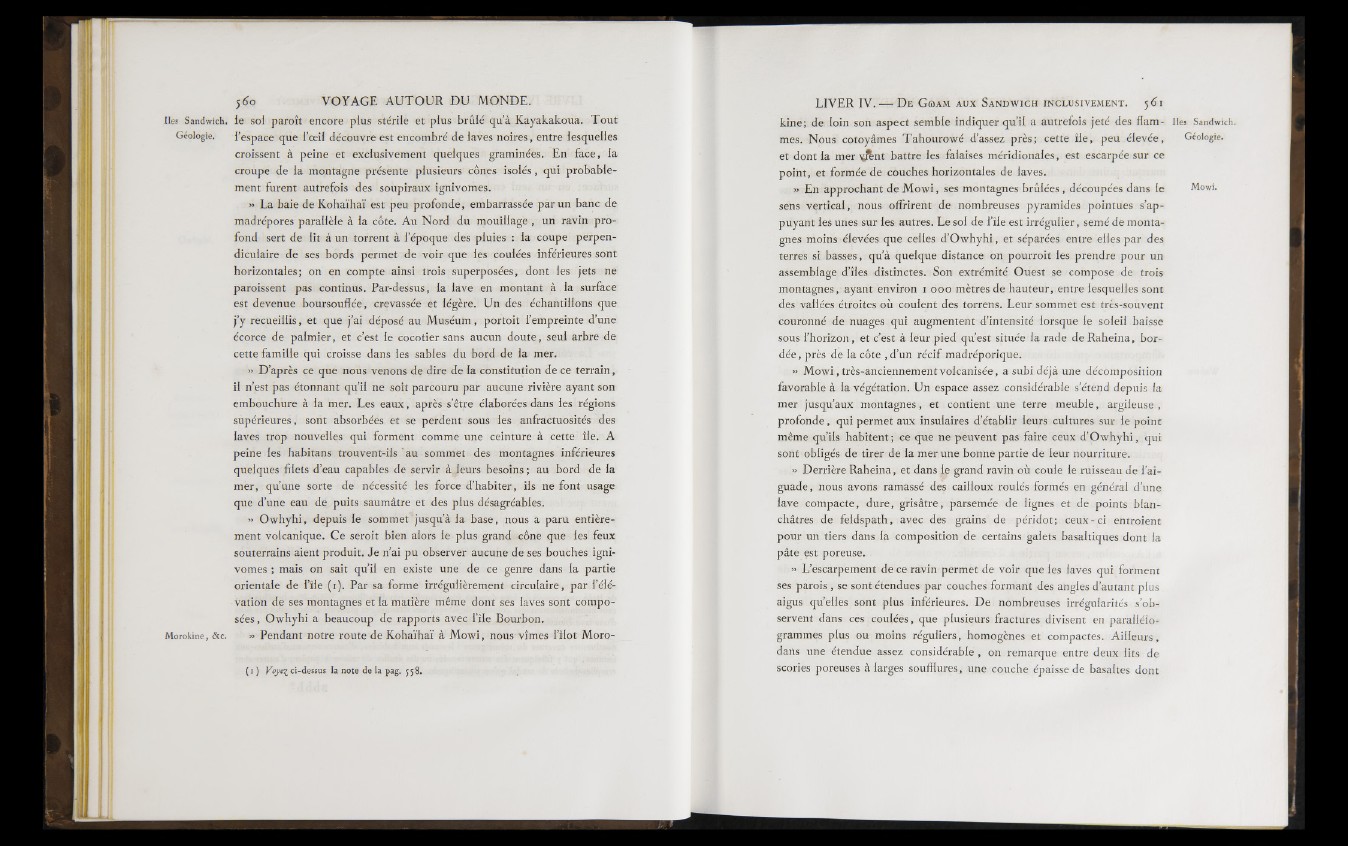
Iles S an dw ich, le soi paroît encore plus stérile et plus brûlé qu’à Kayakakoua. Tout
Géolo g ie . l’espace que i’oeil découvre est encombré de laves noires, entre lesquelles
croissent à peine et exclusivement quelques graminées. En face, ia
croupe de la montagne présente plusieurs cônes isolés, qui probablement
furent autrefois des soupiraux ignivomes.
» La baie de Kohaïhaï est peu profonde, embarrassée par un banc de
madrépores parallèle à la côte. Au Nord du mouillage , un ravin profond
sert de iit à un torrent à l’époque des pluies : la coupe perpendiculaire
de ses bords permet de voir que les coulées inférieures sont
horizontales; on en compte ainsi trois superposées, dont ies jets ne
paroissent p.as continus. Par-dessus, ia lave en montant à la surface
est devenue boursouflée, crevassée et légère. Un des échantillons que
j’y recueillis, et que j’ai déposé au Muséum , portoit i’empreinte d’une
écorce de palmier, et c’est le cocotier sans aucun doute, seui arbre de
cette famille qui croisse dans ies sables du bord de ia mer.
» D’après ce que nous venons de dire de la constitution de ce terrain,
il n’est pas étonnant qu’il ne soit parcouru par aucune rivière ayant son
embouchure à ia mer. Les eaux, après s’être élaborées dans les régions
supérieures, sont absorbées et se perdent sous les anfractuosités des
laves trop nouvelles qui forment comme une ceinture à cette île. A
peine les habitans trouvent-ils au sommet des montagnes inférieures
quelques filets d’eau capables de servir à leurs besoins ; au bord de la
mer, qu’une sorte de nécessité les force d’habiter, iis ne font usage
que d’une eau de puits saumâtre et des plus désagréables.
» Owhyhi, depuis le sommet jusqu’à la base, nous a paru entièrement
volcanique. Ce seroit bien alors le plus grand cône que les feux
souterrains aient produit. Je n’ai pu observer aucune de ses bouches ignivomes
; mais on sait qu’il en existe une de ce genre dans la partie
orientale de l’île (i). Par sa forme irrégulièrement circuiaire, par l’élévation
de ses montagnes et la matière même dont ses iaves sont composées
, Owhyhi a beaucoup de rapports avec l’île Bourbon.
M o ro k in e , & c . » Pendant notre route de Kohaïhaï à Mowi, nous vîmes l’îlot Moro-
( i ) ci-dessus ia note de la pag. 558.
i II
M ow i.
LIVER IV. — De G û a m a u x S a n d w i c h i n c l u s i v e m e n t , jô i
kine; de loin son aspect semble indiquer qu’il a autrefois jeté des flam- lie s San dw ich,
mes. Nous côtoyâmes Tahourowé d’assez près; cette île, peu élevée. G é olo g ie ,
et dont la mer vient battre ies falaises méridionales, est escarpée sur ce
point, et formée de couches horizontales de laves.
» En approchant de Mowi, ses montagnes brûlées, découpées dans le
sens vertical, nous offrirent de nombreuses pyramides pointues s’appuyant
les unes sur les autres. Le soi de l’île est irrégulier, semé de montagnes
moins élevées que celles d’Owhyhi, et séparées entre elles par des
terres si basses, qu’à quelque distance on pourroit les prendre pour un
assemblage d’îles distinctes. Son extrémité Ouest se compose de trois
montagnes, ayant environ i 000 mètres de hauteur, entre lesquelles sont
des vallées étroites où coulent des torrens. Leur sommet est très-souvent
couronné de nuages qui augmentent d’intensité lorsque le soleil baisse
sous l’horizon, et c’est à leur pied qu’est située la rade de Raheina, bordée
, près de la côte , d’un récif madréporique.
» Mowi, très-anciennement volcanisée, a subi déjà une décomposition
favorable à la végétation. Un espace assez considérable s’étend depuis ia
mer jusqu’aux montagnes, et contient une terre meuble, argileuse ,
profonde, qui permet aux insulaires d’établir ieurs cultures sur le point
même qu’ils habitent; ce que ne peuvent pas faire ceux d’Owhyhi, qui
sont obligés de tirer de la mer une bonne partie de leur nourriture.
» Derrière Raheina, et dans le grand ravin où coule le ruisseau de l’aiguade,
nous avons ramassé des cailioux roulés formés en général d’une
lave compacte, dure, grisâtre, parsemée de lignes et de points blanchâtres
de feldspath, avec des grains de péridot; ceux-ci entroient
pour un tiers dans la composition de certains galets basaltiques dont la
pâte est poreuse.
» L ’escarpement de ce ravin permet de voir que les laves qui forment
ses parois , se sont étendues par couches formant des angles d’autant plus
aigus qu’elles sont plus inférieures. De nombreuses irrégularités s’observent
dans ces coulées, que plusieurs fractures divisent en parallélogrammes
plus ou moins réguliers, homogènes et compactes. Ailleurs,
dans une étendue assez considérable , on remarque entre deux lits de
scories poreuses à larges soufflures, une couche épaisse de basaltes dont
V