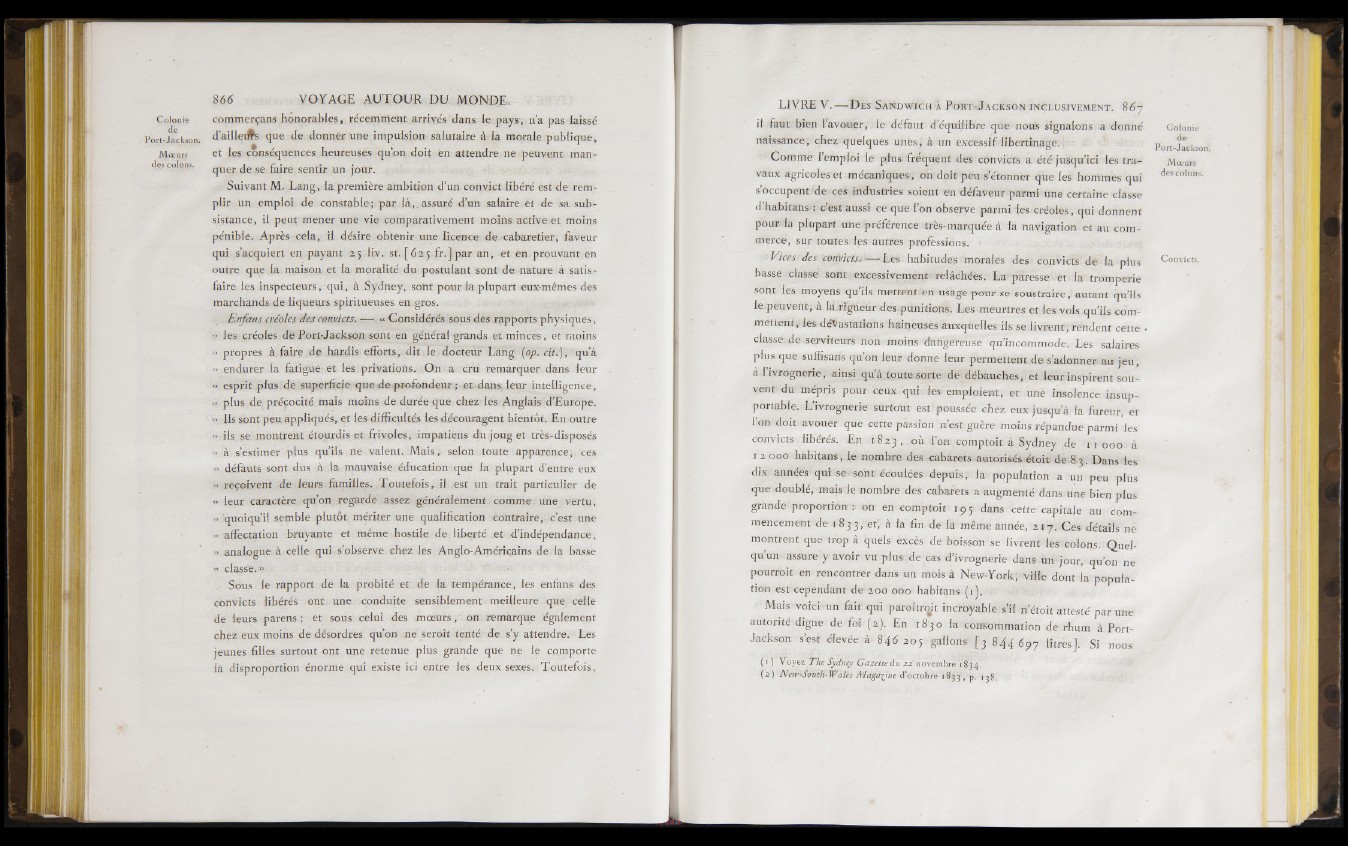
Moeurs
des colons.
commerçans honorables, récemment arrivés dans ie pays, n’a pas laissé
d’aillet#s que de donner une impulsion salutaire à la morale publique,
et les conséquences heureuses qu’on doit en attendre ne peuvent manquer
de se faire sentir un jour.
Suivant M. Lang, ia première ambition d’un convict libéré est de remplir
un emploi de constable; par là, assuré d’un salaire et de sa subsistance,
il peut mener une vie comparativement moins active et moins
pénible. Après cela, il désire obtenir une licence de cabaretier, faveur
qui s’acquiert en payant 25 iiv. st. [625 fr.Jpar an, et en prouvant en
outre que la maison et la moralité du postulant sont de nature à satisfaire
les inspecteurs, qui, à Sydney, sont pour la plupart eux-mêmes des
marchands de liqueurs spiritueuses en gros.
Enfans créoles des convicts. — « Considérés sous des rapports physiques,
» ies créoles de Port-Jackson sont en général grands et minces, et moins
» propres à faire de hardis efforts, dit ie docteur Lang [op. cit.), qu’à
» endurer la fatigue et ies privations. On a cru remarquer dans ieur
» esprit plus de superficie que de profondeur ; et dans leur intelligence,
» plus de précocité mais moins de durée que chez ies Anglais d’Europe.
» Ils sont peu appliqués, et ies difficultés ies découragent bientôt. En outre
» ils se montrent étourdis et frivoles, impatiens du joug et très-disposés
» à s’estimer plus qu’ils ne valent. Mais, selon toute apparence, ces
» défauts sont dus à la mauvaise éducation que la plupart d’entre eux
» reçoivent de leurs familles. Toutefois, il est un trait particulier de
» ieur caractère qu’on regarde assez généralement comme une vertu,
» quoiqu’il semble plutôt mériter une qualification contraire, c’est une
» affectation bruyante et même hostile de liberté et d’indépendance,
» analogue à celle qui s’observe chez ies Anglo-Américains de la basse
» dasse.»
Sous le rapport de la probité et de la tempérance, ies enfans des
convicts libérés ont une conduite sensiblement meilleure que celle
de leurs parens ; et sous celui des moeurs, on remarque également
chez eux moins de désordres qu’on ne seroit tenté de s’y attendre. Les
jeunes filles surtout ont une retenue plus grande que ne le comporte
la disproportion énorme qui existe ici entre les deux sexes. Toutefois,
L IV R EV . — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 867
ii faut bien l’avouer, ie défaut d’équilibre que nous signalons a donné
naissance, chez quelques unes, à un excessif libertinage.
Comme 1 emploi ie pius fréquent des convicts a été jusqu’ici ies travaux
agricoles et mécaniques, on doit peu s’étonner que les hommes qui
s’occupent de ces industries soient en défaveur parmi une certaine classe
d’habitans : c’est aussi ce que l’on observe parmi les créoles, qui donnent
pour la plupart une préférence très-marquée à ia navigation et au commerce,
sur toutes les autres professions.
Vices des convicts.— Les habitudes morales des convicts de la plus
basse dasse sont excessivement relâchéès. La paresse et la tromperie
sont ies moyens qu’ils mettent en usage pour se soustraire, autant qu’ils
le peuvent, à la rigueur des punitions. Les meurtres et les vols qu’ils commettent,
les dévastations haineuses auxquelles ils se livrent, rendent cette •
classe de serviteurs non moins dangereuse qu’incommode. Les salaires
plus que suffisans qu’on leur donne leur permettent de s’adonner au jeu,
à l’ivrognerie, ainsi qu’à toute sorte de débauches, et leur inspirent souvent
du mépris pour ceux qui les emploient, et une insolence insupportable.
L’ivrognerie surtout est poussée chez eux jusqu’à la fureur, et
1 on doit avouer que cette passion n’est guère moins répandue parmi les
convicts libérés. En 1823, où l’on comptoit à Sydney de 1 1000 à
I 2 000 habitans, le nombre des cabarets autorisés étoit de 83. Dans les
dix années qui se sont écoulées depuis, ia population a un peu plus
que doublé, mais ie nombre des cabarets a augmenté dans une bien plus
grande proportion : on en comptoit ip j dans cette capitale au commencement
de I 833, et, à ia fin de ia même année, 2 17 . Ces détails ne
montrent que trop à quels excès de boisson se livrent ies colons. Quelqu’un
assure y avoir vu plus de cas d’ivrognerie dans un jour, qu’on ne
pourroit en rencontrer dans un mois à New-York, ville dont ia population
est cependant de 200 000 habitans (1).
Mais voici un fait qui paroîtroh incroyable s’ii n’étoit attesté par une
autorité digne de foi (2). En 1830 la consommation de rhum à Port-
Jackson s’est élevée à 846 205 gallons [3 844697 litres]. Si nous
( I ) Voyez Th e Sydney Gaz e tte du 22 novembre 1834.
( 2 ) New-South-Waies Magapine Soaohis 1 8 3 3 , P' '3 8 .
(..'olonie
de
P o r t-Ja c k so n .
Moeurs
des colons.
Convicts.