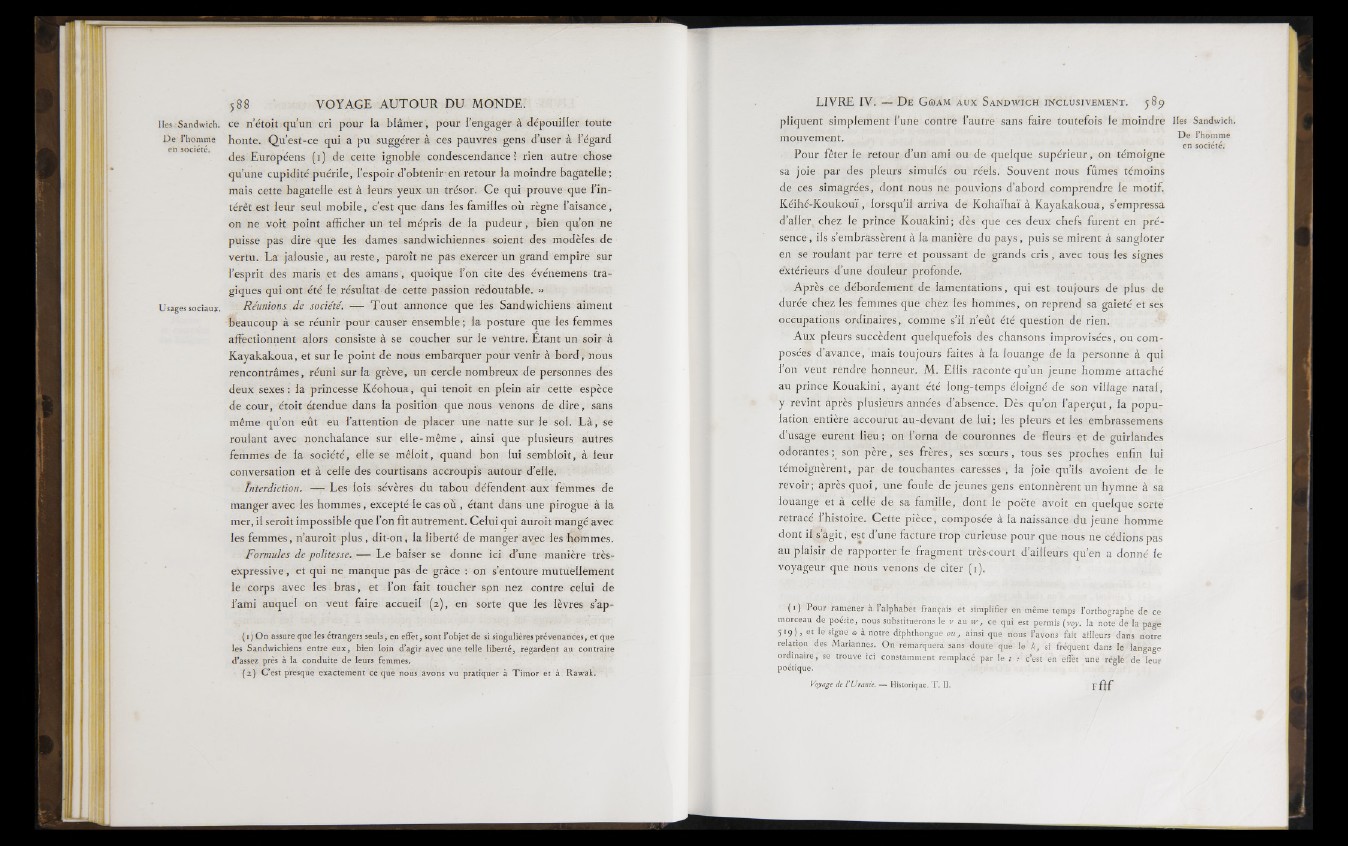
Iles S.indwich. ce n’étoit qtl’un cri pour la blâmer, pour l’engager à dépouiller toute
De riiomme boiite. Qu’est-ce qui a pu suggérer à ces pauvres gens d’user à l’égard
des Européens (i) de cette ignoble condescendance! rien autre chose
qu’une cupidité puérile, l’espoir d’obtenir en retour la moindre bagatelle;
mais cette bagatelle est à leurs yeux un trésor. Ce qui prouve que l’intérêt
est leur seul mobile, c’est que dans les familles où règne i’aisance,
on ne vok point afficher un tel mépris de la pudeur , bien qu’on ne
puisse pas dire que les dames sandwicliiennes soient des modèles de
vertu. La Jalousie, au reste, paroît ne pas exercer un grand empire sur
l’esprit des maris et des amans , quoique l’on cite des événemens tragiques
qui ont été le résultat de cette passion redoutable. »
Usages sociaux. Réunions de société. — Tout annonce que les Sandwichiens aiment
beaucoup à se réunir pour causer ensemble ; la posture que les femmes
affectionnent alors consiste à se coucher sur le ventre. Étant un soir à
Kayakakoua, et sur le point de nous embarquer pour venir à bord, nous
rencontrâmes, réuni sur la grève, un cercle nombreux de personnes des
deux sexes: la princesse Kéohoua, qui tenoit en plein air cette espèce
de cour, étoit étendue dans ia position que nous venons de dire, sans
même qu’on eût eu l’attention de placer une natte sur le sol. L à , se
roulant avec nonchalance sur elle-même , ainsi que plusieurs autres
femmes de la société, elie se mêloit, quand bon lui sembioit, à leur
conversation et à celle des courtisans accroupis autour d’elle.
Interdiction. — Les lois sévères du tabou défendent aux femmes de
manger avec les hommes, excepté le cas où , étant dans une pirogue à la
mer, il seroit impossible que l’on fît autrement. Celui qui auroit mangé avec
les femmes, n’auroit plus , dit-on, la liberté de manger avec les hommes.
Formules de politesse. — Le baiser se donne ici d’une manière très-
expressive , et qui ne manque pas de grâce : on s’entoure mutuellement
le corps avec les bras, et l’on fait toucher son nez contre celui de
i’ami auquel on veut faire accueil (2), en sorte que les lèvres s’ap-
( i ) On assure que les étrangers seuls, en effe t, sont l’objet de si singulières p révenances, et que
les Sandwichiens entre e u x , bien loin d’agir avec une telle liberté, regardent au contraire
d’assez près à la conduite de leurs femmes.
{ 2 ) C ’ est presque exactement ce que nous avons vu pratiquer à T im o r et à Rawak.
LIVRE IV. • D e G ® a m a u x S a n d w i c h i n c l u s i v e m e n t . 589
pliquent simplement l’une contre i’autre sans faire toutefois ie moindre lie s San dw ich.
mouvement. U e l’homme
. / . sociere.
Pour fêter Îe retour d’un ami ou de quelque supérieur, on témoigne
sa joie par des pleurs simulés ou réels. Souvent nous fûmes témoins
de ces simagrées, dont nous ne pouvions d’abord comprendre le motif.
Kéihé-Koukouï, lorsqu’il arriva de Kohaïhaï à Kayakakoua, s’empressa
d’aller chez le prince Kouakini; dès que ces deux chefs furent en présence
, iis s’embrassèrent à la manière du pays, puis se mirent à sangloter
en se roulant par terre et poussant de grands cris, avec tous ies signes
extérieurs d’une douleur profonde.
Après ce débordement de lamentations, qui est toujours de plus de
durée chez les femmes que chez les hommes, on reprend sa gaieté et ses
occupations ordinaires, comme s’il n’eût été question de rien.
Aux pleurs succèdent quelquefois des chansons improvisées, ou composées
d’avance, mais toujours faites à la louange de ia personne à qui
l’on veut rendre honneur. M. Ellis raconte qu’un jeune homme attaché
au prince Kouakini, ayant été long-temps éloigné de son village natal,
y revint après plusieurs années d’absence. Dès qu’on l’aperçut, la population
entière accourut au-devant de iui ; les pleurs et ies embrassemens
d’usage eurent lieu ; on l’orna de couronnes de fleurs et de guirlandes
odorantes; son père, ses frères, ses soeurs, tous ses proches enfin lui
témoignèrent, par de touchantes caresses , la joie qu’ils avoient de le
revoir; après quoi, une fouie de jeunes gens entonnèrent un hymne à sa
louange et à celle de sa famille, dont le poëte avoit en quelque sorte
retracé i’histoire. Cette pièce, composée à la naissance du jeune homme
dont ii s’agit, es^ d’une facture trop curieuse pour que nous ne cédions pas
au plaisir de rapporter le fragment très-court d’aiileurs qu’en a donné ie
voyageur que nous venons de citer (i).
( i ) Pour ramener à l’alphabet français et simplifier en même temps l’orthographe de ce
morceau de p oésie , nous substituerons le v au i f , ce qui est permis [voy. la note de la page
5 1 9 ) , et le signe a à notre diphthongue o u , ainsi que nous l’avons fait ailleurs dans notre
relation des Mariannes. On remarquera sans doute que le k , si fréquent dans le langage
o rd in a ire , se trouve ici constamment remplacé par le t .- c’est en effet une régie de leur
poétique.