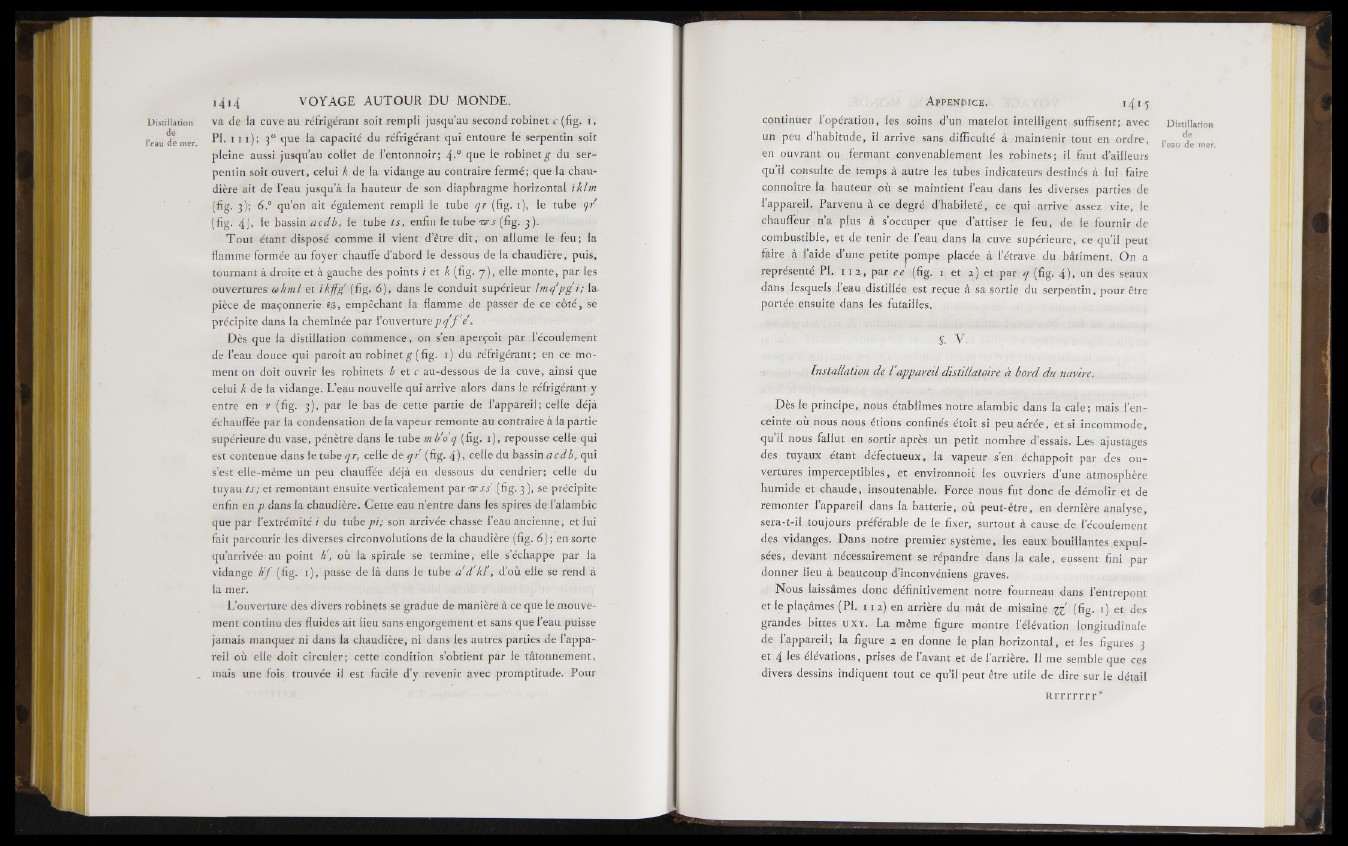
d■ ■m ■'
i'ÉI ?
l í
va de la cuveau réfrigérant soit rempli jusqu’au second robinet c (fig. i,
Pl. 1 I i); 3° que ia capacité du réfrigérant qui entoure le serpentin soit
pleine aussi jusqu’au collet de l’entonnoir; 4-“ qae le robinet g du serpentin
soit ouvert, celui k de la vidange au contraire fermé; que la chaudière
ait de i’eau jusqu’à la hauteur de son diaphragme horizontal iklm
(fig. 3); 6.° qu’on ait également rempli le tube qr (fig. i), le tube qr
(fig. 4). le bassin <2 64/1, le tu b e /j, enfin le tube-ztrj (fig. 3).
Tout étant disposé comme il vient d’être dit, on allume le feu; la
flamme formée au foyer chauffe d’abord ie dessous de la chaudière, puis,
tournant à droite et à gauche des points i et k (fig. 7), elle monte, par les
ouvertures cùhml et ikffg (fig. 6), dans le conduit supérieur Irnq'pg i; la
pièce de maçonnerie ig, empêchant la flamme de passer de ce côté, se
précipite dans la cheminée par l’ouverture p q 'f 'e .
Dès que la distillation commence, on s’en aperçoit par l’écoulement
de l’eau douce qui paroît au robinet g (fig. i) du réfrigérant; en ce moment
on doit ouvrir les robinets h et c au-dessous de la cuve, ainsi que
celui k de la vidange. L’eau nouvelle qui arrive alors dans le réfrigérant y
entre en v (fig. 3), par le bas de cette partie de i’appareil ; celle déjà
échauffée par la condensation delà vapeur remonte au contraire à ia partie
supérieure du vase, pénètre dans le tube mb'dq (fig. 1), repousse celle qui
est contenue dans le tube qr, celle de qr (fig. 4) > celle du bassin <2 6 4 / qui
s’est eile-même un peu chauffée déjà en dessous du cendrier; celle du
tuyau ts; et remontant ensuite verticalement par-t^-jf (fig. 3), se précipite
enfin en p dans la chaudière. Cette eau n’entre dans les spires de l’alambic
que par l’extrémité i du tube p i; son arrivée chasse l’eau ancienne, et lui
fait parcourir les diverses circonvolutions de la chaudière (fig. 6); en sorte
qu’arrivée au point h', où la spirale se termine, elle s’échappe par la
vidange h'f (fig. 1), passe delà dans le tube d d 'k ï , d’où elle se rend à
la mer.
L’ouverture des divers robinets se gradue de manière à ce que ie mouvement
continu des fluides ait iieu sans engorgement et sans que i’eau puisse
jamais manquer ni dans la chaudière, ni dans les <autres parties de l’appareil
où elle doit circuler; cette condition s’obtient par le tâtonnement,
mais une fois trouvée il est facile d’y revenir avec promptitude. Pour
continuer l’opération, les soins d’un matelot intelligent suffisent; avec
un peu d’habitude, il arrive sans difficulté à maintenir tout en ordre,
en ouvrant ou fermant convenablement les robinets; il faut d’ailleurs
qu’il consulte de temps à autre les tubes indicateurs destinés à lui faire
connoître la hauteur où se maintient l’eau dans ies diverses parties de
1 appareil. Parvenu à ce degré d’habiieté, ce qui arrive assez vite, le
chauffeur n’a plus à s’occuper que d’attiser le feu, de ie fournir de
combustible, et de tenir de l’eau dans la cuve supérieure, ce qu’il peut
faire à l’aide d’une petite pompe placée à l’étrave du bâtiment. On a
représenté Pl. i 1 2 , par cc' (fig. i et 2) et par ^ (fig, 4), un des seaux
dans lesquels leau distillée est reçue à sa sortie du serpentin, pour être
portée ensuite dans les futailles.
V.
Installation de l ’appareil distillatoire à bord dti navire.
Dès le principe, nous établîmes notre alambic dans la cale; mais l’enceinte
ou nous nous étions confinés étoit si peu aérée, et si incommode,
qu il nous fallut en sortir après un petit nombre d’essais. Les ajustages
des tuyaux étant défectueux, la vapeur s’en échappoit par des ouvertures
imperceptibles, et environnoit ies ouvriers d’une atmosphère
humide et chaude, insoutenable. Force nous fut donc de démolir et de
remonter Iappareil dans la batterie, où peut-être, en dernière analyse,
sera-t-il toujours préférable de ie fixer, surtout à cause de i’écoulement
des vidanges. Dans notre premier système, les eaux bouillantes expulsées,
devant nécessairement se répandre dans la cale, eussent fini par
donner lieu à beaucoup d’inconvéniens graves.
Nous laissâmes donc définitivement notre fourneau dans l’entrepont
et ie plaçâmes (Pl. i 12) en arrière du mât de misaine zZ (ùg- >) et des
grandes bittes uxy. La même figure montre l’élévation longitudinale
de l’appareil; la figure 2 en donne le plan horizontal, et les figures 3
et 4 les élévations, prises de l’avant et de l’arrière. Il me semble que ces
divers dessins indiquent tout ce qu’ii peut être utile de dire sur le détail