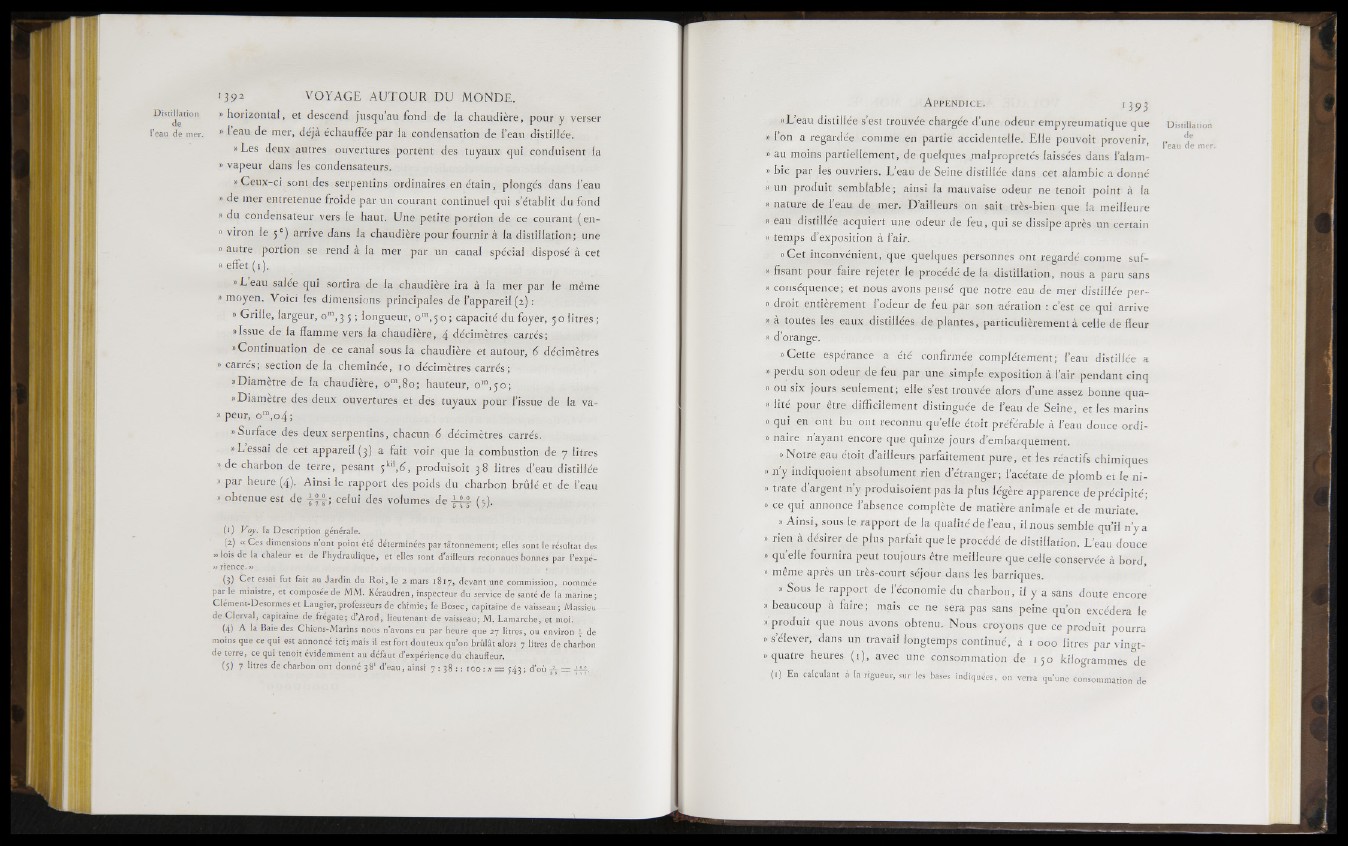
» horizontal, et descend jusqu’au fond de la chaudière, pour y verser
» leau de mer, déjà échauffée par la condensation de l’eaii distillée.
»Les deux autres ouvertures portent des tuyaux qui conduisent la
» vapeur dans les condensateurs.
»Ceux-ci sont des serpentins ordinaires en étain, plongés dans l’eau
» de mer entretenue froide par un courant continuel qui s’établit du fond
» du condensateur vers le haut. Une petite portion de ce courant (en-
» viron le 5“) arrive dans Ja chaudière pour fournir à la distillation; une
» autre portion se rend à la mer par un canal spécial disposé à cet
» effet ( 1 ).
»Leau salée qui sortira de la chaudière ira à ia mer par le même
» moyen. Voici ies dimensions principales de l’appareil (2) :
» Grille, largeur, o"',3 5 ; longueur, o™,5o; capacité du foyer, 50 litres ;
»Issue de la flamme vers la chaudière, 4 décimètres carrés;
»Continuation de ce canal sous la chaudière et autour, 6 décimètres
» carres; section de la cheminée, 10 décimètres carrés;
»Diamètre de la chaudière, o” ,8o; hauteur, o ^ .jo ;
»Diamètre des deux ouvertures et des tuyaux pour l’issue de la va-
» peur, o™,o4;
»Surface des deux serpentins, chacun 6 décimètres carrés.
»L essai de cet appareil (3) a fait voir que ia combustion de 7 litres
» de charbon de terre, pesant / '\ 6 , produisoit 38 litres d’eau distillée
» par heure (4). Ainsi le rapport des poids du charbon brûlé et de l’eau
» obtenue est de celui des volumes de (5),
(1) Voy. la D e sc ription générale.
(2) « C e s dimensions n’ont point été déterminées par tâtonnement; elles sont le résultat des
>1 lois de la chaleur et de 1 hydrauliqu e, et elles sont d’ailleurs reconnues bonnes par l’expé-
>j rien c e .»
(3) C e t essai fut fait au Ja rd in du R o i , le 2 mars 1 8 1 7 , devant une commission, nommée
par le ministre, et composée de M M . Kéraudren, inspecteur du service de santé de la ma rine ;
Clément-Desormes et Laugier,professeurs de chimie; le B o se c , capitaine de v a isse au ; Massieu
de C le r v a l, capitaine de fré gate; d’A ro d , lieutenant de vaisseau; M . L am a rch e , et moi.
(4 ) A la B a ie des Chiens-Ma rins nous n’avons eu par heure que 27 litres, ou environ 2 de
moins que ce qui est annoncé ic i; mais il est fort douteux qu’on brûlât alors 7 litres de charbon
de terre, ce qui tenoit évidemment au défaut d’expérience du chauffeur.
(5) 7 litres de charbon ont donné 38' d’e au , ainsi 7 : 38 : : 10 0 : x = 5 4 3 ; d’où oe 242,
»Leau distillée s’est trouvée chargée d’une odeur ernpyreumatique que Distillation
» l’on a regardée comme en partie accidentelle. Elle pouvoit provenir, iVau d/mer
» au moins partiellement, de quelques malpropretés laissées dans l’alam-
» hic par les ouvriers. L’eau de Seine distillée dans cet alambic a donné
»un produit semblable; ainsi la mauvaise odeur ne tenoit point à la
» nature de l’eau de mer. D’ailleurs on sait très-bien que la meilleure
» eau distillée acquiert une odeur de feu, qui se dissipe après un certain
» temps d’exposition à l’air.
»Cet inconvénient, que quelques personnes ont regardé comme sul-
» fisant pour faire rejeter ie procétlé de la distillation, nous a paru sans
» conséquence; et nous avons pensé que notre eau de mer distillée per-
» droit entièrement l’odeur de feu par son aération : c’est ce qui arrive
» à toutes ies eaux distillées de plantes, particuiièrement à ceile de fleur
» d’orange.
»Cette espérance a été confirmée complètement; l’eau distillée a
» perdu son odeur de feu par une simple exposition à l’air pendant cinq
» ou six jours seulement; elle s’est trouvée alors d’une assez bonne qua-
» iité pour être difficilement distinguée de l’eau de Seine, et les marins
» qui en ont bu ont reconnu qu’elle étoit préférable à l’eau douce ordi-
» naire n ayant encore que quinze jours d’embarquement.
«Notre eau étoit d’ailleurs parfaitement pure, et les réactifs chimiques
» n’y indiquoient absolument rien d’étranger; l’acétate de plomb et le ni-
» trate d’argent n’y produisoient pas la plus légère apparence de précipité;
» ce qui annonce l’absence complète de matière animale et de muriate.
» Ain.si, sous le rapport de ia qualité de l’eau , il nous semble qu’il n’y a
» rien à désirer de plus parfait que le procédé de distillation. L ’eau douce
» qu’elie fournira peut toujours être meilleure que celle conservée à bord,
» même après un très-court séjour dans les barriques.
» Sous ie rapport de l’économie du charbon, il y a sans doute encore
» beaucoup à faire; mais ce ne sera pas sans peine qu’on excédera le
» produit que nous avons obtenu. Nous croyons que ce produit pourra
» s’élever, dans un travail longtemps continué, à i 000 litres par vingt-
» quatre heures (i), avec une consommation de 150 kiJogrammes de
( I) E n c a lc u la n t â la r ig u eu r , su r les bases in d iq u é e s , on v e r ra q u ’ une c o n som m a tio n d e