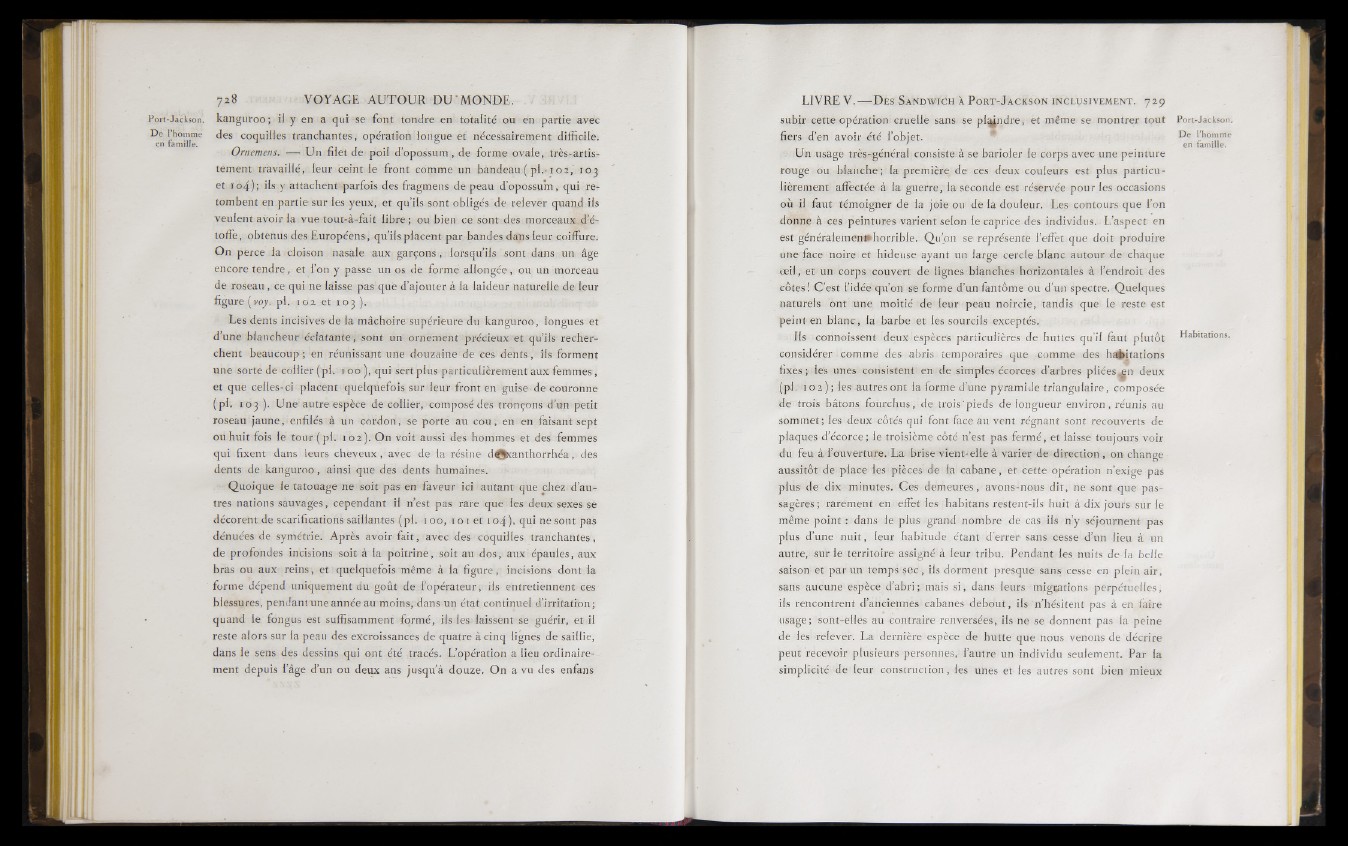
P o r t-Ja c k so n . kangiiroo ; il y en a qui se font tondre en totalité ou en partie avec
D e i’ homnie des coquilles tranchantes, opération longue et nécessairement difficile.
en famille. ^ ,
Ornemens. — Un niet de poil d’opossum, de forme ovale, très-artistement
travaillé, leur ceint le front comme un bandeau ( pl. i o 2, 103
et io4); ils y attachent parfois des fragmens de peau d’opossum, qui retombent
en partie sur les yeux, et qu’ils sont obligés de relever quand ils
veulent avoir la vue tout-à-fait libre ; ou bien ce sont des morceaux d’étoffe,
obtenus des Européens, qu’ils placent par bandes dans leur coiffure.
On perce la cloison nasale aux garçons , lorsqu’ils sont dans un âge
encore tendre, et l’on y passe un os de forme allongée, ou un morceau
de roseau , ce qui ne laisse pas que d’ajouter à la laideur naturelle de leur
figure (voy. pl. 102 et 103 ).
Les dents incisives de ia mâchoire supérieure du kanguroo, longues et
d’une blancheur éclatante, sont un ornement précieux et qu’ils recherchent
beaucoup ; en réunissant une douzaine de ces dents, ils forment
une sorte de collier (pl. 1 00 ), qui sert plus particulièrement aux femmes ,
et que celles-ci placent quelquefois sur leur front en guise de couronne
(pl. 103 ). Une autre espèce de collier, composé des tronçons d’un petit
roseau jaune, enfilés à un cordon, se porte au cou, en en faisant sept
ou huit fois le tour (pl. 102 ). On voit aussi des hommes et des femmes
qui fixent dans ieurs cheveux , avec de la résine dajfcianthorrhéa , ties
dents de kanguroo , ainsi que des dents humaines.
Quoique le tatouage ne soit pas en faveur ici autant que chez d’autres
nations sauvages, cependant il n’est pas rare que les deux sexes se
décorent de scarifications saillantes (pl. i 00, 10 1 et 1 04 ), qui ne sont pas
dénuées de symétrie. Après avoir fait, avec des coquilles tranchantes,
de profoJides incisions soit à la poitrine, soit au dos, aux épaules, aux
bras ou aux reins, et queiquefois même à la figure, inci.sions dont ia
forme dépend uniquement du goût de l’opérateur, ils entretiennent ces
blessures, pendant une année au moins, dans un état continuel d’irritation;
quand le fongus est suffisamment formé, ils les laissent se guérir, et il
reste alors sur la peau des excroissances de quatre à cinq lignes de saillie,
dans le sens des dessins qui ont été tracés. L’opération a lieu ordinairement
depuis 1 âge d’un ou deux ans jusqu’à douze. On a vu des enfans
D e l’homme
en famille.
H abitations.
LIVRE V. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 729
subir cette opération cruelle sans se pltjindre, et même se montrer tout P o r t - Ja c k
fiers d’en avoir été l’objet.
Un usage très-général consiste à se barioler le corps avec une peinture
rouge ou blanche; la première de ces deux couleurs est plus particulièrement
affectée à la guerre, la seconde est réservée pour les occasions
où il faut témoigner de la joie ou de la douleur. Les contours que l’on
donne à ces peintures varient selon ie caprice des individus. L’aspect en
est généralement horrible. Qu’on se représente l’effet que doit produire
une face noire et hideuse ayant un large cercle blanc autour de chaqtie
oeil, et un corps couvert de lignes blanches horizontales à l’endroit des
côtes! C ’est l’idée qu’on se forme d’un fantôme ou d’un spectre. Quelques
naturels ont une moitié de leur peau noircie, tandis que le reste est
peint en blanc, la barbe et les sourcils exceptés.
Ils connoissent deux espèces particulières de huttes qu’il faut plutôt
considérer comme des abris temporaires que comme des habitations
fixes; ies unes consistent en de simples écorces d’arbres pliées ^n deux
(pl. 10 2 ) ; les autres ont ia forme d’une pyramide triangulaire, composée
de trois bâtons fourchus, de trois'pieds de longueur environ, réunis au
sommet; les deux côtés qui font lace au vent régnant sont recouverts de
plaques d’écorce; le troisième côté n’est pas fermé, et laisse toujours voir
du feu à l’ouverture. La brise vient-elie à varier de direction , on change
aussitôt de place ies pièces de ia cabane, et cette opération n’exige pas
pius de dix minutes. Ces demeures, avons-nous dit, ne sont que passagères;
rarement en effet les habitans restent-ils huit à dix jours sur le
même point : dans le pius grand nombre de cas iis n’y séjournent pas
plus d’une nuit, ieur habitude étant d'errer sans cesse d’un lieu à un
autre, sur le territoire assigné à leur tribu. Pendant les nuits de la belle
saison et par un temps sec, ils dorment presque sans cesse en plein air,
sans aucune espèce d’abri; mais si, dans leurs migrations perpétuelles,
ils rencontrent d’anciennes cabanes debout, ils n’hésitent pas à en faire
tisage; sont-elles au contraire renversées, ils ne se donnent pas la peine
de ies relever. La dernière espèce de hutte que nous venons de décrire
peut recevoir plusieurs personnes, l’autre un individu seulement. Par la
simplicité de leur construction, les unes et les autres sont bien mieux
i -1.