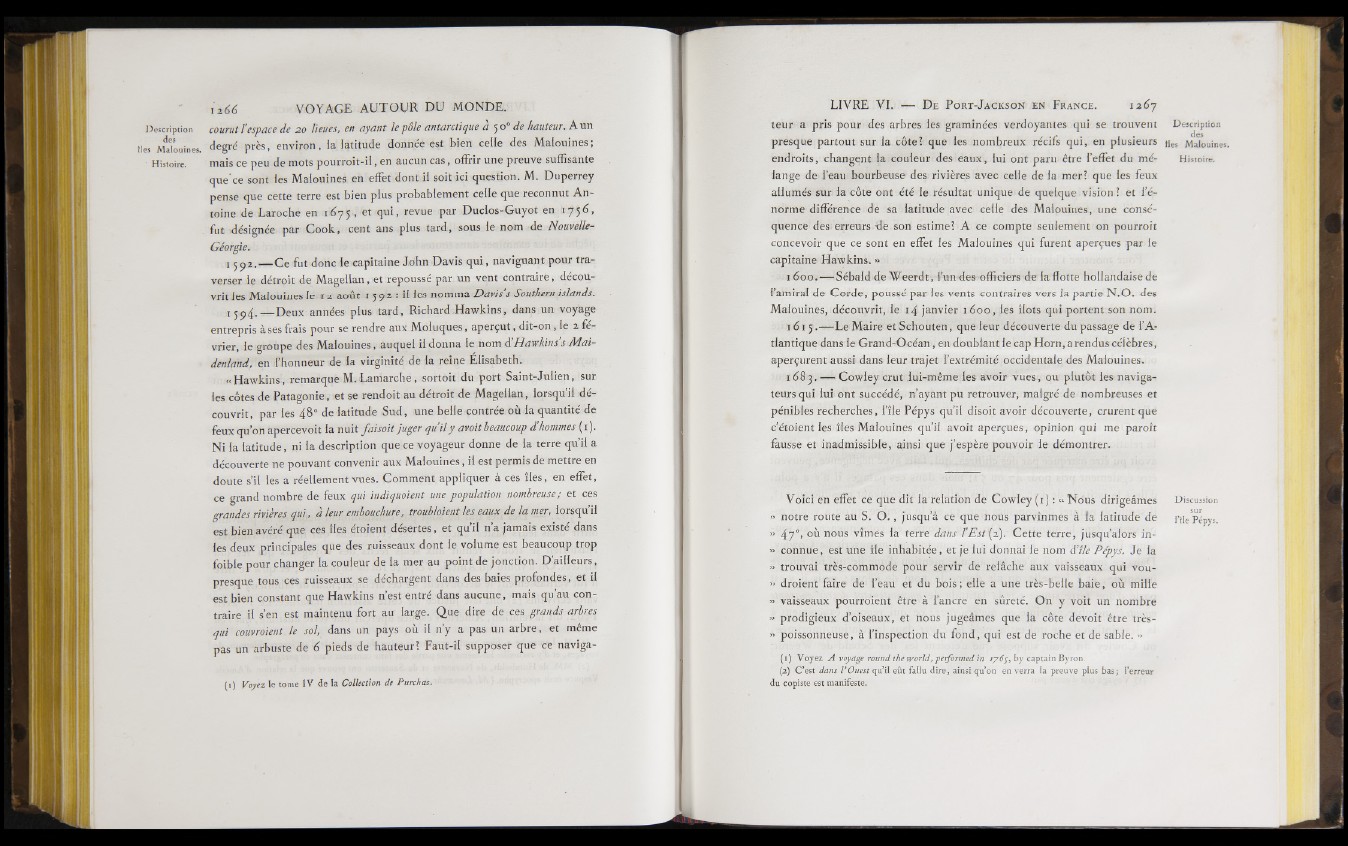
r ‘t:
NM
r'"'
Description
d es
îies Malouines.
Histoire.
courut ¡’espace de 20 lieues, en ayant k pôle antarctique à 30" de hauteur. km\
degré près, environ, ia latitude donnée est bien celle des Malouines;
mais ce peu de mots pourroit-il, en aucun cas, offrir une preuve suffisante
que'ce sont les Malouines en effet dont il soit ici question. M. Duperrey
pense que cette terre est bien plus probablement ceile que reconnut Antoine
de Laroche en 16 7 5 , et qui, revue par Duclos-Guyot en 17 5 6 ,
fut désignée par Cook, cent ans plus tard, sous ie nom de Nouvelle-
Géorgie.
15 9 2 . — Ce fut donc ie capitaine John Davis cp i, naviguant pour traverser
le détroit de Magellan, et repoussé par un vent contraire, découvrit
les Malouines le 1 2 août i j 92 : il les nomma Davis s Southern islands.
J — Deux années plus tard, Richard Hawkins, dans un voyage
entrepris à ses frais pour se rendre aux Moluques, aperçut, dit-on, ie 2 février,
le groupe des Malouines, auquel il donna le nom S Hawkins’s Mai-
denland, en l’honneur de ia virginité de la reine Élisabeth.
« Hawkins, remarque M. Lamarche , sortoit du port Saint-Julien, sur
ies côtes de Patagonie, et se rendoit au détroit de Magellan, lorsqu’il découvrit,
par les 48° de latitude Sud, une belle contrée où la quantité de
feux qu’on apercevoit la nuit faisoit juger qu’il y avoit beaucoup d’hommes (i).
Ni la latitude, ni la description que ce voyageur donne de la terre qu’ii a
découverte ne pouvant convenir aux Malouines, il est permis de mettre en
doute s’il les a réellement vues. Comment appliquer à ces îles, en effet,
ce grand nombre de feux qui indiquaient une population nombreuse; et ces
grandes rivières qui, à leur embouchure, troublaient les eaux de la mer, lorsqu’il
est bien avéré que ces îles étoient désertes, et qu’il n’a jamais existé dans
les deux principales que des ruisseaux dont le volume est beaucoup trop
foible pour changer la couleur de la mer au point de jonction. D’ailleurs,
presque tous ces ruisseaux se déchargent dans des baies profondes, et il
est bien constant que Hawkins n’est entré dans aucune, mais qu’au contraire
il s’en est maintenu fort au large. Que dire de ces grands arbres
qui couvroient le sol, dans un pays où il n’y a pas un arbre, et même
pas un arbuste de 6 pieds de hauteur! Faut-il supposer que ce navigaleur
a pris pour des arbres les graminées verdoyantes qui se trouvent D e sc rip tion
presque partout sur ia côte! que les nombreux récifs qui, en plusieurs ¡¡gs Malouines.
endroits, changent la couleur des eaux, lui ont paru être l’effet du mé- Histoire,
lange de l’eau bourbeuse des rivières avec celle de la mer! que ies feux
allumés sur la côte ont été le résultat unique de quelque vision! et l’énorme
différence de sa latitude avec celle des Malouines, une conséquence
des erreurs tie son estime! A ce compte seulement on pourroit
concevoir que ce sont en effet les Malouines qui furent aperçues par le
capitaine Hawkins. »
I 600. — Sébald de Weerdt, l’un des officiers de la flotte hollandaise de
i’amiral de Corde, poussé par les vents contraires vers la partie N.O. des
Malouines, découvrit, le 14 janvier 16 0 0 , les îlots qui portent son nom.
I 6 1 J .— Le Maire et Schouten, que leur découverte du passage de l’A-
tlantique dans le Grand-Océan, en doublant le cap Horn, arendus célèbres,
aperçurent aussi dans leur trajet l’extrémité occidentale des Malouines.
t 683. — Cowley crut iui-même ies avoir vues, ou plutôt les navigateurs
qui iui ont succédé, n’ayant pu retrouver, malgré de nombreuses et
pénibles recherches, l’île Pépys qu’ii disoit avoir découverte, crurent que
c’étoient les îles Malouines qu’il avoit aperçues, opinion qui me paroît
fausse et inadmissible, ainsi que j’espère pouvoir ie démontrer.
Voici en effet ce que dit la relation de Cowley (i j ;« Nous dirigeâmes
■' notre route au S. O ., jusqu’à ce que nous parvînmes à la latitude de
» 4 7 °> où nous vîmes la terre dans l’Est {2). Cette terre, jusqu’alors in-
» connue, est une île inhabitée, et je hii donnai le nom d’île Pépys. Je ia
’> trouvai très-commode pour servir de relâche aux vaisseaux qui vou-
” droient faire de l’eau et du bois; elle a une très-belle baie, où mille
» vaisseaux pourroient être à l’ancre en sûreté. On y voit un nombre
» prodigieux d’oiseaux, et nous jugeâmes que la côte devoit être très-
» poissonneuse, à l’inspection du fond, qui est de roche et de sable. »
( 1 ) V o y e z A voyage round ihe world,peiformed in 7765, b y captain Byron
(2) C ’est dans l’Ouest opi 'û eût fallu d ire , ainsi qu’on en verra la preuve plus b a s ; l’erreur
du copiste est manifeste.
Discussion
sur
l’île Pépys.