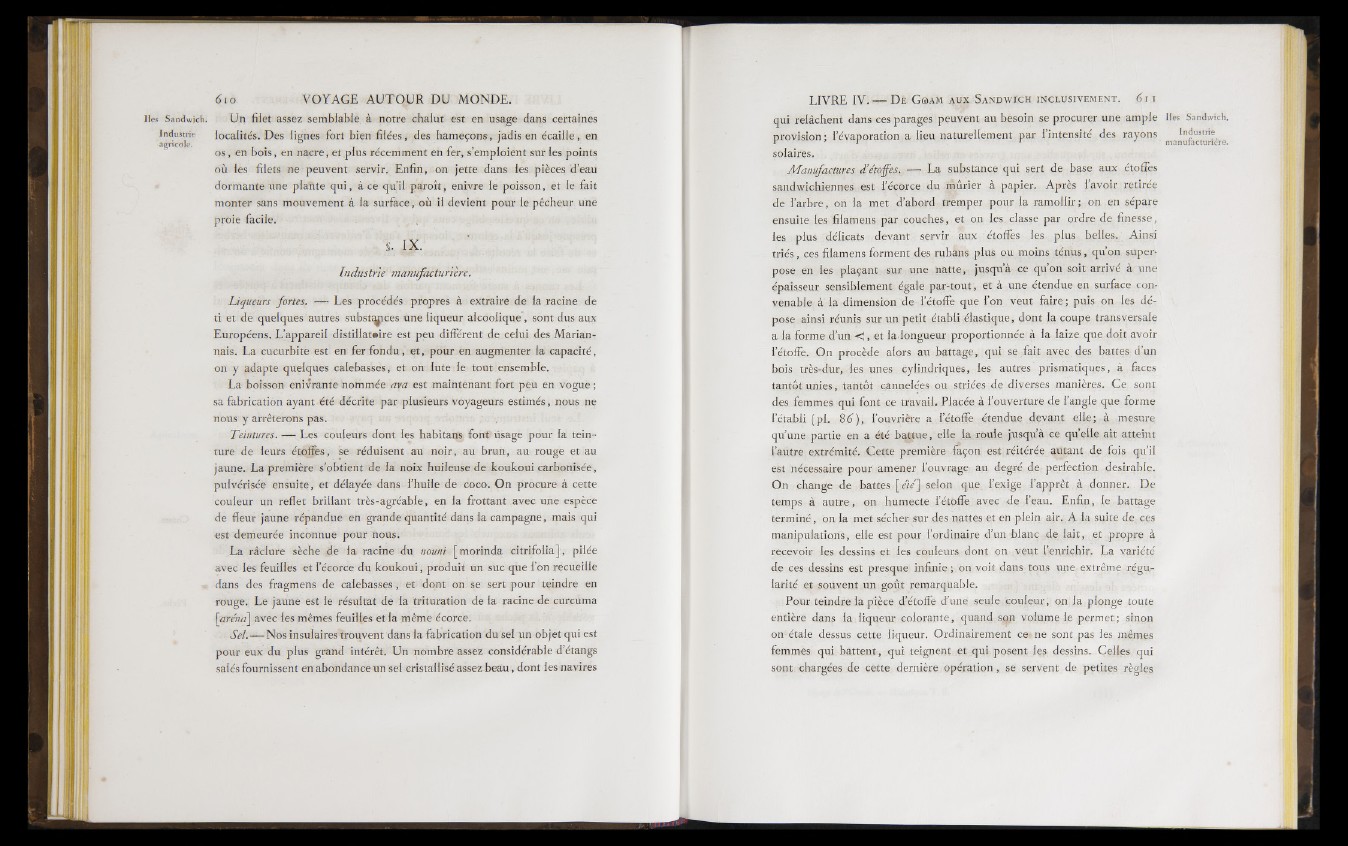
r
!ÎÎ
it II i
IJ i"
Kl
tfl
iit !
Iles S andwich.
Industrie
agricole.
Un fiiet assez semblable à notre chalut est en usage dans certaines
localités. Des lignes fort bien filées, des hameçons, jadis en écaiile, en
os, en bois, en nacre, et plus récemment en fer, s’emploient sur les points
où les filets ne peuvent servir. Enfin, on jette dans les pièces d’eau
dormante une plante qui, à ce qu’il paroit, enivre le poisson, et le fait
monter sans mouvement à la surface, où ii devient pour le pêcheur une
proie facile.
L IX .
Industrie manufacturière.
Liqueurs fortes. — Les procédés propres à extraire de la racine de
ti et de quelques autres substances une iiqueur alcoolique , sont dus aux
Européens. L’appareii distillat«ire est peu différent de celui des Mariannais.
La cucurbite est en fer fondu, et, pour en augmenter la capacité,
on y adapte quelques calebasses, et on lute le tout ensemble.
La boisson enivrante nommée ava est maintenant fort peu en vogue ;
sa fabrication ayant été décrite par plusieurs voyageurs estimés, nous ne
nous y arrêterons pas.
Teintures. — Les couleurs dont les habitans font visage pour la teinture
de leurs étoffes, se réduisent au noir, au brun, au rouge et au
jaune. La première s’obtient de ia noix huileuse de koukoui carbonisée,
pulvérisée ensuite, et délayée dans l’huiie de coco. On procure à cette
couleur un reflet brillant très-agréable, en la frottant avec une espèce
de fleur jaune répandue en grande quantité dans la campagne, mais qui
est demeurée inconnue pour nous.
La râclure sèche de la racine du nouni [morinda citrifolia], pilée
avec les feuilles et l’écorce du koukoui, produit un suc que l’on recueille
dans des fragmens de calebasses , et dont on se sert pour teindre en
rouge. Le jaune est le résultat de la trituration de la racine de curcuma
[are'na] avec les mêmes feuilles et la même écorce.
Sel.— Nos insulaires trouvent dans la fabrication du sei un objet qui est
pour eux du plus grand intérêt. Un nombre assez considérable d’étangs
salés fournissent en abondance un sel cristallisé assez beau, dont les navires
LIVRE IV. — De G û a m a u x S a n d w i c h i n c l u s i v e m e n t . 6 \ 1
qui relâchent dans ces parages peuvent au besoin se procurer une ample
provision; l’évaporation a lieu naturellement par l’intensité des rayons
solaires.
Manufactures d'étoffes. — La substance qui sert de base aux étofîés
sandwichiennes est l’écorce du mûrier à papier. Après l’avoir retirée
de l’arbre, on la met d’abord tremper pour la ramollir; on en sépare
ensuite les fiiamens par couches, et on les classe par ordre de finesse,
les pius délicats devant servir aux étoffes les plus belles. Ainsi
triés, ces fiiamens forment des rubans plus ou moins ténus, qu’on superpose
en ies plaçant sur une natte, jusqu’à ce qu’on soit arrivé à une
épaisseur sensiblement égale par-tout, et à une étendue en surface convenable
à ia dimension de l’étoffe que l’on veut faire; puis on les dépose
ainsi réunis sur un petit établi élastique, dont la coupe transversale
a la forme d’un <1, et la longueur proportionnée à la laize que doit avoir
i’étoffe. On procède alors au battage, qui se fait avec des battes d’un
bois très-dur, les unes cylindriques, les autres prismatiques, à faces
tantôt unies, tantôt cannelées ou striées de diverses manières. Ce sont
des femmes qui font ce travail. Placée à l’ouverture de l’angle que forme
l’établi (pl. 8ô), l’ouvrière a i’étoffe étendue devant elle; à mesure
qu’une partie en a été battue, elle la rouie jusqu’à ce qu’elle ait atteint
l’autre extrémité. Cette première façon est réitérée autant de fois qu’il
est nécessaire pour amener l’ouvrage au degré de perfection desirable.
On change de battes [éié] selon que l’exige i’apprêt à donner. De
temps à autre, on humecte l’étoffe avec de l’eau. Enfin, le battage
terminé, on la met sécher sur des nattes et en plein air. A la suite de ces
manipulations, elle est pour l’ordinaire d’un blanc de lait, et propre à
recevoir les dessins et les couieurs dont on veut i’enrichir. La variété
de ces dessins est presque infinie ; on voit dans tous une extrême régularité
et souvent un goût remarquable.
Pour teindre la pièce d’étoffe d’une seuie couieur, on la plonge toute
entière dans la liqueur colorante, quand son voiume le permet; sinon
on étale dessus cette iiqueur. Ordinairement ce ne sont pas les mêmes
femmes qui battent, qui teignent et qui posent les dessins. Celies qui
sont chargées de cette dernière opération , se servent de petites règles
Industrie
manufacturière.
ihj 1 ■
[
l i .