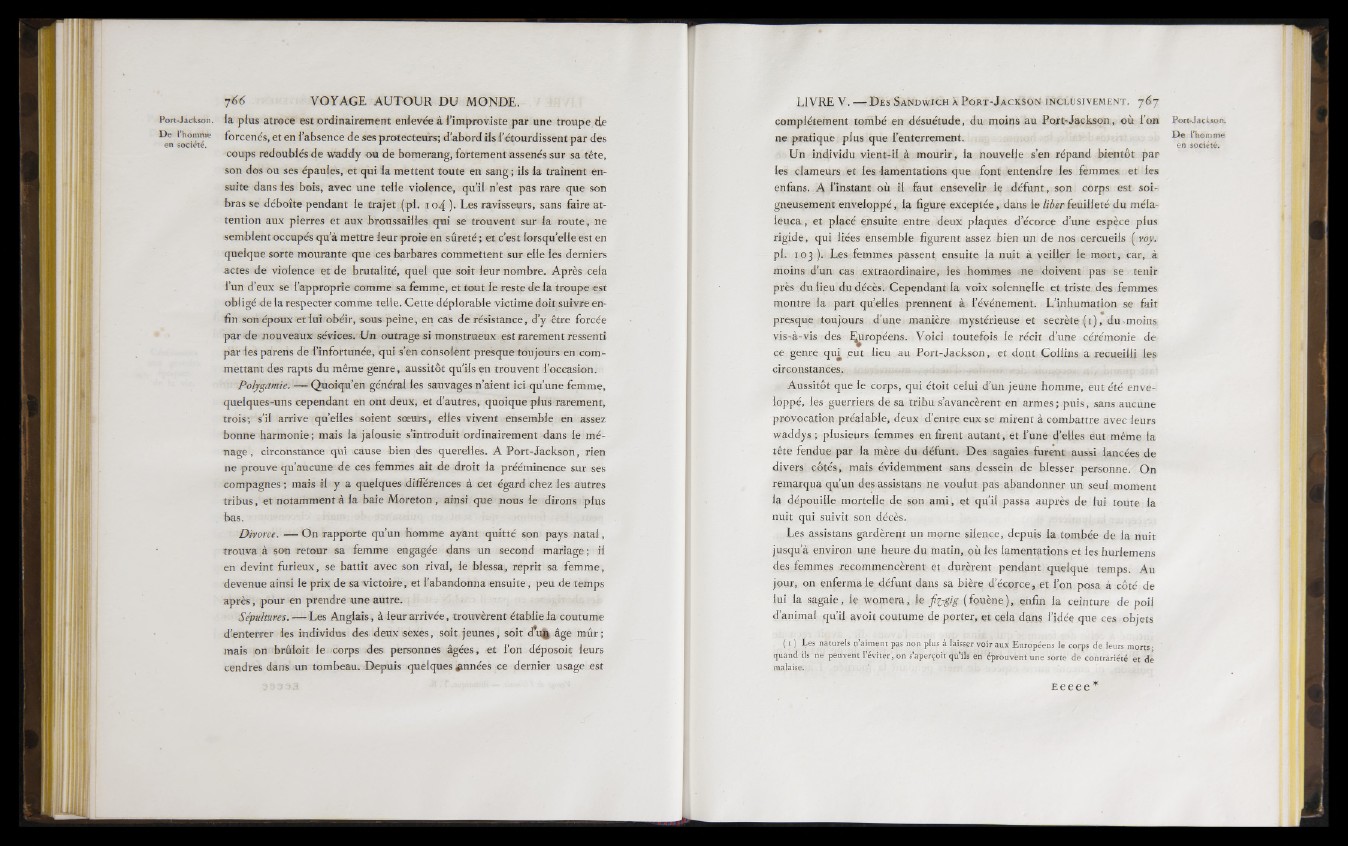
P on - Ja ck son . la pius atTOce est ordinairement enlevée à i’improviste par une troupe de
U e l’ homme forcenés, et en l’absence de ses protecteurs; d’abord ils l’étourdissent par des
en société. ‘ r
coups redoublés de waddy ou de bomerang, fortement assenés sur sa tête,
son dos ou ses épaules, et qui ia mettent toute en sang ; ils la traînent ensuite
dans les bois, avec une telle violence, qu’il n’est pas rare que son
bras se déboîte pendant le trajet (pl. to 4 ). Les ravisseurs, sans faire attention
aux pierres et aux broussailles qui se trouvent sur la route, ne
semblent occupés qu’à mettre leur proie en sûreté ; et c’est lorsqu’elle est en
quelque sorte mourante que ces barbares commettent sur elle ies derniers
actes de violence et de brutalité, quel que soit ieur nombre. Après cela
l’un d’eux se l’approprie comme sa femme, et tout le reste de la troupe est
obligé de la respecter comme telle. Cette déplorable victime doit suivre enfin
son époux et lui obéir, sous peine, en cas de résistance, d’y être forcée
par de nouveaux sévices. Un outrage si monstrueux est rarement ressenti
par les parens de i’infortunée, qui s’en consolent presque toujours en commettant
des rapts du même genre, aussitôt qu’ils en trouvent l’occasion.
Polygamie. — Quoiqu’en générai les sauvages n’aient ici qu’une femme,
quelques-uns cependant en ont deux, et d’autres, quoique plus rarement,
trois; s’il arrive qu’elles soient soeurs, elles vivent ensemble en assez
bonne harmonie ; mais ia jalousie s’introduit ordinairement dans le ménage,
circonstance qui cause bien des querelles. A Port-Jackson, rien
ne prouve qu’aucune de ces femmes ait de droit la prééminence sur ses
compagnes ; mais il y a quelques différences à cet égard chez les autres
tribus, et notamment à la baie Moreton , ainsi que nous le dirons plus
bas.
Divorce. — On rapporte qu’un homme ayant quitté son pays natal,
trouva à son retour sa femme engagée dans un second mariage ; ii
en devint furieux, se battit avec son rival, ie blessa, reprit sa femme,
devenue ainsi le prix de sa victoire, et l’abandonna ensuite, peu de temps
après, pour en prendre une autre.
Sépultures. — Les Anglais, à ieur arrivée, trouvèrent établie la coutume
d’enterrer les individus des deux sexes, soit jeunes, soit cfuQ âge mûr;
mais on brûloit le coi-ps des personnes âgées, et l’on déposoit leurs
cendres dans un tombeau. Depuis quelques années ce dernier usage est
LIVRE V. — D e s S a n d w ic h a P o r t - J a c k s o n in c lu s iv e m e n t . 767
complètement tombé en désuétude, du moins au Port-Jackson, où l’on P on- Ja ck son .
ne pratique plus que l’enterrement. 1 homme
* ^ ^ ^ en société.
Un individu vient-ii à mourir, la nouvelle s’en répand bientôt par
les clameurs et les lamentations que font entendre les femmes et ies
enfans. A l’instant où il faut ensevelir le défunt, son corps est soigneusement
enveloppé, la figure exceptée, dans le liber feuilleté du méia-
leuca, et placé ensuite entre deux plaques d’écorce d’une espèce plus
rigide, qui liées ensemble figurent assez bien un de nos cercueils ( voy.
pi. 103 ). Les femmes passent ensuite la nuit à veiller le mort, car, à
moins d’un cas extraordinaire, les hommes ne doivent pas se tenir
près du lieu du décès. Cependant la voix solennelle et triste des femmes
montre la part qu’elles prennent à l’événement. L ’inhumation se fait
presque toujours d’une manière mystérieuse et secrète (i) , du-moins
vis-à-vis des I^iropéens. Voici toutefois le récit d’une cérémonie de
ce genre qui eut lieu au Port-Jackson, et dont Collins a recueilli les
circonstances.
Aussitôt que le corps, qui étoit celui d’un jeune homme, eut été enveloppé,
ies guerriers de sa tribu s’avancèrent en armes; puis, sans aucune
provocation préalable, deux d’entre eux se mirent à combattre avec leurs
waddys ; plusieurs femmes en firent autant, et l’une d’elles eut même la
tête fendue par ia mère du défunt. Des sagaies furent aussi lancées de
divers côtés, mais évidemment sans dessein de blesser personne. On
remarqua qu’un des assistans ne voulut pas abandonner un seul moment
la dépouille mortelle de son ami, et qu’il passa auprès de iui toute la
nuit qui suivit son décès.
Les assistans gardèrent un morne silence, depuis la tombée de la nuit
jusqu’à environ une heure du matin, où les lamentations et les hurlemens
des femmes recommencèrent et durèrent pendant quelque temps. Au
jour, on enferma le défunt dans sa bière d’écorce, et i’on posa à côté de
lui la sagaie, ie womera, le fizrgig (fouène), enfin la ceinture de poil
d’animal qu’il avoit coutume de porter, et cela dans l’idée que ces objets
( I ) L es naturels n’aiment pas non plus à laisser voir aux Européens le corps de leurs morts ■
quand ils ne peuvent l’é v ite r , on s’aperçoit qu’ ils en éprouvent une sorte de contrariété et dé
naïaise.
E e e e e