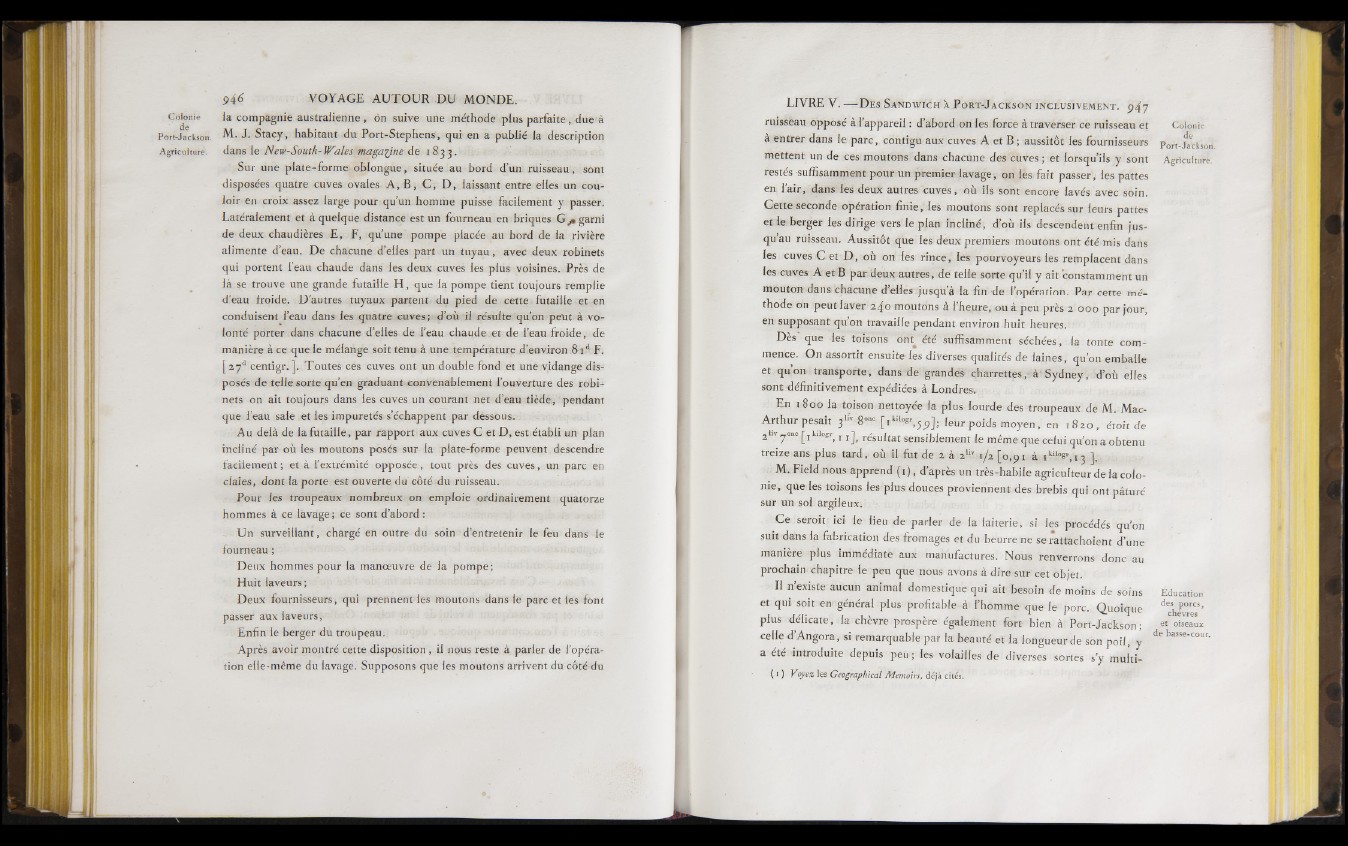
‘ i
i:' 1
'H Y u
' fS
( Ì
j
Agriculture.
la compagnie australienne , on suive une méthode plus parfaite , due à
M. J. Stacy, habitant du Port-Stephens, qui en a publié la description
dans le New-South-Wales magazine de 1833.
Sur une plate-forme oblongue, située au bord d’un ruisseau, sont
disposées quatre cuves ovales A , B , C , D, laissant entre elies un couloir
en croix assez large pour qu’un homme puisse facilement y passer.
Latéralement et à quelque distance est un fourneau en briques G ^ garni
de deux chaudières E , F, qu’une pompe placée au bord de la rivière
alimente d’eau. De chacune d’elles part un tuyau, avec deux robinets
qui portent l'eau chaude dans les deux cuves ies plus voisines. Près de
là se trouve une grande futaille H , que la pompe tient toujours remplie
d’eau froide. D’autres tuyaux partent du pied de cette futaille et en
conduisent l’eau dans les quatre cuves; d’où il résulte qu’on peut à volonté
porter dans chacune d’elles de l’eau chaude et de i’eau froide, de
manière à ce que ie mélange soit tenu à une température d’environ 8 D F.
[2 7 “* centigr.]. Toutes ces cuves ont un double fond et une vidange disposés
de telle sorte qu’en graduant convenablement l’ouverture des robinets
on ait toujours dans les cuves un courant net d’eau tiède, pendant
que l’eau sale et les impuretés s’échappent par dessous.
Au delà de la futaille, par rapport aux cuves C et D, est établi un plan
incliné par où les moutons posés sur la plate-forme peuvent descendre
tacilement ; et à l’extrémité opposée, tout près des cuves, un parc en
claies, dont la porte est ouverte du côté du ruisseau.
Pour les troupeaux nombreux on emploie ordinairement quatorze
hommes à ce lavage; ce sont d’abord :
Un surveillant, chargé en outre du soin d’entretenir le feu dans le
fourneau ;
Detix hommes pour la manoeuvre de ia pompe;
Huit laveurs ;
Deux fournisseurs, qui prennent les moutons dans le parc et les font
passer aux laveurs,
Enfin le berger du troupeau.
Après avoir montré cette disposition , il nous reste à parler de l’opération
elle-même du lavage. Supposons que les moutons arrivent du côté du
LIVRE V .— D e s S a n d w i c h a P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 947
ruisseau opposé à l’appareil : d’abord on les force à traverser ce ruisseau et
à entrer dans le parc, contigu aux cuves A et B ; aussitôt les fournisseurs
mettent un de ces moutons dans chacune des cuves; et lorsqu’ils y sont
restés suffisamment pour un premier lavage, on les fait passer, ies pattes
en l’air, dans ies deux autres cuves, où ils sont encore iavés avec soin.
Cette seconde opération finie, les moutons sont replacés sur leurs pattes
et le berger ies dirige vers le plan incliné, d’où ils descendent enfin jusqu’au
ruisseau. Aussitôt que les deux premiers moutons ont été mis dans
les ctives C et D , où on ies rince, les pourvoyeurs les remplacent dans
les cuves A et B par deux autres, de telle sorte qu’il y ait constamment un
mouton dans chacune d’elles jusqu’à la fin de l’opération. Par cette méthode
on peut laver 240 moutons à l’heure, ou à peu près 2 000 par jour,
en supposant qu’on travaille pendant environ huit heures.
Dès que les toisons ont été suffisamment séchées, la tonte commence.
On assortit ensuite les diverses qualités de laines, qu’on emballe
et qu’on transporte, dans de grandes charrettes, à Sydney, d’où elies
sont définitivement expédiées à Londres.
En 1800 la toison nettoyée la pius lourde des troupeaux de M. Mac-
Arthur pesait 3>-8 “- [ i “ °«h59]; leur poids moyen , en 1820, étoit de
2iiv.^onc I i]. résultat sensihiement le même que celui qu’on a obtenu
treize ans plus tard, où il ffit de 2 à 2’" 1/2 [0,91 à D 'H q ij ]_
M. Field nous apprend ( i ), d’après un très-habile agriculteur de la colonie,
que les toisons ies plus douces proviennent des brebis qui ont pâturé
sur un sol argileux.
Ce seroit ici le lieu de parier de la laiterie, si les procédés qu’on
suit dans ia fabrication des fromages et du beurre ne se rattachoient d’une
manière plus immédiate aux manufactures. Nous renverrons donc au
prochain chapitre ie peu que nous avons à dire sur cet objet.
Il n’existe aucun animal domestique qui ait besoin de moins de soins
et qui soit en général plus profitable à l’homme que le porc. Quoique
plus délicate, la chèvre prospère également fort bien à Port-Jackson ;
celle d’Angora, si remarquable par la beauté et la longueur de son poil, y
a été introduite depuis peu; les volailles de diverses sortes s’y muiti-
{ I ) Voyez les Geographical Memoirs, déjà cités.
Agriculture.
E d uca tion
des porcs.
chèvres
et oiseaux
de basse-cour.
iîl