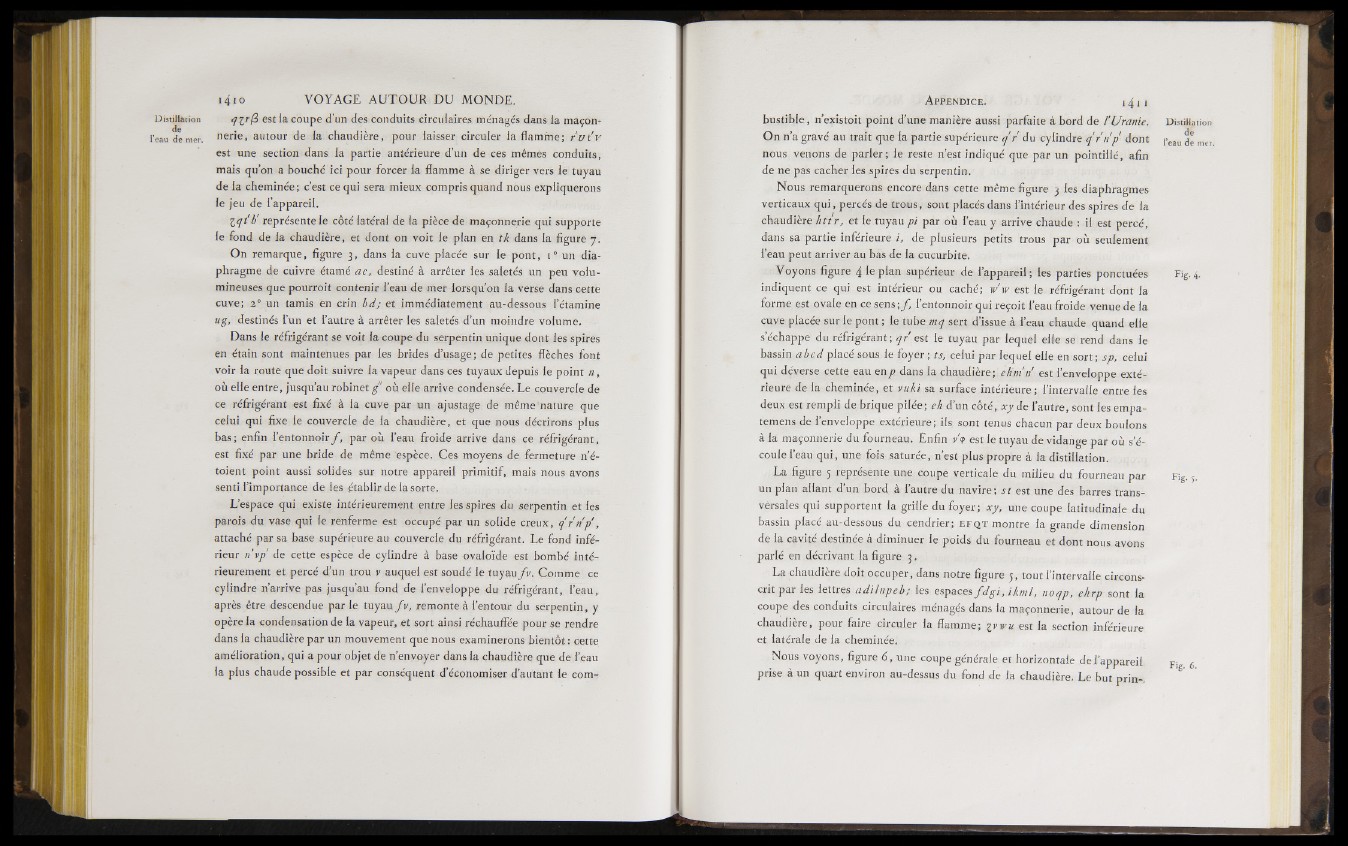
E
- J
I
hI
K ;|{!j
f
ïî
s
ï! î i i ! •Ci
<72r/3 est la coupe d'un des conduits circulaires ménagés dans la maçonnerie,
autour de la chaudière, pour laisser circuler la flamme; r'u t'v
est une section dans la partie antérieure d’un de ces mêmes conduits,
mais qu’on a bouché ici pour forcer la flamme à se diriger vers le tuyau
de la cheminée; c’est ce qui sera mieux compris quand nous expliquerons
le jeu de fappareil.
Zqt'b' représente le côté latéral de la pièce de maçonnerie qui supporte
le fond de ia chaudière, et dont on voit Je plan en tk dans la figure 7,
On remarque, figure 3, dans la cuve placée sur ie pont, 1° un diaphragme
de cuivre étamé ac, destiné à arrêter ies saletés un peu volumineuses
que pourroit contenir l’eau de mer lorsqu’on la verse dans cette
cuve; 2° un tamis en crin b d; et immédiatement au-dessous l’étamine
ug, destinés l’un et l’autre à arrêter les saletés d’un moindre volume.
Dans le réfrigérant se voit la coupe du serpentin unique dont les spires
en étain sont maintenues par les brides d’usage; de petites flèches font
voir la route que doit suivre la vapeur dans ces tuyaux depuis le point n ,
où elle entre, jusqu’au robinet g où elle arrive condensée. Le couvercle de
ce réfrigérant est fixé à la cuve par un ajustage de même nature que
celui qui fixe le couvercle de la chaudière, et que nous décrirons plus
bas; enfin l’entonnoir/, par où i’eau froide arrive dans ce réfrigérant,
est fi.xé par une bride de même espèce. Ces moyens de fermeture n’étoient
point aussi solides sur notre appareil primitif, mais nous avons
senti l’importance de les établir de la sorte.
L ’espace qui existe intérieurement entre les spires du serpentin et les
parois du vase qui le renferme est occupé par un solide creux, q r n'p',
attaché par sa base supérieure au couvercle du réfrigérant. Le fond inférieur
n'vp' de cette espèce de cylindre à base ovaioïde est bombé intérieurement
et percé d’un trou v auquel est soudé ie tuyau/v. Comme ce
cylindre n’arrive pas jusqu’au fond de l’enveloppe du réfrigérant, l’eau,
après être descendue par le tuyau f v , remonte à l’entour du serpentin, y
opère la condensation de la vapeur, et sort ainsi réchauffée pour se rendre
dans la chaudière par un mouvement que nous examinerons bientôt: cette
amélioration, qui a pour objet de n’envoyer dans la chaudière que de l’eau
la plus chaude possible et par conséquent d’économiser d’autant le com-
A p p e n d i c e . 1 4 i 1
bustible, n’existoit point d’une manière aussi parfaite à bord de l'Uranie.
On n’a gravé au trait que la partie supérieure q f du cylindre q f n p dont
nous venons de parler; le reste n’est indiqué que par un pointillé, afin
de ne pas cacher les spires du serpentin.
Nous remarquerons encore dans cette même figure 3 les diaphragmes
verticaux qui, percés de trous, sont placés dans l’intérieur des spires de la
chaudière httr, et le tuyau pi par où l’eau y arrive chaude : il est percé,
dans sa partie inférieure i, de plusieurs petits trous par où seulement
l’eau peut arriver au bas de ia cucurbite.
Voyons figure 4 le plan supérieur de l’appareil; les parties ponctuées
indiquent ce qui est intérieur ou caché; w'w est Je réfrigérant dont la
forme est ovale en ce sens;/ , l’entonnoir qui reçoit l’eau froide venue de la
cuve placée sur le pont ; le tube mq sert d’issue à i’eau chaude quand elle
s’échappe du réfrigérant; qr' est le tuyau par lequel elle se rend dans le
bassin abcd placé sous le foyer ; is, celui par lequel elle en sort; sp, celui
qui déverse cette eau en p dans ia chaudière; e/im'n' est l’enveloppe extérieure
de la cheminée, et vuki sa surface intérieure; l’intervalle entre les
deux est rempli de brique pilée; ek d’un côté, xy de l’autre, sont les empa-
temens de l’enveloppe extérieure; ils sont tenus chacun par deux boulons
à la maçonnerie du fourneau. Enfin Y? est Je tuyau de vidange par où s’écoule
l’eau qui, une fois saturée, n’est plus propre à la distillation.
La figure 5 représente une coupe verticale du milieu du fourneau par
un plan allant d’un bord à i’autre du navire; s i est une des barres transversales
qui supportent la grille du foyer; xy, une coupe iatitudinale du
bassin placé au-dessous du cendrier; e f q t montre la grande dimension
de la cavité destinée à diminuer le poids du fourneau et dont nous avons
parlé en décrivant la figure 3.
La chaudière doit occuper, dans notre figure 5, tout l’intervalle circonscrit
par les lettres adilnpeh; les espaces f d g i , ikml, noqp, ehrp sont la
coupe des conduits circulaires ménagés dans la maçonnerie, autour de la
chaudière, pour faire circuler la flamme; est la section inférieure
et latérale de ia cheminée.
Nous voyons, figure 6, une coupe générale et horizontale de l’appareil
prise à un quart environ au-dessus du fond de la chaudière. Le but prin-
D is tilla tion
de
Teau de nier.
F ig . 4.
Fig- 5-
F ig . È.