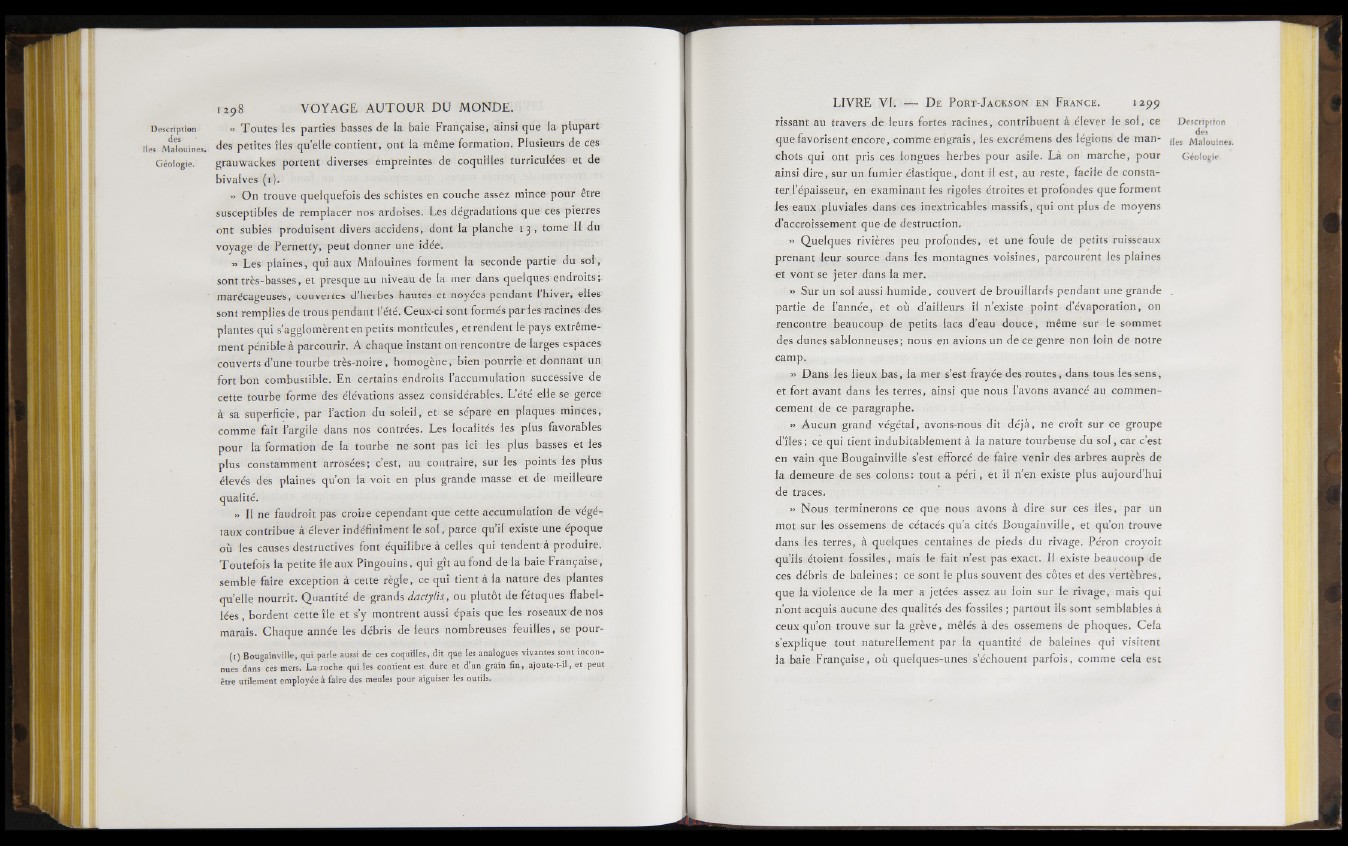
i a
i.u
fú
Description
des
iles iVlaiouines.
Géologie.
» Toutes les parties basses de la baie Française, ainsi que la plupart
des petites îles quelle contient, ont la même formation. Plusieurs de ces
grauwack.es portent diverses empreintes de coquilles turriculées et de
bivalves (i),
» On trouve quelquefois des schistes en couche assez mince pour être
susceptibles de remplacer nos ardoises. Les dégradations que ces pierres
ont subies produisent divers accidens, dont ia planche 13 , tome II du
voyage de Pernetty, peut donner une idée.
» Les plaines, qui aux Malouines forment la seconde partie du sol,
sont très-basses, et presque au niveau de la mer dans quelques endroits;
marécageuses, couvertes d’herbes hautes et noyées pendant l’hiver, elles
sont remplies de trous pendant l’été. Ceux-ci sont formés par les racines des
plantes qui s’agglomèrent en petits monticules, et rendent le pays extrêmement
pénible à parcourir. A chaque instant on rencontre de larges espaces
couverts d’une tourbe très-noire , homogène, bien pourrie et donnant un
fort bon combustible. En certains endroits l’accumulation successive de
cette tourbe forme des élévations assez considérables. L’été elle se gerce
à sa superficie, par l’action du soleil, et se sépare en plaques minces,
comme fait l’argile dans nos contrées. Les localités les plus favorables
pour la formation de la tourbe ne sont pas ici les pius basses et ies
plus constamment arrosées; c’est, au contraire, sur ies points ies plus
élevés des plaines qu’on la voit en plus grande masse et de meilleure
qualité.
» Il ne faudroit pas croire cependant que cette accumulation de végétaux
contribue à élever indéfiniment le sol, parce qu’il existe une époque
où les causes destructives font équilibre à celles qui tendent à produire.
Toutefois la petite île aux Pingouins, qui gît au fond de la baie Française,
semble faire exception à cette règle, ce qui tient à la nature des plantes
qu’elle nourrit. Quantité de grands dactylis, ou plutôt de fétnques flabel-
lées, bordent cette île et s’y montrent aussi épais que les roseaux de nos
marais. Chaque année les débris de leurs nombreuses feuilles, se pour-
( i) B o u g a in v ille , qui parle aussi de ces coquille s, dit que les analogues vivantes sont inconnues
dans ces mers. L a roche qui les contient est dure et d’ un grain fin , a jou te-t-il, et peut
être utilement employée à faire des meules pour aiguiser ies outils.
LIVRE VI. — De P o r t - J a c k s o n e n F r a n c e . 1299
rissant au travers de leurs fortes racines, contribuent à élever le soi, ce De scription
que favorisent encore, comme engrais, les excrémens des légions de man- Maiouines.
chots qui ont pris ces longues herbes pour asile. Là on marche, pour
ainsi dire, sur un fumier élastique, dont il est, au reste, facile de constater
l’épaisseur, en examinant les rigoles étroites et profondes que forment
les eaux pluviales dans ces inextricables massifs, qui ont plus de moyens
d’accroissement que de destruction.
» Quelques rivières peu profondes, et une foule de petits ruisseaux
prenant leur source dans les montagnes voisines, parcourent les plaines
et vont se jeter dans la mer.
» Sur un sol aussi humide, couvert de brouillards pendant une grande
partie de l’année, et où d’ailleurs il n’existe point d’évaporation, on
rencontre beaucoup de petits lacs d’eau douce, même sur le sommet
des dunes sablonneuses; nous en avions un de ce genre non loin de notre
camp.
» Dans les lieux bas, la mer s’est frayée des routes, dans tous ies sens,
et fort avant dans les terres, ainsi que nous l’avons avancé au commencement
de ce paragraphe.
» Aucun grand végétal, avons-nous dit déjà, ne croît sur ce groupe
d’îles ; ce qui tient indubitablement à la nature tourbeuse du sol, car c’est
en vain que Bougainville s’est efforcé de faire venir des arbres auprès de
la demeure de ses colons: tout a péri, et il n’en existe plus aujourd’hui
de traces.
» Nous terminerons ce que nous avons à dire sur ces îles, par un
mot sur ies ossemens de cétacés qu’a cités Bougainville, et qu’on trouve
dans les terres, à queiques centaines de pieds du rivage. Péron croyoit
qu’ils étoient fossiles, mais ie fait n’est pas exact. Il existe beaucoup de
ces débris de baleines ; ce sont le plus souvent des côtes et des vertèbres,
que la violence de la mer a jetées assez au loin sur le rivage, mais qui
n’ont acquis aucune des qualités des fossiles ; partout ils sont semblables à
ceux qu’on trouve sur ia grève, mêlés à des ossemens de phoques. Cela
s’explique tout naturellement par la quantité de baleines qui visitent
la baie Française, où quelques-unes s’échouent parfois, comme cela est
G éologii