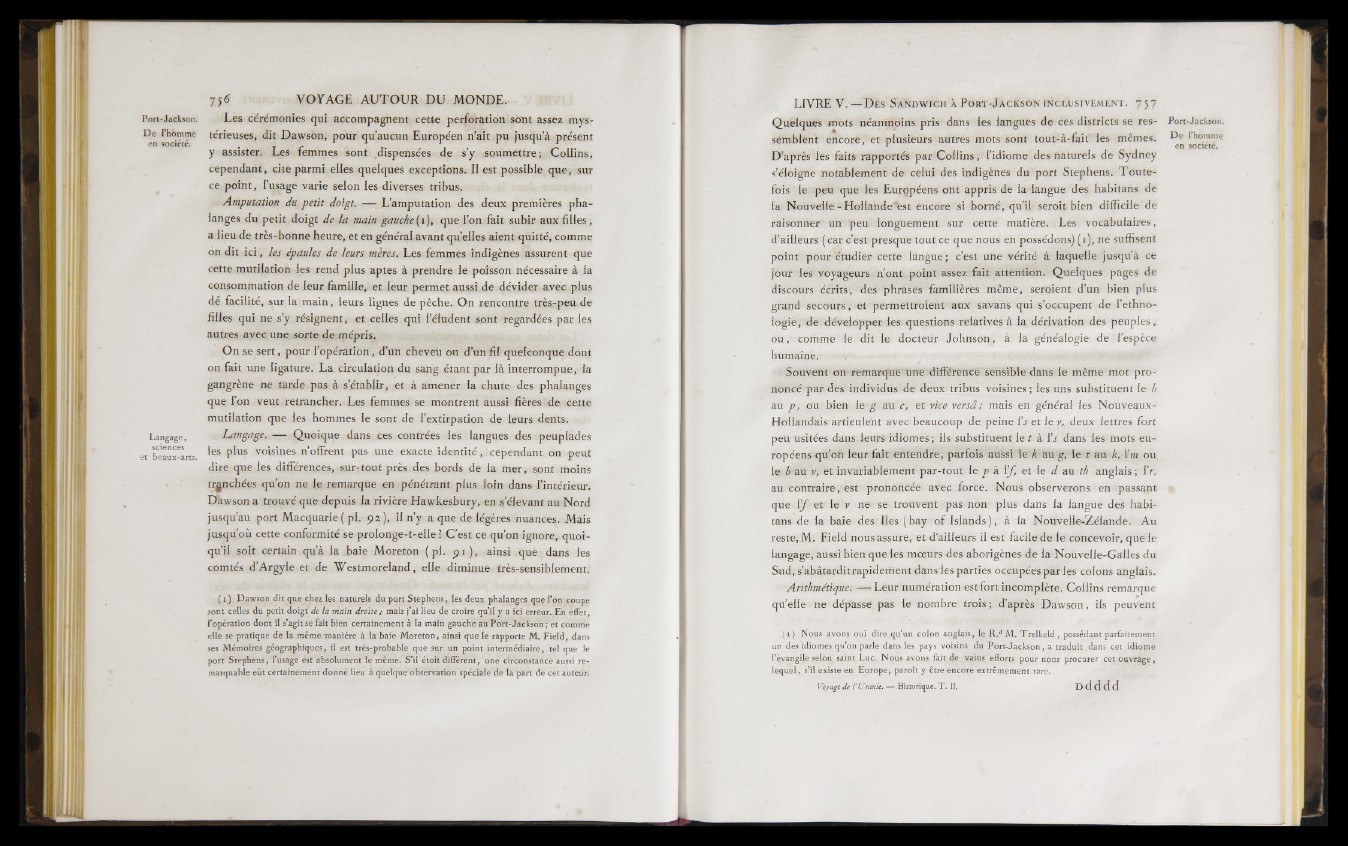
D e Thomme
en société.
L an g a g e ,
sciences
et beaux-arts.
Les cérémonies qui accompagnent cette perforation sont assez mystérieuses,
dit Dawson, pour qu’aucun Européen n’ait pu jusqu’à présent
y assister. Les femmes sont dispensées de s’y soumettre; Collins,
cependant, cite parmi eiles quelques exceptions. II est possible que, sur
ce point, l’usage varie selon les diverses tribus.
Amputation du petit doigt. — L’amputation des deux premières phalanges
du petit doigt de la main gauche (i), que i’on fait subir aux filles ,
a lieu de très-bonne heure, et en général avant qu’elles aient quitté, comme
on dit ic i, les épaules de leurs mères. Les femmes indigènes assurent que
cette mutilation les rend plus aptes à prendre le poisson nécessaire à la
consommation de leur famille, et leur permet aussi de dévider avec plus
dé facilité, sur ia main, leurs lignes de pêche. On rencontre très-peu de
filles qui ne s’y résignent, et celles qui l’éludent sont regardées par ies
autres avec une sorte de mépris.
On se sert, pour l’opération, d’un cheveu ou d’un fil quelconque dont
on fait une ligature. La circulation du sang étant par là interrompue, la
gangrène ne tarde pas à s’établir, et à amener la chute des phalanges
que l’on veut retrancher. Les femmes se montrent aussi fières de cette
mutilation que ies hommes le sont de l’extirpation de leurs dents.
Langage. — Quoique dans ces contrées les langues des peuplades
les plus voisines n’offrent pas une exacte identité, cependant on peut
dire que les différences, sur-tout près des bords de la mer, sont moins
trgnchées qu’on ne le remarque en pénétrant plus loin dans i’intérieur.
Dawson a trouvé que depuis la rivière Hawkesbury, en s’élevant au Nord
jusqu’au port Macquarie ( pl. 92), il n’y a que de légères nuances. Mais
jusqu’où cette conformité se prolonge-t-elle ? C ’est ce qu’on ignore, quoiqu’il
soit certain qu’à la baie Moreton (pl. 9 1 ) , ainsi que dans les
comtés d’Argyle et de Westmoreland, elle diminue très-sensiblement.
( I ) D aw son dit que chez les naturels du port Steph en s , les deux phalanges que l’on coupe
sont celles du petit doigt de la main droite ; mais f a i lieu de croire qu’ il y a ici erreur. E n effet,
l’opération dont il s’ agit se fait bien certainement à la main gauche au P o r t-Ja c k so n ; et comme
elle se pratique de la même manière à la baie M o re to n , ainsi que le rapporte M . F ie ld , dans
ses Mémoires géographiques, il est très-probable que sur un point inte rmédia ire, tel que le
port Stephens, i’usage est absolument le même. S ’ il étoit différent, une circonstance aussi remarquable
eût certainement donné lieu à quelque observation spéciale de la part de cet auteur.
L I V R E V. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t , 7 5 7
Quelques mots néanmoins pris dans les langues de ces districts se res- P o r t-Ja c k so n .
semblent encore, et piusieurs autres mots sont tout-à-fait les mêmes. De 1 homme
r en société.
D’après les faits rapportés par Collins, l’idiome des naturels de Sydney
s’éloigne notablement de celui des indigènes du port Stephens. Toutefois
le peu que ies Européens ont appris de la langue des habitans de
la Nouvelle - Hollande est encore si borné, qu’il seroit bien difficile de
raisonner un peu longuement sur cette matière. Les vocabulaires,
d’ailleurs (car c’est presque tout ce que nous en possédons) (1), ne suffisent
point pour étudier cette langue ; c’est une vérité à laquelle jusqu’à ce
jour les voyageurs n’ont point assez fait attention. Quelques pages de
discours écrits, des phrases familières même, seroient d’un bien plus
grand secours , et permettroient aux savans qui s’occupent de l’ethnologie,
de développer ies questions relatives à la dérivation des peuples,
ou, comme le dit le docteur Johnson, à la généalogie de l’espèce
humaine.
Souvent on remarque une différence sensible dans ie même mot prononcé
par des individus de deux tribus voisines; les uns substituent le l>
au p , ou bien le g au c, et vice versa; mais en général les Nouveaux-
Hollandais articulent avec beaucoup de peine l’r et le v, deux lettres fort
peu usitées dans leurs idiomes ; iis substituent le r à i’r dans les mots européens
qu’on leur fait entendre, parfois aussi le k aw g, le t au k, I’m ou
le /> au V, et invariablement par-tout l e p k l’f , et le d au th anglais ; l’r,
au contraire, est prononcée avec force. Nous observerons en passant
que \’f et le v ne se trouvent pas non plus dans la langue des habitans
de la baie des Iles (bay of Islands), à la Nouvelle-Zélande, Au
reste, M. Field nous assure, et d’ailleurs il est facile de le concevoir, que le
langage, aussi bien que les moeurs des aborigènes de la Nouvelle-Galles du
Sud, s’abâtardit rapidement dans les parties occupées par les colons anglais.
Arithmétique. -—Leur numération est fort incomplète. Collins remarque
qu’elle ne dépasse pas le nombre trois ; d’après Dawson, ils peuvent
( i ) N ous avons ouï dire qu’un colon an g la is, le R.'^ M . T re lk e ld , possédant parfaitement
un des idiomes qu’on parle dans les pays voisins du P o r t - Ja c k so n , a traduit dans cet idiome
l’évangile selon saint L u c . N ous avons fa it de va ins efforts pour nous procurer cet o u v ra g e ,
leq u e l, s’ il existe en E u ro p e , paroit y être encore extrêmement rare.
Voyage Je VUranie. — Historique. T, II. D cl d (J d
iUjüÎl.