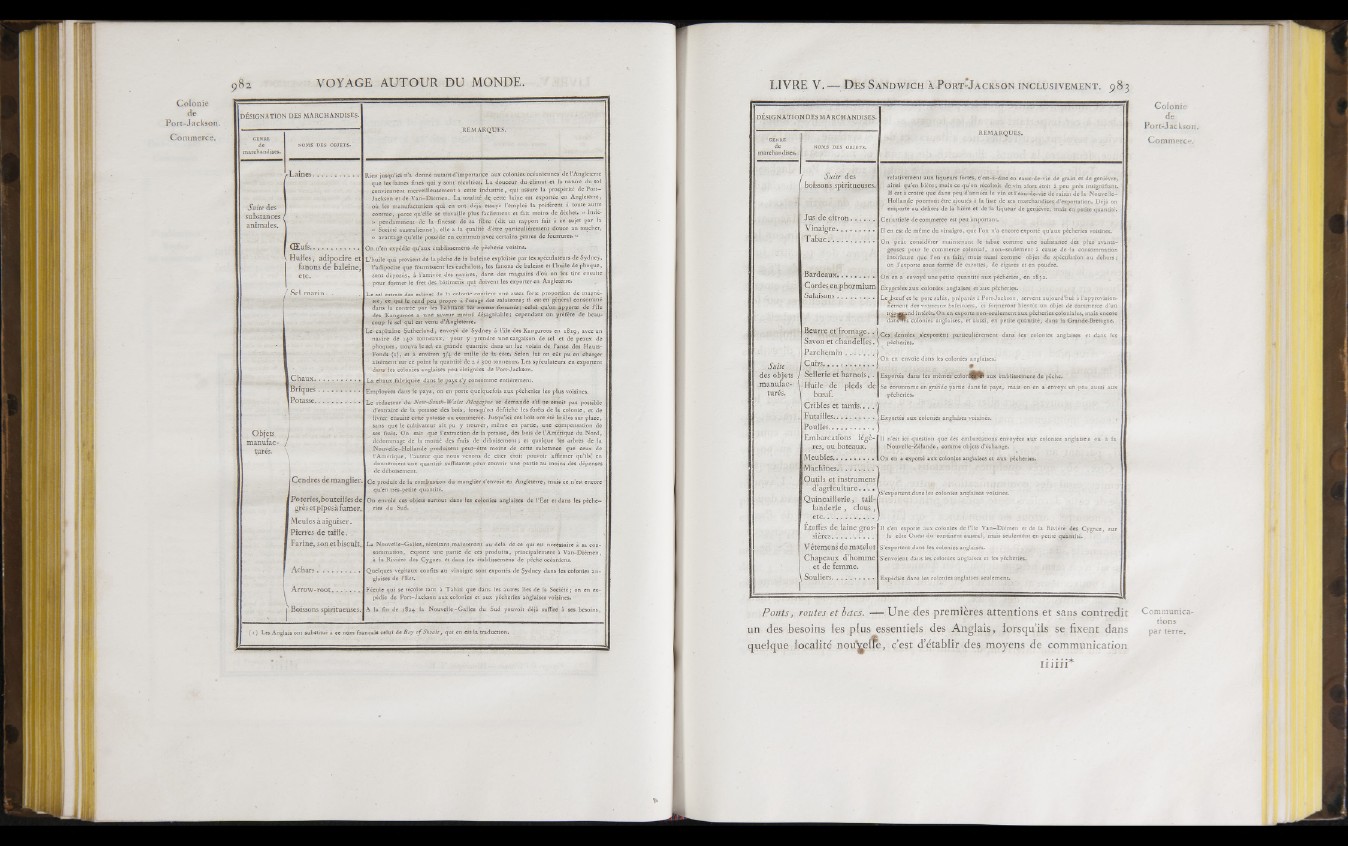
1
Commerce.
d é s i g n a t i o n d e s m a r c h a n d i s e s .
GENRE
de
marchandises.
NOMS DES OBJETS.
Laines........................
Suite des
substances
animales.
OEufs . .. ,
V Huiles, adrpocire et
' fanons de baleine.
'' Sei 1
Chaux. .
Bricfues .
Potasse..
Objets
raanufac-
Cendres demangiier,
PoC€ries,bouteillesde
grès et pipes à fumer,
Meules à aiguiser.
Pierres de taille.
Farine, son et biscuit
Achars....................
Arrow-root............
\ Boissons spiritueuses.
R EM A R Q U E S .
R ien ju squ ’ici n’a donné autant d ’im p on ance aux colonies océaniennes de l'Anglete rre
qu e les la ines fines qu i y sont récoltées. L a douceur du clim a t et ia nature du sol
conviennent me rveilleu sement à cette in d u s trie , qu i assure la prospérité de P o r t -
Ja ck so n et de V an -D iém e n . L a totalité dç cette la ine est exportée en A ngleterre,
où ies manufacturiers q u i en ont dé jà es sayé l ’emploi la p réfèrent à toute autre
c on nu e , p arce q u 'e lle se t rav a ille p lus facilemen t et fa it moins de déchet. « Indc-
» pendamment de ia finesse de sa fib re (d it un rapport fa it à ce sujet par ia
» Société a u s t ra lien n e ), e lle a la qualité d ’ctre particuliè rement douce au toucher,
» avantage q u ’e lle possède en commun av e c c erta ins genres de fourrures. »
On n’en exp édie qu ’au x établissemens de pêcherie voisins.
L 'h u ile qu i provient de ia pêche de la b ale in e exploitée par les spéculateurs de S yd n e y,
l ’ad ip ocire qu e fournis sent le s c a ch a lo ts , ies fanons de b ale ine et l’hu ile de phoq ue ,
sont d é p o sé s , à l’arriv é e des n a v ire s , dans des maga sins d ’où on le s tire ensuite
p our former ie fret des bâtimens q u i doivent les exporter en Angleterre.
L e sel ex trait des sa line s de ia colonie contient u n e assez forte proportion de magnés
ie , c e qu i Je re iid 'p e u propre à i ’usage des s a la iso n s ; il est en générai consommé
dans ia contrée p a r ies habitans le s m o in s fortun é s ; c e lu i q u ’on apporte de l'îJe
des K angu roos a u n e sa veur moins dé sag ré able ; cependant on préfère dc beaucoup
ie se l qu i est v enu d ’A ngleterre.
L e - c a p it a in e $u th e rlan d , en voyé de S y d n e y à l'île des K angu roos en 1 8 1 9 , avec un
n av ire de 14 .0 to n n e au x , pour y prendre u ne cargaison dc sei et dc p eaux de
p hoq u e s , trouva le se i en grande quantité dans un la c voisin de l’anse des H au ts -
F on d s ( i ) , et à environ 3 /4 de m ille de la côte. Se ion iu i on eût p u en charger
a isément su r ce point ia quantité de a à 30 0 tonneaux. L e s spéculateurs en exportent
dans ies colonies anglaise s p eu éloignées de P ort-Ja ck son .
L a chau x fab riqu é e dans ie p ay s s ’y consomme entièrement.
Em p lo y é e s dans le p a y s , on en porte qu elque fo is au x pêcheries les plus voisines.
L e rédacteur d u N e w - S o u t h - l V a / e s A i a g a i h e se d emande s ’ii ne seroit pas possible
d ’ex traire de ia potasse des b o is , iorsqu'on dé friche le s forêts d e ia co io n ie , et de
liv re r ensuite cette potasse au comm erce. Ju sq u ’ic i ces bois ont été brûlés su r p la ce,
sans qu e le cultiva teur a it pu y tro u v e r, même en p a r tie , une compensation dc
ses fra is . On sait qu e i'extraction de la potasse, des bois dc rAm é r iq u e du N o rd ,
dédommage dc la moitié des fra is de d éb o is em ent; ct quoique ies arbres de la
N o u v e lle -H o lla n d e produisent p eu t-ê tre moins de cette substance qu e ceux de
l ’A m é r iq u e , l’ auteur qu e nous venons de citer croit pouvoir affirmer q u ’ilsj en
donneroient une quantité suffisante pour cou vrir une partie au moins des dépenses
de déboisement.
C e produit de la combustion du manglier s ’envoie en Angle te rre , ma is ce n’est encore
qu ’en très-petite quantité.
On envoie ces objets surtout dans les colonies anglaise s de l ’E s t ct dans ies pêcheries
du Su d .
L a N o u v e lie -G a l le s , récoltant maintenant au delà de ce qu i est nécessaire à sa consom
m a tion, exporte une partie de ces p ro d u it s , p rincipalement à V an -D iém e n ,
à la R iv iè re des C y gn e s et dans les établissemens de pêche océaniens.
Q u elque s végétaux confits au vin a ig re sont exportés de Syd n e y dans le s colonies anglaises
de l'E s t .
F é cu le qu i se récolte tant à T a h it i que dans ies autres îie s de ia S o c ié té ; on en expédie
dc P o rt -Ja c k so n aux colonies et au x pêcheries anglaise s voisines .
A ia fin dc J8 2 4 ia N o u v e ile -G a l le s du Su d pouvoit déjà suffire à ses be so in s.
( 1 ) Le s A n g la is ont substitué à ec nom fra n ç a is celui de B a y o f S h o a h , qui en est ia traduction.
D É S IG N A T IO N D E S M A R C H A N D I S E S .
GENRE
de
march andises .
NOMS DES OBJETS.
R EM A R Q U E S .
Suite des
boissons spiritueuses.
Jus de citron............
Vinaigre....................
Tabac........................
rela tivemen t au x liqu eu rs fortes, c ’es t-à-d ire en e au x -d e -v ie de g rain c t de genièvre,
ain s i qu ’en b iè re ; m a is ce q u ’on técoltoit de v in alors étoit à peu près ins ignifianu
Il est à croire qu e dans peu d ’années le v in ct l ’cau -d e -v ie dc raisin de la N o u v e lle -
H o lland e pourront être ajoutés à la liste de scs marchandises d ’exportation. D é jà on
emporte au dehors de ia bière et de la liqu eu r de g enièvre, ma is en petite quantité.
C e t article de commerce est peu important.
I l en est de même d u v in a ig re , qu e i ’on n’a encore exporté q u ’au x pêcheries voisines.
On p eut considérer maintenant ie tabac comme u ne substance des plus avantageuses
pour ie commerce co lo n ia l, n o n-s eu iem en t à cau se de la consommation
inté rieu re qu e l’on en fa it , m a is aussi comm e ob jet d e spéculation a u d e h o rs ;
on l'e xporte sous form e dc carottes, de cigare s et en poudre.
On en a en voyé une petite quantité a u x pê ch e rie s , en 18 3 2 .
Exportées au x colonies anglaise s et au x pêcheries.
L e ^ oe u f et le porc s a lé s , préparés à P o rt -Ja ck so n , servent au jou rd ’hui i l'app rov is io n nement
des v.iis se aux b a le in ie r s , et formeron t bientôt un ob jet de commerce d ’un
t r è s ^ ^ n d intérêt. On en exporte non-seuiement au x pêcheries coloniale s , ma is encore
d a n ^ R s colonies an g la is e s , et a u s s i, en petite q u an tité , dans la Grande-Bretagne.
,C e s denrées s’exportent particuliè remen t dans le s colonies anglaise s et dans le s
1 p êche ries.
Bardeaux....................
Cordes enphormium
Salaisons...................
Beurre et fromage. . j
Savon et chandelles, j
Parchemin............
Cuirs.. . . r . . . . . . . O n en en vo ie dans les colonies anglaises.
Suite
des objets )
manufacturés.
Sellerie et harnois. .
Huile de pieds de
boeuf.
Cribles et tamis.. . .
#
Exp ortés dans le s mêmes colonl(Jftfc aux établissemens de pêche.
S c consomme en grande partie dans ic p a y s , m a is on en a envoyé un peu au ss i au x
pêcheries.
Poulies,......................
Exp orté s au x colonies anglaise s voisines . ,
Embarcatrons légères,
ou bateaux.
Meubles.....................
Machines................... '
II n’est ic i question qu e des embarcations envoyé es au x colonies a n g la is e s ou 3 la
N o u v e lle -Z é lan d e , comme objets d’échange.
On en a exporté au x colonies anglaise s et au x pêcheries.
Outils et instrumens
d’agriculture.. . ,
Quincaillerie, taillanderie
, clous ,
etc..........................
^S’exportent dans le s colonies anglaise s voisines .
!
Etoffes de laine grossières......................
Vêtemens de matelot
Chapeaux d’homme
et de femme.
\ Souliers......................
1
Il s ’en exporte au x colonies de l’île V a n -D iém e n ct de ia R iv iè re d e s C y g n e s , su r
la côte Ouest du continent a u s t ra l, ma is seulement çn petite qu an tité.
S ’exportent datis les colonies anglaises.
S ’envoient dans les colonies anglaise s et ies pècheries-
Ex p éd ie s dans les colonies ang laise s seulement.
C o lo n ie
de
Port-Jackson.
CommerC’N
Ponts, routes et bacs. — Une des premières attentions et sans contredit
un des besoins les plus essentiels des Anglais, lorsqu'ils se fixent dans
quelque localité noii^elfe, c’est d’établir des moyens de communication
liiiii*
Corn munica-
tions
par terre.
I l ■