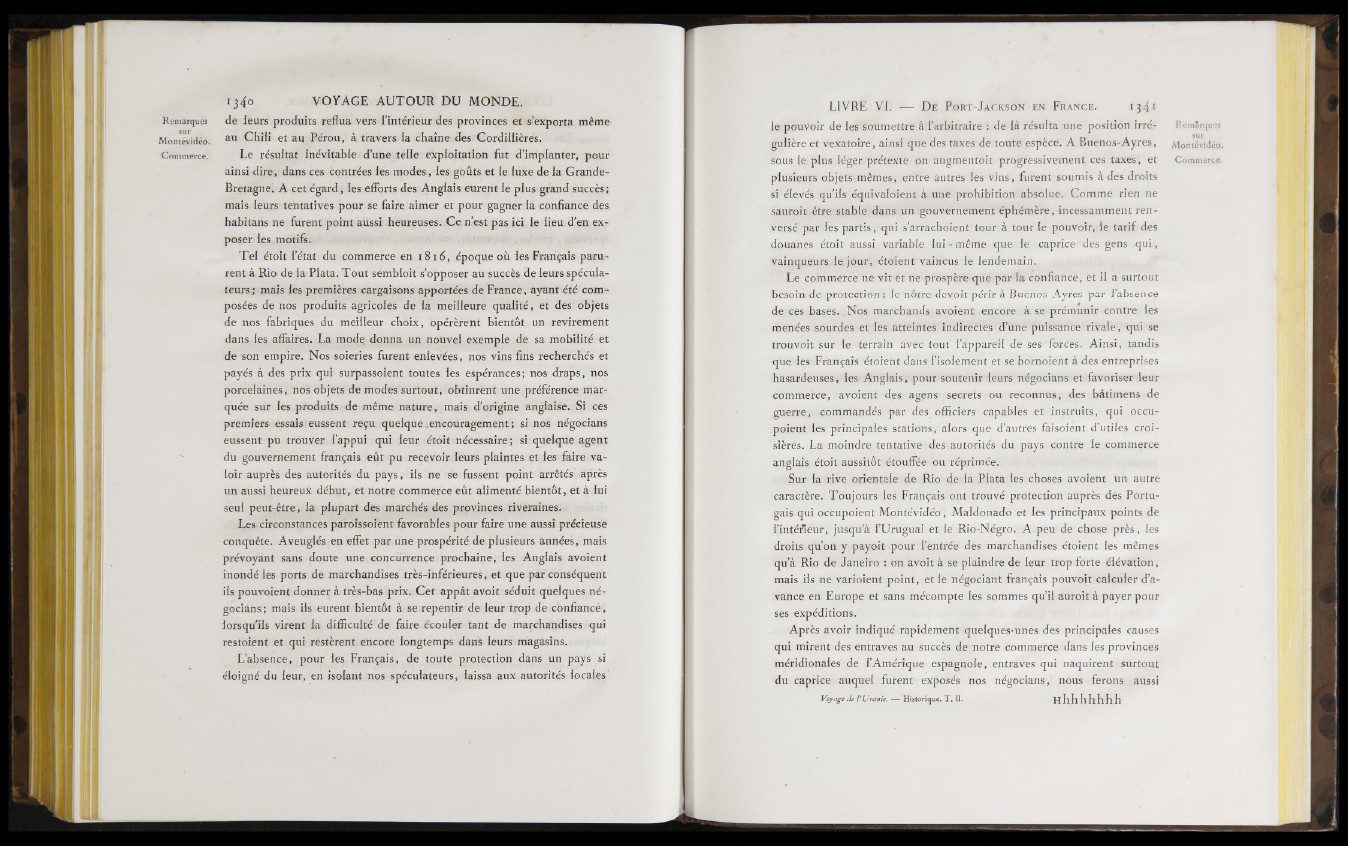
IcV
I l j .^
R em a rq u e s
sur
M o n t e v id e o .
C om m e r c e .
de leurs produits reflua vers l’intérieur des provinces et s’exporta même
au Chili et au Pérou, à travers la chaîne des Cordillières.
Le résultat inévitable d’une telle exploitation fut d’implanter, pour
ainsi dire, dans ces contrées les modes, les goûts et le luxe de la Grande-
Bretagne. A cet égard, les efforts des Anglais eurent le pius grand succès;
mais ieurs tentatives pour se faire aimer et pour gagner la confiance des
habitans ne furent point aussi heureuses. Ce n’est pas ici le lieu d’en exposer
les motifs.
Tel étoit i’état du commerce en 1816, époque où les Français parurent
à Rio de la Piata. Tout sembloit s’opposer au succès de ieurs spéculateurs;
mais les premières cargaisons apportées de France, ayant été composées
de nos produits agricoles de la meilleure qualité, et des objets
de nos fabriques du meilleur choix, opérèrent bientôt un revirement
dans les affaires. La mode donna un nouvel exemple de sa mobilité et
de son empire. Nos soieries furent enlevées, nos vins fins recherchés et
payés à des prix qui surpassoient toutes les espérances; nos draps, nos
porcelaines, nos objets de modes surtout, obtinrent une préférence marquée
sur les produits de même nature, mais d’origine anglaise. Si ces
premiers essais eussent reçu quelque encouragement ; si nos négocians
eussent pu trouver l’appui qui leur étoit nécessaire; si quelque agent
du gouvernement français eût pu recevoir leurs plaintes et les faire valoir
auprès des autorités du pays, ils ne se fussent point arrêtés après
un aussi heureux début, et notre commerce eût alimenté bientôt, et à lui
seul peut-être, la plupart des marchés des provinces riveraines.
Les circonstances paroissoient favorables pour faire une aussi précieuse
conquête. Aveuglés en effet par une prospérité de plusieurs années, mais
prévoyant sans doute une concurrence prochaine, les Anglais avoient
inondé les ports de marchandises très-inférieures, et que par conséquent
ils pouvoient donner à très-bas prix. Cet appât avoit séduit quelques négocians;
mais iis eurent bientôt à se repentir de ieur trop de confiance,
lorsqu’ils virent ia difficulté de faire écouler tant de marchandises qui
restoient et qui restèrent encore longtemps dans leurs magasins.
L’absence, pour ies Français, de toute protection dans un pays si
éloigné du leur, en isolant nos spéculateurs, laissa aux autorités locales
LIVRE Y l. — De P o r t - J a c k s o n e n F r a n c e . 1341
le pouvoir de les soumettre à l’arbitraire : de là résulta une position irrégulière
et vexatoire, ainsi que des taxes de toute espèce. A Buenos-Ayres,
sous le plus léger prétexte on augmentoit progressivement ces taxes, et
plusieurs objets mêmes, entre autres les vins, furent soumis à des droits
si élevés qu’ils équivaloient à une prohibition absolue. Comme rien ne
sauroit être stable dans un gouvernement éphémère, incessamment renversé
par les partis, qui s’arrachoient tour à tour le pouvoir, ie tarif des
douanes étoit aussi variable lui-même que le caprice des gens qui,
vainqueurs le jour, étoient vaincus le iendemain.
Le commerce ne vit et ne prospère que par la confiance, et il a surtout
besoin de protection ; le nôtre devoit périr à Buenos-Ayres par l’ahsence
de ces bases. Nos marchands avoient encore à se prémunir contre les
menées sourdes et les atteintes indirectes d’une puissance rivale, qui se
trouvoit sur le terrain avec tout i’appareil de ses forces. Ainsi, tandis
que les Français étoient dans l’isolement et se bornoient à des entreprises
hasardeuses, les Anglais, pour soutenir leurs négocians et favoriser leur
commerce, avoient des agens secrets ou reconnus, des bâtimens de
guerre, commandés par des officiers capables et instruits, qui occupoient
les principales stations, alors que d’autres faisoient d’utiles croisières.
La moindre tentative des autorités du pays contre le commerce
anglais étoit aussitôt étouffée ou réprimée.
Sur ia rive orientale de Rio de la Plata les choses avoient un autre
caractère. Toujours ies Français ont trouvé protection auprès des Portugais
qui occupoient Montévidéo, Maldonado et les principaux points de
l’inténeur, jusqu’à l’Uruguai et le Rio-Négro. A peu de chose près, les
droits qu’on y payoit pour l’entrée des marchandises étoient les mêmes
qu’à Rio de Janeiro ; on avoit à se plaindre de leur trop forte élévation,
mais ils ne varioient point, et le négociant français pouvoit calculer d’avance
en Europe et sans mécompte les sommes qu’il auroit à payer pour
ses expéditions.
Après avoir indiqué rapidement quelques-unes des principales causes
qui mirent des entraves au succès de notre commerce dans les provinces
méridionales de l’Amérique espagnole, entraves qui naquirent surtout
du caprice auquel furent exposés nos négocians, nous ferons aussi
C om m e r c e .