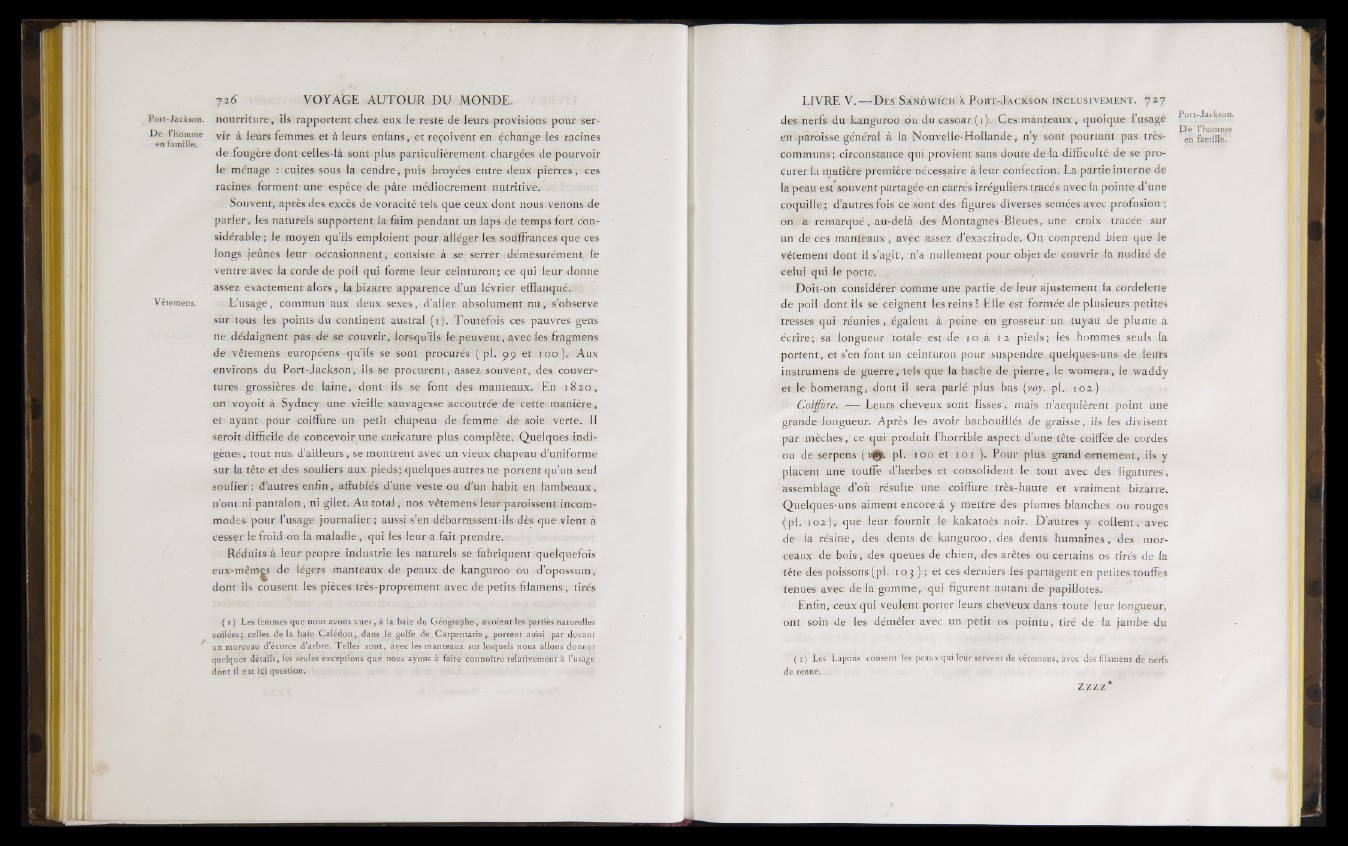
P o r t-Ja c k so n . nourriture, ils rapportent chez eux le reste de leurs provisions pour servir
D e l’homme
en tamille.
Vêtemens.
à leurs femmes et à leurs enfans, et reçoivent en échange ies racines
de fougère dont celles-là sont plus particulièrement chargées de pourvoir
le ménage ; cuites sous la cendre, puis broyées entre deux pierres , ces
racines forment une espèce de pâte médiocrement nutritive.
Souvent, après des excès de voracité tels que ceux dont nous venons de
parler, les naturels supportent la faim pendant un laps de temps fort considérable
; le moyen qu’ils emploient pour alléger les souffrances que ces
longs jeûnes leur occasionnent, consiste à se serrer démesurément le
ventre avec la corde de poil qui forme leur ceinturon; ce qui ieur donne
assez e.vactement alors, la bizarre apparence d’un lévrier efflanqué.
L’usage, commun aux deu.x sexes, d’aller absolument nu, s’observe
sur tous les points du continent austral (i). Toutefois ces pauvres gens
ne dédaignent pas de se couvrir, lorsqu’ils le peuvent, avec les fragmens
de vêtemens européens qu’ils se sont procurés (pl. pp et 10 0 ) . Aux
environs du Port-Jackson, ils se procurent, assez souvent, des couvertures
grossières de laine, dont iis se font des manteaux. En 18 2 0 ,
on voyoit à Sydney une vieille sauvagesse accoutrée de cette manière,
et ayant pour coiffure un petit chapeau de femme de soie verte. Il
seroit difficile de concevoir une caricature plus complète. Quelques indigènes,
tout nus d’ailleurs, se montrent avec un vieux chapeau d’uniforme
sur la tête et des souliers aux pieds; quelques autres ne portent qu’tin seul
soulier ; d’autres enfin, affublés d’une veste ou d’un habit en lambeaux,
n’ont ni pantalon, ni gilet. Au total, nos vêtemens leur paroissent incommodes
pour l’usage journalier ; aussi s’en débarrassent-ils dès que vient à
cesser le froid ou la maladie , qui les leur a fait prendre.
Réduits à leur propre industrie les naturels se fabriquent quelquefois
eux-mêm|s de légers manteaux de peaux de kanguroo ou d’opossum,
dont ils cousent les pièces très-proprement avec de petits fiiamens, tirés
( I ) Les femmes que nous avons v u e s , à la baie du G é o g rap h e , avoient les parties naturelles
vo ilé e s ; celles d e là b aie C a lé d o n , dans le golfe de C a rp en ta r ie , portent aiTssi par devant
un morceau d’écorce d’ arbre. T e lle s son t , avec les manteaux sur lesquels nous allons donner
quelques d é ta ils, les seules exceptions que nous ayons à faire connoître relativement à l’usage
dont il e s t ici question.
LIVRE V .— D e s S a n d w i c h a P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 727
des nerfs du kanguroo ou du casoar (1). Ces manteaux , quoique l’usage
en paroisse général à la Nouvelle-Hollande, n’y sont pourtant pas très-
communs; circonstance qui provient sans doute de la difficulté de se procurer
la matière première nécessaire à leur confection. La partie interne de
ia peau est souvent partagée en carrés irréguliers tracés avec la pointe d’une
coquille; d’autres fois ce sont des figures diverses semées avec profusion ;
on a remarqué, au-delà des Montagnes-Bleues, une croix tracée sur
un de ces manteaux, avec assez d’exactitude. On comprend bien que le
vêtement dont il s’agit, n’a nullement pour objet de couvrir la nudité de
celui qui ie porte.
Doit-on considérer comme une partie de ieur ajustement la cordelette
de poil dont ils se ceignent les reins î Elle est formée de plusieurs petites
tresses qui réunies , égalent à peine en grosseur un tuyau de plume à
écrire; sa longueur totale est de 10 à 12 pieds; ies hommes seuls la
portent, et s’en font un ceinturon pour suspendre quelques-uns de leurs
instrumens de guerre, teis que la hache de pierre, le womera, le waddy
et le bomerang, dont ii sera parlé plus bas (voy. pi. 10 2 )
Coiffure. — Leurs cheveux sont lisses, mais n’acquièrent point une
grande longueur. Après ies avoir barbouillés de graisse, ils les divisent
par mèches, ce qui produit l’horrible aspect d’une tête coiffée de cordes
ou de serpens ( vi^. pl. 100 et lo i ). Pour plus grand ornement, ils y
placent une touffe d’herbes et consolident le tout avec des ligatures,
assemblage d’où résulte une coiffure très-haute et vraiment bizarre.
Quelques-uns aiment encore à y mettre des plumes blanches ou rouges
(pl. T02),. que leur fotirnit le kakatoès noir. D’autres y collent, avec
de la résine, des dents de kanguroo, des dents humaines, des morceaux
de bois, des queues de chien, des arêtes ou certains os tirés de la
tête des poissons (pl. 103 ) ; et ces derniers ies partagent en petites touffes
tenues avec de la gomme, qui figurent autant de papillotes.
Enfin, ceux qui veulent porter leurs cheveux dans toute leur longueur,
ont soin de les démêler avec un petit os pointu, tiré de la jambe du
D e l’homme
en famille.
(1 ) Les L ap o n s cousent les peaux qui leur servent de vêtemens, avec des fiiamens de nerfs
de renne.
Z z z z *