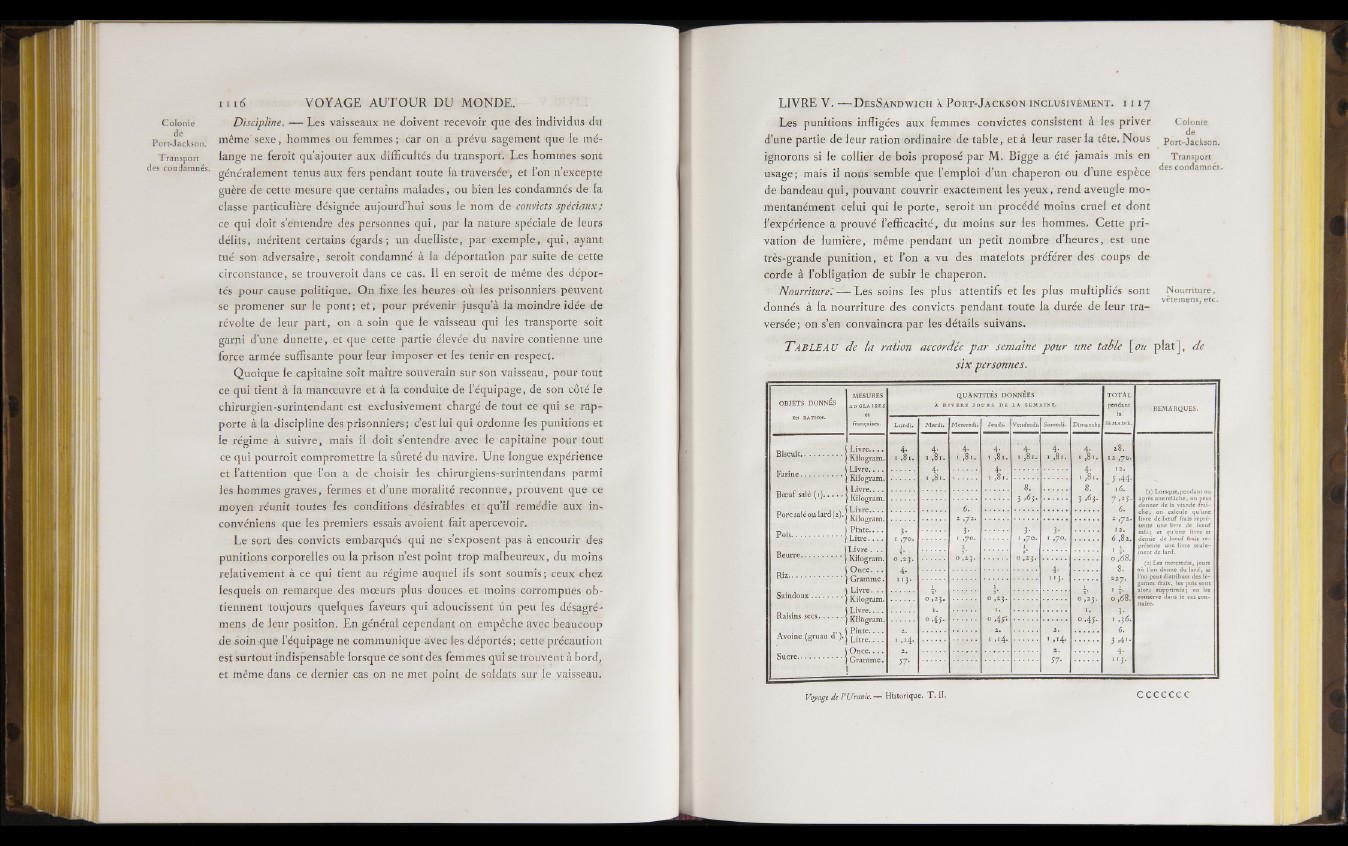
Colonie
de
i i i ó VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Discipline. — Les vaisseaux ne doivent recevoir que des individus du
Port-j'ackson luêine sexe, hommes ou femmes; car on a prévu sagement que le mé-
Transport lange ne feroit qu’ajouter aux difficultés du transport. Les hommes sont
des condamnes, généralement tenus aux fers pendant toute la traversée, et l’on n’excepte
guère de cette mesure que certains malades, ou bien les condamnés de la
classe particulièj-e désignée aujourd’hui sous le nom de convicts spéciaux ;
ce qui doit s’entendre des personnes qui, par la nature spéciale de leurs
délits, méritent certains égards; nn duelliste, par exemple, qui, ayant
tué son adversaire, seroit condamné à la déportation par suite de cette
circonstance, se trouveroit dans ce cas. II en seroit de même des déportés
pour cause politique. On fixe les heures où les prisonniers peuvent
se promener sur le pont ; e t, pour prévenir jusqu’à la moindre idée de
révolte de leur part, on a soin que ie vaisseau qui les transporte soit
garni d’une dunette, et que cette partie élevée du navire contienne une
force armée suffisante pour leur imposer et les tenir en respect.
Quoique le capitaine soit maître souverain sur son vaisseau, pour tout
ce qui tient à la manoeuvre et à la conduite de l’équipage, de son côté le
chirurgien-surintendant est exclusivement chargé de tout ce qui se rapporte
à la discipline des prisonniers; c’est lui qui ordonne les punitions et
le régime à suivre, mais il doit s’entendre avec le capitaine pour tout
ce qui pourroit compromettre la sûreté du navire. Une longue expérience
et l’attention que i’on a de choisir les chirurgiens-surintendans parmi
les hommes graves, fermes et d’une moralité reconnue, prouvent que ce
moyen réunit toutes les conditions désirables et qu’il remédie aux in-
convéniens que les premiers essais avoient fait apercevoir.
Le sort des convicts embarqués qui ne s’exposent pas à encourir des
punitions corporelles ou la prison n’est point trop malheureux, du moins
relativement à ce qui tient au régime auquel ils sont soumis; ceux chez
lesquels on remarque des moeurs plus douces et moins corrompues obtiennent
toujours quelques faveurs qui adoucissent lîn peu les désagrémens
de leur position. En général cependant on empêche avec beaucoup
de soin que l’équipage ne communique avec les déportés; cette précaution
est surtout indispensable lorsque ce sont des femmes qui se trouvent à bord,
et même dans ce dernier cas on ne met point de soldats sur le vaisseau.
Transport
des condamnés.
LIVRE V. ■— D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t , i i i 7
Les punitions infligées aux femmes convictes consistent à les priver
d’une partie de leur ration ordinaire de table, et à leur raser ia tête. Nous
ignorons si le collier de bois proposé par M. Bigge a été jamais mis en
usage; mais il nous semble que l’emploi d’un chaperon ou d’une espèce
de bandeau qui, pouvant couvrir exactement ies yeux, rend aveugle momentanément
ceiui qui le porte, seroit un procédé moins cruel et dont
l’expérience a prouvé l’efficacité, du moins sur les hommes. Cette privation
de lumière, même pendant un petit nombre d’heures, est une
très-grande punition, et l’on a vu des matelots préférer des coups de
corde à l’obligation de subir le chaperon.
Nourriture. — Les soins ies plus attentifs et les plus multipliés sont
donnés à la nourriture des convicts pendant toute la durée de leur traversée;
on s’en convaincra par les détails suivans.
T ableau de la ration accordée par semaine pour une table [ou plat], de
six personnes.
No u r r i tu r e ,
vêtemens, etc.
OBJETS DONNÉS
MESURES
A N G LA I S E S
et
À D
QUANT ITÉ S DONNÉES
IV E B S JO U R S DE L A S EM A IN E .
TO T A L
pendant
la
REMARQUES.
E.H RATION.
françaises. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche SEMAINE.
Biscuit.......................
L i v r e . . . .
t 4- 4-
I l ' 1 ; 4 *
l i
2 8 .
Kilogram. 1 , 8 1 . 1 , 8 1 .
4-
1 8 i .
1 , 8 1 . 1 , 8 1 .
4-
I , 0 1 . I , 8 1 . I , 8 1 . 1 2 , 7 0 .
I 2,
F a rin e ....................... ç A À
Boe uf salé ( i ) ..........
Kilogram.
L iv r e .. .
I
8 . 8 .
) ’44-
1 6. (i) Lorsque,pendant ou
après une relâche, on peut
donner dc la viande fraîKilogram.
6.
3 r i i - 3 r i ) . 7 > = 5-
6.
Porcsaléou lard(2).
Kilogram.
Pinte----- 3-
2 , 7 2 .
3' 3- 3*
................ 2 , 7 2 .
12 .
che, on calcule qu’une
livre de hoeuf frais représente
une livre de hoeuf
Pois............................ sale; et qu’une iivre et
Beurre .......................
L it r e . . . .
L iv re . . .
Kilogram.
O n c e . . .
G ramm e .
L iv r e . . .
Kilogram.
1 , 7 0 . I , 7 0 .
1.
■ , 7 0 .
î ’
f , 7 0 . 6 , 8 2 .
I J .
0 , 6 8 .
8.
demie de boeuf frais représente
une livre seulement
dc l.trd.
0 / ; .
4-
0 , 2 3 . 0 , 2 3 .
4 .
(2) Les mercredis, jours
où l ’on donne du lard, si
l'on peut distribuer des légumes
frais, les pois sont
aiors supprimés; on les
conserse dans ie cas con-
Riz ..............................
t: ’
1 1 3 .
S a in d o u x .................
1 1 3 .
0 , 2 3 ,
J ,
0 , 2 3 .
I .
0 , 2 3 .
I ,
2 2 7 .
I i .
0 , 6 8 .
3-
Raisins secs............. Kilbgram. 1 . î 6 .
P in t e .. . .
L i t r e . . . .
O n c e .. . .
Gramme.
i
0 .d. c. 0 ,4.?'. 0 4 g
2. 6.
3 , 4 . .
4.
Avoine (gruau d’ ). , . % . I d 4 - I , 1 4 .
2 .
Su cre ......................... 57- 57* 1 1 3 .