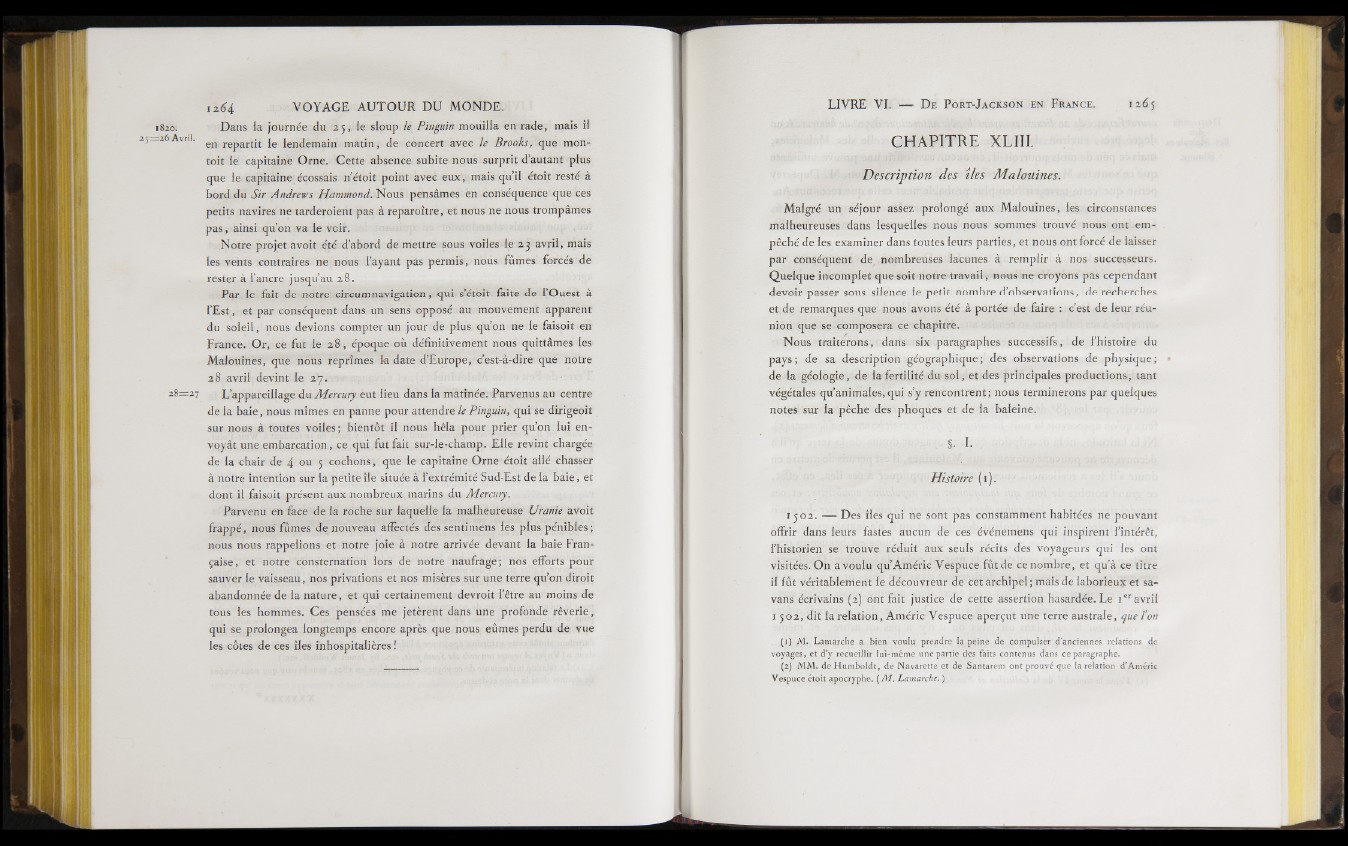
I(■ ■f! 1 ' il ' 11
E i
; ■ i
I'/- :.
ÎMv
18 2 0 .
2 5 = 2 6 A v r il.
2 8 = 2 7
Dans ia journée du 2 5 , le sloup le Pinguin mouilla en rade, mais il
en repartit ie lendemain matin, de concert avec le Brooks, que mon-
toit ie capitaine Orne. Cette absence subite nous surprit d’autant plus
que le capitaine écossais n'étoit point avec eux, mais qu’il étoit resté à
bord du Sir Andrews Hammond. ïAons pensâmes en conséquence que ces
petits navires ne tarderoient pas à reparoître, et nous ne nous trompâmes
pas, ainsi qu’on va ie voir.
Notre projet avoit été d’abord de mettre sous voiles le 23 avril, mais
ies vents contraires ne nous l’ayant pas permis, nous fûmes forcés de
rester à i’ancre jusqu’au 28.
Par le fait de notre circumnavigation, qui s’étoit faite de i’Ouest à
l’E st, et par conséquent dans un sens opposé au mouvement apparent
du soleil, nous devions compter un jour de plus qu’on ne le faisoit en
France. Or, ce fut le 28 , époque où définitivement nous quittâmes les
Malouines, que nous reprîmes la date d’Europe, c’est-à-dire que notre
28 avril devint le 27.
L ’appareillage du Mercury eut lieu dans la matinée. Parvenus au centre
de la baie, nous mîmes en panne pour attendre le Pinguin, qui se dirigeoit
sur nous à toutes voiles; bientôt il nous bêla pour prier qu’on fui envoyât
une embarcation, ce qui fut fait sur-le-champ. Elle revint chargée
de la chair de 4 ou 5 cochons, que ie capitaine Orne étoit allé chasser
à notre intention sur ia petite île située à l’extrémité Sud-Est de la baie, et
dont 11 faisoit présent aux nombreux marins du Mercury.
Parvenu en face de la roche sur laquelle la malheureuse Uranie avoit
frappé, nous fûmes de nouveau affectés des sentimens les plus pénibles;
nous nous rappelions et notre joie à notre arrivée devant la baie Française,
et notre consternation lors de notre naufrage; nos efforts pour
sauver le vaisseau, nos privations et nos misères sur une terre qu’on diroit
abandonnée de la nature, et qui certainement devroit l’être au moins de
tous les hommes. Ces pensées me jetèrent dans une profonde rêverie,
qui se prolongea longtemps encore après que nous eûmes perdu de vue
ies côtes de ces îles inhospitalières !
CHAPITRE XLIII.
Description des îles Malouines.
Malgré un séjour assez prolongé aux Malouines, les circonstances
malheureuses dans lesquelles nous nous sommes trouvé nous ont empêché
de les examiner dans toutes leurs parties, et nous ont forcé de laisser
par conséquent de nombreuses lacunes à remplir à nos successeurs.
Quelque incomplet que soit notre travail, nous ne croyons pas cependant
devoir passer sous silence le petit nombre d’observations, de recherches
et de remarques que nous avons été à portée de faire : c’est de leur réunion
que se composera ce chapitre.
Nous traiterons, dans six paragraphes successifs, de i’histoire du
pays; de sa description géographique; des observations de physique;
de ia géologie, de la fertilité du sol, et des principales productions, tant
végétales qu’animales, qui s’y rencontrent; nous terminerons par quelques
notes sur la pêche des phoques et de la baleine.
§. I.
Histoire (i).
I J0 2 . — Des îles qui ne sont pas constamment habitées ne pouvant
offrir dans leurs fastes aucun de ces événemens qui inspirent l’intérêt,
l’historien se trouve réduit aux seuls récits des voyageurs qui les ont
visitées. On a voulu qu’Améric Vespuce fût de ce nombre, et qu’à ce titre
il fût véritablement le découvreur de cet archipel ; mais de laborieux et savans
écrivains (2) ont fait justice de cette assertion hasardée. Le D'avril
I 502, dit la relation, Améric Vespuce aperçut une terre australe, que l'on
. ( i ) M . L am a rch e a bien voulu prendre ia peine de compulser d ’anciennes relations de
v o y a g e s , et d’y recue illir Iui-même une partie des faits contenus dans ce paragraphe.
(2) M M . de H um b o ld t, de Nav a re tte et de Santarem ont prouvé que la relation d’Améric
Vespuce étoit apocryphe. (M. Lamarche. )