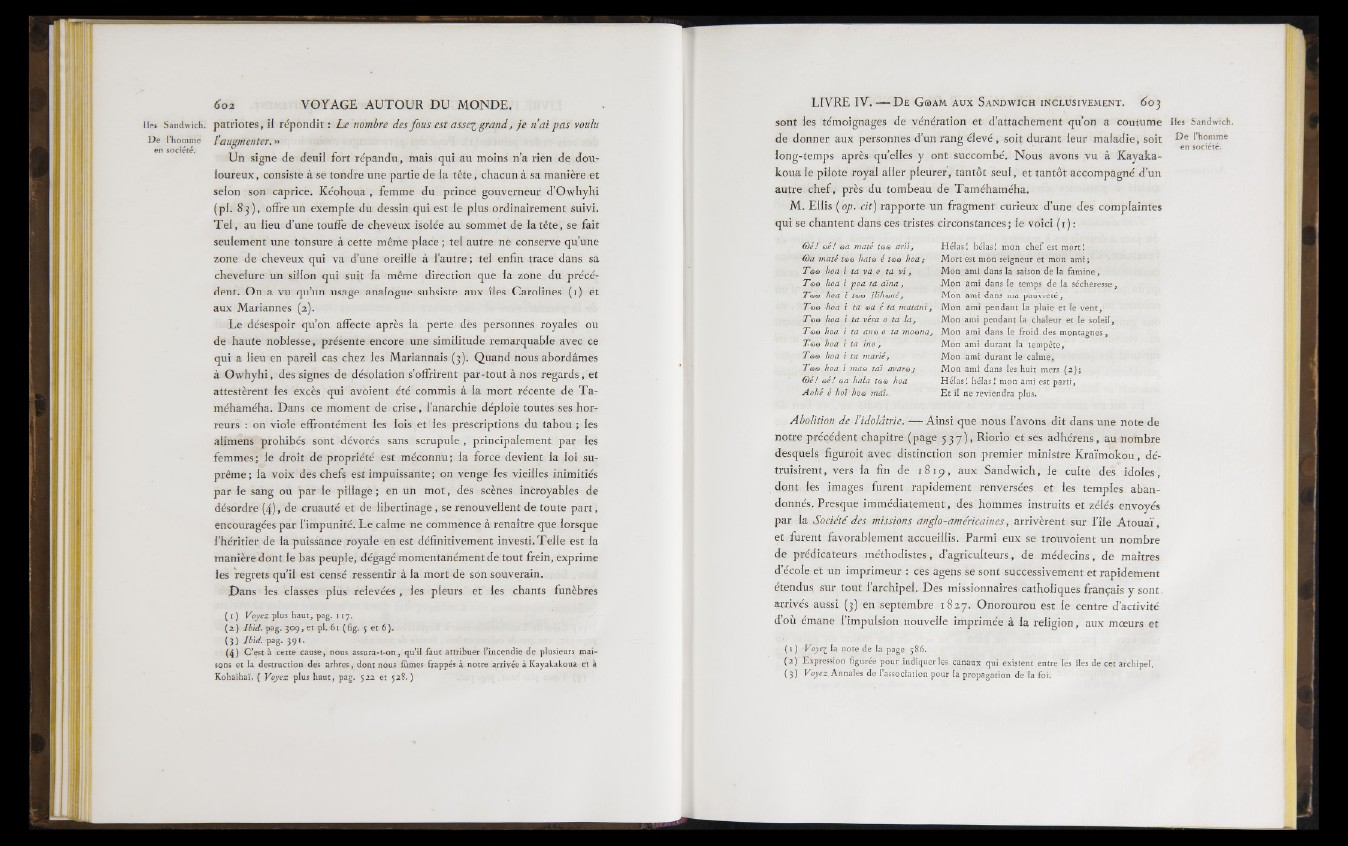
llci San dw ich, patriotes, il répondit : Le nombre des fous est assez grand, Û n’ai pas voulu
D e l’homme l’augmcnter. »
en société.
Un signe de deuil fort répandu, mais qui au moins n’a rien de douloureux,
consiste à se tondre une partie de la tête, chacun à sa manière et
selon son caprice. Kéohoua , femme du prince gouverneur d’Owhyhi
(pl. 83), offre un exemple du dessin qui est le plus ordinairement suivi.
T e l, au lieu d’une touffe de cheveux isolée au sommet de la tête, se fait
seulement une tonsure à cette même place ; tel autre ne conserve qu’une
zone de cheveux qui va d’une oreille à i’antre ; tel enfin trace dans sa
chevelure un sillon qui suit la même direction que la zone du précédent.
On a vu qu’un usage analogue subsiste aux îles Carolines (1) et
aux Mariannes (2).
Le désespoir qu’on affecte après la perte des personnes royales ou
de haute noblesse, présente encore une similitude remarquable avec ce
qui a lieu en pareil cas chez les Mariannais (3). Quand nous abordâmes
à Owhyiii, des signes de désolation s’offrirent par-tout à nos regards , et
attestèrent les excès qui avoient été commis à la mort récente de T a méhaméha.
Dans ce moment de crise, l’anarchie déploie toutes ses horreurs
; on viole effrontément les lois et les prescriptions du tabou ; les
alimens prohibés sont dévorés sans scrupule , principalement par les
femmes; le droit de propriété est méconnu; la force devient la loi suprême;
la voix des chefs est impuissante; on venge les vieilles inimitiés
par ie sang ou par le pillage ; en un mot, des scènes incroyables de
désordre (4), de cruauté et de libertinage , se renouvellent de toute part,
encouragées par l’impunité. Le calme ne commence à renaître que lorsque
l’héritier de la puissance royale en est définitivement investi. Telle est la
manière dont le bas peuple, dégagé momentanément de tout frein, exprime
ies regrets qu’il est censé ressentir à la mort de son souverain.
Dans les classes plus relevées, les pleurs et les chants funèbres
( I ) Voyez p l u s h a u t , p a g . i 17 .
{ 2 ) Ih id . pag. 3 0 9 , et pl. 6 1 (fig. 5 et 6 ).
( 3 ) pag. 3 9 t .
(4 ) C ’est à cette c au se , nous assura-t-on, qu’ il faut attribuer l’ incendie de plusieurs maisons
et la destruction des a rbre s, dont nous fûmes frappés à notre arrivée à Kayakakoua et a
Kohaïhaï. ( Voyez plus haut, pag. 5 2 2 et 5 2 8 ,)
LIVRE IV. — De Goam a u x S a n d w i c h i n c l u s i v e m e n t . ¿03
sont les témoignages de vénération et d’attachement qu’on a coutume ile s San dw ich,
de donner aux personnes d’un rang élevé, soit durant leur maladie, soit D e l’ homme
^ ^ ^ ^ en société.
long-temps après qn'elles y ont succombé. Nous avons vu à Kayaka-
koua le pilote royal aller pleurer, tantôt seul, et tantôt accompagné d’un
autre chef, près du tombeau de Taméhaméha.
M. Eliis [op. cit) rapporte un fragment curieux d’une des complaintes
qui se chantent dans ces tristes circonstances; le voici (i) :
(d é ! a é ! aa maté t&o a r iï,
(da maté taxa iiat& é ta a h o a ;
T&& hoa i ta va 0 ta v i ,
7 ’fflffl hoa i p o a ta d in a ,
T&si hoa 1 too iUhané ,
T a a hoa i ta c a é ta m a ta n i,
T&& hoa i ta véra o ta la ,
T a a hoa i ta ana o ta mo an a,
T a a hoa i ta in o ,
T a a hoa i ta m a rié ,
T a a hoa i maa tdi a v a r a ;
(d é ! a é ! aa hala ta a hoa
A o h é é hoi hoa mai.
H é la s ! hélas! mon ch e f est mort!
M o r t est mon seigneur et mon ami ;
M on ami dans la saison de la famine ,
M on ami dans le temps de la sé ch ere sse,
M on ami dans ma p a u v re té .
M on ami pendant la pluie et le v e n t .
M on ami pendant la chaleur et le so le il.
M o u ami dans le froid des m on ta gne s ,
M on ami durant la tempête.
M on ami durant le ca lm e .
M on ami dans les huit mers ( 2 ) ;
H é la s ! h é las ! mon ami est p a r ti.
E t il ne reviendra plus.
Abolition de l’idolâtrie. — Ainsi que nous l’avons dit dans une note de
notre précédent chapitre (page 537), Riorio et ses adhérens, au nombre
desquels figuroit avec distinction son premier ministre Kraïmokou, détruisirent,
vers la fin de 1 8 1 9 , aux Sandwich, le culte des idoles,
dont les images furent rapidement renversées et les temples abandonnés.
Presque immédiatement, des hommes instruits et zélés envoyés
par la Société' des missions anglo-américaines, arrivèrent sur l’île Atouaï,
et furent favorablement accueillis. Parmi eux se trouvoient un nombre
de prédicateurs méthodistes, d’agriculteurs, de médecins, de maîtres
d’école et un imprimeur : ces agens se sont successivement et rapidement
étendus sur tout l’archipei. Des missionnaires catholiques français y sont,
arrivés aussi (3) en septembre 1827. Onorourou est le centre d’activité
d’où émane l’impulsion nouvelle imprimée à la religion, aux moeurs et
{ I ) V o ye i la note de la page 586.
( 2 ) Expression figurée pour indiquer les canaux qui existent entre les îles de cet archipel.
( 3 ) Voyez Annales de l’association pour la propagation de la foi.