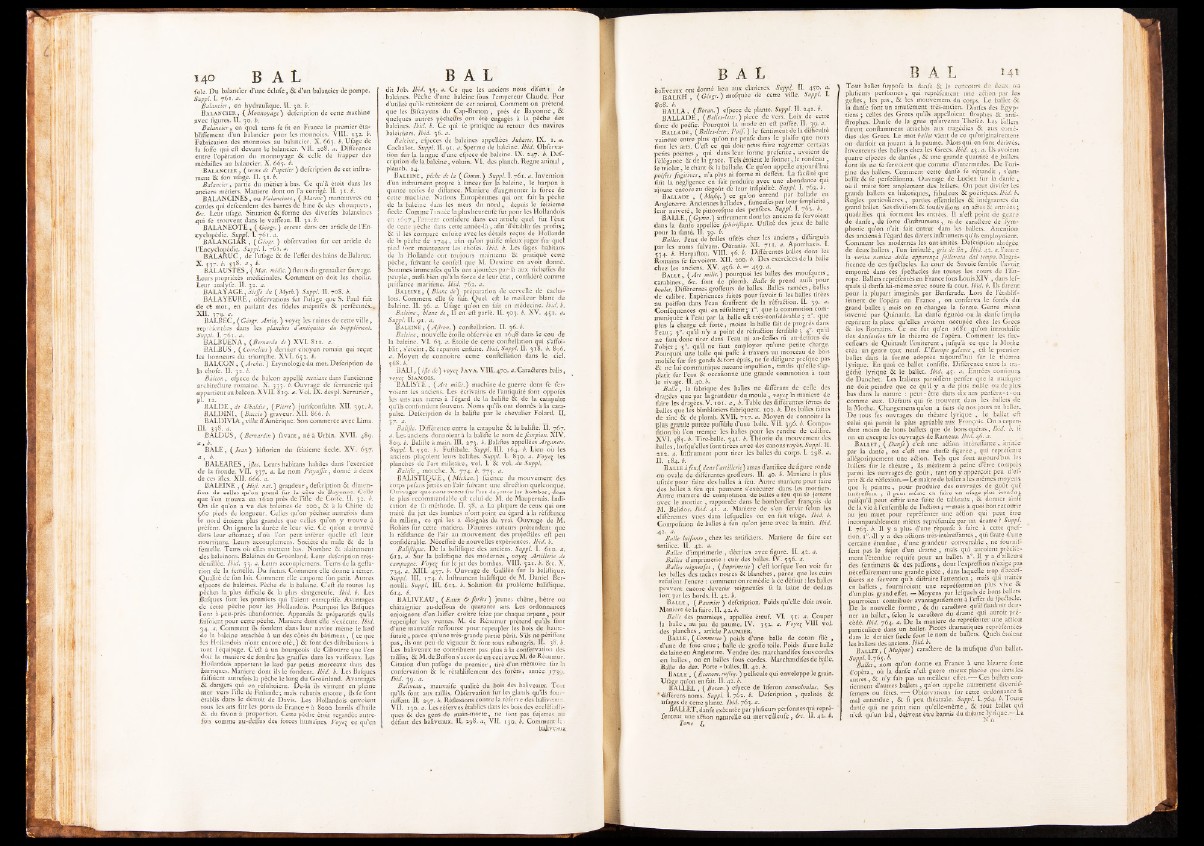
i4° B A L BAL
foie. D u balancier d’une èclufe., & d’un balancier de pompe.
Suppl. I. 761 . a.
Balancier t en hydraulique. IL 30. b.
BALANCIER, ( Monnayage) defcriprion de cette machine
.avec figures. II. 30. b.
Balancier, en quel tems fe fit en France le premier éta-
bliffement d’un balancier pour les monnoies. V I I I . 132. b.
Fabrication des monnoies.au balancier. X. 663. b. Ufage de
la foffe qui eft devant le balancier. VII . 208. a. Différence
entre l’opération du monnoyage & celle de frapper des
médailles au balancier. X. 663. b.
B a l a n c ie r , ( terme de Papetier ) defcription de cet infiniment
& fon ufage. II. 31. é.
Balancier, partie du métier à bas. C e qu’il étoit dans les
anciens métiers. Maniéré dont on l’a corrigé. II. 31 .b.
B A L A N C IN E S , ou Valancines, ( Marine) manoeuvres ou
cordes qui defcendent des barres de lune & des chouquets,
&c. Leur ufage. Situation & forme des diverfes balancines
q u i fe trouvent dans le vaiffeau. II. 31 .b.
B A L A N E O T E , ( Géogr. ) erreur dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. I. 761 . a.
B A L A N G IA K , ( Géogr. ) obfervation fur cet article de
l ’Encyclopédie. Suppl. I. 761 . a.
B A L A R U C , de l’ufage 8c de l’effet des bains de Balaruc.
X . 537. b. 538. a , b.
B A L A U S T E S , ( Mat. médic. ) fleurs du grenadier fauvage.
Leurs propriétés médicinales. Comment on doit les choifir.
Leur analyfe. II. 32. a.
. B A L A Y A G E , déejfe du ( Myth.) Suppl. II. 708. b.
B A L A Y E U R E , obfervations fur l’ufage que S. Paul fait
de e t m o t , en parlant des fideles méprifés & perfécutés^.
X II. 379.
B A L B E C , ( Géogr. Antiq. ) voye^ les ruines de cette v i l le ,
repréfentées dans les planches d’antiquités du Supplément.
Suppl. I. 761 . a.
B A L B U E N A , (Bemardo de) X V I . 8 11 . a.
BA LBUS , ( Cornélius ) dernier citoyen romain qui reçut
les honneurs du triomphe. X V I . 652. b.
B A L C O N , ( Archit. ) Étymologie du mot. Defcription de
la chofe. H. 3 2. b.
Balcon, efpece de balcon appellé meniane dans l’ancienne
architeélure romaine. X . 333. b. Ouvrage de ferruierie qui
appartient au balcon. X V I I . 819. a. V o l. IX. des pi. Serrurier,
pl. 12.
B A L D E , de Ubaldis, ( Pierre) jurifconfulte. XII. 391. b.
B A LD IN I , ( Bac cio) graveur. XII. 866.-b.
B A L D IV IÀ , v ille d’Amérique. Son commerce avec Lima.
LU. 238. a.
B A L D U S , ( Bernardin ) fav ant, né à Urbin. X V I I . 489.
'a , b.
B A L E , (J ea n ) hiftorien du feizieme fiecle. X V . 637:
a , b.
B A L E A R E S , ijles. Leurs habitans habiles dans l’exercice
de la fronde. V IL 337, a. Le nom Pityujftz, donné à deux
de ces ifles. XII. 666. a.
BALEINE , ( Hifl. nat. ) grandeur, defcription 8c dimen-
fion de celles qu’on prend fur la côte de Bayonne. Celle
que l’on trouva en 1620 près de l’ifle de Corfe. II. 32. b.
O n dit qu’on a v u des baleines de 200, 8c à la Chine de
960 pieds de longueur. Celles qu’on pêchoit autrefois dans
le nord étoient plus grandes que celles qu’on y trouve à
préfent. On ignore la durée de leur vie. C e qu’on a trouvé
dans leur eftomac; d’où l’on peut in férer quelle eft leur
nourriture. Leurs accouplemens. Société du mâle 8c de la
femelle. Tems où elles mettent bas. Nombre 8c alaitement
des baleinons. Baleines du Groenland. Leur defcription très-
détaillée. Ibid. 33. a. Leurs accouplemens. Tems de la.gefta-
-tion de la femelle. D u foetus. Comment elle donne à tetter.
Qualité de fon lait. Comment elle emporte fon petit. Autres
.efpeces de baleines. Pêche de la baleine. C ’eft de toutes les
pêches la plus difficile 8c la plus dangereufe. Ibid. b. Les
Bafques font les premiers qui l’aient entreprife. Avantages
de cette pêche pour les Hollandois. Pourquoi les Bafques
l ’ont à-peu-près abandonnée. Appareils 8c préparatifs qu’ils
faifoient pour cette pêche. Maniéré dont elle s’exécute. Ibid.
34. a. Comment ils fondent dans leur navire même le lard
de la haleine attachée à un des côtés du bâtiment, ( c e que
les Hollandois n’ont encore o f é ,) 8c font des diftributions à
tout l’équipage. C ’eft à un bourgeois de Cibourre que l’on
doit la maniéré de fondre les graiffes dans les vaiffeaux. Les
Hollandois apportent le lard par petits morceaux dans des
barriques. Maniéré dont ils le fondent. Ibid. b. Les Bafques
faifoient autrefois la pêche le long du Groenland. Avantages
& dangers qui en réfultoient. De-là ils vinrent en pleine
iner v ers l’iîle de Finlande; mais rebutés encore , ils le font
établis dans le détroit de Davis. Les Hollandois envoient
tous les ans fur les ports de France 7 à 8000 barrils d’huile
8c du favon à proportion. Cette pêche étoit regardée autrefois
comme au-deffus des forces humaines. Voye^ ce qu’en
dit Job. Ibid. 3 3. a. C e que les anciens nous difen t de
. baleines. Pêche d’une baleine fous l’empereur Claude. Peu
d’utilité qu’ils retiroient de cet animal. Comment on prétend
que les Bifcayens du Cap-Breton , près de B a y o n n e , 8c
quelques autres pêcheSVs ont été engagés à la pêche des
baleines. Ibid. b. C e qui fe pratique au retour des navires
baleiniers. Ibid. 36. a.
Baleine, efpeces de baleines appellées Jubarte. IX. 1. a.
Cachalot. Suppl. II. 9 1 . a. Sperme de baleine. Ibid. Obfervation
fur la langue d’une efpece de baleine. IX; 247. b. D e fcription
de la baleine, volum. V I . des planch. Régné animal,
planch. 24.
Baleine, pêche de la ( Cornrn. ) Suppl. 1. 761 . a. Invention
d’un inftrument propre à lancer fiir la baleine, le harpon à
quinze toifes de diftance. Maniéré d’augmenter la force de
cette machine. Nations Européennes qui ont fait la pêche
de la baleine dans les mers du n o rd , depuis le feizieme
fiecle. Comme l’année la plus heureufe fut pour les Hollandois
en 1 6 9 7 , l ’auteur confidere dans cet article quel fin l’état
de cette pêche dans cette année-là, afin "d’établir fes profits;
8c il les compare enfuite avec les détails reçus de Hollande
de la pêche de 1 7 4 4 , afin qu’on puiffe mieux juger fur quel
pied font maintenant les chofes. Ibid. b. Les fages habitans
de la Hollande ont toujours maintenu 8c pratiqué cette
pêche, fuivant le confeil que M. Dewitte en avoit donné.
Sommes immenfes qu’ils ont ajoutées par-là aux richeffes du
peuple, aufli bien qu’à la force de leur état, confidéré comme
puiffance maritime. Ibid. 762. a.
Baleine, (Blanc de) préparation de cervelle de cachalots.
Comment elle fe fait. Q u el eft le meilleur blanc de
baleine. II. 36. a. Ufage qu’on en fait en médecine. Ibid. b.
Baleine, blanc de. Il en eft parlé. H. 503. b. X V . 431. a,
Suppl. II. 91. a.
Baleine, ( Afiron. ) conftellation. H. 36. b.
Baleine, nouvelle étoile obfervée en 1648 dans le cou de
la baleine. V I . 63. a. Étoile de cette conftellation qui s’affoi-
b lit , s’éteint, 8c reparoît enfuite. Ibid. Suppl. II. 318. b. 896.
a. M oy en de connoître cette conftellation dans le ciel.
568. b.
B A L I , ( ijle de ) voye\' Ja v a . VIH. 470. a. Caraéleres balis,
voyez Siamois.
B À L IST E , ( Art milit.) machine de guerre dont fe fer-
voient les anciens. Les écrivains de l’antiquité font oppofés
les uns aux autres à l’égard de la balifte 8c de la catapulte
qu’ils confondent fouvent. Noms qu’ils ont donnés à la catapulte.
Defcription de la balifte par le chevalier Folard, II.
^Balifte. Différence entre la catapulte 8c la balifte. II. 767.
a. Les anciens donnoient à la balifte le nom de feorpion. X IV .
809, b. Balifte à main. III. 273. b. Bal.Iles appellées Arganete.
Suppl. I . 3 30. b. Fuftibale. Suppl. III. 164. b. Lieu où les
anciens plaçoient leurs baliftes. Suppl. I . 830. a. Voye\[ les
planches de l’art militaire, vol. I. 8c vo l. du Suppl.
Balijle , mouche. X. 774. b. 773 . a.
B A L IS T IQ U E , ( Méchan. ) fcience du mouvement des
corps pefans jettés en l’air fuivant une direction quelconque.
Ouvrages que nous avons fur l’art de jetter les bombes, donc,
le plus recommandable eft celui de M. de Maupertuis. Indication
de fa méthode. II. 38. a. La plupart de ceux qui ont
traité du jet des bombes n’ont point eu égard à la réfiftance
du milieu, ce qui les a éloignés du vrai. Ouvrage de M.
Robins fur cette matière. D ’autres auteurs prétendent que
la réfiftance de l’air au mouvement des projeéiiles eft peu
confidérable. Néceflité de nouvelles expériences. Ibid. b.
Balifiique. D e la baliftique des anciens. Suppl. I. 610. a.
6 1 1 . a. Sur la baliftique des modernes, voye[ Artillerie de
campagne. Voyeç fur le jet des bombes. VII I. 321. b. 8cc. X.
734. a. XIII. 437. b. Ouvrage de Galilée fur la baliftique.
Suppl. III. 174. b. Inftrument baliftique de M. Daniel Bernoulli.
Suppl. III. 612. b. Solution au problème baliftique.
614. b.
B A L IV E A U , ( Eaux & forêts ) jeunes chêne, hêtre ou
châtaignier au-deffous de quarante ans. Les ordonnances
enjoignent d’en laiffer croître feize par chaque arpent, pour
repeupler les ventes. M. de Réaumur prétend qu’ils font
d’une mauvaife reffource pour repeupler les bois de haute-
futaie , parce qu’une très-grande partie périt. S’ils ne périffent
pas, ils ont peu de vigueur 8c font tous rabougris. IL 3 8. b.
Les baliveaux ne contribuent pas plus à la confervation des
taillis; 8c M.deBuffon s’accorde en c e c ia v e cM .d e Réaumur.
Citation d’un paffage du premier, tiré d’un mémoire fur la
confervation 6c le rétahuffement des fo rê ts , année 1739.
Ibid. 39. a.
Baliveau, mauvaife qualité du bois des baliveaux. To rt
qu’ils font aux taillis. Obfervation fur les glands qu’ils four-
niffent. IL 297. b. Réflexions contre la réferve des baliveaux.
V IL 130. a. Les réferves établies dans les bois, des eccléfiafli-
ques 8c des gens de main-morte, ne font pas fujettes au
défaut des baliveaux. IL 298. 0. VII. 13.0. b. Comment le;
' baliYçau*
BAL
baliveaux ont donné lieu a i« c k r iç e s . s lp p i B H H 9
BA LKH , ( Géogr. ) mofquée de cette ville. Suppl. 1.
8° B A L L A , (Botan.) efpece de plante. Suppl. IL 241. b.
B A L L A D E , (Belles-lettr. ) piece de v er s ..Loix de cette
forte de poéfie. Pourquoi la mode en eft paffée. II. 39. a.
Ballade, ( Belles-lettr. Poéf. ) le fentiment de la difficulté
vaincue entre plus' qu’on ne penfe dans le plaifir que nous
font les arts. C ’eft ce qui doit-nous foire regretter certains
petits poëmes , qui dans leur forme preferite, avoient de
l’élégance 8c de la grâce. Te ls étoient le fonnet, le rondeau ,
le trio le t, le chant 8c lâ ballade. C e qu’on appelle aujourd’hui
poéfies fugitives, n’a plus ni forme m deffein. La facilité que
fuit la négligence en fait produire avec une abondance' qui
ajoute encore au dégoût de leur infipidité. Suppl. I. 762. b.
■ Ballade , ( Mufiq. ) ce qu’on entend par ballade en
Angleterre. Anciennes ballades, fomeufes par leur fitnplicité,
leur naïveté, lé pittorefque des penfées. Suppl. I. 762. b.
B A L L E , ( Gymn.) infiniment dont les anciens fe fe rm e n t
dans la danfe appellée fphériftique. Utilité des jeux de balle
pour la fanté. IL 39. b. - . , . . . ,
Balles. Jeux de balles ufités chez les anciens, diftmguês
par les noms fuîvans. Oùrania. XI. 7 1 1 . a. Aporrhaxis. I.
334. b. Harpafton. VIII. 36. b. Différentes balles dont les
Romains fe forvoiént. XII. 200. b. D es exercices de la balle
chez les anciens. X V . 43 6. b. — 459.
Balle, ( Art milit.) pourquoi les balles des moufquets,
carabines, &c. font de plomb. Balle fe prend aufli pour
boulet. Différentes groffeurs de balles. Balles ramées, balles
de calibre. Expériences foites pour favoir fi les balles tirées
au poiffon dans l’eau fouffrent de la réfraétion. II. 39, a.
Conféquences qui en réfultent;-1°. que la commotion communiquée
à l’eau par la balle eft tres-confidérable ; 2 . que
plus la charge eft fo r te , moins la balle fait de progrès dans
l ’eau; 30. qu’il n’y a point de réfraétion fenfible ; 40. qu’il
ne faut donc tirer dans l’eau ni aU-deffus ni au-deffous de
l ’objet ; 5°-. qu’il ne fout employer qu’une petite charge.
Pourquoi une balle qui paffe à travers un morceau de bois
mobile fur fes gonds 8cfort épais, ne fe défigure prefque pas
& ne lui communique aucune impulfion, tandis qu elle s ap-
platit fur l’eau 8c occafionnè une grande commotion à tout
le rivage. ÏI. 40. b. _
.Balle, la fabrique des balles ne différant de celle des
dragées que par la grandeur du moule', voye[ la maniéré de
foire les dragées. V . 101. a , b. T able des différentes fortes de
balles que les biroblotiers fabriquent. 102. b. D es balles faites
d e zinc 8c de plomb. X V II . 7 1 7 . <i. Moyen de connoître la
plus grande portée poflible d’une balle. VH. 396. b. Compofition
l ’on trempe les balles pour les rendre de calibre.
X V I . 383. £. Tire-balle. 341. b. Théorie du mouvement des
b a lle s , lorfqu’elles font tirées avec des canons rayés. Suppl. II.
-212. a. Inftrument pour tirer les balles du corps. I. 298. a.
II. 184. *. . . .
Balle àfeu,( dans l ’artillerie) amas d’artifice de figure ronde
o u ovale de différentes groffeurs. II. 40. b. Maniéré la plus
•ufitée pour foire des balles à feu. Autre maniéré pour faire
des balles à feu qui peuvent s’exécuter dans les mortiers.
Autre maniéré de compofition de balles à feu qui fe jettent
av e c le mortier , rapportée dans le bombardier françois de
M . Belidor. Ibid. 41. a. Maniéré de s’en fervir félon les
différentes vues dans lefquelles on en fait ufage. Ibid. b.
Compofition de balles à feu qu’on jette avec la main. Ibid.
,42, ,a.
Balle luifante, chez les artificiers. Maniéré de foire cet
•^artifice: II. 42. a.
Balles d’imprimerie , décrites avec figure. IL 42. a.
Balles d'imprimerie : cuir des balles. IV . 3-36. a.
Balles teigneufes , ( Imprimerie ) c’eft lorfque l’on vo it fur
les balles des taches noires 8c blanches, parce que les cuirs
refufent l’encre : comment on remédie à ce défont : les halles
peuvent encore devenir teigneufes fi la laine de dedans
fort par les bords. II. 42. b.
Balle , ( Paumier ) defcription. Poids qu’elle doit avoir.
Maniéré de la faire. II. 42 .b.
Balle des paumiers , appellée éteuf. V I . 31: a. Couper
la b alle , au jeu de paume. IV . 332. a. Voye[ V I I I vol.
des planches, article Paumier.
Balle , ( Commerce ) poids d’une balle de coton filé ,
• d’une de foie crue ; balle de groffe toile. Poids d’une balle
de laine en Angleterre. Vendre des marchandifes fous cordes,
en balles, ou en balles fous cordes. Marchandifes de balle.
Balle de dez. Porte - balles. ÏI. 42. b.
Balle , (Économ. rufiiq. ) pellicule qui enveloppe le grain.
Ufage qu’on en foit. II. 42. b. :
BALLEL , ( Botan. ) efpece de liferon convolvulus. Ses
•différens noms. Suppl. I. 762. b. Defcription , qualités 8c
«fages de cette plante. Ibid, 763. a.
BAL L E T , danfe exécutée par plufieurs perfonnes qui repré-
fentent une aftion naturelle ou mervcilleufç, frc. II. 42. b.
Tome I,
BAL 141
T o u t ballet fuppofe la danfô 8C le concours de deux ou
plufieurs perfonnes , qui. reprèfentent une aéiion par les
geftes, les pas, 8c les mouvémens du corps. L e ballet &
la danfe font un amufement très-ancien. Danfes des Eg yptiens
; celles des Grecs qu’ils appelloient ftroplies 8c anti-
ftrophes. Danfe de la grue qu’mventa Theféc. Les ballets
furent conftamment attachés aux tragédies 8c aux comédies
des Grecs. L e mot ballet v ient de ce qu’originairement
on danfoit en jouant à la paume. Mots qui en font dérivés»
Inventeurs des ballets chez les Grecs. Ibid. 43. a. Ils avoient
quatre efpeces de danfes , 8c une grande quantité de ballets
dont ils ne fe fervoient que comme d’intermedes. D e l’ori--
gine des ballets. Comment cetté danfe fe répandit , s’embellit
8c fe perfectionna. Ouvrage de Lucien fur la danfe ,
où il traite fort amplement des ballets. On peut divifer les.
grands ballets en hiftoriques, fabuleux 8c poétiques. b.
Réglés particulières , parties effentielles 8c intégrantes du
grand ballet. Ses divifions 8c foudivifions en aétes 8c entrées ;
quadrilles qui forment les entrées. Il n’eft point de genre
de danfe, de forte d’in f t rum e n sn i de caraétere de lymphome
qu’on n’ait fait entrer dans les ballets. Attention
des anciens à l’égard des divers inftrumens qu’ils employoient»
Comment- les modernes les ont imités. Defcription abrégée
de deux ballets , l’un intitulé, gris de lin, Ibid. 42. a. l’autre
la verita jicmica délia apparenta follevata dal tempo.-Magnificence
de ces fpefiacles. La cour de Savoie femble l’avoic
emporté dans ces fpeâacles fur toutes les cours de l’Europe.
Ballets représentés en France fous Louis X IV , dans lef-
quels il danfa lui-même avec toute fa cour. Ibid. b. Us furent
pour la plupart imaginés par Benferade. Lors de Pétablif-
fement de l’opéra en France , on conferva le fonds du
grand ballet ; mais on en changea la forme. Genre mixte:
inventé par Quinault. La danle figurée ou la danfe fimple
reprirent la place qu’elles avoient qccupée chez les Grecs
8c les Roihains. C e ne fut qu’en 1681 qu’on introduffic
des danfeufes ftfr le théâtre de l’opéra. Comment les fuc-
ceffeurs de Quinault l’imitèrent, jufqu’à ce que la Mothe
créa un genre tout neuf. L ’Europe galante, eft le premier
ballet dans la forme adoptée aujourd’hui fur le théâtre
lyrique. En quoi ce ballet confifte. Différence entre la tragédie
lyrique 8c le ballet. Ibid. 43. a. Entrées comiques,
de Danchet. Les Italiens paroiffent penfer que la mufique
ne doit peindre que ce qu’il y a de plus noble ou déplus
bas dans la nàture : p eu t-ê tre dans dix ans penfera-t-011
comme eux. Défauts qui fe trouvent dans les ballets de
la Mothe. Changemens qu’on a faits de nos jours au ballet.
D e tous les ouvrages du théâtre lyrique , le ballet eft
-celui qui paroît le plus agréable aux François. On a cependant
moins de bons ballets que de bons opéras, Ibid. b. lï
on eh excepte les ouvrages de Rameau. Ibid. 46. a.
Ballet, (D a n fe ) c’eft une aétion intéreffante ,.. imitée
par la danfe, ou c’eft une danfe figurée, qui repréfente
allégoriquement une aétion. Te ls que font aujourd’hui les
ballets fur le théâtre, ils méritent à peine d’être comptés,
parmi les ouvrages de g o û t , tant on y apperçoit peu d ’ef-
prit 8c de réflexion.— L e maître de ballet a les mêmes moyens
que le peintre, pour produire des ouvrages.dé goût quL
intéreffent , il peut même en faire un ufage plus etendu ;
puilqu’il peut offrir une fuite de tableaux, 8c donner ainft
de la v ie à l’enfemble de l’aétion ; — mais à quoi bon recourir
au jeu muet pour repréfenter une aétion qui peut être
incomparablement mieux repréfentée par un drame ? Suppl.
I. 763. b. Il y a plus d’une réponfe à foire à cette qnef-
tion. i° . .I l y a des aétions très-intéreffantes, qui faute d’une
certaine étendue, d’une grandeur convenable , ne fournif-
fent pas le fujet d’un drame , mais qui auroient. précifé-
ment l’étendue requife pour un ballet. 20. I l y a d’ailleurs
des fentimens 8c des paflions, dont l’expreflion n exige pas
néceflàirement une grande pie ce , dans laquelle trop d accefi-
foires ne fervent qu’à diftraire l’attention ; mais qui traites
en ballets , fourniroient une repréfentation plus v iv e 8c
d’un plus grand effet. — Moyens par lefquels de bons banets
pourroient contribuer avantageufement à l’effet du fpectacle.
D e la nouvelle forme , 8c au caraétere qu’il faudrou donner
au ballet, félon le caraétere du drame qui auroit précédé.
Ibid. 764. a. D e la manière de reprefenter une aétion
particulière dans un ballet. Pie«* dramaMues repréfentdes
Sans le dernier fiecle finis le nom de ballers. Q u els étoient
les ballets des anciens. IM - . . . I
Ballet, ( Mufique) caraétere de la mufique dun ballet.
^U^Ballct, nom qu’on donne en France à une bizarre forte
d’opéra, où la aanfe n’eft guère mieux placée que dans les
autres , 8c n’y fait pas un meilleur effet.— Ce s ballets contiennent
d’autres ballets, qu’on appelle autrement divertif-
femens ou fêtes. -— Obfervations fur cette ordonnance fi
mal entendue , 8c fi peu théâtrale. Suppl. I. 764. b. To ute
danfe qui ne peint rien qu’elle-même, 8c tout ballet qui
n’eft qu’un b a l, doivent être banni* du théâtre lyrique.— La
I
mm