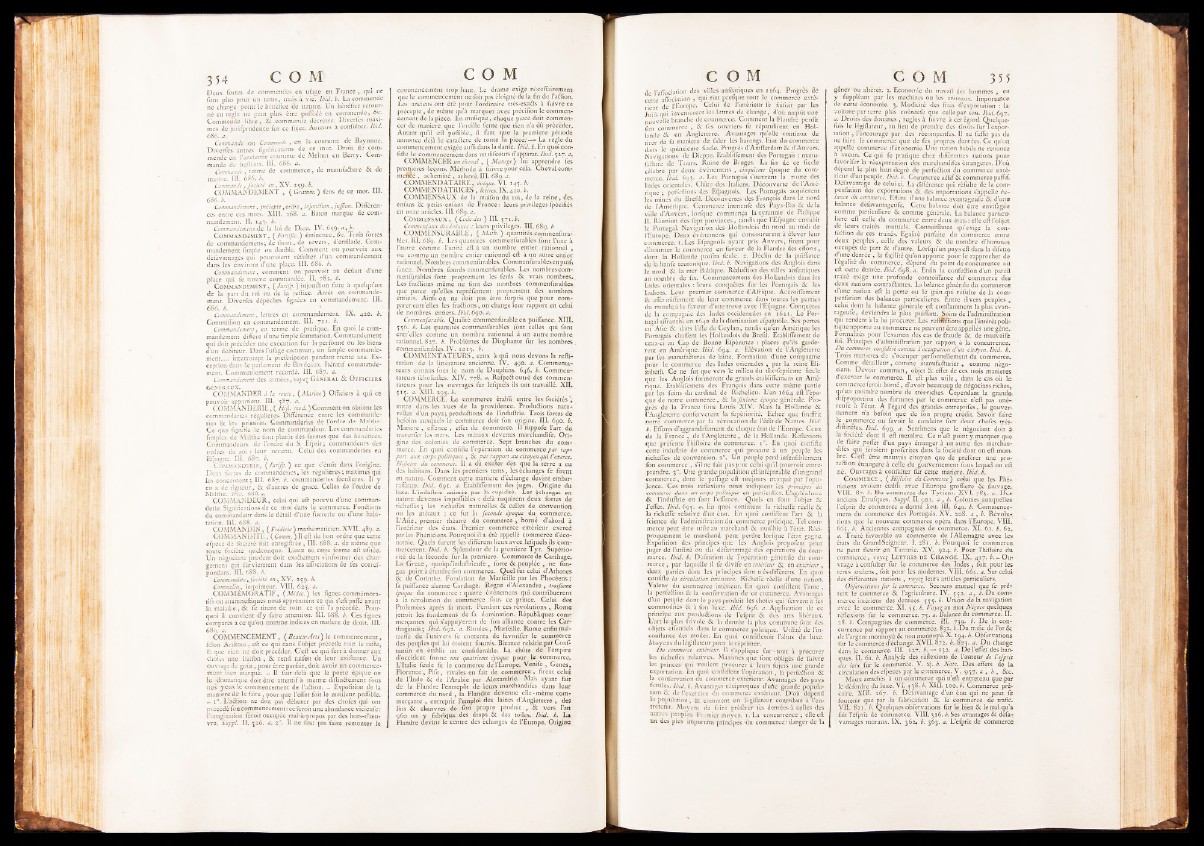
Deux fortes de commendes en ufage en France , qui ne
font plus pour un teins, mais à Vie. Ibid. b. La commende
ne change point le bénéfice de nature. Un bénéfice retourné
en réglé ne peut plus, être pofféclé en commende, 6,c.
Commende libre , & connnende décrétée. Diverfes maximes
de jurisprudence fur ce fujet. Auteurs à confulter. Ibid.
686. a. I _
Commande ou Commende 1 en la coutume de Bayonne.
D iv erfes autres Significations de ce mot. Droit de commende
en l’ancienne coutume de Mehun en Berry. Commande
de beftiaux. III. 686. a. *
Commande, terme de commerce, de manufacture oc de
marine. III. 686. b.
Commande, fociété en, X V . 259. b.
COM M AN D EM EN T , ( Gramrn. ) fens de ce mot. III,.
686. b. . . . . .
Commandement, précepte, ordre, injonElion, jujfion. Différences
entre ces mots. XIII. 268. a. Bâton marque de commandement.
II. 143. b.
Commandernens de la loi de Dieu. IV . 639. a , b.
C om m an d em en t , ( Fortifie. ) éminence, &c. Trois fortes
de commandemensj de front, de rev e r s, d’enfilade. Commandement
fimple ou double. Comment on pourvoit aux
défavantages qui poui'roient réfulter d’un commandement
dans les environs d’une place. III. 686. b.
Commandement t comment on pourvoit au défaut d’une
place qui fe trouve commandée. IL 782. b.
C ommandement , ( Jurifp. ) injonction faite à quelqu’un,
de la part du roi ou de la juftice. Arrêt en commandement.
Diverfes dépêches fignées en commandement. III.
686. b. 4
Commandement, lettres en commandement. IX. 420. b.
Commifîion en commandement. III. 7 1 1 . b.
Commandement, en terme de pratique. En quoi le com - .
mandement différé d’une fimple Sommation, Commandement
qui doit précéder une exécution fur la perfonne ou les biens
d’un débiteur. Dans l’ufage commun, un fimple commandement.....
interrompt la prefeription pendant trente, ans. Ex -
ception dans, le parlement de Bordeaux. Itératif commandement,
Commandement recordé. III. 687. a.
Commandement des armées, voye[ GÉNÉRAL Sc OFFICIERS
GÉNÉRAUX.
COM M AN D ER à la route, ( Marine ) Officiers à qui ce
pouvoir appartient. III. 587. a.
C OM M A N D üR IE , ( Hifi. mod. ) Comment on obtient les
commanderies régulières. Différence entre les commande-
ries & les prieurés. Commanderies de l’ordre de Malthe.
C e que Signifie le nom de commandeur. Les commanderies
Simples de Malthe font plutôt des fermes que des bénéfices.
Commandeurs de l’ordre du S. Efprit; commandeurs des
ordres du roi : leur revenu. Celui des -commanderies en
Efpagne. III. 687. b. . , . .
Commanderie, ( Jurifp. ) ce que c’étoit dans l’origine.
Deux fortes de commanderies, les régulières ; maximes qui
les concernent; III. 687. b. commanderies féculieres. Il y
en a de rigueur, & d’autres de grâce. Celles de l’ordre de
Malthe. Ibid. 688. a.
COM M AN D EU R , celui qui eft pourvu d’une commanderie.
Significations de ce mot dans le commerce. Fondions
du commandeur dans le détail d’une fucrerie ou d’une habitation.
III. 688. a.
C O M M A N D IN , ( Frédéric ) mathématicien. X V I I . 489. a.
C O M M A N D IT E , ( Comm. ; Il eft du bon ordre que cette
efpece de fociété foit enregiftrée, III. 688. a. de même que
toute fociété quelconque. Lieux où cette forme eft ufitée.
U n négociant prudent doit exaélement s’informer des change
mens qui furviennent dans les affociations de fes corref-
pondans. III. 688. b.
Commandite r fociété en , X V . 239. b.
Commelin, imprimeur. VII I. 625. a.
CO M M ÉM O R A T IF , ( Médec. ) les lignes commémora-'
tifs ou anamneffiques nous apprennent ce qui s’eft paffé avant
la maladie, 8c fe tirent de tout çe qui l’a précédé. Pourquoi
il convient d’y faire attention. III. 688. b. Ces fignes
comparés à ce qu’on nomme indices en matière de droit. III.-
689. ai
COM M E N C EM EN T , ( Beaux-Arts) le commencement,
félon Ariftote, eft ce qui dans l’objet précédé tout, le refte,
& que rien ne doit précéder. C ’eft ce qui fert à donner aux
chofes une liaifon , & rend raifen de leur exiftence. Un
ouvrage de goût , pour être parfait, doit avoir un commencement
bien marqué. - Il fuit delà que le poëte épique ou
le dramatique doit être attentif à mettre diftinéfement fous
nos y e u x le commencement de l ’aâion. - Expofition de la
maniéré dë le faire , pour que l’effet foit le meilleur poflïble.
- i° . L ’aâ ion ne doit pas débuter par des chofes qui ont
précédé fon commencement : ceferoit une abondance vicieufe :
l’imagination féroit occupée mal-à-propos par des hors-d’oeu-
v re. Suppl. II. £26. a. 2°. Il ne faut pas faire remonter le
commencement trop haut. Le drame exige ncceffairement-
que le commencement 11e foit pas éloigné de la fin de l’aétion.
Les anciens ont été pour l’ordinaire très-exaéls à fuivre ce
précepte, de même qu’à marquer avec précifion le commencement
de la p iece. En mufique, chaque piece doit commencer
de maniéré que l’oreille fente que rien n’a dû précéder.
Autant qu’il eft poffible, il faut que la première période
annonce déjà le caraélere de toute la piece;—- La réglé du
commencement exigée auffi dans la danfe. Ibid. b. En quoi con-
fifte le commencement dans un difcôurs d’apparat.Ibid. 527. <z,
COM M EN CE R un cheval, ( Manege ) lui apprendre fes
premières leçons. Méthode à fuivre pour cela. Cheval com-*
meficé , acheminé , achevé. III. 689. a.
CO M M E N D A T A IR E , évêque. V I . 145. bi
COM M EN D AT R IC E S , lettres. IX. 420. b.
COM M EN SAU X de la maifon du ro i, de la reine, des
enfans 6c petits-enfans de France : leurs privilèges fpécifiés
en onze articles. III. 689. a.
COMMENSAUX , ( Code des ) III. 371. b.
Commenfaux des évêques : leurs privilèges. III. 689. b
COM M EN SU R A B L E , ( Math. ) quantités commenfurables'.
III. 689. b. Les quantités commenfurables font l’une à
l’autre comme l’unité eft à un nombre entier rationnel ,
ou comme un nombre entier rationnel eft à un autre entier
rationnel. N ombres commenfurables. Commenfurables en puift
fance. Nombres fourds commenfurables. Les nombres çom-
menfurables font proprement les feuls 8c vrais nombres.
Les fractions même ne font des nombres commenfurables
que parce qu’elles repréfentent proprement des nombres,
entiers. Ainfi on ne doit pas être furpris que pour comparer
entr’elles les fraétions, on change leur rapport en celui
de nombres entiers. Ibid. 690. a.
Commenfurable. Qualité commenfurable en puiffance. XIII.
356. b. Les quantités commenfurables font celles qui/ont
entr’elles comme un nombre rationnel à un autre nombre,
rationnel. 827. b. Problèmes de Diophante fur les nombres
commenfurables.IV. 1013. b.
COM M E N T A T E U R S , ceux à qui nous devons la refti-
tution de la littérature ancienne. IV . 490. a. Commenta-*
teurs connus fous le nom de Dauphins. 646. b. Commentateurs
feholiaftes. X IV . 778. a. Refpeél outré des commentateurs
pour les ouvrages fur lefquels Us ont travaUlé. XII.
513. a. XIII. 295. b.
COMMERCE. L e commerce établi entre les fociétés V
entre dans les vues de la providence. Produirions naturelles
d’un pays; produirions de l’induftrie. Trois fortes de
befoins auxquels le commerce doit fon origine. III. 690. b.
Matière , effence , effet du commerce. I l fuppofe l’art de
traverfer les mers. Les métaux devenus marchandife. O rigine
des colonies de commerce. Sept branches du commerce.
En quoi confifte l’opération du commerce par rap-,
port aux corps politiques , 8c par rapport au citoyen qui l ’exerce,
Hifioire du commerce. Il a dû exifter dès que la terre a eu
des habitans. Dans les premiers tems, les échanges fe firent
en nature. Comment cetre maniéré d’échange devint embar-
raffante. Ibid. 691. a. Etabliffement des juges. Origine du
luxe. L ’induftrie animée par la cupidité. Les échanges en
nature devenus impoftibles •: delà naquirent deux fortes de
richeffes ; les richeffes naturelles 8c celles de convention
ou les métaux : ce fu t la fécondé époque du commerce.
L ’A fie , premier théâtre du commerce , borné d’abord à
l’intérieur des états. Premier commerce extérieur exercé
par les Phéniciens. Pourquoi il a été appellé commerce d/’éco-
nomie. Quels furent les différens lieux avec lefouels ils commercèrent.
Ibid. b. Splendeur de la première T y r . Supériorité
de la fécondé fur la première. Commerce de Carthage,
La, G r e c e , quoiqu’induftrieufe , forte 8c peuplée , ne fon-
gea point à.étendre fon commerce.. Q u e l fiit celui d’Athenes
8c de Corinthe. Fondation de Marfeille par les. Phocéens ;
fa puiffance alarme Carthage. Régné d’Alexandre , troifieme
époque du commerce : quatre évenemens qui contribuèrent
à la révolution du commerce fous ce prince. Ce lu i des
Ptoleinées après fa mort. Pendant ces révolutions , Rome
jettoit les fondemens de fa domination. Républiques commerçantes
qui s’appuyèrent de fon alliance contre les Car*
rhaginois ; Ibid. 692. a. Rhodes , Marfeille. Rome enfin maî-
treffe de l’univers fe contenta de favorifer le commerce
des peuples qui lui étoient fournis. Bizance rebâtie par Conf-
tantin en établit un confidérable. La chûte de l’empire
d’occident forme une quatrième époque pour le commerce.
L’Italie feule fit le commerce de l’Europe. Venife , Genes,
F lorence, P ife , rivales en fait de commerce , firent celui
de l’Inde & de l’Arabie par Alexandrie. Mais avant fait
de la Flandre l’entrepôt de leurs marchandifes dans leur
commerce du nord , la Flandre devenue elle - même commerçante
, entreprit l ’emploi des laines d’Angleterre , des
lins & chanvres de fon propre produit , 8c vers l’an
960 on y fabriqua, des draps. 8c , des toiles. Ibid,, b. La
Flandre devint le centre des échanges de l’Europe. Origine
de r’affodatiôn des villes anféatiques en 1164. Progrès dè
cette affociarion , qui tint prefque tout le commerce extérieur
de l'Europe. Celui de l’intérieur fe faifoit par les
Juifs qui inventèrent les lettres de change, d’où naquit une
nouvelle branche de commerce. Comment la Flandre perdit
fon commerce , 8c fes ouvriers fe répandirent en Hollande
8c en Angleterre. Avantages qu’elle continua de
tirer de fa maniéré de faler les harengs. Etat du commerce
dans le quinzième fiecle. Progrès d’Amfterdam 8c d’Anvers.
Navigations de Dieppe. Etabliffement des Portugais : manufacture
de Tours. Ruine de Bruges. La fin de ce fiecle
célébré par deux événemens , cinquième époque du commerce.
Ibid. 693. a. Les Portugais s’ouvrent la route des -
Indes orientales. Chûte des Italiens. Découverte de l’Amérique
; polfeffions des Efpagnols. Les Portugais acquièrent
les mines du Brefil. Découvertes des François dans le nord
de l’Amérique. Commerce immenfe des Pays-Bas 8c de la
ville d’A n v e r s , lorfque commença la tyrannie de Philippe
II. Réunion desfept provinces, tandis que l’Efpagne envahit
le Portugal. Navigation des Hollandois du nord au midi de
l ’Europe. Deux événemens qui concoururent à élever leur
commerce. i.L e s Efpagnols ayant pris A nv ers , firent pour
détourner le commerce en faveur de la Flandre des efforts,
dont la Hollande profita feule. 2. Déclin de la puiffance
de la hanfe teutonique. Ibid. b. Navigations des Anglois dans
le nord '8c la mer Baltique. Réduétion des v illes anféatiques
au nombre de fix. Commencemens des Hollandois dans les
Lides orientales : leurs conquêtes fur les Portugais 8c les
Indiens. Leur premier commerce d’Afrique. Àccroiffement
8c affermiffement de leur commerce dans foutes les parties
du monde.à la faveur d’une treve avec l’Efpagne; Conquêtes
de la compagnie des Indes occidentales en 1621. Le Portugal
affranchi en 1640 de la domination efpagnôle. Ses pertes
en Afie 8c dans l’ifle de C e y la n , tandis qu’en Amérique les
Portugais chaffent les Hollandois du Brefil. Etabliffement de
ceux-ci au Cap de Bonne Efpérance : places qu’ils gardèrent
en Amérique. Ibid. 694. a. Elévation de l’Angleterre
par fes manufactures de laine. Formation d’une compagnie
pour le commerce des Indes orientales , par la reine Elizabeth.
C e ne fut que vers le milieu du dix-feptienje fiecle
que les Anglois formèrent de grands établiffemens en Amérique.
Etabliffemens des François dans cette même partie
par les foins du, cardinal de Richelieu. L ’an 1664 .eft l’époque
de notre commerce, 8c la fixieme époque générale. Progrès
de la France fous Louis X IV . Mais la Hollande 8c
l ’Angleterre conferverent 'la fupériorité. Echec que fouffrit
notre commerce par la révocation de l’édit de Nantes. Ibid,
b. Efforts d’aggrandiffement de chaque état de l’Europe. Ceux
de la France , de l’Ang leterre, de la Hollande. Réflexions
que préfente l’hiftoire du commerce. x°. En quoi éonfifte
cette induftrie de commerce qui procure à un peuple les
richeffes de convention. 20. Un peuple perd infenfiblement
fon commerce , s’il ne fait pas tout celui qu’il pourroit entreprendre.
30. Une grande population eft inféparable d’un grand
commerce, dont le paffage eft toujours marqué par l’opulence.
‘Ces trois réflexions nous indiquent les principes dû
commerce dans un corps politique en particulier. L’agriculture
& l’induftrie en font l’effencè. Quels en font l’objet 8c
l ’effet. Ibid. 695. a. En quoi confident la riclieffe réelle 8c
la richeffe relative d’un état; En quoi confiftënt l’art 8c la
fcience de l’adminiftration du commerce politique. T e l commerce
peut être utile au marchand 8c nuifible à l’état. Réciproquement
le marchand peut perdre lorfque l’état gagne.
Expofition des principes que les Anglois propofent pour
juger de l’utilité ou du défavantage des opérations du commerce.
Ibid. b. Définition de l’opération générale du commerce
, par laquelle il fe divife en intérieur 8c en extérieur,
deux parties dont les principes font très-dift'érens. En quoi
confifte la circulation intérieure. Richeflë réelle d’une nation.
Valeur du commerce intérieur; En quoi confiftënt famé ,
la perfeftion 8c la confèrvation de ce commerce. Avantages
d’un peuple dont le pays produit les chofes qui fervent à feS
commodités 8c à fon luxe. Ibid. 696. a. Application de ce
principe aux produirions de l’efprit 8c des arts libéraux.
L ’art le plus frivole 6c la denrée la plus commune font des,
objets effentiels dans le commerce politique. Utilité de l’in-
conftance des modes. En quoi confifteroit l’abus du luxe.
Moyens'du légiflateur pour le réprimer.
Du commerce extérieur. Il s’applique fu r -to u t à procurer
les richeffes relatives. Maximes que font obligés de fuivre
les princes qui veulent procurer à leurs fujets une grande
exportation. En quoi confiftënt l’opération | la perfection 8c
la confèrvation du commerce extérieur. Avantages des pays
fertiles. Ibid. b. Avantages- réciproques d’ufie grande population
8c de l’exercice du commerce extérieur. D ’o.ù ' dépend
la population , 8c comment un légiflateur contribué à l’entretenir.
Moyens de faire préférer fes denrées à celles des
autres peuples. Premier moyen. i . La concurrence'; elle eft
un des plus importans-principes -du' commerce.: danger de ‘la J
gènër Ou altérer. '2. Economie du travail des hommes , en
y fuppléant par les machines ou les animaux. Importance
de cette économie. 3. Modicité des frais d’exportation : la-
voiture par terre plus coûteufc que celle par eau. Ibid. 6qj.
a. Droits des douanes , réglés à fuivre à cet égard. Quelque*
fois le légiflateur, au lieu de prendre des droits fur l’exportation
, l’encourage par des récompenfes. Il ne fuffit pas de
ne faire le commerce" que de fes propres denrées. C e qu’on
appelle commerce d’économie. U ne nation habile ne renonce
a aucun. C e qui fe pratique chez différentes nations pour
favorifer la réexportation des marchandifes étrangères. D ’où
dépend le plus haut degré de perfection du commerce extérieur
d’un peuple. Ibid. b. Commerce aétif 8c commerce paflif.
Défavantage de celui-ci. La différence qui réfulte de la com*
penfation des exportations 8c des importations s’appelle balance
du commerce. Effets d’une balance avantageufe 8c d’une
balance défavantageufe. Cette balance doit être envifagée
comme particulière 8c comme générale. La balance particu*
liere eft celle du commerce entre deux états : elle e u l’objet
de leurs traités mutuels. Connoiffance qu’exige la confection
de ces traités. Egalité parfaite du commerce entre
deux peuples , celle dès valeurs 8c du nombre d’hommes
occupes de part 8c d’autre. Lôrfqu’un pays eft dans la difette
d’une denrée , la facilité qu’on apporte pour le rapprocher de
l’égalité du commerce, dépend du point de concurrence où
eft cette denrée. Ibid. 698. a. Enfin la confection d’un pareil
traité exige une profonde connoiffance d if commerce des
deux nations contractantes. La balance générale du commerce,
d’une nation eft la perte ou le "gain .qui réfulte de la com-
penfotion des balances particulières. Entre divers peuples ,
celui dont la balance générale eft conftamment laplusavan--
tageufe, deviendra le plus puiffant. Soins de l’adminiftration
qui tendent à la lui procurer. L es reftffiftions que l ’intérêt politique
apporte au commerce ne peuvent être appellés une gêne.
Formalités pour l’eXamen des cas de fraude & de mauvaife
foi. Principes d’adminiftration par rapport à la concurrence;
Du commerce confédéré comme l ’occupation d’un citoyen. Ibid, b.
Trois maniérés de s’occuper perfonnellement du commerce.
Comme détailleur, comme- manufacturier , comme négociant.
De voir commun, objet Sc effet de ces trois maniérés
d’exercer le commerce. Il eft plus u t ile , dans le cas où le
commerce feroit borné, d’avoir beaucoup de négocians riches^
qu’un moindre nombre de très-riches. Cependant la grande,
difproporrion des fortunes par le commerce n’eft pas oné-
reufe à l’état. A l’égard des grandes entreprifes, le' gouver*
nement n’a befoin que de fon propre crédit. Savoir foire
le commerce ou favoir le conduire font deux chofes très-
diftinCtes. Ibid. 699. a. Sentimens que le négociant doit à
la fociété dont il eft membre. C e n’eft point y manquer que,
de foire paffer d’un pays étranger à un autre des marchan-,
difes qui feroient proferites dans la fociété dont on eft membre.
C ’eft être mauvais citoyen que de préférer une pro-
teétion étrangère à celle du gouvernement fous lequel on eft
né. Ouvrages à confulter für cette matière. Ibid..b.
Commerce, ( Hifioire du Commerce} celui que les Phé-,
niciens avoient établi avec l ’Europe grofliere 8c fauvage.
VIII. 87. b. ©u commerce des Tyriens. X V I . 783. a. Des
anciens Etrufques. Suppl. II. 901. a , b. Colonies auxquelles
l’efprit de commerce a donné lieu. III. 649. b. Commencemens
du commerce des Portugais. X V . 208. a , b. Révolu-;
tions. que le nouveau commerce opéra dans' l’Europe. V I I I .
661. b. Anciennes compagnies de commerce. XI. 61. b. 62,
a. Traité favorable au commerce de l’Allemagne avec les
états du Grand-Seigncür. I. 281. b. Pourquoi le commerce
ne peut fleurir en Tartarie. X V . 924.. b. Pour l’hiftoire du
commerce, voye[ Lettres de Changé. IX. 417. b. - Ouvrage
à confulter fur l,e commerce des Indes , foit pour les
tems anciens, foit pour les îii.odernes. VIÏ Ï. 661. a. Sur celui
des différentes nations , voye^ leurs articles particuliers.
Obfervations fur le commerce. Secours mutuel que fe prêtent
le commerce 8c l’agriculture. IV . 352. a , b. D u com-î
merce intérieur des denrées. 533'. b. Union de la navigation
avec le commerce. XI. 35. b. Voyez.au mot Négoce quelques
réflexions fur le commerce. 73. Balance du commerce. IL
28. b. Compagnies de commerce. • IÎI. 739. b. D e la concurrence
par rapport au commerce; 832; b. D u trafic de l’or &
de l’argent monnoyé 8c non monnoyé. X. 194. b. Obfervations
fur le commerce d’échange. XVII . 872. b,.873. a. D u change
dans le commerce. III. 127* b- ~~ I32- a- D e l’effet des banques.
II. 61. b. Analyfe des réflexions de l’auteur de l ’efprit
des loix fur le commerce. V . xj. b. Note. D es -effets de la
circulation des efpeces par le commerce. V . 937. a , b , 8cc.
Maux attachés à un commerce qui n’eft entretenu que par
Ic défordre du luxe. V I . 338. b. XIII. 100. bl Commerce précaire.
XIII. 267. b. Défavantage d’un état qui ne peut fe
foutenir que par .la fabrication ,8c le cqqunerce de trafic.
VII. 821'. b. Quelques obfervations fur le bien 8c le mal qu’a
fait l ’efp'rît de commerce. VII I. 3 16. é. Ses avantages 8c défavantages
moraux. IX . 362* b. 363. a. L’efprit de commerce