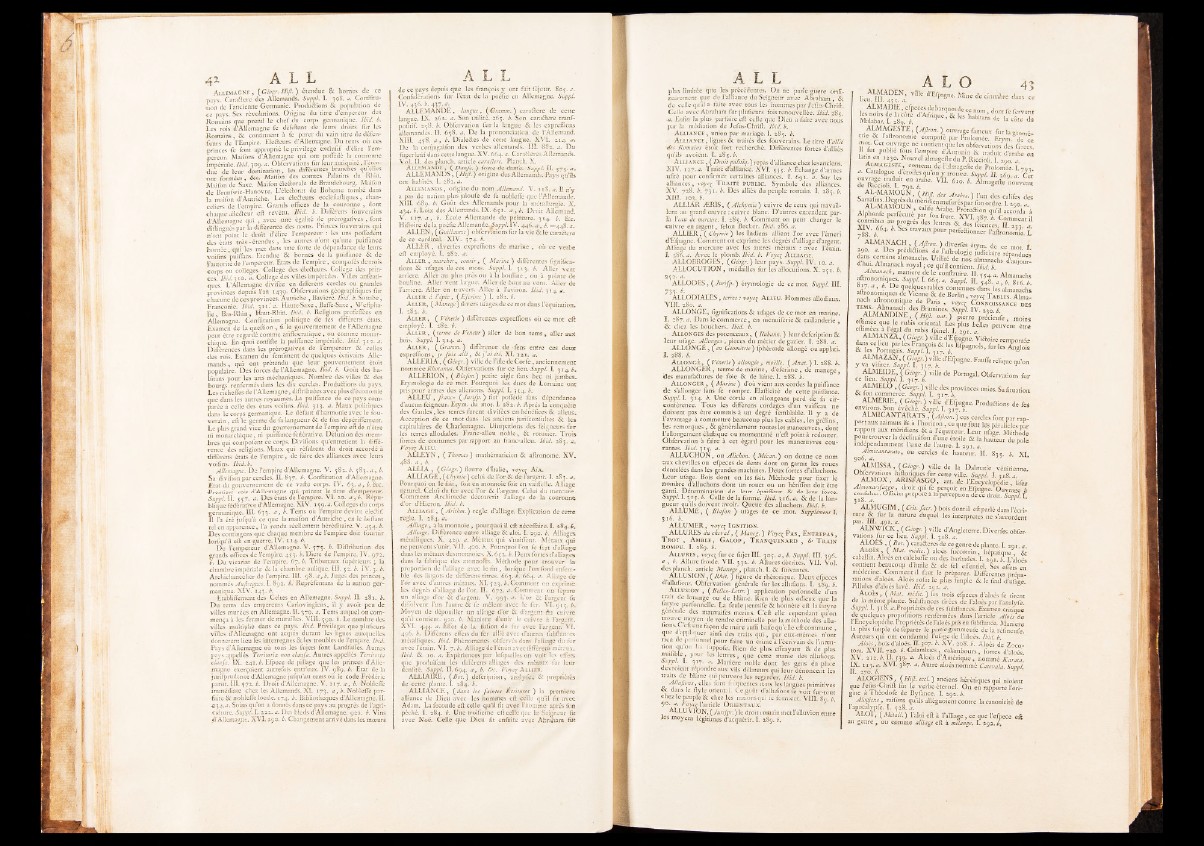
42 A L L
A llemagne, ( Gcogr.-Hifi. ) étendue & bornes de ce
•pays. Caraélere des Allemands. Suppl. I. 308. a. Conftitu-
tion de l’ancienne Germanie. Productions 8c population de
ce pays. Ses révolutions. Origine du titre d’empereur des
Romains que prend le ch e f du corps gerinamque. Ibid. b.
•Les rois d’Allemagne fe débitent de leurs droits fur les
Romains, & continuent à fe parer du vain titre de défendeurs
de l’Empire. Eleéteurs d’Allemagne. D u teins où ces
princes fe font approprié le privilège exclufif d’élire l’empereur.
Maifons d’Allemagne qui ont poffédé la couronne
impériale. Ibid. 300. a. Obfervations fur leur antiquité, l ’étendue
de leur domination, les différentes branches cp» 'elles
ont formées 8cc. Maifon des comtes Palatins du Kmn.
Maifon de Saxe. Maifon éleélorale de Brandebourg. Maifon
de Brunfwic-Hanovre. L’éleélorat de Boheme tombé dans
la maifon d’Autriche. Les éleéteurs eccléfiaftiques, chanceliers
de l’empire. Grands offices de la couronne , dont
chaque .éleaeur eft révêtu. Ibid., b. Différens fouverains
d’Allemagne qui , avec une égalité de prérogatives , font
diftineuésparla différence des noms. Princes fouverains qui
n’ont point le droit d’élire l’empereur : les uns poffedent
des états très-étendus , les autres n’ont qu’une puiffance
b ornée, qui les met dans une forte de dépendance de leurs
voifins puiffans. Etendue & bornes de la puiffance & .d e
l ’autorité de l’empereur. Etats de l’empire, compofés de trois
corps ou colleges. College des éleaeurs. College des princes.
Ibid. 310. a. College des villes impériales. Villes anféati-
ques. L’Allemagne divifée en différens cercles ou grandes
provinces depuis l’an 1430. Obfervations géographiques fur
chacune de ces provinces. Autriche , Bavière. Ibid. b. Souabe,
Franconie. Ibid, 311.' a. Haute-Saxe, Rafle-Saxe, Weftpha-
l ie , Bas-Rhin, Haut-Rhin. Ibid. b. Religions profeffées en
Allemagne. Conftitution politique de les différens états.
Examen de la queftion , fi le gouvernement de l’Allemagne
peut être regardé comme ariftocratique, ou comme monarchique.
En quoi confifte la puiffance impériale. Ibid. 312. a.
Différences dans les prérogatives de l’empereur & celles
des rois. Examen du fentiment de quelques écrivains Allemands
, qui ont prétendu que leur gouvernement étoit
populaire. Des forces de l’Allemagne. Ibid. b. Goût des ha-
bitans pour les arts méchaniques. Nombre des v illes & des
bourgs renfermés dans les dix cercles. Productions du pays.
Les richeffes de l’A llemagne, diftribuées a vec plus d’économie
que dans les autres royaumes. La puiffance de ce pays comparée
à celle des états voifins. Ibid. 313. a. Maux politiques
dans le corps germanique. L e défaut d’harmonie avec le fou-
v e r a in , efl le germe de fa langueur & de fon dépériffement.
L e plus grand v ice du gouvernement de l’empire eft de n’être
ni monarchique, ni puiffance fédérative. Défunion des membres
qui compofent ce corps. Divifions qu’entretient la différence
des religions. Maux qui réfultent du droit accordé à
différens états de l’empire , de faire des alliances avec leurs
voifins. Ibid. b.
Allemagne. D e l’empire d’Allemagne. V . 382. b. 383. a , b.
Sa divifion par cercles. H. 837. b. Conffitution d’Allemagne.
Etat du gouvernement de ce vafie corps. IV . 63. a , b. 8cc.
Premiers rois d’Allemagne qui prirent le titre d’empereur.
Suppl. II. 337. a. Des états de l’empire. V I . ao. a , b. République
fédérative d’Allemagne. X IV . 139. a. Colleges du corps
germanique. III. 633. a , b. Tems où l’empire devint éleétif.
I l l’a été jufqu’à ce que la maifon d’Autriche , en le laiffant
te l en apparence, T a rendu réellement héréditaire. V . 454. b.
D e s contingens que chaque membre de l’empire doit fournir
iorfqu’il eft en guerre. IV . 114. b.
D e l’empereur d’Allemagne. V . 373. b. Diftribution des
grands offices de l’empire. 433. b. Diete de l’empire. IV . 972.
b. Du vicariat de l’empire. 67. b. Tribunaux fupérieurs ; la
chambre impériale & l a chambre aulique. III. 32. b. IV . 3. b.
Archichancelier de l’empire. III. 98. a , b. Juges des princes ,
nommés Auûregucs. I. 892. b) Repréfentans de la nation germanique.
X IV . 143. b.
Etabliffement des Celtes en Allemagne. Suppl. II. 281. b.
D u tems des empereurs Carlovingiens, il y avoit peu de
villes murées en Allemagne. II. 370. a. Tems auquel on commença
à les fermer de murailles. V II I. 390. b. Le nombre des
villes multiplié dans ce pays. Ibid. Privilèges que plufieurs
v illes d’Allemagne ont acquis durant les ligues auxquelles
donnèrent lieu les interrègnes 8c les troubles de l’empire. Ibid.
Pays d’Allemagne où tous les fujets font Landfaffes. Autres
pays appellés Territoria non claufa. Autres appèllés Terrîtoria
claufa. IX. 241. b. Efpece de pillage que les princes d’A lle magne
exerçoient autrefois entr’eux. IV . 989. b. Etat de la
jurifprudence d’Allemagne jufqu’au tems où le code Frédéric
parut. III. 372. b. Droit d’Allemagne. V . 117. a , b. Nobleffe
immédiate Chez les Allemands. X l. 173. a , b. Nobleffe par-
• • faite & nobleffe locale. 174. b. Bibliothèques d’Allemagne. IL
* 3 4 .a. Soins qu’on a donnés dans ce pays au progrès de l’agri-
euhure. Suppl. I. 222. a. D es bleds d’Allemagne. 921. b. vins
«d’Allemagne. X V I . 290. b. Changement arrivé dans les moeurs
A L L
de ce pays depuis que les françois y ont fait féjeur. 803. a.
Confidérations fur l’état de la poéfie en Allemagne. SuppL
IV . 436. b. 437. a-
AL LEM AN D E , langue, ( Gramm. ) caraélere de cette
langue. IX. 262. a. Son utilité. 263. b. Son caraélere tranf-
pofitif. 238. b. Obfervation fur la langue & les expreffions
allemandes. II. 638. a. D e la prononciation de l’Allemand.
XIII. 438. a y b. Dialeéles de cette langue. X V I . 214. a.
D e la conjugaifon des verbes allemands. III. 882. a. D u
fuperlatif dans cette langue. X V . 664. a. Caraéleres Allemands.
Vol. II. des planch. article caraélere. Planch. X.
A llemande , ( JDanfc. ) forte de danl'e. Suppl. II. 373. a.
A L L EM AN D S , (H ifi.) origine des Allemands. P ays qu’ils
ont habités. I. 282. a.
A llemands , origine du nom Allemand. V . 1 r8. a. I l n’y
a pas de nation plus jaloufe de fa nobleffe que l’Allemande.
XIII. 689. b. Goût des Allemands pour la métallurgie. X .
434. b. Loix des Allemands. IX. 631. a , b. Droit Allemand.
V . x i 7. a y b. École Allemande de peinture. 314. b. 8cc.
Hiftoire de la poéfie A l l e m a n d e . I V . 446. a , b. — 448. a.
A L L E N , ( Guillaume') obfervations fur la v ie 8c le caraélere
de ce cardinal. X IV . 374. b.
A L L E R , diverfes expreffions de marine , où ce verbe
eft employé. I. 282. a.
A ller , marcher, courir, ( Marine ) différentes lignifications
8c ufages de ces mots. Suppl. I. 313. b. Aller vent
arriéré. A lle r au plus près ou à la bouline , ou à pointe de
bouline. A lle r vent largue. A lle r de bout au vent. A lle r de
l’arriere. A lle r en travers. A lle r à l’aviron. Ibid. 314. *.
A ller à l’épée , ( Efcrime ) I. 282. b.
A ller, (Manège) divers ufages de ce mot dans l’équitation.
I. 282. b.
A ller , ( Vénerie ) différentes expreffions où ce mot eft
employé. I. 282. b. (
A ller , ( terme de Veneur ) aller de bon tems, aller aux
bois. Suppl. I. 314. a.
A ller , ( Gramm. ) différence de • fens entre ces deux
expreffions, je fuis a llé, 8c j ’ai été. XI. 121. a.
A L L E R IA , ( Géogr. ) v ille de l’ifle de C o r fe , anciennement
nommée Rhotanus. Obfervations fur ce Heu. Suppl. I. 314. b.
A L L E R IO N , ( Blafon ) petite aigle fans bec ni jambes.
Etymologie de ce mot. Pourquoi les ducs de Lorraine ont
pris pour armes des aliénons. Suppl. I. 314. b.
A L L E U , franc- ( Jurifp. ) fie f poffédé fans dépendance
d’aucun feigneur. Etym. du mot. I. 282. b. Après la conquête
des Gaules, les terres furent divifées en bénéfices & alleus.
Acception de ce mot dans les anciens jurifconfultes & les
capitulaires de Charlemagne. Ufurpations des feigneurs fiir
les terres allodiales. Franc-alleu noble, 8c roturier. Trois
fortes de coutumes par rapport au franc-alleu. Ibid. 283. a.
Voye{ A leu.
A L L E Y N , ( Thomas ) mathématicien & aftronome. X V .
488. a , b.
A L L IA , (Géogr.) fleuve d’Italie, voyc^ A i a .
A L L IA G E , (Chymie ) celui de l’o r & de l ’argent. I. 283. a.
Pourquoi on le fait, foit en monnoie foit en vaiffelle. Alliage
naturel. Celui du fer avec l’or & l’argent. Celui du mercure.
Comment Archimede découvrit l’alHage de la couronne
d’o r d’Hieron. Ibid, b; . .
A lliage , (Arithm.) réglé d’alliage. Explication de cette
réglé. I. 284. a.
Alliage , à la monnoie , pourquoi il eft néceffaire. I. 284. b.
Alliage. Différence entre alUage & aloi. I. 292. b. Alliages
métalliques. X. 429. a. Métaux qui s'unifient. Métaux qui
. ne peuvent s’unir. V II . 400. b. Pourquoi l’on fe ftjrt d’alliage
dans les métaux desmonnoies. X. 632. b. Deux fortes d’alliages
dans la fabrique des monnofès. Méthode pour trouver la
proportion de l’alliage avec le fin , lorfque l’On fond enfem-
ble des lingots de différens titres. 663. b. 664. a. Alliage de
l’or avec d’autres métaux. XI. 323. b. Comment on exprime
les degrés d’alfiage de l’or. II. 672. a. Comment on fépare
un alliage d’or & d’argent. V . 993. a. L ’or & l’argent fe
diffolvent l’un l’autre 8c fe mêlent avec le fer. V I . 913, b.
Moyen de dépouiller un alliage d’or & d’argent du cuivre
qu’il contient. 920. b. Maniéré d’unir le cuivre à l’argent.
X V I . 444. a. Effet de la fufion de fer avec l’argent. V I.
496. b. Différens effets du fer allié avec d’autres fubffances
métalliques. Ibid. Phénomènes obfervés dans l’alüage du fe r
avec l’étain. V I . 7. b. Alliage de l’étain avec différens métaux.
■ Ibid. 8c 10. a. Expériences par lefquelles on voit les effets
que produifent les différens alliages des métaux fur leur
denfité. Suppl. II. 694. a , b. &c. Voyez ALLIER.
A LLIA IRE , (B o t.) defeription, an a ly fe $ & propriétés
de cette’ plante. I. 284. b.
A L L IA N C E , (dans les faintes Écritures ) la première
alliance de Dieu avec les hommes eft celle qu’il fit avec
Adam. La fécondé eft celle qu’il fit avec l’homme après fon
péché. I. 284. b. Une troifieme eft celle que le Seigneur fit
avec Noë. Celle que D ieu fit enfuite ayec Abraham fut
A L L
plus limitée qiie lés précédentes. On né parle guere ordln;
lirement que de: l’alliance du Se:igneùr av ec Ab:raham, 8c
dt» celle qu’il à fa;ife avec tous le;> hommeji par Je:fùs-Chrift.
C elle avecAbrah;im fut plufieurs fois rcnoüvellée.. Ibid. 283.
.a. Enfin la plus, parfàite eft celle (pie Diéü a faite avec nous
Pa:r la médiation de Jefus-Chrift. Ibid, b.
A lliance , union par mariage. I. 28 3. b.
A lliance , ligues & traités des fouverains. Le titre d'allié
des Romains étoit fort recherché. Différentes fortes d’alliés
qu’ils avoieht. I. 283. b.
A lli AN CE, ( Droit pôlïiiq. ) repas d’alliance chez les anciens.
X IV . 127. a. Traité d’alliâiice. X V I . 333. 4. Échange d’armes
ufité pour confirmer certaines alliances. I. 691. a. Sur les
alliances, vdye^ T raité public. Symbole des alliances.
X V . 728. b. 73 1 . b. Des alliés du peuple romain. I. 283, b.
XIII. 103..b.
A L L IA R Æ R ÎS , ( Alchymie ) cuivre de ceux qui travaillent
au grand oeuvre : cuivre blanc. D ’autres entendent par-
là l'eau de mercure. I. 283. b. Comment on peut changer le
cuivre en argent, félon Becker. Ibid. 286.«.
A L L IE R , ( Chymie ) les Indiens allient l’or avec l’émèri
d ’Efpagne. Comment on exprime les degrés d’alliage d’argent.
Alliage du mercure avec les autres métaux : avec l’étain".
I. 286. a. A v e c le plomb. Ibid. b. Voyez A lliage.
A L LO B R O G E S , (Géogr. ) leur pays. Suppl. IV . 10. ù.
A L L O C U T IO N , médailles fur les allocutions. X. 231. b.
432
A L L O D E S , (Ju r ifp .) étymologie de ce mot. Suppl. III.
735- b- , .
A L L O D IA L E S , terres : voyez A lleu. Hommes allodiaux.
V I I I . 280. a.
A L LO N G E , fignifications 8c ufages de ce mot en marine.
I . 287. a. Dans le commerce, en menuiferie 8c taillanderie ,
8c chez les bouchers. Ibid. b.
A llonges des potenceaux, (Rubatih.) leur defeription &
leur ufage. Allonges, pièces du métier de gazier. I. 288. a.
A L L O N G É , (en Géométrie) fphéroïde allongé ou applati.
L 2 88 . b.
ALLONGÉ, (Vénerie) allongée , moelle. (A n a t.) I. 288. b.
A L L O N G E R , terme de marine, d’eferime , de manege,
«des manufactures de foie & de laine. I. 288. b.
A llonger, (M arin e) d’où vient aux cordes la puiffance
de s’allonger fans fe rompre. Elafticité de cette puiffance.
Suppl. I. 314. b. Une corde en allongeant perd de fa circonférence.
Tous les différens cordages d’un vaiffeau ne
doivent pas être commis à un degré femblable. Il y a de
l ’avantage à commettre beaucoup plus les cables, les g rêlins,
les remorques , & généralement toutes les manoeuvres, dont
l ’allongement élaftique ou momentané n’eft pointa redouter.
Obfervation à faire à cet égard pour les manoeuvres courantes.
Ibid. 3 x3. a.
A L L U CH O N , ou Alichon. (Mécan.) on donne ce nom
aux chevilles ou efpeces de dents dont on garnit les roues
dentelées dans les grandes machines. Deux fortes d’alluchons. 1
Leu r ufage. Bois dont on les fait. Méthode pour fixer le
nombre d’alluchons dont un rouet ou un hériffon doit être
garni. Détermination de leur épaiffeur & de leur force.
Suppl. I. 313. b. Celle de la forme. Ibid. 316. a. & de la longueur
qu’ils doivent avoir. Queue des alluchons. Ibid. b.
A L LU M É , ( Blafon ) ufages de ce mot. Supplément I.
3 1 6 . b.
A L LUM E R , voyeç I gnition.
ALLU RES du cheval, ( Maneg. ) Voye\> PAS, ENTREPAS,
T rot , A mble, Ga l o p , T ranquenard , 6- T rain
rompu. I. 289. b.
A llures, voye^ fur ce fujetHI. 303. a , b. Suppl. III. 396.
a , é. Allure froide. VII. 332. b. Allures décrites.’ V II . V o l.
des planch. article Manege, planch. I. & fuivantes.
) A L LU S IO N , ( Rhét. ) figure de rhétorique. Deux efpeces
d’allufions. Obfervation générale fur les allufions. I. 289. b.
A llusion , (Belles-Lettr.) application perfonnelle d’un
trait de louange ou de blâme. Rien de plus odieux que la
,Pei'fonnelle. La feule permife & honnête eft la làtyre
générale des mauvaifes moeurs. C ’eft elle cependant qu’on
trouve inoyen de rendre criminelle par la méthode des allufions.
C eft une façon de nuire auffi baffe q uelle eft commune ,
que d appliquer ainfi des traits q u i , par eux-mêmes n’ont
rien de perfonnel pour faire un crime à l’écrivain de l’inten-
t o .n. 011 1 | fnppofe. Rien de plus effrayant & de plus
nuuible, pour les lettres, que cette manie des allufioqs.
Suppl. I. 317. a. Maniéré noble dont les géns e'n place
devroiènt répondre aux vils délateurs qui leur dénoncent les
traits de blâme qui peuvent les regarder. Ibid. b.
Allufions, elles font fréquentes dans les langues primitives
OC dans le ftyle oriental. Ce,goût d’allufiOns le vo it fur-tout
chez le peuple'& chez les nations qui fe forment. VII I. 89. b.
SO,a. Voye{ l’article ORIENTAUX.
A L LU V IO N , ( Jurijpr.) le droit romain met l’alluvion entre
les moyens légitimas d’acquérir. I. 289. b.
A L O
Sà T‘*le Minc * cinnabre dans cc
Malabar, !, H , •*- « s nawtans de la côw de
• i ) ouvrage fameux fur la a-omérne
& laftronomie compolc par Prolomée. Etym.S de™ce
■ B m l né. contient que les obfervations des Grecs.
11 fut pttbljè ^m ^em mre cl’A ntonin .& traduit d'arabe en
latin en 1230. Nou ve l almagelle du P . Riccioli. 1 ,<,0 „ .
A lm a g e s t i , contenu de lalmageflcde Ptplomée. 1 .7 oé
n. Catalogue tl etotles qti'on y trouve. Siwpl. II. a. Oét
W î i i l M W y ifn ta g e fe N ouveau
A f -M AM O U N , ( Wi/i. des Arabes. ) r „ n des califes lies
A L o * e . I .a 9o . r
— üm s . breé m ! Ç°8rés l« r e s lifflMiiMgK M V . « 4- i . Ses travaux pour perfeatonner l’a f l r om S e L
A LM A N A CH , (Agron ) dtverfe étym de 5 mot I
« A P » prbdidions de l’aflrologie judiciaire répZdùes
■ ■ g t ,a,,ac,hs-Ut“ « M m t m m dliui. Almanach royal -, c e qu’il contient. Ibid, b
Almanach, maniéré de le conftruire. II. 334.*. Almanachs
aftronommnes. Suppl. I. H H n . B M P I H
“à7 ’ ■ ^ ^ “ JSdes tables contenues dans les almanachs
alhononuques de Vienne & de B e rlin, » » T ables Alma-
■ P i l M M i > W CONNOISSANCE DES
tems. Almanach des Bramines. Suppl. IV 210 b
A 1A 1A N I11NK ( / / B M — moinJ
eftimée que le rubis oriental. Les plus belles peuvent être
eftimées a le ga l du rubis fpinel. I. 201. «
A LM A N Z A , ( Geogr.) ville d’Efpagne. V ifto ire remportée mÊMÊÊmm 1 MB m ■
ViUedC Pom,Sa L Obfervations fur
A LM E LD , ( Géogr ) vd le des p rovinces unies Sa fnuation 8c fon commerce. Suppl. I. 317. b.
AI.MKRIK, ( Giogr. ) ville d lilbagnc. Prodnfiioiis de fes
environs. Son éy.écbe. S u s c i I - ,i - “
u o ^ L ^ I C é ^ T ^ ^ T ^ .» )'ces 'cercles font par rapp
o r t anx azimuts & a 1 horizon, ce que font les parallèles par
rapport aux méridiens & à l’équateur. Leur ufage. Méthode
pour trouver la déclinaifou d’une étoile Si la hauteur, du pôle
indépendamment l une de l’autre. I. 291. a.
Almicantarats, ou cercles de hauteur. II. 833. b X I
906. a. } ‘ ’ *
A LM IS SA > (Géogr. ) ville de la Dalmatie vénitienne.
Uolervations hifton.ques fur cette ville. Suppl I i i ü n
A L M O X , A R IS F A SG O , art. de l ’Encyclopédie', iifez
Almoxanfazeo, droit qui fe perçoit en Efpagne. Ouvrage à
conlulter. O fficier prépofé à la perception de ce droit. Suppl. I .
^ o ^ y G lM » ( Crit. fiacr. ) bois dont il eft parlé dans l’écrir-
ture & for la nature duquel les interprètes ne s’accordent
pas. LLL. 401. a.
A L N W IC K , ( Géogr. ) ville d’Angleterre. Diverfes obfervations
nir ce heu. Suppl. I. 318. a.
A LOÈ S , ( Bot. ) caraéleres de ce genre de plante. I. 29.1. a.
A loes , ( Mat. medic. ) alocs fuccotrin, hépatique &
caballin. Aloès en calebaffe ou des barbades. I. 29,1. b L’aloès
contient beaucoup d’huile & de fel effehtiel. Ses effets en
médecine. Comment il faut le préparer. Différentes préparations
d’aloès. Aloès rofat le plus fimple & le feul d’ufage.
Pillules d’aloès lavé. Ibid. 292. a.
A loès , ( Mat. médic. ) les trois efpeces d’aloès fe tirent
de la même plante. Subftances tirées de l’aloès par l’analyfe.
Suppl. I. 318. a. Propriétés de ces fubffances. Examen critique
de quelques propofitions renfermées dans l ’article Aloes de
l ’Encyclopédie. Propriétés del’aloêspiisen fubftance. Maniéré
la plus fimple de féparer le partie gommeufe de la réfineufe.
Auteurs qui ont condamné i ’ufage de l’aloès. Ibid. b.
Aloès, bois d’aloès. II. 307. b. X V . 208. b. Aloès de Zoco-
tora. XVII . 720. b. Calambacs, calambours, fortes d’aloès.
X V . 212.b. II. 339. a. Aloès d’Amérique, nommé Karatà.
IX. 113. a. XVI. 387. a. A utre aloès nommé Catevala. Suppl.
II. 270. b.
A LO G IEN S , (Hifl. eccl. ) anciens hérétiques qui nioient
que Jefus-Ghrifl fut le verbe éternel. O n en rapporte l’origine
à Théodofe de Byfance. I. 292. b. ‘
Alogiens, raifons qu’ils alléguoient contre la canonicité de
l ’apocalypfe. I. 328. '«.
A L O I , ( Métall. ) l’aloi eft à l’alliage , ce que l’efpece eft
au genre , ou comme alliage eft à mélange, I. 292. b.