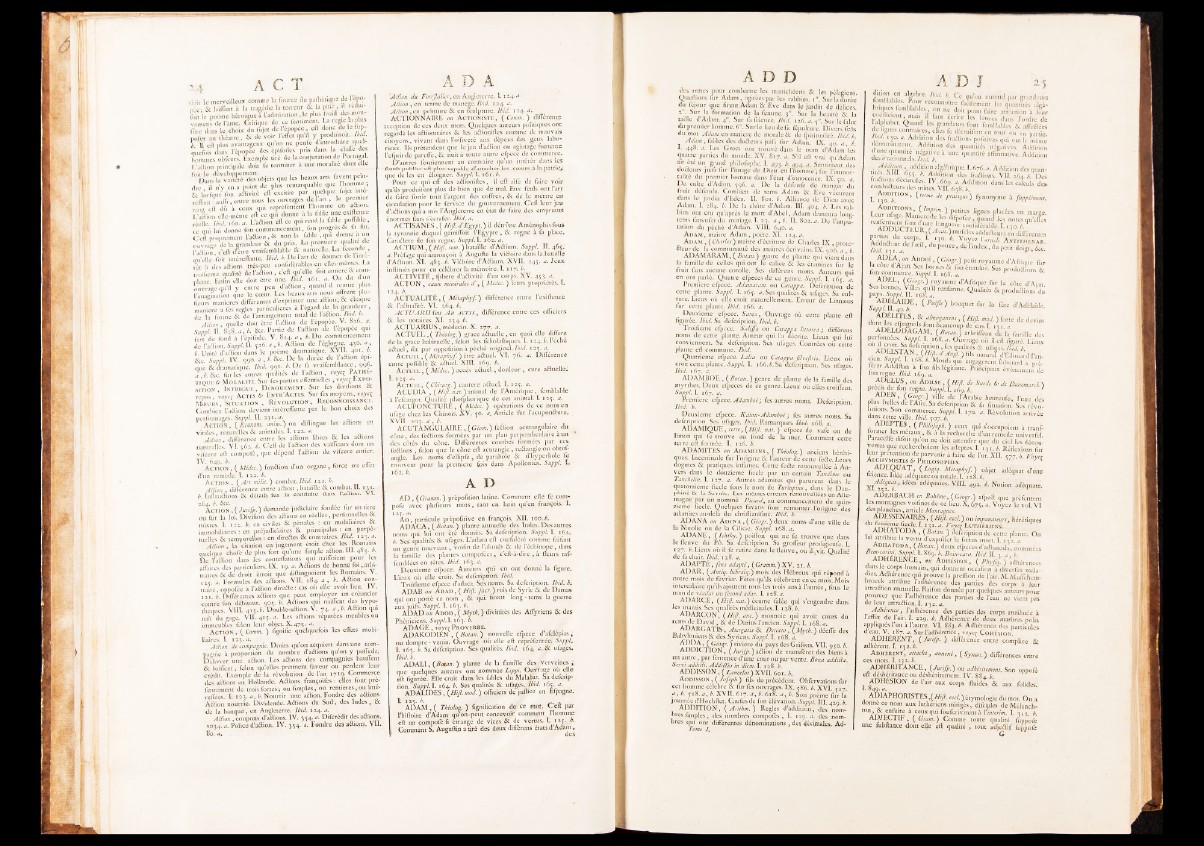
I A A C T
1C merveilleux comme la fource du pathétique de Upo-
oée- & IniflVmt à la tragédie la terreur & la pitié , il rètlut-
Foit’le poème h è row u e l l'admiration ,1c plus froid dea mo tt
vemeiis de l'ame. Critique ■ M M H R M & f f i
(5re dans le choix du (lijet de 1 épopée, eft donc de le jup-
pqfer au théâtre, & de voir l'effet qml y produirott, J U
A II cft plus avantageux quon ne peine d introduite quel-
miefbis dans l’épopée des èpifodes pris dans la claflc des
hommes obfcurs. Exemple tiré de la conjuration de Portugal.
L’aélion principale doit fe terminer à une moralité dont eue
f° DansdlaTv a ° f f i rodeés objets que les beaux arts favent peindre
il n’y en a point de plus remarquable que llio tntu e ,
5c lorfquc fou aéliviié eft excitée par quelque j p B 8 B |
reliant■ aufïi, entre tous les ouvrages de la i t , le premier
etl tlf, à ceux qui repréfentent l’homme en action.
L ’action elle-même eft ce qui donne à la u f i g B P ‘ f l B
réelle Ibid 160. a. L’aflion eft ce qui rend la fable pomble,
ce qui lui donne fon commencement, Ion progrès 8c la ta .
Ç J proprement l’aftion , & non la fable , qui donne à un
ouvrage d e là grandeur 8c du prix La première K f f lH g g
l’aftion, e’eft t fit re vraifemblable & naturel c. La fécondé ,
„„•elle Voit intéreffante. Ibid. i. D e l’art de donner de lutte-
rôt à des aélions très-peu confidèrables en elles-mêmes. L.a
troifieme qualité de l’a& o n , e’eft qu’elle foit entière & corn-
„lotte. Enfin elle doit être une. I U . tô t- -<■ On du d m
ouvrage qu’il y entre peu d’aélion, quand il remue p us
l'imagination que le coeur. Les beaux-arts nous offrent pht-
fietirs maniérés différentes d’exprimer une aa ton ; & chaque
maniéré a fes réglés particulières à l'égard de la grandeur,
de la forme 8c de l'arrangement total de l’aélton. Ibid. b.
M i on , quelle doit être l’aélion de lepopée V . 8x6. u.
Srnvl n . 8 » 8 .« ,é . 8ce. Partie de l’aftion de 1 épopée qui
fort tle fond à l’épifode. V . 8tq. u , b. D u commencement
de l’aflion. Suppl. U. v 6 . a , b A flio n de l’églomm. 43° . » .
i Unité d’aftion dans le poeoie dramatique. X V 1L 4°>; f
& c. Suppl. IV . 990. .1 , b Bec. D e la durée de 1action épi-
nue &. dramatique. H 991. i . De fa yrtufemblanee 996.
à b 8cc furies autres qualités de 1 aélion, Pathétique
6- Moralité. Sur fes parties effentielles, voytr Exposition
Inthigui: , D énouement. Sur fes divifions oc
renos voye? A ctes 6- Entu’A ctes. Sur fes mo yens, v o yn
Moeurs Situation , Révolution, Reconnoissance.
Combien l’aétion devient intéreffante par le bon choix des
perfonnages. Suppl- II. 2.31- a.
A c t io n , ( Econom. anim.) on diftingue-les aérions en
v itale s, naturelles & animales. I. 122. a
Aélion, différence entre les a&ions libres & les aéhons
naturelles V I. 362. b. C ’eft de l’aélion des vaiffeaux dont un
vjfcere eft compofé,que dépend M o n du vifeere entier.
IV . 64O. b. rr
A ction , ( Médcc.) fonétion d u n organe, force ou effet
d’un remede. I. 122. b.
A ction , ( Art milit. ) combat.Ibid. 122. b.
H , différence entre aélion , bataille 8c combat. II. 131.
A ction (M f p . ) demande judiciaire fondée fur Un titre
on fur la loi. Divifton des aftions en réelles, perfonitellcs 8c
mixtes I iaa. b en civiles Sc pénales : en mobihaires 8c
immobiliaires : en préjudiciâmes 8c principales : en perpè-
tuolles Sc temporelles : en direftes 8c contraires. Ibid, i o y n.
A lto n , la citation en jugement étott cher les Romains
quelque ciiofe de plus fort qu’une fimple aftion. 111. 485. é.
D e laétion dans les conteftations qui naiffoient pour les
affaires des particuliers. IX. 19. a. Aélions de bonne fq i,arb itraires
& de droit étroit que diftinguoient les Romains. V .
1 « . a. Formules des aélions. V II . 184. a b. Aélion contraire,
oppofée à l’aélion direéte: cas ou elle avoit lieu. IV .
121. b. Différentes aélions que peut employer un créancier
contre fon débiteur. 903. b. Aélions qui naiffent des hypotheques.
VII I. 413.6. Double-aétion. V . 74. a , b. Aélion qui
naît du gage. VII . 4x3. a. Les aélions réputées meubles ou
immeubles, félon leur objet. X .473. a.
A ction , ( Comm. ) fignine quelquefois les effets mobi-
liaires. I. 123- a. ' .
A (lion .dp compagnie. Droits qu on acquiert dans une compagnie
à proportion du nombre d’aétions qu’011 y poffede.
Délivrer une aélion. Les aftions des compagnies hauffent
& baillent, félon qu’elles prennent faveur ou perdent leur
crédit. Exemple de la révolution de l’an 17x9. Commerce
des aélions en Hollande. Aélions, firançoifes : elles font pré-
fentement de trois fortes ; ou fimples, ou rentieres, ou inté-
refféès. I. 123. a , b. Nourrir une aélion. Fondre des aélions.
Aélion nourrie. Dividende. Aélions du S u d , des Indes, 8c
d e la banque, en Angleterre. Ibid. 124. a.
Aélion, coupoxxs d’aélions. IV . 3 34. a. Difcrédit des aélions.
1034. a. Police d’aétion. IV . 334. a. Fondre des aélions. V I I .
80. a.
A D A
Adlon du Foreflaller, en Angleterre. 1. 124. a
Aélion , en terme de manège. Ibid. 124. a.
Aélion, en peinture 8c en lculpture. Ibid. 124. a. '
A C T IO N N A IR E ou A ctioniste, ( Comm. ) différente
acception de ces deux mots. Quelques auteurs politiques ont
regardé les aélionnaires & les aétioniftes comme de mauvais
cito yens, vivant dans l’oifxveté aux dépens des gens laborieux.
Ils prétendent que le,jeu d’aélion ou agiotage fomente
l ’efurit de p a r e ffe ,& nuit à toute autre efpece de commerce.
D ’autres foutiennent au contraire qu’un intérêt dans les
ronds publics c il plus capable d'attacher les coeurs à la patrie^!
que de les en éloigner. Suppl. ï. 161. b.
Pour ce qui eft des aétioniftes, il eft aifé de faire v o it
qu’ils produitent plus de bien que de mal. Eux feuls ont l’art
de faire fortir tout l’argent des coffres, & de le mettre en
circulation pour le fervice du gouvernement. C ’eft leur jeu
d’aélions qui a mis l’Angleterre en état de faire des emprunts
énormes fans s’écrafer. Ibid. a.
A C T IS A N È S , ( Hiß. d ’Egyot.) il détrône Aménopbis fous
la tyrannie duquel gémiffoit l’E g y p te , 8c regne à la place.
Caraétere de fon regne. Suppl. I. 102. a.
A C T IU M , ( Hiß. rom. ) bataille d’Aétium. Suppl. II. 463.'
a. P ré Age qui annonçoit à Augufte la viétoire dans la.bataille
d’Aélium. X i. 483. b. Viétoire d’Aétium. XV II . 243. a. Jeux
inftitués pour en célébrer la mémoire. 1 . 117. b.
A C T I V I T É , fphere d’aélivité d’un corps. X V . 433. a.
A C T O N , eaux minérales d’ , ( Médcc. ) leurs propriétés. I.
124. b.
A C T U A L IT É , ( Mètaphyf. ) différence entre l’exiftencc
& l’aélualité. V I . 264. b.
A C T U A R I I feu A s a c t is , différence entre ces officiers
8c les notaires. XI. 234. b.
A C T Ü A R IU S , médecin. X. 277. a.
A C T U E L , ( Theolog. ) grâce aftuelle , en quoi elle différé
de la grâce habituelle, félon les fcholaftiques. 1. 124. b. Péché
aétuel, dit par oppofition h péché originel. Ibid. 123.a .
A ctuel , ( Mètaphyf. ) être aétuel. VI. 76. a. Différence
entre poffible & aétuel, XIII. 169. b.
A ctuel , ( Médcc. ) accès a é tu el, douleur , cure aéluelleà
I. 123. a.
A ctuel, ( Chirurg. ) cautere aétuel. 1. 123 .a .
A C U D 1A , ( Hiß. nat. ) animal de l’Amérique, femblable
à l’efcargot. Qualité phofphorique de cet animal. 1. 123. a.
A C U P O N C T U R É , (Médcc. ) opérations de ce nom en
ufage chez les Chinois. X V . 30. a. Article fur l’acuponéture. .
X V I I . 203. a , b.
A C U T A N G U L A 1RE , ( Gcom. ) fcétion acutangulaire du
côn e, des feétions formées par un plan perpendiculaire à un
des côtés du cône. Différentes courbes formées par ces
feétions , félon que le cône eft acutangle , reétangle ou obtuF
angle. Les noms d’e llip fe , de parabole & d h yperbole fe
trouvent pour la première fois dans Apollonius. Suppl. I .
162. b.
A D
A D , (Gramm. ) prépofition latine. Comment elle fe com-
pofe avec plufieurs mo ts , tant en latin qu’en françois. L
A n , particule prépofitive en françois. XII. 100. b.
A D A C A , ( Botan. ) plante annuelle des Indes. D es autres
noms qui lui ont été donnés. Sa defeription. Suppl. I. 162.
b. Ses qualités & ufages. L ’adaca eft conlidéré comme faifant
un genre nouveau , voifin de .l’akoub & de l’échinope , dans
la famille des plantes cpmpofces, c’eft-à-dire , à fleurs raf-
femblées en têtes. Ibid, 163. a. ,
Deuxieme efpece. Auteurs qui en ont donne la figure.
Lieux où elle croît. Sa defeription. Ibid.
Troifieme efpece d’adaca. Ses noms. Sa defeription. Ibid. b.
A D A B ou A d ad , ( Hiß. facr.) rois de Syrie & de Damas
qui ont porté ce nom , 8c qui firent long - teins la guerre
aux juifs. Suppl. I. 163. b. n _
A D A D ou A d o d , ( Myth. ) divinités des Affyriens 8c des;
; Phéniciens. Suppl. 1. 163. b.
A D A G E , voyeç Proverbe.
A D A K O D IE N , ( Botan. ) nouvelle efpece d’afelépias ;
ou dompte-venin. Ouvrage où elle eft repréfentée., Suppl.
I. 163. b. Sa defeription. Ses qualités. Ibid. 164. a. 8c ufages.
Ibid. b. I ■ ;
A D A L I , {Botan. ) plante de la famille des, verveines ;
que quelques auteurs ont nommée Lippi. Ouvrage ou elle
eft figurée. Elle croît dans les fables du Malabar. Sa deferip-
ûon. Suppl. 1. 164. b. Ses qualités 8c ufages. Ibid. i6< .a .
A D A L ID E S , {Hiß. mod. ) officiers de juftice en Efpagne:
A I^ AM , ( Thcolog. ) lignification de ce mot. C ’eft par
l’hiftoire d’Adam qffon.peut concevoir comment l’horiime
eft un compofé fi étrange de vices 8c de vertus. I. 123. b.
, Comment î>. Auguftin a tiré des deux différens états d’A d am,
A D D
des armes pour combattre les manichéens 8c les pé'lagiens.
Queftions fur A d am , agitées par les rabbins. i° . Sur la durée
du féjour que firent Adam 8c E v e dans le jardin de délices.
2". Sur la formation de la femme. 30. Sur la beauté 8c là
taille d’Adam. 40. Sur fa fcience. Ibid. 126. a. 30. Sur le falut
du premier homme. 6°. Sur le lieu de fa fépulture. Divers ferts
du mot Adam en matière de morale 8c de fpiritualité. Ibid. b.
Adam, fables des doéteurs juifs fur Adam. IX. 49. a ' b.
I. 448. a. Les Grecs ont trouvé dans le nom d’Adam les
quatre parties du monde. X V . 817. ,1. S’il eft vrai qu’Adam
f m un. s ra" d plffiofophe. I. 493. b. 494. a. Sentiment des
docteurs juifs fur l’image de Dieu en riiomine'j fur l’immortalité
du premier homme dans l’état d’innocence. IX. 30. a.
D u culte dAdam. 39^- a- O e la défenfe de manger du
fruit défendu. Combien de tems Adam 8c E v e vécurent
dans le jardin d’Eden. II. 801. b. Alliance de Dieu avec
Adam. I. 284. b. D e la chute d’Adam. III. 404. b. Les rabbins
ont cru qu’après la mort d’A b e l , Adam demeura long-
tems fansuferdu mariage. I. 23. a , b. IL 802. a. Do l’imputation
du péché d’Adam. VII I. 640. a.
A dam , maître A d am , poëte. XI. 114. a.
A dam , {Charles') maître d’écriture de Charles IX , prote-
fteur de la communauté des maîtres écrivains. IX. 906. a b.
A D AM A R AM , ( Botan.) genre de plante qui vient dans
la famille de celles qui ont le calice 8c les étamines fur le
fruit fans aucune corolle. Ses différens noms. Auteurs qui
en ont parlé. Quatre efpeces dé ce genre. Suppl. I. 163. a.
Première efpece. Adamaram ou Catappa. Defeription dé
cette plante. Suppl. I. 163. a. Ses qualités 8c ufages. Sa culture.
Lieux où elle croît naturellement. Erreur de Linnæus
fur cette plante. Ibid. 166. a.
Deuxieme efpece. Saros, Ouvrage où cette plante eft
figurée. Ibid. Sa defeription. Ibid. b.
Troifieme efpece. Salijfa ou Catappa littorea ; différens
noms de cette .plante. Auteur qui l’a décrite. Lieux qui lui
conviennent. Sa defeription. Ses ufages. Contrées où cette
plante eft commune. Ibid.
Quatrième efpece. Lalia ou Catappa filveflris. Lieux où
croît cette plante. Suppl. I. 166. b. Sa defeription. Ses ufaces
Ibid. 167. a. b '
A D AM B O E , {Botan. ) genre de plante de la famille des
myrthes. D eu x efpeces de ce genre. Lieux où elles croiffent.
Suppl. I. 167. a.
^ e m i e r e efpece. Adarnboé; fes autres noms. Defeription.
Deuxieme efpece. Katou- Adarnboé ; fes autres noms. Sa
defeription. Ses ufages. Ibid. Remarques. Ibid. 168. a.
A D AM IQ U E , terre,{Hifl. nat.) efpece de vafe ou de
limon qui fe trouve au fond de la mer. Comment cette
terre eft formée. I. 126. b.
A D AM IT E S ou A damiens, {Théolog.) anciens hérétiques.
Incertitude fur l’origine 8c l’auteur de cette feéte. Leurs
dogmes 8c pratiques infâmes. Cette feéte renouvellée à A n vers
dans le douzième fieclc par un certain Tandbne ou
Tanchelin. I. 127. a. Autres adamites qui parurent dans le
quatorzième fiecle fous le nom de Turlupins, dans le Dauphiné
8c la Savoie. Les mêmes erreurs renouvellées en A lle-
iriagne par un nommé Picard, au commencement du quinzième
fiecle. Quelques favans font remonter.l’origine des
adamites au-delà du chriftianifme. Ibid. b.
A D A N A ou A dena, ( Géogr.) deux noms d’une v ille de
la Natolie ou de la Cilicie. Suppl. 168. a.
A D A N E , ( Ichthy. ) poiffon qui ne fe trouve que dans
le fleuve du Pô. Sa cldcription. Sa groffeur prodigieufe. I.
127. b. L ieux où il fe retire dans le fleu v e , où LL vit. Qualité
de fa chair. Ibid. 128. a,
A D A P T É , fens adapté, {Gramm.) X V . 21. b.
A D A R , {Antiq. hébraiq.) mois des Hébreux qui répond à
notre mois de février. Fêtes qu’ils célèbrent en ce mois. Mois
intercalaire qu’ils ajoutent tous les trois ans à l’année, fous le
nom de véadar ou fécond adar. I. 128. a.
A D A R C E , {H ijl.n a t.) écume falée qui s’engendre dans
les marais. Ses qualités médicinales. 1. 128. b.
A D A R C O N , {Hijl. anc.) monnoie qui avoit cours du
4ems de David , 8c de Darius l’ancien. Suppl. I. 168. a.
A D A R G A T IS , Atergatis 8c Derceto, {M yth.) déeffe des
Babyloniens 8c des Syriens. Suppl. I. 168. a.
) riv *ere du pays des Grifons. V II. 930. b.
A D D IC T IO N , {ju r ifp .) aélion de transférer des biens à
un autre, par fentence d’une cour ou par vente. Bona addiCla.
Servi addiïti. AddiÜio in diem. I. 128. b.
A D D IS SO N , ( Lancelot ) X V II . 601. b.
A ddisson , (Jofep h) fils du précédent. Obfervations fur
cet homme célébré 8c fur fes ouvrages. IX. ç86. b. X V I. 317.
a , b. 318. a, b. X V II . 617. a , b. 6 18. a , b. Son poème iur la
journée d’Hochftet. Caufes de fon élévation. Suppl. III. 420. b.
A D D IT IO N , ( Arithm. ) Regies d’addition, des nombres
fimples, des nombres compofés, I. 129. à. des nombres
qui ont différentes dénominations , des décimales. Ad-
Tome I. I
IAX JDLA JJ
S h n n/ ' , f brc- m k: Ce 1 "'“ ' par grand,.,«
r n u g * « » facilement les quantités algé-
a W B j î»> "<i doit point faire attention à £ tr
1l Malpnhhaabbeet.r 'QOu andI 'lte s^ gra ndeurs fno nt '™fcm,rbal abdlac,s,s 8lco arfdfrréct édeés
d i g n e s contraires, elfes fe détruifcn, en tou, ou en tie
' 3° ' Addition des M i n u s pof,rives qui ont le même
dénominateur. Addition des quantités négatives. Addition
d une quantité négative à une quantité affirmative. Addition
des irrationnels. Ibid. b.
■ EwSfll i all‘¥ 0ï ü 67<S- “ ■ Addition des quantités.
XIII. b. Addition des fraéiions. VII. 264. b. Des
f raflions déc,males. IV . 66a. a. Addition dans les calculs dea
conducteurs des mines. V IL 638. b.
I I “ T 0 " ' de pratique') fynonyme à fuppllment.
A dditions, (/»prit».) petites lignes placées en maree
renfe " :'SC' ® . !rc d<i les tufpofer , quand les notes qu’c l E
A D W C T Ï u l lÆ
la r M royaume d’A ftique f „ r
yr „ ü A hin- M bornes 8c fon étendue. Ses produétions 8c
fon commerce. Suppl. I. 168. a.
A D E L , (Géogr!) royaume d’A frique fur la côte d’Aian
pays W renf<ïrmC- QuaHtés & pr° du£lions du
rur h . fêK d’Adélaïde.
■ I H W B B f m 1 h B ) forte de devins
d0 WM beaucoup de cas. I. „
A D E L O D A G A M , (Botan.) arbriffeau cîe la famille des
S t creh s f E ° ™ S 0 oit il eft figuré. Liem!
à n K c - f a i t r‘pt‘° n ’ fcs loadtés & ufages. H ® b.
P P K S M M M ffls naturel d’Édouard f i t
1 ’• r b‘ m 0,';6 -1?“ 1 ongagcrent Édouard h ,,ré-
feù r e g 'e Z f o l ^ IV" x i^ ^ênemens de
p r ê t s ^
A D E N , ( C w r . ) ville de l’Arabie liettreufe,. l ’une des
plus belles de l’Afte. Sa defeription & fa feuation’ SeFTévoddaMns
ÏcÏeAtte0 ,v' i lllew. Ibr ivd. C3e0’ 7S. Tb. L L ' 7° ’ dévolution arrivée
A D E P T E S , ( P ’ùlofopk. ) ceux qui s’occupolem à tranf-
P a r S l f e J ? •taUX. ’ & 4 ia recherebe d’un re.ncde univerfel.
raracelle dtfott qu on ne don; jittendre que du ciel les découvertes
que rccherchpiem les adeptes. I. t^i. b. Réflexions fur
leur prétention de parvenir à faire de l’or. XII. m b. Vovk
A lchymistes <S* Philosophes. v /
M m m Ê ‘>biet h M i i d’un,
lcience. Idée adéquate ou totale. I. 128. b.
1 — adéquates. .VIII. 49a, b. Notion adéquate.
À D E R B A CH m Ro/té,« (Géogr.) afpeâ que préfentenr
les moma^ttes votfines de ce lieu. X . V o y e i le v ol. V I
des planches, article Montagnes.
, Ab)ESSENAIR£S, {Hifl. eccl.) ou impapateurs, hérétiques
1 B Luthériens. 4
A D H A T O D A , {Botan.) defeription de cette plante. On
lui attribue la vertu dexpuller le foetus mort. I. 122.4.
A dhatoda , ( Botan) deux efpeces d’adhatoda, nommées
B 1 869- b- Boïn-caro. Ibid.ll. 3. 4 . b.
A D H É R E N C E , eu A dhésion, ( Phyfiq. ) adhérences
dans le corps humain, qui donnent occafion à diverfes maladies.
Adhérence qui prouve la preffion de l’air. M. Muffcberà-
broeck attribue l ’adhérence clés parties des corps à leur
attraécion mutuelle. Raifon domiée par quelques auteurs pour
prouver que l’adhérence des parties de l’eau ne vient pas
de leur attraction. I. 132. a.
., ’■ ^^bérence des parties des corps attribuée à
1 effet de 1 air. I. 229. b. Adhérence de deux marbres polis
appliqués l ’un à l’autre. VI. 88j . b. Adhérence des particules
d’eau. V . 187. a. Sur l’adhérence, voye^ C ohésion.
A D H É R EN T , ( Jurifp. ) différence entre complice 8c
adhérent. I. 132.6.
A dhérent, attaché, annexé, {Synon.) différences entre
ces mots. 1 . 13 2. b.
■ ■ B ( A r f f r ) OU adUncmen,. Son oppofé
eft déshéntance ou déshérltement. IV . 884. b.
ADH ÉSIO N de l’air aux corps fluides & aux folides;
I. 849.4.
A D IAPH O R IST E S ,{Hifl. eccl. ) étymologie du mot. On a
donné ce nom aux luthériens mitigés, difciples de Mélanch-
4 D r r lte à ceux qui fouferivirent à Y intérim. I. 312. 6.
A D JE C T IF , ( Gram. ) Comme toute qualité fuppofe
une fubftance dont elle eft qualité ; tout adjeétif fuppofe