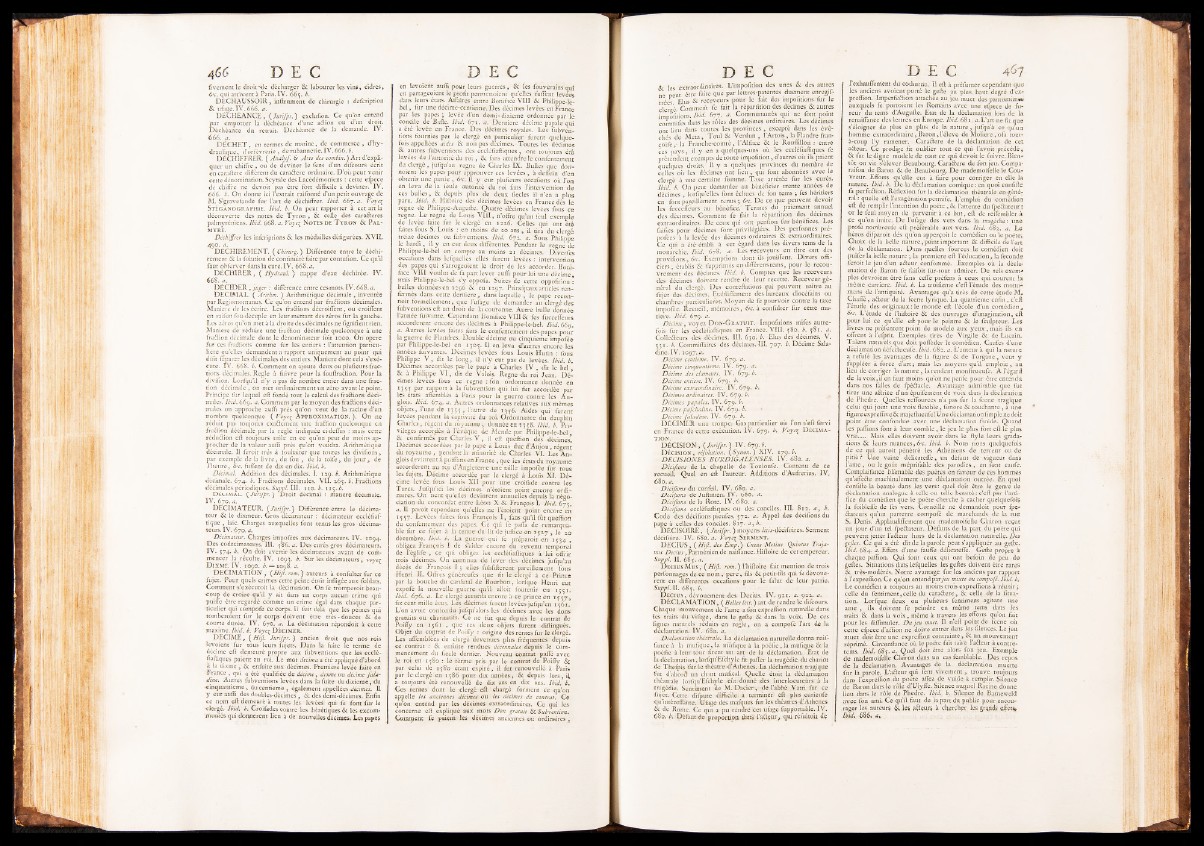
466 D E C D E C
fivement le droit x le décharger & labourer les v ins , cidres,
&c. qui arrivent à Paris. IV . 665. 6.
D E CH A U S SO IR , inftrument de chirurgie : defcription
8c u{âge. IV . 666. a,
D É C H É A N C E , ( Jurifpr. ) exclufion. C e qu’on entend
Ëj—ir emporter la déchéance d’une aétion ou d’un droit.
échéance du retrait. Déchéance de la demande. IV .
666. a.
D É C H E T , en termes de marine, de commerce , d’h y draulique,
d’orfèvrerie, derubannerie.IV.666.b.
DÉCHIFFRER. ( Analyf. & Arts des cornbin. ) A rt d'expliquer
un chiffre , ou de deviner le fens d’un difcours écrit
en caraélere différent du caraélere ordinaire. D ’où peut venir
cette dénomination. Scytale des Lacédémoniens : cette elpece
de chiffre ne devoit pas être fort difficile à deviner. IV .
666. b. On donne ici l’extrait raifonné d’un petit ouvrage de
M. S’gravefande fur l’art de déchiffrer. Ibid. 667. a. Voyeç
St Ég a n o g r a ph ie . Ibid. b. On peut rapporter à cet art la
découverte des notes de T y r o n , & celle des caraéteres
palmyréniens. Ibid. 668. a. Voyeç Notes de T y r o n 8c Pa l -
m y r e .
Déchiffrer les irtfcriptions & les médailles défigurées. X V II .
490. a.
DÉCHIREMENT. ( Chirurg. ) Différence entre le déchirement
& la folution de continuité faite par contufion. C e qu’il
faut obferver dans la cure. IV . 668. a.
D É C H IR E R , ( Hydraul. ) nappe d’eau déchirée. IV .
668. a.
D É C ID E R , juger : différence entre ces mots. IV . 668. a.
D E C IM A L . ( Arithm. ) Arithmétique décimale , inventée
par Regiomontanus. C e qu’on entend par fraéïions décimales.
Maniéré de les écrire. Les fraéïions décroiffent, ou croiffent
en raifon fou-décuple en leur mettant des zéros fur la gauche.
Les zéros qu’on met à la droite des décimales ne lignifient rien.
Maniéré de réduire une fraction décimale quelconque à une
fraétion décimale dont le dénominateur foit 1000. O n opéré
fur ces fraéïions comme fur les entiers : l’attention particulière
qu’elles demandent a rapport uniquement au point qui
doit féparer les décimales des entiers. Maniéré dont cela s’exécute.
IV . 668. b. Comment on ajoute deux ou plufieurs fractions
décimales. Réglé à fuivre pour la fouftraétion. Pour la
divifion. Lorfqu’il n’y a pas de nombre entier dans une fraction
décimale, on met ordinairement un zéro avant le point.
Principe fur lequel efl fondé tout le calcul des fraéïions décimales.
Ibid. 66p. u. Comment par le moyen des fraéïions décimales
on approche auffi près qu’on v eu t de la racine d’un
nombre quelconque ( Voye[ A p p r o x im a t io n . ). On ne
réduit pas toujours exaétement une fraétion quelconque en
fraétion décimale par la réglé indiquée ci-deflùs : mais cette
réduétion efl toujours utile en ce qu’on peut du moins approcher
de la valeur auffi près qu’on voudra. Arithmétique
décimale. Il feroit très à fouhaiter que toutes les divifions,
par exemple de la liv r e , du fou , de la to ife , du jo u r , de
l ’heure, &c. fuflent de dix en dix. Ibid. b.
Décimal. Addition des décimales. I. 129. b. Arithmétique
décimale. 674. b. Fraéïions" décimales. V I I . 265. b. Fraéïions
décimales périodiques. Suppl. III. 110. b. 113.6.
D é c im a l . ( Jurifpr. ) Droit décimal : matière décimale.
IV . 670. a.
D E C IM A TEU R . ( Jurifpr. ) Différence entre le décima-
teur & le dixmeur. Gros décimateur : décimateur eccléfiaf-
tique , laïc. Charges auxquelles font tenus les gros décima-
teiurs. IV . 670. a.
Dicilutmr. C h B impofées aux décimateurs. IV . 1094.
Des codécimateurs. III. 586. a. Des curés gros décimateurs.
IV . 574. b. On doit avertir les décimateurs avant de commencer
la récolte. IV . 1093. b. Sur les décimateurs, voye^
DlXME. iV . 1090. b.— 1090. a.
D E C IM A T IO N , (Hift. rom. ) auteurs à confulter fur ce
fujet. Pour quels crimes cette peine étoit infligée aux foldats.
Comment s ’exécutoit la décimation. On fe tromperoit beaucoup
de croire qu’il y ait dans un corps aucun crime qui
puiffe être regardé comme un crime égal dans chaque particulier
qui compofe ce corps. 11 fuit delà que les peines qui
tomberoient fur le corps doivent être très - douces & de
courte durée. IV . 670. a. La décimation répondoit à cette
maxime. Ibid. b. Voyeç DÉCIMER.
D EC IM E , ( Hift. Jurifpr. ) ancien droit que nos rois
levoient fur tous leurs fujets. Dans la fuite le terme de
décime efl demeuré propre aux fubventions que les ecclé-
fiaftiques paient au roi. Le mot décima a été appliqué d’abord
à la dixme , & enfuite aux décimes. Premier« levée faite en
France , qui a été qualifiée de décime, dixme ou décime fala-
d'ine. Autres fubventions levées dans la fuite du dixième, du
cinquantième, du centième, également appellées décimes. Il
y eut auffi des doubles-décimes y 8c des demi-décimes. Enfin
ce nom efl demeuré à toutes lés levées qui fe font fur le
clergé. Ibid. b. Croifades contre les hérétiques & les excom-
munies qui donnèrent lieu à de nouvelles décimes. Les papes
en levoient auffi pour leurs guerres, & les fouverains quj
en partageoient le profit permettoient qu’elles fuffent levées
dans leurs états. Affaires entre Boniface V I I I 8c Philippe-Ic-
b e l, fur une décime-centieme. D es décimes levées en France
par les papes ; levée d’un demi-dixième ordonnée par le
concile de Baffe. Ibid. 671. a. Derniere décime papale qui
a été levée en France. Des décimes royales. Les fubventions
fournies par le clergé en particulier frirent quelquefois
appellées aides & non pas décimes. Toutes les décimes
& autres fubventions des eccléfiafliques, ont toujours été
levées de l’autorité du r o i , 8c fans attendre le confentement
du cle rgé , jufqu’au régné de Charles IX. Bulles que don-
noient les papes pour approuver ces levées , à deffein d’en
obtenir une partie , &c. Il y eut plufieurs ôccafions où l’on
en leva de la feule autorité du roi fans l’intervention de
ces bulles, & depuis plus de deux fiecles il n’en a plus
paru. Ibid. b. Hiftoire des décimes levées en France dès le
régné de Philippe-Augufte. Quatre décimes levées fous ce
régné. Le régné de Louis V I I I , n’offre qu’un feul exemple
de levée faite fur le clergé en 1226. Celles qui ont été
faites fous S. Louis : en moins de 20 an s , il tira du clergé
treize décimes ou fubventions. Ibid. 672. a. Sous Philippe
le hardi, il y en eut deux différentes. Pendant le régné de
Philippe-le-bel on compte au moins 21 décimes. Dtverfes
occafions dans lefquelles elles frirent levées : in tervention
des papes qui s’arrogeoient le droit de les accorder. Boni-
face V II I voulut de fa part le ve r auffi pour lui une décime,
mais Philippe-le-bel s’y oppofa. Suites de cette oppofition :
bulles données en 1296 8c en 1297. Principaux articles renfermés
dans cette derniere, dans laquelle , le pape recon-
noît formellement, que l’ufage de demander au clergé des
fubventions efl un droit de la couronne. Autre bulle donnée
l’année fuivante. Cependant Boniface V II I & fes fucceffeurs
accordèrent encore des décimes à Philippe-le-bel. Ibid. 669.
a. Autres levées faites fans le confentement des papes pour
la guerre de Flandres. Double décime ou cinquième impofée
par Philippe-le-bel en 1305. Il en leva d’autres encore les
années fuivantes. Décinies levées fous Louis Hutin : fous
Philippe V , dit le lo n g , il n’y eut pas de levées. Ibid. b.
Décimes accordées par le pap'e à Charles IV , dit le b e l ,
& à Philippe V I , dit de Valois. Régné du roi Jeàn. D é cimes
levées fous ce régné : fon ordonnance donnée en
13 5 5 par rapport à la fubvention qui lui fut accordée par
les états afîemblés à Paris pour la guerre contre les A n -
glois. Ibid. 674. a. Autres ordonnances relatives aux mêmes
objets, l’une de 13 3 5 , l’autre de 1336. Aides qui furent
levees pendant la captivité du roi. Ordonnance du dauphin
Charles, régent du royaume,- donnée en 1338; Ibid. b. Privilèges
accordés à l’évêque de Mende par Philippe-le-bel ,
& confirmés par Charles V , il efl queflion des décimes.
Décimes accordées par le pape à Louis duc d’A n jo u , régent
du royaume , pendant la minorité de Charles V I . Les A n -
glois devinrent fi puiffans en France ,qu e les états du royaume
accordèrent au roi d’Angleterre une taille impofée fur tous
les fujets. Décime accordée par le clergé à Louis XI. D é cime
levée fous Louis X I I pour une croifade contre les
Turcs. Jufqu’ici les décimes n’étoient point encore ordinaires.
On tient qu’elles devinrent annuelles depuis la négociation
du concordat entre Léon X & François I. Ibid. 673.
a. Il paroît cependant qu’elles ne l’étoient point encore en
1337. Levées faites fous François I , fans qu’il fût queftion
du confentement des papes. C e qui fe pafla de remarquable
fur ce fujet à la tenue'du lit de juflice en 1327 , le 20
décembre. Ibid. b. La guerre -qui fe préparoit en 1334 ,
obligea François I de s’aider encore du revenu temporel
-de l’églife , ce qui obligea les eccléfiafliques à lui offrir
trois décimes. On continua .de le ve r des décimes jufqu’au
décès de François I ; elles fubfiflerent pareillement fous
Henri H. Offres généreufes que fit le clergé à ce;.Prince
par la bouche du cardinal.de Bourbon, lorlque Henri eut
expofé là nouvelle guerre qu’il alloit foutenir en 1331.
Ibid. 676. a. L e clergé accorda encore à ce prince en 13 3 7 ,
forcent mille écus. Les décimes furent levées jufqu’en 1.361.
L ’on avoit confondu jùfqu’alors les décimes avec les dons
gratuits ou charitatifs. C e ne fut que depuis le contrat de
Poiffy en 1361 , que ces deux objets furent diflingués.
Objet du contrat de Poiffy : origine des rentes fur le clergé.
Les affemblées du clergé devenues plus fréquentes depuis
ce contrat : 8c enfuite rendues décennales dëpuis le commencement
du fiecle dernier. Nouveau contrat paffé avec
le roi en 1380 : lé terme pris par le contrat de Poiffy 8c
par celui de 1580 étant expiré , il fut renouvellé à Paris
par le clergé en 1386 pour dix années, 8c depuis lo r s , il
a toujours été renouvellé de dix ans en dix ans. Ibid, b.
Ce s rentes dont le clergé efl chargé forment ce qu’on
appelle les anciennes décimes du les décimes du contrat. C e
•qu’on entend par les décimes extraordinaires. C e qui les
concerne efl expliqué aux mots Don gratuit 8c Subvention.
Comqiem fe paient les décinies anciennes ou ordinaires,
D E C
Sc les extraordinaires. L ’impofition des unes 8c des à titres
ne peut être faite que par lettres-patentes duement enregif-
trées Elus 8c receveurs pour le fait des impofitions: fur le
clergé. Comment fe fait la répartition des décimes 8c autres
impofitions. Ibid. 677. a. Communautés qui ne font point
commifes dans les rôles des décimes ordinaires. Les décimes
ont lieu dans toutes les provinces , excepté dans les évêchés
de M e tz , T o u l 8c Verdun , l’A rto is , la Flandre fran-
çoife ,• la Franche-comté, l ’Alfacp 8c le Roulfillon : entre
ces p a y s , il y en a quelques-uns où les eccléfiafliques fe
prétendent exempts de. toute impofition, d’autres où ils paient
quelques droits. Il y a quelques provinces du nombre de
celles où les décimes ont l ie u , qui font abonnées avec le
clergé à une certaine fomme. Taxe arrêtée fur les curés.
Ibid. b. On peut demander au bénéficier trente années de
décimes , lorfqu’elles font échues de fon tems ; fes héritiers
en font pareillement tenus 3 &c. D e ce que peuvent devoir
les fucceffeurs au bénéfice/ Termes du paiement annuel
des décimes. Comment fe fait la répartition des décimes
extraordinaires. D e ceux qui ont penfion fur bénéfices. Les
faifies pour décimes font privilégiées. Des perfonnes pré-
pofées à la levée des décimes ordinaires 8c extraordinaires.
C e qui a été établi à cet égard dans les divers tems de la
monarchie. Ibid. 678. a. Les receveurs en titre ont des
provisions, &c. Exemptions dont ils jouiffent. Divers officier
s , établis 8c fupprimés en différens tems, pour le recouvrement
des décimes. Ibid. b. Comptes que les receveurs
des décimes doivent rendre de leur recette. Receveur général
du clergé. Des conteflations qui peuvent naître au
fujet des décimes. Etabliffement des bureaux diocéfains ou
chambres' particulières. Moyen de fe pourvoir contre la taxe
impofée. Recueil, mémoires, &c. à confulter fur cette matière.
Ibid. 679. a.
Décime, v o y e z Don-Gratuit. Impofitions mifes autrefois
fur les eccléfiafliques en France. VIII. 380. b. 581. a.
Colleéteurs des décimes. III. 630. b. Elus des décimes. V .
331. b. Commiffaires des décimes.III. 707. b. Décime Sala-
dine. IV . 1097. a.
Décime centième. IV . 679. a.
Décime cinquantième. IV . 679. a.
Décime des clameurs. IV . 679. 6.
Décime entière. IV . 679. &
Décime extraordinaire. IV . 679. b.
Décimes ordinaires. IV . 679. b.
Décimes papales. IV . 679. b.
Décime pafchaline. IV . 679. b.
Décime faladine. IV . 679. b.
D É C IM ER une troupe. Cas particulier où l’on s’efl fervi
en France de cette exécution. IV . 679. b. Voye[ Décimation.
D É C IS IO N , ( Jurifpr. ) IV . 679.6.
DÉCISION y résolution. ( Synon. ) X IV . 179. 6.
D E C IS IO N E S BU R D IG A L E N S E S . IV . 680. a.
Dêcifions de la chapelle de Touloufe. Contenu de ce
recueil. Q u el en efl l’auteur. Additions d’Aufrerius. IV .
680. a.
Dêcifions du cönfeil. IV . 680. a,
Dêcifions de Juftiniën. IV . 680. a.
Dêcifions de la Rote. IV . 680. a:
Dêcifions eccléfiafliques ou des conciles. III. 812. a , 6.
Code- des dêcifions pieufes. 372. a. Appel des dêcifions. du
pape à celles des conciles. 817. a , b.
D É C ISO IR E , ( Jurifpr. ) moyens /hw-décifoires. Serment
décifoire. IV . 680. a. Voye[ Serment.
D E C IU S , {Hift. des Emp.) Cneus Metius Quintus Trajanus
Decius, Parménien de naiffance. Hiftoire de cet empereur.
Suppl. II. 683. a.
Decius M u s , ( Hift. rom. ) l’hiftoire fait mention de trois
perfonnages de-ce nom , pere , fils 8ç petit-fils qui fe d évouèrent
en différentes occafions1'pour le falut de leur patrie.
Suppl. II. 683. 6.'
Decius, dévouement des Deciüs. IV . 921. a. 922. a.
D É C L AM A T IO N , ( Belles leti. ) art de rendre le difcours.
Chaque mouvement de l’ame a fon expreffion naturelle dans
les traits du vifag e, dans le gefte 8c dans la voix. D e ces
fignes naturels réduits en reg le , on a compofé l’art de la
déclamations IV . 680. a.
Déclamation théatrale. La déclamation naturelle donna naiffance
à la mufique, la nnifique à la poèfie, la müfiqué 8c la
poéfie" à leur-tour firent un art de la déclamation. Etat de
la déclamation, lorfqu’Efehyle fit paffer la tragédie du chariot
de Thefpis fur le théâtre d Athènes. La déclamation tragique
fut d’abord un chant mufical. Quelle étoit la déclamation
théatrale lorfqu’Efehyle eût . donné ides interlocuteurs à la
tragédie'. Sentiment de M. D ad e r y de l’abbé Vatri fur ce
-fujet. Cette difpute difficile: à terminer: eft plus .çurieufe
qu’intéreffahte. Ufage des mafqués fur les théatres d’Athen es
oc de Rome. C e qui .a pu rendre cet ufage fuppórtable. IV .
680. 6. Défautde proportion dans l’qélçur,, qui rélùltou. de
D E C 467
l’exhaufferrient du codiurrte. Il efl à préfumer cependant qua
les anciens avoient porté le gefte au plus haut degré d’ex-
preffion. Imperfection attachée au jeu muet des pantomime«
auxquels fe portoient les Romains avec une efpèce de fureur
du tems d’Augufte. Etat de la déclamation lors de la
renaiffance des lettres en Europe. Ibid. 681 ; a. L’art ne fit que
s’éloigner de plus en plus de la nature, jufqu’à ce qu?un
homme e xtraordinaire,Baron,l’éleve d eM o lie re , ofa tout-
à-coup l 'y ramener. Caraétere de la déclamation de cet
afreur. C e prodige fit oublier tout ce qui l’avoit précédé *
8c fut le digne modèle de tout ce qui devoit le fuivre. Bientôt
on v it s’élever Beaubourg. Caraétere de fon jeu. Compa-
raifoa de Baron 8c de Beaubourg. D e mademoifelle le Couvreur.
Efforts qu’elle eut à faire pour corriger en elle la
nature. Ibid, b. D e la déclamation comique: en quoi confifte
fa perfeélion. Réflexion fur la déclamation théâtrale en géné;
ral : quelle éft l’éxagération permife. L’emploi du comédien
eft de remplir l’intention du p oète, 8c l’attente du fpeélateur :
or le feul moyen de parvenir à ce but, eft de reffembler à
ce qu’on imite. D e l’ufage des vers dans la tragédie: .une
proie nombreufe eft préférable aux vers. Ibid. 682. a. L e
héros difparoît dès qu’on apperçoit le comédien ou le poète;
Choix de la belle nature, point important 8c difficile de l’art
de la déclamation. Dans quelles fources le comédien doit
puifer la belle nature ; la première eft l’éducation, la féconds
leroit le jeu d’un aéteur confommé. Exemples où la déclamation
de Baron fe failoit fur-tout admirer. D e tels exem-»
pies devroient être fans ceffe préfens à ceux qui courent la
même carrière. Ibid. b. . La troifieme c’eft l’étude des monu-,
mens de l’antiquité. Avantages qu’a tirés de cette étude M ,
Chaffé, aéleur de la feene lyrique. La quatrième enfin, c’eft
l’étude des originaux:1e monde eft l’école d’un comédien,
&c. L ’étude de l’hiftoire 8c des ouvrages d’imagination, eft
pour lui ce qu’elle eft pour le peintre 8c le fculpteur. Les
livres ne préfentent point de modèle aux y e u x , mais ils en
offrent à l’efprit. Exemples tirés de Virgile 8c de Lucain.
Talens naturels que doit pofféder le comédien. Caufes d’une
déclamation défeétueufe. Ibid. 682. a. L ’auteur à qui la nature
a refufé les avantages. de la figure 8c de l’organe, veut y
fuppléer à force d’art j mais les moyens qu’il emploie, au
lieu de corriger la n ature, la rendent monftrueufe. A l ’égard
de la v o ix ,il en faut moins qu’on n e penfe. pour être entendu
dans nos falles de fpéétacle. Avantage admirable que fut
tirer une aétrice d’un épuifement de v o ix dans la déclaration
de Phedre. Quelles reffources n’a pas fur la feene tragique
celui qui joint une v o ix flexible, fonore 8c touchante , à une
figure expreffive 8c majeftueufel.Une déclamation fimple ne doit
point être confondue avec une déclamation froide. Quand
les paffions font à leur comble, le jeu le plus fort eft le plus
vrai,..,. Mais elles doivent avoir dans le ftyle leurs gradations
8c leurs nuances, &c. Ibid. b. Nous rions quelquefois
de ce qui auroit pénétré les Athéniens de terreur ou de
pitié? Une vaine dèlicateffe, un défaut de vigueur dans
l’ame, ou le goût méprifable des parodies , en font caufe.
Complaifance blâmable des poètes en faveur de ces hommes
qu’afteéle machinalement une déclamation outrée. En quoi
confifte la beauté dans les vers : quel doit être le genre de
déclamation analogue à telle ou telle beauté : c’eft par l’artifice
du comédien que le poète cherche à cacher quelquefois
la foibleffe de fes vers. Corneille ne demandoit pour fpe-
élateurs qu’un parterre compofé de marchands de la rue
S. Denis. Applaudiffement que mademoifelle Clairon reçut
un jour d’un tel fpeélateur. Défauts de la part du poète qui
peuvent jetter l’aéteur hors de la déclamation naturelle. Des
geftes. C e qui a été dit de la parole peut s’appliquer au gefte.
Ibid. 684. a. Effets d’une fauffe dèlicateffe. Gefte propre à
chaque paffion. Q u i font ceux, qui ont befoin de peu de
geftes. Situations dans lefquelles les geftes doivent être rares
8c très-modérés. Notre avantage fur les anciens par rapport
à l’expreffion.Ce qu’on entend par jeu mixte ou compofé. Ibid. b.
Le comédien a toujours au moins trois expreffions à réunir ;
celle du fentiment, celle du caraélere, 8c celle de la fitua-
tion. Lorfque deux ou plufieurs fentimens agitent une
ame , ils doivent fe peindre en même tems dans les
traits 8c dans la v o ix , même à travers les efforts qu’on fait
pour les diffimuler. Du jeu muet. Il n’eft point de feene où
cette efpece d’aétion ne doive entrer dans les filences. Le jeu
muet doit être une expreffion contrainte, 8c un mouvement
réprimé. Circonflance où le poète fait taire l’aélëur à contre-
terns. Ibid. 685. a. Q u el doit être alors fon jeu. Exemple
de mademoifelle Clairon dans un cas femblable.- Des repos
de la déclamation. Avantages de la déclamation muette
fur la parole. L ’aéteur. qui lent vivement ,. trouve, toujours
dans l’expreffion du poète affez de yuide à remplir. Silence
de Baron dans le rôle d’Ulyffe. Silence auquel Racine donne
lieu dans le rôle de Phedre. Ibid, 6. Silence de Barneweld
avec fon ami. C e qu’il faut de la part du public pour^encou-
rager les auteurs & les aétcuvs à chercher les grands effets
Ibid. 686« a%