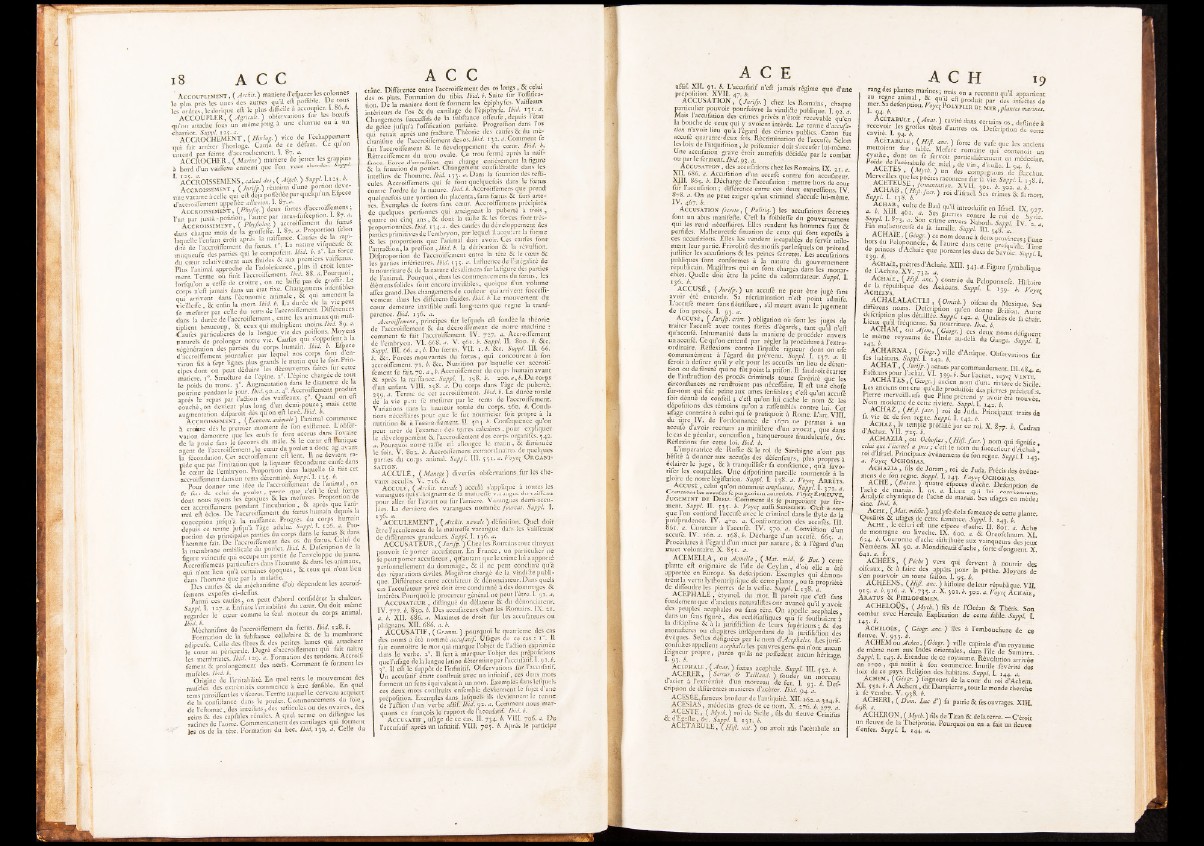
i 8 A C C A C C
Accouplement , ( Archit. ) maniéré d’efpacer les colonnes
le plus près les unes des. autres qu’il eft poffible. D e tous
le s ordres, ledorlque eft le plus difficile à accoupler, 1. 8S. k
A C C O U P L E R , ( Asricult. ) obiervanons lur les poeuts
qu ’on attache fous un même jong à Une charrue ou a un
•charriot. SuppL 1 1 5 .^ , . , . ___I
A C C R O CH EM Ê N T , ( Horlog. ) v ice de 1 échappement
qui feit arrêter l’horloge. Gaule de ce défaut. C e q uon
entend par feinte d’accroehement. ï . 87. a.
A C C R O C H E R , ( Marine) maniéré de jetter les grappins
à bord d’un vaiffeau ennemi que l’on veut aborder.
S P ^ C R O IS S EM EN S , calcul des, Ç Algeb. )rSitppl.B S | k
A ccro is sem en t , J jurifp.) r éu n ion du ne portion t i e nne
vacante à celle qui eft dejapoffèdeepar qneiqu nn,Efpece
d’accroiffement appeliée alluvion. 1. 07- a- l l B B B I
A ccro is sem en t 1 XThyfiq.) deux fort® d a c c r# em e n s
d’un par — M l ’autre par mtus-ftfcepüon. L 8 7. e.
A rrnoissEMÉNT, ( Phyjiolog. ) accroiffement du foetus ACCROISSEm en i , i rr L ^ 87. Proportion félon
dans chaque mois de la groiieue. ï. 07. a.
laquelle l’enfant croît après la naiffanpe. Caufes. de la WR
dite do l’accroiflement du foetus. i° . La niume vdqt.ct.fe &
muqueufe des parties qui le compofcnt. Ibid. b. a . L a to r c e
du coeur relativement aux fluides & aux premiers vaiffeaux.
Plus l’animal approche de l’adolefcence plus .1 croit g B
ment. Te rme mi finit l’accroiffement. IM . 88. u.Pourquoi
lorfqu'on a ce .® de croître , on ne taille pas de
coins n’cft jamais dans un état fixe. Chaugemens mfenfibloe
qui arrivent dans l’ économle atnmale St qui mnenent la
yieilleffe 8c enfifi la mo rt.,Æ ii b. L a .duree de h w j «
fe mefmer par celle du tems de l'accroiffement. Différences
dans la durere de l’hecroiffement, entre lesannuaux.qm multiplient
beaucoup, & ceux qpi multiptojn u a n H H H a H
Caufes parriculier® de la longue vie^des poiffons. Moyens,
naturels'de prolonger notre r ie . Cauf® qm s iyp o fen t a la.
régénération d® parties du corps, humam. J M b. Elpece
d'accroiffement journalier par lequel nos corps font nen-
v iron Gx à fept lignes plus grands le matin que le foir.Pnn-
cipes dont o n peut déduire les decouvertes Sûtes.fin cette-
matière. r°. s / u f f® d'e l’ épine, a” . Dépure chargée de tout
le poids du tronc. H Augmentation dans le diamètre de ta
poitrine p en d an te jour. Æ i i A c c r o i f f e m e n t prqdtut
iprès le repas par l’afhon des vaiffeaux i l » . “ “ 1 ° n elt
couché, on devient plus.lpggoffim demt-ppuce; mais cette
augmentation difparoît dès qu on eft levé. Ibid. b.
A ccroissement, (Econom. animale) lanunal commence
à crcà re dès le premier moment de l’on exiftence. L’obier-
vation démontre que les oeufs fe font accrus dans lo v aire
de la poule fans le fecours du mâle. Si le coeur eft »unique
agent de l’accroiffement, le coeur du poulet a donc agi avant
la fécondation. C e t accroiffement eft lent. I l ne devient rapide
que par l’irritation que la liqueur fécondante caule dans
le coeur de l’embryon. Proportion dans laquelle fe fait cet
accroiffement dans un tems déterminé. Suppl. 1. 1 25. b.
Pour donner une idée de l’accroiffement de Ianimal, on
fe fert de celui du p o u le t , parce que c eft le feul foetus
dont nous ayons les époques & les mefures. Proportion de
cet accroiffement pendant l’incubation, & apres que 1 animal
eft éclos. D e l’accroiffement du foetus humain depuis la
conception jufquu la naiffanee. Progrès du corps humain
depuis ce terme jufqu’à l’âge adulte. ’*• g H
pomon d® principales parti® du corps dans le 6oe & I B
l’homme fait. D e l’accroiffement des os du foetus. Celui de
la membrane ombilicale du poulet. Ibid.J>. Defeription de la
figure veineufe qui occupe un partie de 1 enveloppe du jaune.
Accroiffemens particuüers dans l’homme & dans les animaux,
qui n’ont lieu qu’à certaines époques, & ceux qui no n t heu
dans l’homme que par la maladie. , .c
Des caufes & du méchanifme d ou dépendent les accroil-
femens expofés ci-deffüs.
Parmi ces caufes, on peut d abord confidérer la chaleur.
Suppl. 1. 127. a. Enfuite l’irritabilité du coeur. O n doit même
regarder le coeur comme le feul moteur du corps animal.
Ib‘Méchanifme de l’accroiffement du foetus. Ibid. 128. b
Formation de la fubftance cellulaire & de la membrane
adipeufe. Celle des fibres & des petites lames qui attachent
le coeur au péricarde. De gré d’accroiffement qui fait naître
les membranes. W m 129, a. Formation des tendons. A ccroiffement
crâne. Différence entre l’accroiffement des os longs , & celui
des os plats. Formation du tibia. Ibid. b. Suite fur lofhhca-
tion. D e la maniéré dont fe forment les épiphyfes. Vaifleaux
intérieurs de l’os 8c du cartilage de l’épiphyfe. Ibid. i ) i . a,
Changemens fucceffffs de la fubftance offeufe,depuis-1 é tat
de gelée jufqu’à l’oflification parfaite. Progreffion dans 1 os
qui renaît après une frafture. T héorie des caufes Sc du méc
h a n t e de l’accroiffement des os. Ibid. 13 2. «. Comment fe I
fait l’accroiffement 8c le développement du coeur. Ibid, b
Rétreciffement du trou ovale. C e trou fermé apres la naii-
Caixce. Force dWra&ion qui change entièrement la ngure
& la fituation du poulet. Changement confidérable dans les
inteftins de l’homme. Ibid. 133. a. Dans la fituation des tefticules.
& prolongement des nerfs. Comment fe forment les
mufcles. Ibid. b. ,
Origine de l’irritabilité. En quel tems le mouvement des
mufcles des extrémités commence à être fenfible. En quel
tems paroiffent les vifeeres. Te rme auquel le cerveau acquiert
de la confiftance dans le poulet. Commencemens du f ç ie ,
de l’eftomac, des inteftins, des tefticules ou des o vaires, des
reins 8c des capfüies rénales. A quel terme on dilbngue les
racines de l’aorte. Commencement des cartilages qui forment
les os de la tête. Formation du bec. Ibid, 130, a. Celle du
Accroiffemens qui fe font quelquefois dans le foetus
contre l’o rdre de la nature. Ibid. b. Accroiffemens que prend
quelquefois une portion du placenta, fans foetus 8c fans artères.
Exemples de foetus fans coeur. Accroiffemens précipités
de quelques perfonnes qui atteignent la puberté à t ro is ,
quatre ou cinq an s , 8c dont la taille 8c les forces font tres-
proportionnées. Ibid. 13 4. a. des caufes du développement des
parties primitives de l’embryon, par lequel il acquiert la forme
& les proportions que l’animal doit avoir. Ces caufes font
l’attraéiion, la preffion, Ibid. b. la dérivation 8c la revulfion.
Difproportion de l’accroiffement entre la tête 8c le coeur 8c
les parties inférieures. Ibid. 135. a. Influence de l’inégalité de
la nourriture 8c de la nature desalimens fur la figure des parties
de l’animal. Pourquoi, dans les commencemens du foetus, les
élémensfolides font encore inVifibles, quoique d’un volume
affez grand. D e s changemens de couleur qui arrivent fuccefli-
vement dans les différens fluides. Ibid. b. Le mouvement du
coeur demeure invifible auffi long-tems que régné la tranf-
parence. Ibid. 13 6. a. , .
Accroiffement, principes fur lefquels eft fondée la théorie
de l’accroiffement 8c du décroiffement de notre machine :
comment fe fait l’àccfoiffement. IV . 72,7. a. Accroiffement
de l’embryon. V I . 668. a. V . 361. b. Suppl. II. 800. b. & c .
Suppl. III. 66. a , b. D u foetus. V II . 1. b. 8cc. Suppl. III. 66.
b. 8cc. Forces mouvantes du foetus., qui concourent à fon
accroiffement. 7 1 . b. 8cc. Nutrition par laquelle cet accroiffement
fe fait. 70. a , b. Accroiffement du corps humain avant
& après la naiflànce. Suppl. I. 198. b. - io o . a ,b . D u corps '
d’un enfant. VII I. 258. a. D u corps dans l’âge de puberté.
a. Terme de cet accroiffement. Ibid. b. La durée totale
de ia vie p a ît fe mefurer par le tems de l’accroiffement.
Variations dans la hauteur totale du corps. 260. b. Con ditions
néceffaires pour que le fuc nburriciier foit propre à la
nutrition 8c à l’accroiffement. II. 504. b. Conféquence qu’on
peut nrer de l’examen, des terres calcaires , pour expliquer
le développement 8c. racçroiffement des corps organifes. 342.
a. Pourquoi notre taille eft allongée lé. matin , 8c diminuée
le foir. V . 802. b. Accroiffemens extraordinaires de quelques
parties du corps animal. Suppl. III. 551. a. Voye^ ORGANISATION.
' ,
A C C U L É , ( Manège) diverfes obfervations,fur les chev
au x acculés. V . 7 1 6. b,..
ACCULÉ, ( Archit. navale ) acculé s’applique à toutes les
v arangues qui s’éloignent de la maîtreffë varangue du vaiffeau,
pour aller fur l’avant ou fur l’arriere. Varangues demi-accu^
lées. La derniere des varangues nommée fourcat. Suppl. I.
:3b. a.
A C C U L EM E N T , ( Archit. navale ) définition. Q u e l doit
être l’acculement de la maîtreffe varangue dans les vaiffeaux:
de différentes grandeurs. SuppL I. 136. a.
A C C U S A T E U R , ( Jurifp. ) Chez les Romains tout c itoyen
pouvoit fe porter accufateur. En France, un particulier ne
fe peut porter accufateur, qu’autant que le crime lui a apporté
perfonnellement du dommage, 8c il ne peut conclure qu’à
des réparations civiles. Magiftrat chargé de la vindicte publique.
Différence entre accufateur 8c dénonciateur. Dans quels
cas l’accufateur privé doit être condamné à des dommages 8c
intérêts. Pourquoi le procureur général ne peut l’être. I. 91 .a .
A ccusateur , diftingué du délateur 8c du dénonciateur.
IV . 777 . b. 830. b. Des accufateurs chez les Romains. IX. 21.
a. b. XII. 686. a. Maximes de droit fur les accufateurs ou
plaignanSi XII. 686. a. b. - • _ . -ff.-
A C C U S A T IF , ( Gramrn. ) ^pourquoi le quatrième des cas
des noms a été nommé accujatif. Ufages dé ce cas : 1 . Il
fait connoître le m ot qui marque l’objet de l’aélion exprimée
dans lé verbe. 20. Il fert à marquer l’objet des p r o f i t io n s
quel’ufage de la langue latine détermine par l’accuiatif. 1 . 91 .b.
30. Il eft le fuppôt de l’infinitif. Obfervations fur- l àccufatif.
Un accufatif étant confirait a v e c un infinitif, ces deux mots
forment un lens équivalent à un nom. Exemplès dans lefquels
ces deux mots conftruits enfemble deviennent le fujet d’une
prépofition. Exemples dans lefquels ils deviennent le terme
de l’aéïion d’un verbe aélif. Ibid. 92; a. Comment nous marquons
en françois le rapport dè l’accufatifi Ibid. b.
A ccusatif , ufage dé ce cas. II. 734. b. VIII. 706. a. D e
l’accufatif après un infinitif. VIII; 703. b. Après le participe
A C E
§ l i i 9\ J \. L’accufatif n’eft jamais régime que d’une
prépofition. XV II . 47. b.
A C C U S A T IO N , ( Jurifp. ) chez les Romains, chaque
particulier pouvoit pourfuivre la vindifte publique. I. 02. a.
Mais l’accufation des crimes privés n’étoit recevable qu’en
la bouche de ceux qui y avoient intérêt. L e terme d'accufa-
tton n’avoir lieu qu’à l’égard des crimes publics. rCaton fut
acculé quarante-deux fois. Récrimination de l’accufé- Selon
les loix de l’mquifition, le prifonnier doit s’accufer lui-même.
Une accufation grave étoit autrefois décidée par le combat
ou par le ferment. Ibid. 93. a,
A ccusation, des accufàtions chez les Romains. IX. n . a.
XII. 686. a. Accufation d’un accufé contre fon accufateur.
X I IL 863. b. Décharge de l’accufation : mettre hors de cour
fur l’accufation ; différence entre ces deux expreffions. IV .
878. a. O n ne peut exiger qu’un criminel s’accufe lui-même.
IV . 467. b.
A ccusation fecrete, ( Politiq. ) les accufations fecretes
font un abus manifefte. C ’eft la foibleffe du gouvernement
qui les rend néceffaires. Elles rendent les hommes faiix &
perfides. Malheureufe fituation de ceux qui font expofés à
ces accufations. Elles les rendent incapables de fervir utilement
leur partie. Frivolité des m otifs par lefquels on prétend
juftifier les accufations 8c les peines fecretes. Les accufations
publiques font conformes à la nature du gouvernement
républicain. Magiftrats qui en font chargés dans les monarchies.
Q u elle doit être la peine du calomniateur. Suppl. I.
136. b. r r
A C C U S É , ( Jurifp. ) un accufé ne peut être jugé fans
avoir été entendu. Sa récrimination n’eft point admife.
L ’accufé meurt fans flétriflure, s’il meurt avant le jugement
de fon procès. I. 93. a.
A ccusé , ( Jurifp. crim. ) obligation ou font les juges de
traiter l’accufé avec toutes fortes d’égards, tant qu’U n’eft
•qu’accufé. Inhumanité dans la maniéré de procéder envers
un accufé. C e qu’on entend par régler la procédure à l ’extraordinaire.
Réflexions contre l’injufte rigueur dont on ufe
communément à l’égard du prévenu. Suppl. I. 137, a. Il
feroit à defirer qu’il y eût pour les accufés un lieu de détention
ou d e filreté qui ne fût point la prifon. I l faudrait écarter
de l’inftruftion des procès criminels toute févérité que les
circonftances ne rendraient pas néceffaire. Il eft uné chofe
fur-tout qui fait peine aux âmes feiifibles ; c’eft qu’un accufé
fo it dénué de confeil 3 c’eft qu’on lu i càclie le nom 8c les
dépofitions des témoins qu’on a raffemblés contré lui. Ce t
«fage contraire à celui qui fe pratiquoit à Rome. L’art. V II I.
du titre IV . de l’ordonnance de 1670 ne permet à un
accufé d’avoir recours au miniftere d’un a v o ca t, que dans
le cas de péculat , concuflion , banqueroute frauduleufe &c.
Réflexions fur cette loi. Ibid: b; "\r
L’impératrice de Ruflie & le roi de Sardaigne n’ont pas
héfité à donner aux accufés des défenfeurs, plus propres à
éclairer le ju g e , 8c à tranquillifer fa confciencé, qu’à favo-
rifer les coupables. Une difpofition pareille tournerait à la
gloire de notre légiflation. Suppl. I. 138 fa . Voye^ A rrêts.
A ccusé , celui qu’on nommoit ampliatus. Suppl. I. 372.
Comment les accules fepurgeoient autrefois. Voye? Épreuve
Jugement de D ieu. Comment ils fe purgeoient par ferment.
Suppl. IL 333. b. Voyei auffi Serment. C ’c À-tort
que l’on confond l’accufé a vec le criminel dans le ftyle de la
jurifprudence. IV . 470. a. Confrontation des accufés. III.
861. a. Curateur à l’accufé. IV . 370. a. Conviftion d’un
accufé. IV . 160. a. i6 8 „é . Décharge d’un accufé. 663. a.
Procédures à l’égard d’un muet par na ture, 8c à l’égard d’un
snuet volontaire. X . 831. a.
A C EM E L L A , ou Acmella, ( Mat. méd1 & Bot. ) cette
plante eft originaire de M e de C e y la n , d’où elle a été
apportée en Europe. Sa defeription. Exemples qui démontrent
la v erni lythontriptique de cette plante , ou fa propriété
de diffoudre les pierres de la veffie. Suppl. 1. 138. a.
A C E P H A L E , étymol. du mot. Il paraît que c’eft fans
fondement que d’anciens naturàliftes ont avancé qu’il y avoit
des peuples acéphales ou fans tête. O n appelle acéphales
dans un fens figuré, des eccléfiaftiques qui fe fouftraient à
la difciplme & à la jurifdiftion de leurs fupérieurs ; 8c des
monalteres ou chapitres indépendans de la jurifdiftion des
eveques. Seftes défignées par le nom d’Acéphales. Le s jurif-
çpnfultes appellent acéphales les pauvres gens qui n’ont .aucun
feigneur propre, parce qu’ils ne poffedent aucun héritage.
I. 93.[b. . ' ' ' • - P -
»“ P1’* . B M W I
A C B R ÎR , H H ■ Ü ü m
ü acier à 1 extrémité d u n morceau de fe r. I. 93. A D e feription
de différentes maniérés d’acérer. Ibid. 04. a.
ACE SÉ E , famein c brodeur de l’antiquité. XII. 162. a. •? 24. b.
A C E S IA S , médecins grecs de ce nom. X . 276. b. 277. a.
V ( Myth. ) roi de Sicile , fils du fleuve Crinifus
at. ) on avoit mis l’acétabule au
A C H 1 9
. Â d-EKefte/éî. Süppt. I. 1 .
ACETABULE, \Hifl.
a reconnu H appartient
|g ne aniinal, & q u il eft produit par d® infettes de
L 94Sai.defcr'I>tl° " ' M ïR .p W t r marins.
A cétabule , (Anat. ) cavité dans certains o s , deftinée à
recevoir les grofles têtes d’autres os. Defeription de cette
cavité. 1. 94. b.
A cétabule , ( Hift. anc. j forte de vafe que les anciens
mettoient fur tahle. M e fure 1 roniaiue qui contenoit un
P o S Ï e i T |fe ferToit, particuliérement en Médecine.
M . ti ’ “ “ des compagnons de Bacchus
M A C E T F Æ l<:S/ 0eteS raco" î ent <“ >■ ta v ie. Suppl. L r 38. i .
XVH.- t o i . b. d u a P 9
S u f f i î s ’s çoi “ 4 * ï a mo«.
a. M t l e s 1 £ r S ™ jiUif“ ? m - ëh *?■
FmPl' H H H Sd n fC'’S le enTersCN S o th .es S , f
Fin mallieureUfe de fa famille. Suppl. III. zaS # ' *
I W Ê Ê ) “ nom donné i deux provinces ’ l'une
hors du Peloponnefe, & l'autre dans cette L f S ’ l “ !
de princes dAch aie que portent 1« ducs de ;S av iie, Sïp p t'L
d e l ^ f g ^ ^ ' X I “ ' 343-n.Figure femjiolique
A c k AiE ’ (Æ Æ r n c . j contrée du Peloponnelè. Hiftoire
A chéÉns 5“e ? - ?n?- s “r fL *■ Ù 9- *■ > c £
oifeau du Mexique. S®
B H n“ “ s’ B B S ï “ ’en domle Frièdn. Autre
r f£ s “p r 1-. '-(a. Ç; Qualités de fa cliair.
L'A c â ^ *a-,nj?Prrit,11«- ibid T b.
ACH AM, ou Afcm, (Geogr.'j çes deux noms défiaient
mên
^m êm e rojrjpme de l’Inde.au-delà du Gange. S u p f l t
142. b.
°bferïa,i0<'!
_ A C H A T , C M / p . ) achats par commandement. III. 68x. a:
A i^ rlA 1 ± 0 , Geogr. ) ancien nom d’un-, riviere de Sicile
Les anciens.ont cru qu’elle prodtiifoit des pierres précieufcs
Pierre merveilfeufe que Pline prétend y îv ô i r été tro uvée'
iNom moderne de cette riviere. Suppl. I. 142. b.
A C H A Z , (H ifi./a cr .) roi de Juda. Principaux traits d e
la vie 8c de fon régné. Suppl. I. 142. b
i ’L ^ Cadran
A C H A Z ÏA , ou Ôchofas A H if t . fa c r ,\ nom qui fignifie ,
• J -a ? n s ; c e lt le nom du fucceffeur d’A ch ab ,
roi d lfrael. Principaux événemens de fon régné. Suppl. I i a %
a. Voye[ OCHOSIAS. 0 r r 4 }•
A chazia , fils de Joram, roi de Juda. Précis des événe-
mGA ^ T r% r rDeSn t\ SuPPl- I- 143. Voye^ OCHOSIAS.
A C H L , (Botan. ) quatre efpeces d’ache. Defeription de
AaCh,e / e LmanUS- j * ,L itu x fll,i lui conviennenr.
Analy fe chynuque de lâche de marais. Ses ufages en médej
cine. Ibid. b.
médic‘ ) analyfe d elà femence de cette plante.
Qualités & ufages de cette femence. Suppl. I.. 14a. b.
A c h e , le céleri eft une elpece d’ache. IL 801. a A ch e
de montagne ou liveche. IX. 600. <*. 6c Oreofeliniim. X L
624. b. Couronne d’ache diftribuée aux vainqueurs des jeux
Néméens. XI. 90. a. Mondificatifd’a che , forte d’onguent. X
641. a. b. e • •
A C H É E S , ( Pêche ) vers qui fervent à nourrir des
oifeaux, & a faire des appâts pour la pêche. Moyens de
s en pourvoir en toute faifon. I. 95. b.
A CH É E N S , (Hifl. anc. ) hiftoire de leur république. VIT,
915. a. b. 916. a. V . 733. a. X. 301. b. 302. a. Voyez ACHAÏE -
A ratus 8c Philopoemen.
A CH E LO Ü S , (M y th .) fils de l ’Q céan & Thétis. Son
•combat avec Hercule. Explication de cette fable. SuppL L
!43- 1 ‘
A cheloüs, ( Géogr. anc. ) îles à l’embouchure de ce
fleuve. V . 933. b.
A CH EM ou Achen, (Géogr. ) v ille capitale d’un royaume
de même nom aux Indes orientales, dans l’île de Sumatra.
Suppl. I. 143. b. Etendue de ce royaume. Révolution arrivée
en 170 0 , quinmfit à fon commerce. Inutile févérité des
-loix de ce pays. Religion des habitans. Suppl. I. 144. a.
A chem, ^(Géogr. ) feigneurs de la .cour du roi d’Achem.
X L 332. b..A A ch em , d it Dampierre, tout le monde cherche
a fe vendre. V . 938. b.
y Üb i k m S ( Dom. Luc■ d‘ ) fa patrie 8c fes ouvrages. X IIL
698. a.
A C H E R O N , (Myth. ) fils de Titan 8c de la terre. •— C ’étoit
un fleuve de la Thefprotie. Pourquoi on. en a fait un fleuve
d enfer. Suppl. L 144. a.