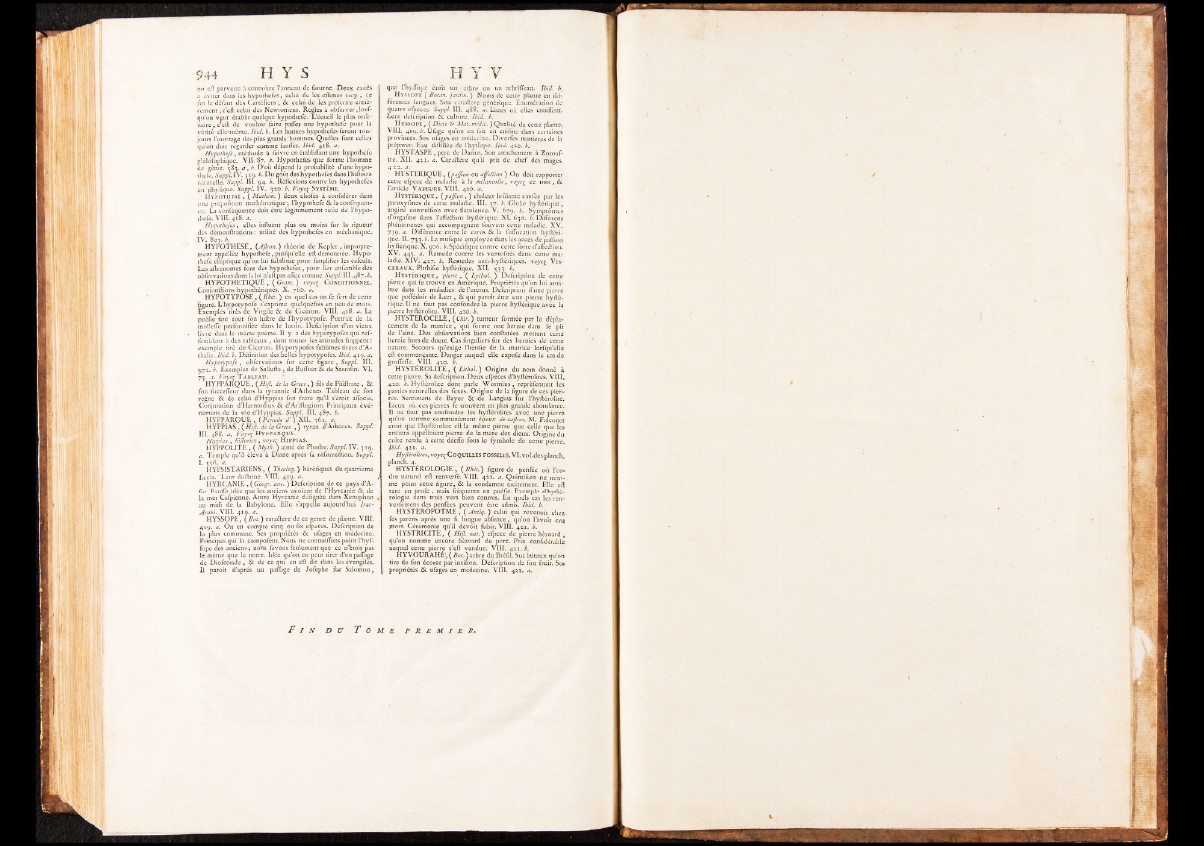
944 H Y S
on eil parvenu à connoître Vanneau de faturne. P e u * excès
à éviter dans les hypothefes, celui de les eftimcr tr o p , ce
fut le défaut des Cartéfiens ; & celui de les prpfcrire entièrement
,c ’eft celui des Newtoniens. Réglés à ob lérv er, lorf-
qu'oti veut établir quelque hypotliefe. L ’écueil le plus ordinaire,
c’eft de vouloir faire paffer une hypotliefe pour la
vérité elle-même. Ibid. b. Les bonnes hypothefes feront rou>-
jours l’ouvrage des plus grands hommes. Q uelles font celles
qu’on doit regarder comme fauffes. Ibid. 418. a.
Hyvothefe, méthode à fuivre en établiffant une hypotliefe
philofophique. V i l . 87. b. Hypothefes que forme Vhpmme
de génie. <583. a , b. D ’où dépend la probabilité d’une hypo-
thefo. Suppl. IV . 3 19. b. D u goût des hypothefes dans l’hiftoire
naturelle. Suppl. III. 94. b. Réflexions contre les hypothefes
en phyfique. Suppl. ÏV. 320. b. Voye^ Système.
Hypothese , ( Mathérn. ) deux chofes à confidérer dans
une proportion mathématique ; l’hypothefe 8c la conféquen-
ce. La conféquence doit être légitimement tirée de l’hypothefe.
VHI. 418. a.
Hypothefes, elles influent plus ou moins fur la rigueur
des démonflrations : utilité des hypothefes en méchanique.
IV . 803. b.
H Y P O TH E S E , [Afr o n .) théorie de Kepler , improprement
appellée hypothéfe, puifqu’elle eft démontrée. Hypo-
thefe elliptique qu’on lui fubftitue pour fimplifier les calculs.
j_.es agronomes font des hypothefes, pour lier enfemble des
obfervations dont la loi n’eft pas affez connue. Suppl. III .487. b.
H Y P O TH E T IQ U E , ( Gram. ) voyeç CONDITIONNEL.
ÇonjonéHons hypothétiques. X. 760. a.
H Y P O T Y P O S E , ( Rhét. ) en quel cas on fe fert de cette
Çgure. L’hypotypofe s’exprime quelquefois en peu de mots.
Exemples tirés de Virgile & de Cicéron. VIII. 418. a. La
poéfie tire tout fon luftre de l’hypotypofe. Portrait de la
molleffe perfonnifiée dans le lutrin. Defcription d'un vieux
livre dans le même poëme. Il y a des hypotypofes qui ref-
feniblent à des tableaux , dont toutes les attitudes frappent :
exemple tiré de Cicéron. Hypotypofes fublimes tirées d’A -
thalie. Ibid. b. Définition des belles hypotypofes. Ibid. 419. a.
Hypotypofe , obfervations fur cette fig u re , Suppl. III.
072. b. Exemples de Sallufte, de Bolïùet 8c de Sarrafin. V I .
75. a. Voyei TABLEAU.
H Y P P A R Q U E , {Hifl. de la Grece,) fils de Pififtrate , &
fon focceffeur dans la tyrannie d’Athenes. Tableau de fon
regne 8c de celui d’Hyppias fon frere qu’il s’étoit aflocié.
Conjuration d’Harmodius & d’Ariftogiton. Principaux évé-
nemens de la v ie d’Hyppias. Suppl. 111. 487. b.
H Y P P A R Q U E , ( Période d‘ ) XII. 361. a.
H YP P LAS, {Hifl. de la Grece , ) tyran d’Atbcncs. Suppl.
III. 488. a. Voyeç Hy p p a r q v e .
Hippias , hiflorien, voyez HlPPIAS.
H Y P PO L ITE , ( Myth. ) aimé de Phedre. Suppl. IV . 319.
a. Temple qu’il éleva à Diane après fa réfurreétion. Suppl.
I. 536. a.
HYPS1STA R IE N S , ( Théolog. ) hérétiques du quatrième
fiecle. Leur doétrine. VII I. 419. a.
H Y R C A N IE , ( Géogr. anc. ) Defcription de ce pays d’A -
fie. Fauffe idée que les anciens avoient de l’Hyrcanie 8c de
la mer Cafpienne. Autre Hyrcanie défignée dans Xenopnon
au midi de la Babylone. Elle s’appelle aujourd’hui Irac-
Arabi. VIII. 419. a.
H Y S SO P E , ( Bot. ) caraétere de ce genre de plante. VIII.
419. a. O n en conmte cinq ou fix efpeces. Defcription de
la plus commune. Ses propriétés 8c ufages en médecine.
Principes qui la compofent. Nous ne connoifibns point l ’hyf-
fope des anciens ; nous favons feulement que ce n’ètoit pas
le même que le notre. Idée qu’on en peut tirer d’un paflage
de Diofcoride-, 8c de ce qui en eft dit* dans les évangiles.
I l pàroît d’après un paflage de Jofephe fur Salomon,
H Y V
que VhyiTope ètoit un arbre ou un arbriffeau. Ibid, b.
Hyssope ( Botan. jardin. ) Noms de cette plante en différentes
langues. Son caraélere générique. Enumération de
quatre efpeces. Suppl. III. 488. a. Lieux où elles croiffent.
Leur defcription 8c culture. Ibid. b.
Hyssope, ( Diete 6* Mat. mèdic. ) Q ualité de cette plante.
VII I. 419. b. Ufage qu’on en fait en cuifine dans certaines
provinces. Ses ufages en médecine. Diverfes maniérés de la
préparer. Eau diftillée de l’hyffope. Ibid. 420. b.
H Y S T A S P E , pere de Darius. Son attachement à Zoroaf-
tre. XII. 421. a. Caraélere qu’il prit de ch e f des mages.
4 2 2 . a.
H Y S T E R IQ U E , ( pafflon ou ajfètfion ) On doit rapporter
cette efpece de maladie à la mélancolie, voyez ce m o t, 8c
l’article V apeurs. V I I I . 420. a.
Hystérique , ( pafflon, ) chaleur brûlante caufée par les
paroxyfmes de cette maladie. III. 37. b. Globe hyftérique,
angine convulfion a v e c flatulence. V . 679. b. Symptômes
d’orgafme dans l’affeéfion hyftérique. X I. 630. b. Différens
phénomènes qui accompagnent fouvent cette maladie. X V .
739. a. Différence entre le carus 8c la fuffocation hyftérique.
II. 73 3. b. La mufique employée dans les accès de paflion
hyftérique. X. 906. b. Spécifique contre cette forte d’afie&ion.
X V . 443. a. Remede contre les ventofités dans cette maladie.
X IV : 427. b. Remedes anti-hyftériques. voye^ V iscéraux.
Phthifie hyftérique. XII. 333.b .
Hystérique , pierre, ( Lythol. ) Defcription de cette
pierre qui fe trouve en Amérique. Propriétés qu’on lui attribue
dans les maladies de l’uterus. Defcription. d’une pierre
que poffédoit de L a e t , 8c qui paroît être une pierre hyftérique.
I l ne faut pas confondre la pierre hyftérique avec la
pierre hyftérolite. V I I I . 420. b.
H Y S T E R O C E L E , {Ckir. ) tumeur formée par le déplacement
de la matrice, qui forme une hernie dans le pli
de l’aine. D e s obfervations bien conftatées mettent cettè
hernie hors de doute. Cas ftnguliers fur des hernies de cette
nature. Secours qu’exige l’hernie de la matrice lorfqu’elle
eft commençante. Danger auquel elle expofe dans le cas de
groffeffe. VIII. 420. b.
H Y S T É R O L IT E , ( Lit hol. ) Origine du nom donné à
cette pierre. Sa defcription. D eu x efpeces d’hyftérolites. V I I I .
420. b. Hyftérolite dont parle W o rm iu s , repréfentant les
parties naturelles des fexes. Origine de la figure de ces pierres.
Sentimens de Bayer 8c de Langius lur l’hyftérolite.
Lieux où ces pierres le trouvent en plus grande abondance.
Il ne faut pas confondre les hyftérolites a v e c une pierrè
qu’on nomme communément bijoux de caftres. M. Falconet
croit que l’hyftérolite eft la même pierre que celle que les
anciens appelloient pierre de la mere des dieux. Origine du
culte rendu à cette déeffe fous le fymbole de cette pierre
Ibid. 421. a.
Hyflérolites, voye1 COQUILLES FOSSILES. V I . vol. des planch.
planch. 4.
H Y S T É R O L O G IE , ( Rhét. ) fi gure de penfée où l’ordre
naturel eft renverfé. V I I I . 4 2 1. a. Quintilien ne nomme
point cette figure, 8c la condamne tacitement. Elle eft
rare en profe , mais fréquente en poéfie. Exemple d’hyfté-
rologie dans trois v ers bien connus. En quels cas les ren-
verfemens des penfées peuvent être admis. Ibid. b.
H Y S T E R O PO TM E , ( Antiq. j celui qui revenoit chez
fes parens après une fi longue abfence, qu’on l’avoit cru
mort. Cérémonie qu’il devoit fubir. VII I. 421. b.
H Y S T R IC IT E , ( Hifl. n a t.j efpece de pierre bézoard ,
qu’on nomme encore bézoard de porc. Prix confidérable
auquel cette pierre s’eft vendue. VII I. 421. b.
H Y V O U R A H É 1, ( Bot. ) arbre du Bréfil. Suc laiteux qu’on
tire de fon écorce par incifion. Defcription de fon fruit. Ses
propriétés 8c ufages en médecine. VII I. 422. a.
F i n d u T o m e p r e m i e r .