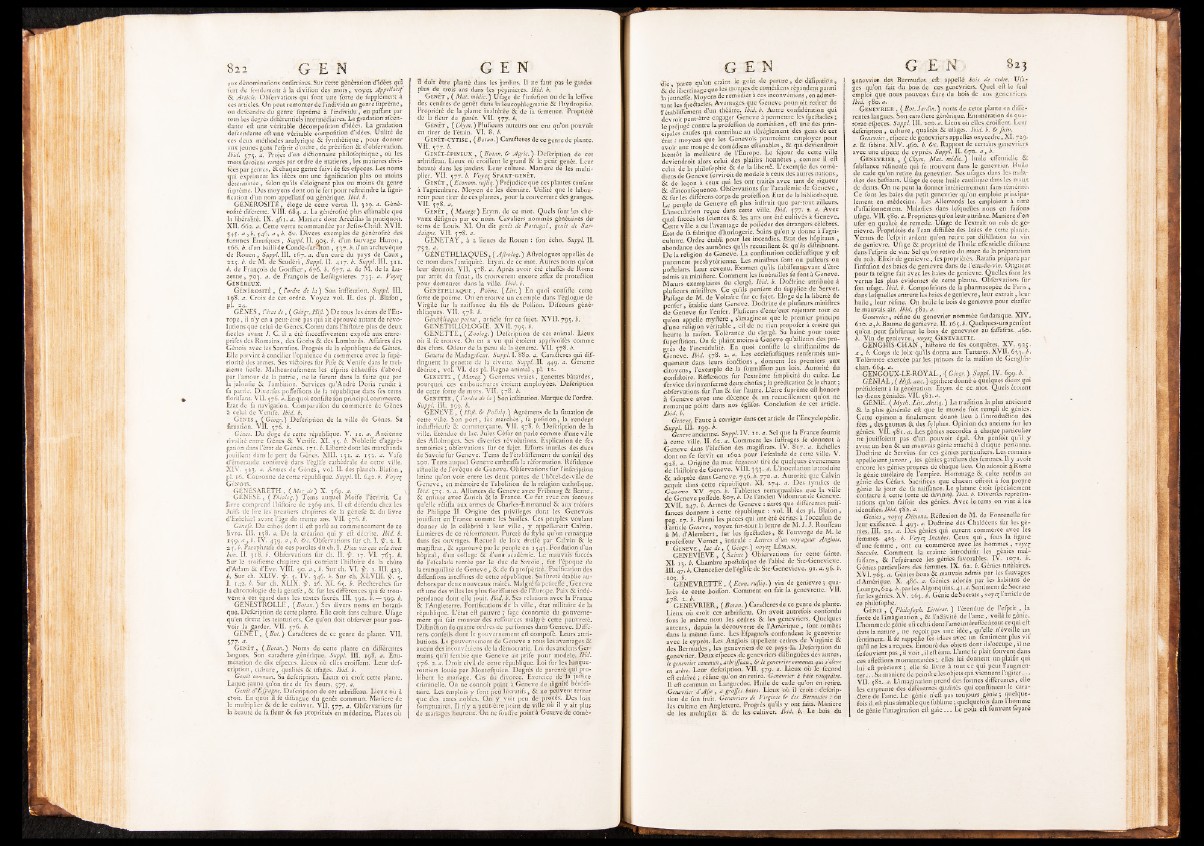
822 G E N GEN
aux dénominations ordinaires. Sur cette génération d’idées qui
fé'rt de fondement à la divifion des mors, v o y e z Appellatif
8c Article. Obfervàtions qui font une forte de fupplémerit à
ces articles. On peut remonter de l’individu au genre fuprême »
ou defcendre du genre fuprême à l’individu , en paflant par
tous les degrés différentiels intermédiaires. La gradation amendante
eft une véritable décompofition d’idées. La gradation
defcendante eft une véritable compofition d’idées. Utilité de
ces deux méthodes analytique & fynthétique, pour donner
aux jeunes gens l’efprit d’ordre, de précifion & d’obfervation.
Ibid. 5715. a. "Projet d’un diâionnaire philofophique, où les
mots feroient rangés par ordre de matières, les matières divi-
fées par genres, & chaque genre fuivi de fes efpeces. L es noms 3ui expriment les idées ont une fignification plus ou moins
éterminée H félon qu’ils s’éloignent plus ou moins du genre
fuprême. Des m oyens dont on fe fertpour reftreindre la fignification
d’un nom appellatif ou générique. Ibid. b.
G ÉN ÉRO SITÉ , éloge de cette vertu. II. 329. a. Géné-
ïo fité difcrette. VII I. 684. a. La générofité plus eftimable que
la libéralité. IX. 461. a. Maniéré dont Àfcéfilas la pratiquoit.
X II. 662. a. Cette vertu rcommandée par Jefus-Chrift. X V I I .
545. a , b. 546. a , b. &c. Divers exemples de générofité des
femmes Etrüfques, Suppl. II. 905. b. d’un fauvage Huron ,
1 66. b. d’un bailli de Condé-fur-tton, 537. b. d’un archevêque
d e Rou en, Suppl. III. 167. a. d’un curé du pays de C a u x ,
225. b. de M. de Scudéri, Suppl. II. 417. b. Suppl. III. 311.
■ b. de François de Gouffier, 676. b. 677. a. de M. de la L u zerne
, 703. a. de François de Lefdiguieres. 733. a. Voyeç
G énéreux.
G énérosité , ( Tordre de la ) Son inftitution. Suppl. III.
198. a. Croix de cet.ordre. V o y e z vol. II. des pl. Bla fon,
pl. 24.
G ÊN E S , l ’état de, ( Gèogr. Hijl. ) D e tous les états de l ’Europe
, il ii’y en a peut-être pas qui ait éprouvé autant de révolutions
que celui de Gênes. Connu dans l’hiftoire plus de deux
fiecles avant J. C . il a été fucceflïvement expolé aux entre-
prifes des Romains, des Goths & des Lombards. Affaires des
Génois avec les Sarrafins. Progrès de la république de Gênes.
Elle parvint à concilier l’opulence du commerce avec la fupé-
riorité des armes. Ses viâoires fur Pife & Venife dans le treizième
fiëcle. Malheureufement les efprits échauffés d'abord
par l ’amour de la patrie, ne le furent dans la fuite que par
la jaloufie & l’ambition. Services qu’André Doria rendit à
fa patrie. Diverfes poffeflions de la république dans fes tems ,
floriffans. V II . 576. a. En quoi confifte fon principal commerce.
Etat de fa navigation. Comparaifon du commerce de Gênes
à celui de Venife. Ibid. b.
Gênes , ( Gèogr. ) Defcription de la v ille de Gênes. Sa
fituation. V IL 576. b.
Gênes. Du doge de cette république. V . 11 . a. Ancienne
rivalité entre Gênes & Venife. X L 5 5- b. Nobleffe d’aggré-
gation dans l’état de Gènes. 17 1 . b. Liberté dont les marchands
jouiflent dans lé port de Gênes. XIII. 131. a. 152. a. Vafe
d’émeraude confervé dans l’églife cathédrale de cette ville.
X IV . 523. a. Armes de Gênes , vol. II. des planch. Blafon ,
pl. 16. Couronne de cette république. Suppl. II. 642. b. Voycç
G énois.
GÉN ÉSARETH , ( Mer de) X . 369. a.
G ÉN E SE , ( Théolog. ) Tems auquel Moïfe l’écrivit. C e
livre comprend l’hiftoire de 2369 ans. Il eft défendu chez les
Juifs de lire les premiers chapitres de la génefe 8c du livre
d’Ezéchiel avant l’âge de trente ans. VII . 576. b.
Génefe. D u cahos dont il eft parlé au commencement de ce
livre.. III. 158. a. D e la création qui y eft décrite. Ibid. b.
159. a , b. IV . 439. a , b. &c. Obfervàtions fur ch. I. ÿ . 2. I.
25. b. Paraphrafe de ces paroles du ch. I. Dieu vit que cela étoit
bon. II. 318. b. Obfervàtions fur ch. II. fr. 17. V I. 763. b.
Sur le troifieme chapitre qui contient l’hiftoire de la chute
d’Adam 8t d’Eve. VII I. 90. a , b. Sur ch. V I. fr. 2. III. 423.
b. Sur ch. X L IV . jlr. 5. IV . 346. b. Sur ch. XLVI II. ÿ . 5.
I. 142. b. Sur ch. X L 1X . fr. 26. X I. 65. b. Recherches fur
la chronologie de la g én efe, 8c fur les différences qui fe trouvent
à cet égard dans les textes facrés. III. 392. b. — 399. b.
GÉN ESTk O L LE , ( Bolan. ) Ses divers noms en botanique.
Defcription de cette plante. Elle croît fans culture. Ufage
qu’en tirent les teinturiers. C e qu’on doit obferver pour pouvo
ir la garder. V II . 576. b.
G E N E T , (B o t.) Caraâeres de ce genre de plante. VII.
577- a-
Genêt , ( Botan. ) Noms de cette plante en différentes
langues. Son caraâere générique. Suppl. III. 198. a. Enumération
de dix efpeces. Lieux où elles croiffent. Leur defcription
, culture, qualités 8c ufages. Ibid. b.
Genêt commun. Sa defcription. Lieux où croit cette plante.
Laque jaune qu’on tire de fes fleurs. 577. a.
Genêt cCEfpagne. D efc ription de cet arbriffeau. Lieux où il
croît. En quoi il fe difl'mgue du genêt commun. Maniéré de
le multiplier 8c de le cultiver. VII. 577. a. Obfervàtions fur
la beauté de fa fleur 8c fes propriétés en médecine. Places où
n dort être planté dans les jardins. Il ne faut pas .le garder
plus de trois ans dans'les pépinières. Ibid. b.
G enêt , ( Mat. rnédic.) Ufage de l’infufion ôu de l’a lefllve
des cendres de genêt dans la leucophlegmatie ,8c l’hydropifie.
Propriété de la plante inaltérée 8c de fa femence. Propriété
de la fleur de genêts V IL 577. b.
G e n ê t , ( C/iyrn. ) Plufieurs auteurs ont cru qu’on pouvoit
en tirer de l’étain. V L 8. h
G enêt-c y t is e , (Botan.) Caraâeres de ce genre de p lante.
V I I . 377. b.
G enêt-épineux , (Botan. & Agric. ) - Defcription de cet •
arbriffeau. Lieux où croiffent le grand 8c le petit genêt. Leur
beauté dans les jardins. Leur culture. Maniéré de les multiplier.
V I I . 377. b. Voye[ SPART-GENÊT.
G en ê t , (Econom. rufliq.) Préjudice que ces plantes caufent
à l'agriculture. Moyen de les détruite. Utilité que le laboureur
peut tirer de ces plantes, pour la couverture des granges.
V I I . 578 . s . M M
G e n ê t , (Manege) Etym. de ce mot. Q uels fönt les chevaux
défignés par ce nom. Cavaliers nommés génétaires dir
tems de Louis. XI. O n dit genêt de Portugal y genêt de Sardaigne.
VII . 378. a.
G Ë N E T A Y , à a lieues de Rouen i fön écho. Suppl. IL
G É N É TH L ÏA Q U E S , (Aftrolog.) Aftrolögues appellés de
ce nom dans l’antiquité. Etym. de ce mot. Autres noms qu’on
leur donnoit. V I I . 378. a. Après avoir été chaffés de Rome
par arrêt du fén a t , ils trouvèrent encore affez de proteâion
pour demeurer dans la ville. Ibid. b.
G én é th l ia q u e , Poeme. (L i t t .) En quoi confifte cette
forte de poème. On en trouve un exemple dans l’églogue de
Virgile lùr la naiffance du fils de Pollion. Difcours géhé-
thliaques. VII. 378. b.
Génèthliaque poème , article fur ce fujet. X V I I . 793. b.
G ÉN É TH LIO LOG IE . X V IL 79 3. b.
G E N E T T E , (Zo o log .) Defcription de cet animal. Lieux
où il fe trouve. On en a v u qui étoient appriyoifés comme
des chats. Odeur de la peau de la genette. V II . 378. b.
Genette de Madagafcar. Suppl. I. 880. a. Caractères qui distinguent
la genette de la civette. Suppl. .11. 449. a. Genette
décrite, vo l. V L des pl. Regne animal, pl, i'2.
G enette , ( Maneg. ) Genettes v raie s , genettes bâtardes,
pourquoi ces embouchures étoient employées.' Defcription
de cette forte de mors. V I I . 378. b.
G enette , ( l ’ordre de la ) Son inftitution. Marque de l’ordre.
Suppl. III. 199. b.
G E N E V E , ( Hiß. & Politiq. ) Agrémens de la fituation de
cette ville. Son p o r t , fes marchés , fa pofition, la rendent
induflrieufe & commerçante. V II . 378. b. Defcription de la
ville. Etendue du lac. Jules Céfar en parle comme d’une ville
des Allobroges. Ses diverfes révolutions. Explication de fes
armoiries; obfervàtions fur ce fujet. Efforts inutiles des ducs
de Savoie fur Geneve. Tems de l’établiffement du confeil des
200. Tems auquel Geneve embraffala réformation. Réfidence
aâuelle dé l ’évêque de Geneve. Obfervàtions fur l’infcription
latine qu’on v o it entre les deux portes de l’hÔtel-de-ville de
G e n e v e , en mémoire de l’abolition de la religion catholique,
Ibid. 373. 2. a. Alliances de Geneve avec Fribourg 8c Berne,
8c enfuice avec Zurich 8c la France. C e fut avec ces fecours
qu’elle réfifta aux armes de Charles-Emmanuel 8c àijx tréfors
de Philippe II Origine des privilèges dont les Genevois
jouiflent en France comme les Suifles. Ces peuples voulant
donner de la célébrité à leur v i l le , y appelèrent Calvin.
Lumières de ce réformateur. Pureté de ftyle qu’on remarqua
dans fes ouvrages. Recueil de. loix dreflé par Calvin 8c le
magiftfat, 8c approuvé par le peuple en 1343. Fondation d ’un
hôpital, d’un college 8c d’une académie. L e mauvais' fucces
de l’efcalade tentée par le duc de Savoie., fut l’époque de
la tranquillité de Geneve , 8c.de fa profpérité. Pacification des
diffenfions inteftines de cette république. Sa fureté établie au-
dehors par deux nouveaux traités. Malgré fa petitefle, Geneve
eft une des villes les plus floriflarites de l’Europe. Paix 8c indépendance
dont elle jouit. Ibid. b. Ses relations avec la France
8c l’Angleterre. Fortifications1'de la v ille , état militaire de la
république. L’état eft pauvre ; fagC économie du gouvernement
qui fait trouver des reflources malgré cette pauvreté.
Diftinaion de quatre o rdres de perfonnes dans G eneve. Diffé-
rens confeils dont le gouvernement eft compofé. Leurs attributions.
L e gouvernement de Geneve a tous les avantages 8c
aucun des inconvéniens de la démocratie. Loi des anciens Germains.
qu’il fembie que Gene ve ait prife pour modele. Ibid.
376. 2. a. Droit civil de cette république. Loi fur les banqueroutiers
louée par Montefquieu. Degrés de parenté qui prohibent
le mariage. Cas du divorce. Exercice d e ’là juflice
criminelle. On ne connoît point à G eneve de.dignité héréditaire.
Les emplois y font pfeü lucratifs, 8c ne peuvent tenter
que des âmes nobles.. O n 'y voit peu de procès. Des loix
lomptuairës. Il n’y a peut-être point de ville.où il y ait plus
de mariages heureux. On ne fouffre point à Geneve de corné-
GEN
a « Warée qu’ on craint
la jeuneffe. M oyens de remédier à ces inconvéniens, en admettant
les fpeâacles. Avantages qpc Geneve pourrqft re|irer de
l ’établiflement d’un théâtre. Ibid. b. Autre çqnfidératipn qui
devroit peut-être engager Geneve à permettre les fpeâacles ;
le préjugé contre laprofeflion de comédien, eft qne des principales
caufes qui contribue au dérèglement des gens de cet
état : moyens que les Genevois pourroient employer pour
avo ir une troupe de comédiens eftimables, 8c qui deyiendroit
bientôt la meilleure de l’Europe. L e féjour de cette yille
deyiendroit alors celui des plaifirs honnêtes , comme il eft
celui de la philofophie 8c de la liberté. L’exemple des comédiens
de Geneve ferviroit de m odèle à ceux des autres nations,
8c de leçon à ceux qui les ont traités avec tant de rigueur
8c d’inconféquence. Obfervàtions fur l’académie de G e n e v e ,
8c fur les différens corps de profeflion. Etat de la bibliothèque.
L e peuple de G en e ve eft plus instruit que par-tout ailleurs.
L ’inoculation reçue dans cette ville. Ibid. 377. t . p. A v e c
quel fuccès les fciences 8c les arts ont été cultivés à Gene ve .
Ce tte ville a eu l’avantage de pofféder des étrangers célébrés.
Etat de fa fabrique d’horlogerie. Soins qu’on y donne à l’agriculture.
Ordre établi pour les incendies. Etat des hôpitaux ,
abondance des aumônes qu’ils recueillent 8c qu’ils diftribuent.
D e la religion de G eneve. La conftitution eccléfiaftique y eft
purement presbytérienne. Les miniftres font ou pafteurs ou
poftulans. Leur revenu. Examen qu’ils fubiffent^vant detre
admis au miniftere. Comment les funérailles fe font à G eneve.
Moeurs exemplaires du cierge. Ibid. b. D o âr ine attribuée à
plufieurs miniftres. C e qu’ils penfent du fupplice de Servet.
Paffage de M. de Voltaire fur ce fujet. Eloge de la liberté de
pen fer , établie dans Geneve. Doétrine de plufieurs miniftres
de Gene ve fur l’enfer. Plufieurs d’entr’eux rejettant tout ce
qu’on appelle myftere , s’imaginent que le premier principe
d ’une religion véritable , eft de ne rien propofer à croire qui
heurte la raifon. Tolérance du clergé. Sa haîne pour toute
fuperftition. O n fe plaint moins à Geneve qu’ailleurs des p rogrès
de l'incrédulité. En quoi confifte le chriftianifme de
G ene ve . Ibid. 578. 2. a. Les eccléfiaftiques renfermés uniquement
dans leurs foqélions , donnent les premiers aux
citoyens , l’exemple de la. fqumiffion aux loix. Autorité du
jtonfiftoire. Réflexions fur l’extrême fimplicité du c,ulte. L e
Service d ivin renferme deux chofes ; la prédication 8c le chant ;
pbfervations fur l’un 8c fur l’autre. L’être fuprême eft honoré
à Geneve avec une décence 8c un recueillement qu’on ne
remarque point dans nos égfifes. Conclufion de cet article.
Geneye. Faute à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. .199. b.
Geneve ancienne! Suppl. IV . 11 . a. Sel que la France fournit
à cette ville. IL 62. a. Comment les fuffrages fe donnent à
Gene ve dans l’éleélion des magiftrats. IV . 817. Echelles
dont on fe fervit en 160a pour l’efçalade de cette ville. V .
«28. a. Origine du mot huguenot tiré de quelques éyénemens
de rhiftoire de Geneve. V I I I . 333.«. L’inoculation introduite
& adoptée dans Geneve. 7 36. b. 770. a. Autorité que Calvin
.acquit dans e.ette république. XI. 274. a. D e s lyndics de
G eneve. X V . 730. b. Tablettes remarquables que la v ille
d e Geneve poffede. 807. b. D e l’ancien Vidomnat de Geneye.
X V I I . 24j . b. Armes de Geneve : titres que différentes puif-
fances donnent à cette république : vol. IL des pl. Blafon ,
pag. 17. b. Parmi les pièces qui ont été écrites à l’oçcafion de
l ’article Geneve, v o y e z fur-tout la lettre de M. J. J. Rouffeau
à M. d’Alemb ert, fur les fpeâ acle s, 8c l’ouvrage de M. le
profeffeur V e rn e t , intitulé : Lettres d’un voyageur Anglois.
G en e v e , lac de y (Gèogr.) voyei LÉMAN.
G E N E V IE V E , (Sain te) Obfervàtions fur cette fainte.
XI. 13. b. Chambre apoftolique de l’abbé de Ste-Genevieve.
•III. 47. b. Chancelier de l’églile de Ste-GeneVieve. 9.1. a. 96. b.
IO& E N E V R E T T E , (Ecop. ru/liq.) v in de genievre ; qualités
de cette -boiffon. Comment on fait la genevrette. V II .
«78..s2ii b. i i
G EN E VR IER , ( Botan..) Caraâeres de ce genre de plante.
Lieux où croît c e t arbriffeau. O n avoit autrefois confondu
fous le même nom les cedres 8c les genévriers. Quelques
:auteurs, depuis la découverte de l’Amérique., font .tombés
dans la même faute. Les Efpagnols confondent le geneyrier
avec le cyprès. Les Anglais appellent cedres de Virginie 8c
des Bermudes , les genévriers de ce pays-là. Defcription du
.genevrier. Deuxefpeces.de genévriers diftinguées des autres,
le genevrier commun , arbriffeau y & le genevrier commun qui s'élève
en arbre. Leur defcription. V II . 37.9. a. Lieux où. le fécond
eft cultivé ; réfine qu’on en retire. Genevrier à baie rougeâtre.
I l eft commun en Languedoc. Huile de cade qu’on en rerire.
tGènevrier d’A /iè , à grojfes baies. Lieux OÙ il çÿoît ; defcription
de fon fruit. Genévriers de Virginie & des Bermudes on
les cultive en Angleterre. Progrès qu’ils y ont faits. Manière
de les multiplier 8c de les cultiver. Ibid. b. Le bois du
G E H 823
genevrier des Bermudes, eft appellè bois de cedre. Uf:a?
gës qu’on fait du bpis de ces genévriers. Q iie l eft le feul
emploi que nous pouvons faire du bois de nos genévriers.
Jh/d. $8q. a. ................... . . . . .
G ene vrier ■, ( Bot. Jardin. ) noms de .cette plante en differentes
langues. Son caraâere générique. Enumération de quatorze
efpeces. Suppl. III. 200. a. Lieux où elles, croiffent. Leur
defcription , culture, qualités 8ç ufages. Ibid. b. b'-fiùv.
Genevrier, efoece de genévriers appellés o xycedre, XI. 729.
a. 8c fabine. X IV . 460. b. &c. Rapport de certains genevfiers
avec une efpece de cyprès. Suppl. II. 670. a , h.
G ene vrier , ( Chym. Mat. rnédic. ) huile eflcntielle 8c
fubftance réfineufe qui fe trouvent dans le genevrier. Huile
de cade qu’on retire du geneyrier. Ses ufages dans les maladies
des beftiaux. Ufage de cette huile canfîique dans les maux
de dents. On ne peut la donner intérieurement fans téméritéi
C e font les baies du petit genevrier qu’on emploie principalement
e n , médecine.' Les Allemands les emploient à titre
d’affaifonnement. Maladies dans lefquelles nous en faifons
ufage. V IL 380. a. Propriétés qu’on leur attribue. Maniéré d’en
ufer en qualité de remede. Ufage de l’extrait ou rob de ge-
nieyre. Propriétés de l’eau diftiflee des baies de cette plante;
Vertus de l’efprit ardent qu’on retire par diftillation ,du_ vin
de genievre. Ufage 8c propriété de l’huile eflentielle diffoutê
dans l’efprit de vin.- Sel qu’on retire du marc de la préparation
du rob. Elixir de g en iev re, fes propriétés. Ratafia préparé .par
l’infufion des baies de; genievre dans de l’eau-de-vie. Onguent
pour la teigne fait avec les baies de genievre-. Quelles font les
vertus les plus évidentes de cette plante. Obfervàtions fur
fon ufage. Ibid. b. Compofirioiis de la pharmacopée de Paris4
dans lefquelles entrent les baies de g enievre, leur extrait, leur
huile, leur réfine. On .brûlé le bois de genievre pour chaffer
le mauvais air. Ibid. 381, a.; . .-
Genevrier, réfine du genevrier nommée fandarâqufe. X IV .
610. a ,b . Baume de genievre. II. 163. é. Quelques-unspenfent
qu’on peut fpbftituer, le bois de genevrier au faffafràs.. 46p;
b. Vin de genievre,, voye[ G enevrette.
G EN G H IS -CH AN , hiftoire de fes conquêtes. X V ; 925.
a y b.^ Corps de Joix- qu’ils donna aux Ta rares . X V II . 6yy.fr.
Tolérance exercée par les princes de la maifon de Gengliis-
chan. C64. a.
G EN G O U X -L E -R O Y A L , ( Gèogr. ) Suppl. IV . 699. b.
G É N IA L , ( Hiß. anc. ) épirhete donné à-quelques dieux qui
préfidoient à la génération'. Etym. de ce mot. Q uels étoient
les d ieux géniales. VH. 381. a.
GÉNIE. ( Myth. Lïtt. Antiq. ) La tradition la plus, ancienne
8c la plus générale eft .que le monde foit rempli de génies;
Cette opinion a finalement donné lieu à l’introduâion des
fé e s , des gnomes 8c des fylphes. Opinion des anciens fi‘r |«s
génies. VII . 381. q. Les génies accordés à chaque particulier
ne jouiffoient pas .d’un pouvoir égal. On penfpit qu’il, y
avoit un bon 8c un mauvais génie attaché à chaque pertbnne.
D o âr ine de Servius fur ces génies particuliers. Les romains
appelloient junons , les génies gardiens des femmes. I l y avoit
encore les génies propres de chaque lieu. O n adoroit à Rome
le génie tutélaire de l’empire. Hommage 8c culte rendus au
génie des Céfars. Sacrifices que chacun offroit à fon propre
génie le jour de fa naiffance. L e platane étoit fpécialement
çonfacré à cette forte de divinité. Ibid. b. Diverfes repréfen-
tations qu’on faifoit des génies. A v e c le;tems on vint a ie s
identifier. Ibid. 382. a.
Génies y voyer Démons. Réflexion de M. de Fontenelle fui'
leur exiftence. I. 493 . a. D o â r in e des Chaldéens fur les génies!
III. 21. u. Des génies qui eurent commerce avec les
femmes. 423. b. Voye^ Incubes. Ceu x q u i, fous la figure
d’une femme , ont eu commerce avec les hommes, voye^
Succube. Comment la crainte introduifit les génies mal-
faifans, 8c l’efpérance les génies favorables. IV . 1071. b.
Génies particuliers des femmes. IX. 62. b. Genies tutélaires.
X V I . 763. a, Génies bons 8c mauvais admis par les fauvages
d’Amérique. X. 486. a. Génies adorés par les habitans de
Loarigo,624. b.,par les Algonquins. 41. «z. Sentiment de Socrate
fur les génies. X V . 263. b. .Génie de Socrate, yoye^ 1 article de
ce philofophe. : : : .2 _i uiiahjup
GÉNIE , ( Philofoph. Littéral. ) l’étendue de 1 efprit , Ja
force de l’imagination , 8c l’aâ ivité de l’ame , voilà le génie.
L’homme de génie eft celui dont l’ame intérefleea tout ce qui eft
dans la nature , ne reçoit pas une idée, qu elle n eveille un
fentiment. Il fe rappelle fes idées avec un fentiment plus v i f
qu’il né les a reçues. Entouré des objets dont ils’occupe, il ne
fe fouvient p as , il vo it , il eft ému. L ’ame fe plaît fouvent dans
ces affeâions momentanées;, elles lui donnent un plaifir qui
lui eft précieux ; elle fe livre à tout ce qui peut l’augmente
r .. . Sa maniéré de peindreles objets qui viennent l’agiter. . .
VII. 382. a. L’imagination prend des formes différentes, elle
les emprunte des différentes qualités qui conftituent le caraâ
e re de l’ame. Le génie n’eft pas toujours, génie ; quelquefois
il eft plus aimable que fublime ; quelquefois dans l’homme
de génie l’imagination eft g a ie . . . Le goût eft fouvent féparé