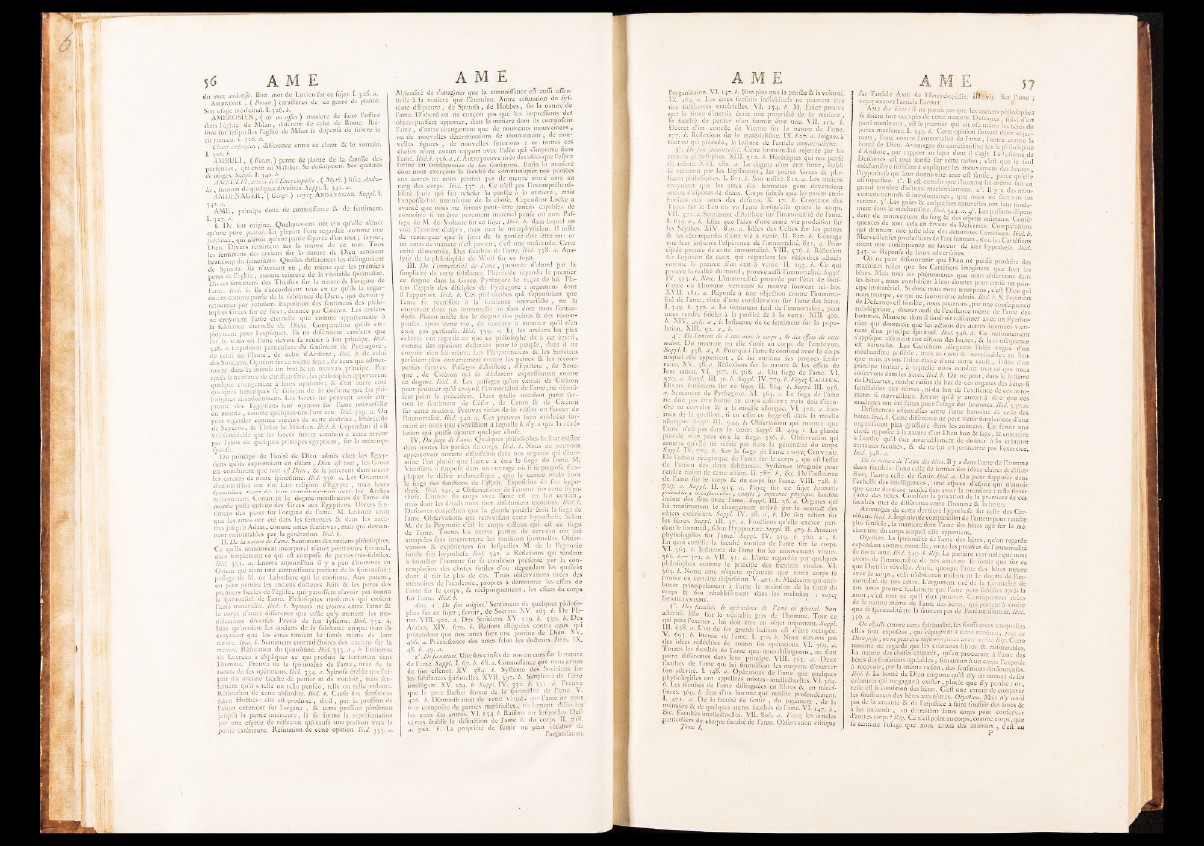
j6 AM E
du mot ambro fie. Bon mot de Lucien fur ce fujet. I. 326. a.
AmbROSIE , ( Botan. ) caractères de ce genre de plante*
Sön ufage médicinal. 1. 326. b.
AM B R O S IEN , ( r i t ou office) maniéré de faire 1 office
dans l’églife de M ilan, diftérent de celui de Rome. Rai-
fons fur lefquellcs l’églife de Milan le difpenfa de fmvre le
r it romain. 1. 326. b.
■ Chant ambrofien, différence entre ce chant & le romain.
1 .3 26 b. ' M Ê Ê M H H i
A M B U L I , {Botan.) genre déplanté de la famille des
perfonées, qui croît au Malabar. Sa defcription. Ses qualités
& ufa<>es. Suppl. I. 341. Æ. H H
A M B U L T l, article de l ’Encyclopédie , ( My th.) liiez Ambu-
là furnom de quelques divinités. Suppl. I. 342. a-
AM D E N A G E R , ( Géogr.) voyeZ A n d a n a g a r . Suppl. Ü
342
AMF .. nrmeine doué rrtnrirtiiTünce & de lentiment.
I .3 2 7 .a . ' ■ ' ,-V .
I D e fon origine. Quelques-uns ont cru qu elle n etoit
qu’une pure qualité. La plupart l’ont regardée comme une
jubfiance, q ui nîétoit qu’une partie féparée d’un tout ; lavo ir,
Dieu. D iv e rs fentimens fur la nature ï de ce tout. Tous
les fentimens des anciens fur la nature de D ieu tenoient
beaucoup du fpinofiline. Quelles différences les diftinguoient
de Spinofa. Us n’avoieBt eu , de même que • les premiers
peres de l’églife , aucune teinture de la véritable fpiritualité.
Divers fentimens des Théiftes fur la nature & l’origine de
l ’ame. Ibid. b. Ils s’aceordoient tous en ce qu’ils la regar-
doient comme partie de la fubftance de D ieu , qui devoir y
retourner par rétulion. Expofition des fentimens des philo-
foplies Grecs fur ce fu je t , donnée par Cicéron. Les anciens
ne croyoient l’ame éternelle que comme appartenante à
la fubltance éternelle de Dieu. Comparaifon qu’ils em-
ployoïent pour l’expliquer. Us ne différoient enrr’eux que
liir le te ms où l’ame devoit fe réunir à fon principe. Ibid.
328. a. Expofition particulière du fentiment de Pythagore ,
de celui de P laton, de celui d’A r ifto te , Ibid. b. de celui
des Stoïciens. Opinion fur ce même fu je t , de ceux qui admet-
toient dans le monde un bon & un mauvais principe. Peu
après la naiffance du chriftianifme, les philofophes apportèrent
quelque changement à leurs opinions 3 & d’un autre côté
quelques hérétiques fe faifirent de la doarine que les philofophes
abandonnoienr. Les Grecs ne peuvent avoir emprunté
des Egyptiens leur opinion fur l’ame univerfelle
du monde , comme quelques-uns l’ont cru. Ibid. 329.sa. On
peut regarder comme auteurs de cette do&rine , Phérécide
de Scy c ro s , & Thaïes le Miléfien. Ibid. b. Cependant il eft
vraifemblable que les Grecs furent conduits à cette erreur
par l’abus de quelques principes égyptiens, fur la métemp-
fycofe.
D u principe de l’unité de D ieu admis chez les Egyptiens
qu’ils exprimoient en difant, Dieu efi tout, les Grecs
en conclurent que tout efi D ieu , & fe jetterent dans toutes
les erreurs de notre ipinofifme. Ibid. 330. a. Les Orientaux
d’aujourd’hui ont tiré leur religion d’Egypte , mais leurs
fpinofifme vient de leur communication avec les Arabes
mahométans. Comment le dogme monftrueux de l’ame du
monde paffa enfuite des Grecs aüx Égyptiens. Divers fentimens
des peres fur l’origine de l’ame. M. Leibnitz croit
que les âmes ont été dans les femences & dans les ancêtres
jufqu’à A d am, comme âmes fenfitives, mais qui deviennent
railonnables par la génération. Ibid. b.
II. De la nature de. Came. Sentimens des anciens philofophes.
C e qu’ils nommoient incorporel n’étoit point notre fpirituel,
mais fimplement ce qui eft compofé de parties très-fubtiles.
Ibid. 331. a. Encore aujourd’hui il y a peu d’hommes en
Orient qui aient une connoiflance parfaite de la fpiritualité :
paffage de M. de Laloubére qui le confirme. A u x p aïens,
on peut joindre les anciens doéteurs Juifs & les peres des
premiers fiecles de l’églife, qui paroiffent n’avoir pas connu
la fpiritualité de l’amè. Philofophes modernes qui croient
l’ame matérielle. Ibid. b. Spinofa ne trouve entre l’ame &
le corps d’autre différence que celle qu’y mettent les modifications
diverfes. Précis de fon fyftême. Ibid. 332. a.
Idée qu’avoient les anciens de la fubftance unique dont ils
croyoient que les êtres tiroient le- fonds même de leiir
nature. Ibid. b. Sentimens contradictoires des anciens fur la
matière: Réfutation du fpinofifme. Ibid. 333. a , b. Embarras
de Lucrèce à expliquer ce qui produit le fentiment dans
l'homme. Preuve de la fpiritualité de l’am e , tirée de la
nature de fes opérations. Ibid. 334. a. Spinofa établit que l’ef-
prit n’a aucune faculté de penler ni de v o u lo ir , mais feulement
qu’il a telle ou telle p en fée, telle ou telle volonté.
Réfutation de cette abfurditè. Ibid. b. Caufe des fenfations
félon Hobbes : elle eft produite , dit-il, par la preffion de
l’objet extérieur fur l’organe , & cette preflion pénétrant
jufqu’à la partie intérieure, là fe forme la repréfentation
par une efpeee de réflexion, qui caufe une preflion vers la
partie extérieure. Réfutation de cette opinion. Ibid, 335. a.
AME
Abfurditè de s’imaginer que la connoiffance eft aufïi effen-
tielle à la matière que l’étendue. Autre réfutation du fy&
tême d’Êpicure , de Spinofa, de Hob b e s , fur la nature de
l’ame. D ’abord on ne conçoit pas que les impreffions des
objets puiffent apporter, dans la matière dont ils compofent
l’ame , d’autre changement que de nouveaux mouvemens ,
ou de nouvelles déterminations de mouvement, de nouvelles
figures , de nouvelles fituations : or toutes-ces
chofes n’ont aucun rapport avec l’idée qui s’imprime dans
l’ame. Ibid. b.y$6. a , b. Autre preuve tirée des idées que 1 efpnt
forme en conféquence de fes fenfations. Enfin la maniéré
dont nous exerçons la faculté de communiquer nos penfées
aux autres ne nous permet pas de mettre notre aine au
rang des corps. Ibid. 337. a. C e n’eft pas l’incompréhenfi-
bilité feule qui fait refufer la penfée à la matière , mais
l’impoflîbilité intrinfeque de la chofe. Cependant Locke a
avancé que nous ne ferons peut - être jamais capables de
connoître fi un être purement matériel penfe ou non. Paffage
de M. de Voltaire fur c e fu je t , Ibid. b. dans lequel on
voit l’homme d’efprit, mais non le métaphysicien. 11 fuffit
de remarquer que le fujet de la penfée doit être un : or
un amas de matière n’eft pas un ; c’eft une multitude. Cette
unité démontrée. Des facultés de l’ame. Ibid. 338. a. Ana-
ly fc de la philofophie de W o l f fur ce fujet.
III. De l ’immortalité dé Came, prouvée d’abord par la
fimplicité de cette fubftance. Phérécide répandit le premier
ce dogme dans la Grece. Pythagore le reçut de lui. Pla-
, ton l’apprit dés difciples de Pythagore : argumens dont
il l’appuyoit. Ibid. b. Ces philofophes qui fnppofoient que
l’ame fe réunifient à la fubftance univerfelle ne la
croyoient donc pas immortelle au fens dont nous l’entendons.
Platon infifte fur le dogme des peines & des récom-
penfes après cette v i e , de maniéré à montrer qu’il n’en
étoit pas perfuadé. Ibid. 339. a. E t les anciens les plus
éclairés ont regardé ce que ce philofophe dit à cet éga rd,
comme des opinions deftinèes pour le peuple, dont i l ne
eroyoit rien lui-même. Les Péripàtéticiens & les Stoïciens
parloient plus ouvertement contre les peines & les recom-
penfes futures. Paffages d’A rifto te , d’Epiélete , de Sene-
que , de Cicéron qui fe déclarent expreffément contre
ce dogme. Ibid. b. Les paffages qu’on extrait de Cicéron
pour prouver qu’il eroyoit rimmbrtalité de l'âme,-ne détrui-
fent point le précédent. Dans quelle oecafion parut fur-
tout le fentiment de Céfar , de Caton & de Cicéron
fur cette matière. Preuves tirées de la raifon en faveur de
l’immortalité. Ibid. 340. a. Ces preuves bien méditées forment
en nous une eonviétion à laquelle il n’y a que la rév élation
qui puiffe ajouter quelque chofe.- . " '• ' V
IV . Du fiege de Came. Quelques philofophes la font exifter
dans toutes les parties du corps. Ibid. b. Nous ne pouvons
- appercevoir aucune difpofition dans nos organes-qui détermine
l’un plutôt que l’autre à être le fiege de l’ame. M.
Vieuffens a fuppofé dans un ouvrage où il fe propofe d’ex--
pliquer le délire mélancolique , que le centre ovale étoit
le fiege des fondions de l’iiïprit. Expofition dè fon hypo-'
thefe. Ibid. 341. a. Obfervations de l’auteur fur cette hypo-'
thefe. L’union du corps avec Pâme eft un fait certain ,
mais dont les détails nous font abfolument inconnus. Ibid. l\
Defcartes conjeétura que la glande pinéale étoit le fiege de
l’ame. Obfervations qui renverfent cette hypothefe. Selon
M. de la Peyronie c’eft le corps calleux qui eft ce fiege
de l’ame. Toutes les autres parties du cerveau ont été
attaquées fans interrompre les fondions fpirituellés. Obfervations
& ' expériences fur lefquelles M. de la Peyronie
fonde fon hypothefe. Ibid. 342. a. Réflexions qui tendent
à humilier l’homme fur fa condition préfente par la contemplation
des chofes futiles d’où dépendent les qualités
dont il fait le plus de cas. Trois obfervations tirées des
mémoires de l’académie, propres à démontrer les;effets de
l’ame fur le co rp s , & réciproquement, lès effets du corps
fur Famé. Ibid. b.
Ame. i° . De fon origine.' Sentimens de quelques pjiilofo-
phes fur ce fujet ; fa v o ir, de Socrate. X V . 263. b. D e Platon.
VII I. 902. a. D e s Stoïciens. X V . 529. b. 530. b. Des
Arabes. X IV . 670. b. Raifons alléguées contre ceux qui
prétendent que nos âmes font une portion de Dieu. X V .
466. a. Préexiftence des âmes félon les do&eurs Juifs. IX.
48. b. 49. a.
2°. De fa nature. U ne des caufes de nos erreurs fur la nature
de l’ame. Suppl. I. 67. b. 68. a. Connoiffance que nous avons
de fon effence. X V . 584. b. Syftême des Sociniens^ fur
les fubftances fpirituelles. XVII . 397. b. Simplicité de 1 être
intelligent. X V . 204. b. Suppl. IV .3 3 2 . bi 333. a. Preuve
que le pere Buffier donne de la 'fp irit^ hte de lame. V .
400. b. Démonftration de cette v é r ité , que 1 ame ne peut
être compofée de parties matérielles Jrïeellement «iftinctes
les unes des autres. V I . 134. b. Raifons mr lefquelles D el-
cartes établit la diftinftion de l’ame & du corps. II. 7 1»-
a 721. b. La propriété de fentir ne peut réfulter de
' l’orgànifation.
A M t a
Porganifation. V I. 147. b. Non plus que la penfée & la volonté.
IX. 464.. a. Les êtres fenfitifs individuels ne peuvent être
des fubftances^ matérielles. V I . 134. k M. Euler prouve
que la force d’inertie étant une propriété de la matière ,
la faculté de .penfer n’en fauroit être une* VII . 112. b.
Décret d’un concile de Vienne fur la nature de l ’ame*
a 77. b. Réflexions fur le ;natérialififte. IX. 62y.'a. Joignez à
tout ce qui précédé, la leéhire de l’article immatériaiifme.
3 °. De fon immortalité. Cette immortalité rejettée .par les
anciens philofophes. XIII. 5 1 2. b. Hérétiques qui ont penfé
de même. X V I . 281. a. L e dogme d’un état fu tu r, établi
& reconnu par les légiflateurs, les poètes Grecs & plu-
fieurs philofophes. I. S u . b. Son utilité. 812. a. Les anciens
croyoient que les âmes des'- honnêtes gens devenoient
■ autant d’efpeces dè dieux. Corps fubtils que les païens attri-
buoient aüx âmes des défunts. X. 17. b. Croyance des
Tu rc s fur le lieu où v a l’ame lorfqu’elle quitte le corps.
V I I . 372. a. Sentiment d’A riftote fur l’immortalité de l’ame.
I. 659. a , b. Effet que l’idée d’une autre v ie produifoit fiir
les Scythes. X IV . 049. a. ,Idées des Celtes fur les peines
& les récompenfes d’une vie à venir. II. 810. b. Courage
que leur inljûroit l ’efpérance de l’immortalité. 811 . a. Principale
preuve de cette immortalité. VII I. 576. b. Réflexion
fur l’opinion 'de ceux qui regardent les défprdres aéluels
comme la preuve d’un état à. venir. II. 193. b. C e qui
prouve la réalité du moral, prouve aufli l’immortalité. Suppl.
IV . 333. b. Note. L ’immortalité prouvée par l ’état de fouf-
france où l’homme vertueux fe trouve fou ven t ici - bas.
X V I I . 181. a. Réponfe à une objection contre l’immortalité
de l’ame, tirée d’une confidération fur l’ame des bêtes.
I- 349- b 3>fP- a- Ee fentiment feul de l’immortalité, peut
nous rendre fideles à la probité & à la vertu. XIIL 400.
b. X IV . 496. a , b. Influence de ce fentiment fur la population.
XIÜ . 92. a , b.
4°• D e l ’union de Came avec le corps , & des effets de cette
union. D u moment où elle s’unit au corps de l’embryon*
Suppl A . 438. a , b. Pourquoi l’ame fe confond avec le, corps
auquel elle appartient , & lui attribue fes propres fenfations.
X V . 38, a. Réflexions fur la nature & les effets de
leur union. VI- 367. b.. 368. a. D u fiege de famé. V I .
370. a. Suppl. III. 36. b. Suppl. IV . 779. b. Voyeç C alleux.
D iv e rs fentimens fur ce fujet. II. 864. b. Suppl. III. 956.
a. Sentiment de Pythagore. XI. 363. a. L e fiege de famé
ne doit pas être borné aü corps calleux; mais doit s’étendre
au cervelet & à la moelle allongée. V I . 370. a. Exa-
men de la queftion, fi en effet ce fiege eft dans la moelle
allongée. Suppl. III., 944. b. Obfervation qui montre que
l’âme n’eft pas dans le coeur. Suppl. II. 494. b. La glande
pinéale n’en peut être le fiege. 536. b. Obfervation qui
montre qu elle ne réfide pas dans la généralité du corps.
Suppl. IV . 779. b. Sur le fiege de l’ame : voyc^ Cerveau.
D e l aélion réciproque de l’ame fur le co rp s , qui eft l ’effet
de funion • des deux fubftances. Syftêmes imaginés pour
rendre raifon de cette aétion. II. 787. b, &ç. D e l’influence
de l’ame fur le cqrps & du corps fur l’amè. VII I. 728. b.
jHHg Suppl. II. 91^. a. Voye[ fur ce fujet harmonie
preetabhe ■ ; occafionnelles, caufes ; influence phyfique: Liaifon
mume des fens avec l’aine. Suppl. IÏÏ. 36. *7. Organes qui
lu i tranfmettent le changement arrivé par le contaél des
objets extérieurs. Suppl. IV . 28. a , b. D e fon aétion fur
les fibres. Suppl. ÏII. 37. a. Fonétions qu’elle exerce pendant
le fommeïi, félon Hyppocrate. Suppl. II. 479. b. Auteurs
phyfiologiftes. fur l ’ame. Suppl. IV . 359. b. 360. a , b.
En quoi confifte la faculté motrice de fam é fur le corps.
V I . 363. b. Influence de l’ame fur les mouvemens vitaux.
1H B ^ I ' a‘ 51 - a- L ’ame regardée par quelques
philofophes comme le principe des facultés vitales. V I.
365. b. Notre ame n’opere qu’autant que notre corps fe
trouve en certaine difpofition. V . 401. b. Médecins qui'a ttribuent
principalement à famé le maintien de la lanté du
corps & fon rétabliflement dans les maladies : voyez
oTAHLIANISME. * J 1
efi : P e* f acultés & opérations de Came en général. Son
activité. Elle fait le véritable prix de l’homme. To ut ce
qui peut 1 exciter , lui doit être un objet important'^/»»/,
l i l . 02». a L u n de fes grands befoins eft d’être occupée.
, ‘ .? ? ' ‘ i ” m ie de l’ame. I. 470. b. Nous n’avons pas
des idées réfléchies de toutes fes opérations. V I . 360. a.
Toutes les facultés de l’aine que • nous diftinguons, 11e font
point dittérentes dans leur principe. VII I. 563. a. Deux
facultés de lame qui lui fourniffent les moyens d’exercer
fon aéhvite. I. 348. Opérations de l’ame que quelques
phyfiologiftes ont appellees mixtes - intelléétiielles. VI.- 364.'
b Les facultés de l’ame diftiiiguées en libres & en riécef-
laires. 369. b. Etat d’un homme qui médite profondément.
L 47h 4. D e la faculté de fentir , du jugément de la
mémoire & de quelques autres facultés de l’ame. V I . i 47. b
occ. Facultés intelleétuelles. VII . 806. a. Voyeç les articles
particuhers.de chaque faculté de l’anie. Obfervation critique
AM E 57
(ur 'l'article A me de l’Encyclopédie. ifttjSu j,, Sur l’ame 1
yoyeç encore 1 article Esprit.
A me i a b !,« : i l i e paroît pas que les anciens pU b& p lw *
4e loient fort occupé? de cette matière. DeCcanes fuivi d’un
parti nombreux ; eft le p remier qui ait o fé traiter f a bêtes de
pures machines. I. 343* b. Cette opinion fauvoitdeux objec*
tions , l’nne contre l’immortalité de l’ame , l’autre .contre la
bonté de Dieu. Avantages du cartéftanifme fur la pliiiofophia
d A n lto te , par rapport au fujet dont il s’agit. L e fyftême de
Delcartes eft tout fondé fur cette raifon ; c’eft que le feul
méchanifine fuffifant à expliquer les mouvemens des brutes *
1 hypothefe qui leur donne une ame eft fauffe, parce qu’elle
eftfiiperflue. i° . Il eft certain que l ’homme lui-même fait un
grand nombre d’aftions machinalement. 20. Il y a des mouvemens
naturels fi involontaires , que nous ne faurions les
retenir. 3 . Les goûts & antipathies naturelles ont leur fonde-
ment dans le mfclianifme. * i d , 344. Les pallions dépen,
, dent du mouvement du fang & . des efprits animaux. Confé*
quences de tout cela en faveur de Defcartes, Coinpa'raifons
qrn donnent une jufte idée des automates Cartéfieni Ibid, b.
Merveilleufes produéhons de l’art humain, d’où f a Cartéftens
tirent une conféquence en faveur de leur hypothefe. Ibid,
3 4 Î - -4* Réponfe de leurs adverfaires.
O n ne peut difeonvenir que Dieu ne puiffe produire des
maclunes teües que les Cartéfiens imagment que font les
betes. Mais tous les phénomènes que nous obïervons dans
les betes ; nous conduifent à leur donner pour caufe un principe
immatériel. Si donc nous nous trompons, c ’eft Dieu qui
nous trompe, ce qui ne fauroit être admis. Ibid. b. Si Bopinion
de D elcartes eft fondée, nous pourrons,par une conféquence
tres-légitime, douter auffi de l ’exiftence même de l’ame des
hommes. Maniéré dont il faudroit raifonner avec un Pyrrho*
nien qui douteroit que les aétions des autres hommes viennent
d un principe fpirituel. Ibid. 346. a. C e raifonnement
s applique aifément aux aétions des b rutes, & la conféquence
eit naturelle. Les Cartéfiens alleguei it l’idée vague d’un
mechanifme poflibie , mais inconnu & inexplicable ; au lieu
que nous avons l’idée claire d’une autre caufe , l’idée d’un
principe fenfitif, à laquelle nous conduit tout’ce que nous
obïervons dans les bêtes. Ibid. b. On ne p eu t, dans le fyftême •
r f ■ f r£es ’ ren^re raifon du but de ces organes des bêtes fi
lemblables aux nôtres, ni du but de Pebciftence de ces auto-*,
mates fi merveilleux, Erreur qu’il y auroit à dire que ces
mai “ ?,es ont été feit.es pour l’ufage des hommes. Ibid. 347.
, , Différences effentielles entre l’aine humaine & celle des
betes. Ibid. b. Cette différence ne peut venir fimplement d’une
orgamiation plus groffiere dans les animaux. C e feroit une
chofeoppcifée à la nature d’un Dieu bon & fage, & contraire
a 1 o rdre qu’il fuit invariablement de donner à la créature
^ CU^ S 5 ^ ^e n e ^ui ert permettre pas l’exercice.
D e là nature d efamc des bêtes. I l y a dans l’ame de l’homme
deux facultés : l ’une celle de former des idées claires & diftin-
ctes; 1 autre celle de fentir. Ibid. a. On peut fuppofer dans |
1 echelle des intelligences, une efpeee d’efprit qui n’auroit
que cette derniere faculté fans avoir la première : telle feroit
lame des bêtes. Combien la privation de la première de ces
facultés met de différence entre l’homme & la brute.
Avantages de cette derniere hypothefe fur celle des Car-
téiiens. Ibid. b. Ingénieufe comparaifon de l ’auteurpour rendre
plus lenfible, la manière dont l ’ame des bêtes agit fur le mé-
chanifine du corps auquel elle appartient.
Objection. La fpiritualité de l’ame des bêtes,, qu’on regarde
cependant comme mortelle, ruine les p reuves de l’ùrfmortalité
de notre ame. Ibid. 349. b. Rép. La parfaite certitude que nous
avons de 1 immortalité de nos aines ne fe fonde que fur ce
que V ie il 1 a révélée. Ainfi, quoique l’ame des bêtes meure
avec le corps j- cela n’obfcureit nullement le dogme de l’im mortalité
de nos âmes. L ’argument tiré de la fpiritualité dç
nos âmes prouve feulement que l ’ame peut fubfifter après la
mort , c eft tout ce qu’il doit prouver. Conféquenees tirées
de la nature même de l’ame des bêtes, qui portent à croire
que fa fpiritualité ne la fauvera pas de i ’anéantiffement. Ibid.
3fio.a.
On objecte contre cette fpiritualité, les fouffrances auxquelles
elles font expofées , qui répugnent à cette maxime, Jous un
Dieujufle , on nepeut être miférable fans C avoir mérité. Rép. C ette
maxime ne regarde que les créatures libres & raifonnables.
La nature des chofes e xigeait, qu’en procurant à l’ame des
bêtes des fenfations agréables , .fon-union à un corps l’exposât
à recevoir, par la même raifon, des fenfations douloureuïes.
■ Ibid. b. La bonté de D ieu emporte qu’il n’y ait aucune de fes
créatures qui ne gagne à exifter, plutôt que d’y perdre : o r ,
telle e ftla condition des bêtes. C ’eft une erreur de comparer
les fpuftrances des bêtes aux nôtres. Objection. Mais n’y a-t-il
pas de la cruauté & de l’injuftice à faire, fouffrit des âmes &
à les anéantir , en détruifant leurs corps pour .conferver
d autres corps r Rép. C e n’eft point au corps, coni me corps, que
le termine l’ufage que nous tirons des animaux, c’.elEau
P