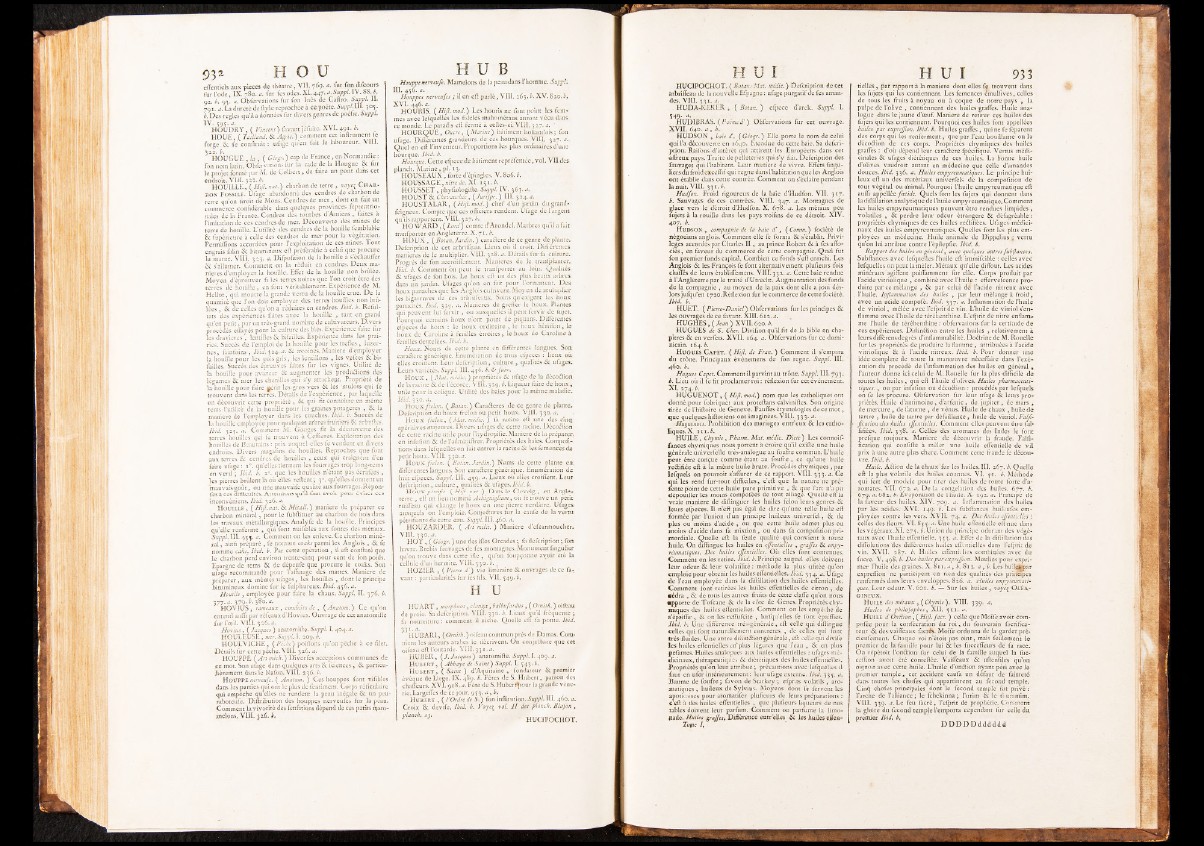
eflentiek aux pièces de théâtre, VII . 769. a. fur fon difcours
fur l’ode, IX. 780. a. fur fes odes. XI. 447- a. Suppl. IV . 88. b.
92. b. 93. a. Obfervations fur fon Inès de Caftro. Suppl. 11.
791 . a. La dureté de ftyle reprochée à ce poète. Suppl.Hl. 305.
b. Des réglés qu’il a données fur divers genres de poéfie. Suppl.
H OU D R Y , ( Vincent ) favant jéfuite. X V I . 49^ • b-
H O U E , ( Tailland. 8c Agric.) comment cet inftrument le
fo rg e ,& le confinât : ufage qu’en fait le laboureur. VII I.
5 HO U GU E , la , ( Géogr. ) cap de France, en Normandie ;
fon nom latin. Obfervations fur la rade de la Hougue Sc fur
le projet.formé par M. de Co lb e r t, de faire un pont dans cet
endroit. V III. 32.2..A n
H O U IL L E , ( Hiß. nat.) charbon de terre , voye[ CHARBON
Fossile. Ufage abandonné des cendres de charbon de
terre qu’on tiroit de Mons. Cendres de me r, dont on fait un
commerce confidérable dans quelques provinces feptentrio-
nales de là France. Cendres des tourbes d’Amiens, faites à
Timitation de ces cendres de mer. Découverte des mines de
terre de houille. L’utilité des cendres de la houille femblable
6 fupérieure à celle des cendres de mer pour la végétation.
Permiffions accordées pour l’exploitation de ces mines. To ut
engrais falin Sc bitumineux eft préférable à celui que procure
la marne. VIII. 323. a. Difpofuion de la houille à s’échauffer
Sc s’allumer. Comment on la réduit en cendres. Deux maniérés
d’employer la houille. Effet de la houille non brûlée.
Moy en d’éprouver fi les terres noires que l’on croit être des
terres de houille , en font véritablement. Expérience de M.
Hellot ; qui montre la grande vertu de la houille crue. D e la
quantité que l ’on doit employer des terres'houilles non brûlées
, & de celles qu’on a réduites en cendres. Ibid. b. Rèful-
tats des expériences faites av,ec la houille , tant en grand
qu’en petit, par un très-grand nombre de cultivateurs. Divers
procédés effayés pour la culture des blés. Expérience faite fur
les dravieres , lentilles 8c bifailles. Expérience dans les prairies.
Succès de l’emploi de la houille pour les trèfles., luzern
e s , fain foins', Ibid. 3 24. a. 8c avoines. Maniéré d’employer
la houille pour les pois g ris , les lentillons , les vgfces 8c bifailles.
Succès des épreuves faites fur les vignes. Utilité de
la houille pour avancer & augmenter les productions des
légumes 8c tuer les chenilles qui s’y attachent. Propriété de
la houille pour faire gérir les-gros vers 8t les ‘mulots qui fe
trouvent dans les terres. Détails de l’expérience, par laquelle I
on découvrit cette propriété , & qui fit connoître en même I
tems-l’utilité de la houille pour les graines potagères , 8c la
maniéré de l’employer dans les couches. Ibid. b. Succès de
la houille employée pour quelques arbres fruitiers & arbuftes.
Ibid. 323. a. Comment M. Gouges fit la découverte des
terres houilles qui fe trouvent à Ceflieres. Exploitation des
houilles de Beaurains : prix auquel elles fe vendent en divers
endroits. Divers magafins de houilles. Reproches que font
aux terres Sc cendres de houilles , ceux qui craignent d’en
faire ufage : i° . qu’elles tiennent les fourrages trop long-tems
en verd ; Ibid. b. 20. .que les houilles n’étant pas écrafées ,
les pierres brûlent là ou elles relient; 30. qu’elles donnent un
mauvais g oût, ou une mauvaife qualité aux fourrages.Réponses
à ces difficultés. Attentions qu’il faut avoir pour éviter ces
xnconvéniens. Ibid. 326. a.
Ho u il l e , ( Hift.nat. 8c Métall.) maniéré de préparer ce
charbon minéral, pour le fubftituer au charbon de bois dans
les travaux métallurgiques. Analyfe de la houille. Principes
quelle renferme , qui font nuifibles aux fontes des métaux.
Suppl. III. 453. a. Comment on les enleve. C e charbon minéral
, ainfi préparé , fe nomme coaks parmi les Anglois , & fe
nomme caks. Ibid. b. Par cette opération , il eft Conftaté que
le charbon perd environ trente-cinq pour cent de fon poids.
Epargne de tems & de dépenfe que procure le coaks. Son »
ufage recommandé pour l’affinage des mattes. Maniéré de
préparer, aux mêmes ufages, les houilles , dont le principe
Bitumineux domine fur le fulphureux. Ibid. 4 56. a.
Houille, employée pour faire la chaux. Suppl. IL 376. b.
3 77 .4. 379. E 380. 0.
H O V IU S , rameaux , conduits de , ( Anatom. ) C e qu’on
entend auffi par réfeaux d’Hovius. Ouvrage de cet anatomifte
fur l’oeil. VII I. 326. 0. . - ' : •
Jîo v ius, ( Jacques ) anatomifte. Suppl. 1. 404. a.
H O U L EU SE , mer.SuppLl. 209.b.
H O U L V ICH E , ( Pèche) poiflons qu’on pêche à ce filet.
Détails fur cette pêche. VII I. 3 26. a;
HOUPPE. {Art méch.) Diverfes acceptions communes de
c e mot. Son ufage dans quelques arts & fciences , 8c particuliérement
dans le blafon. VII I. 236. b,
Ho u p p e nerveufe. ( Anatom. ) Ces houppes font vifibles
flans les parties qui ont le plus de fentiment. Corps réticulaire
qui empêche qu’elles ne rendent la peau inégale 8t un peu*
raboteufe. Distribution des houppes nerveufes fur la peau.
Comment la viyacité des fenfafions dépend de ces petits lijani-
jaelons, VIII. 326. b,
Houppe nerveufe. Mamelons de la peau dans l’homme. Suppl.
IÏÏ. 456. a.
Houppes nerveufes ; il en eft parlé, VIII. 263, b. X V . 820. b.
X V I . 446. a. .
HOURIS. ( Hifl. mod. ) Les houris ne font point les femmes
avec lefquelles les fidelés mahométaus auront vécu dans
ce monde. Le paradis eft fermé à oelles-ei. V III. 327. a. '
H O U R Q U E , Oucre, ( Marine) bâtiment hollandois ; fon
ufage. Différentes grandeurs de ces hourques. VIII. 327. a.
Q u el en eft l’inventeur. Proportions les plus ordinaires d’une
hourque. Ibid. b. ■
Hourque. C ette efpece de bâtiment repréfentée, vol. V I I des
planch. Marine, pl. 13.
H O U S E A U X , forte d’épingles. V . 806. b.
H O U S SA G E , nitre de. X I. 151. b.
HOUSSET , phyfiologifte. Suppl. IV . 363. a.
H O U S T & Chevauchée , ( Jurijpr. ) III. 314. a.
H O U S T A L A R , ( Hift. mod. ) chef d’un jardin du grand-
feigneur. Compte que ces officiers rendent. Ufage de l'argent
qu’ils rapportent. VIII. 3 27. b.
H O W A R D , ( Lord) comte d’A rondel. Marbres qu’il a fait
tranfporter en Angleterre. X. 7 1 .b.
H O U X , {Botan. Jardin. ) caraétere de ce genre de plante.
Defcription de cet arbriffeau. Lieux où il croît. Différentes
maniçres de le multiplier. V III. 328. a. Détails fur fa culture.
Progrès de fon accroiffement. Maniérés de le tranfplanter.
Ibid. b. Co,mment on peut le tranfporter au loip. Qualités
& ufages de fon bois. Le houx eft un des plus beaux arbres
dans un jardin. Ufages qu’on en fait pour l’ornement. Des
houx panaches que les A nglois cultivent. Moyen de multiplier
les bigarrures de ces arbrilTeaux. Soins qu’exigent les houx
panachés. Ibid. 329. a. Maniérés de greffer le houx. Plantes
qui peuvent lui fervir , ou auxquelles il peut fervir de fujet.
Pourquoi certains houx n’ont point de piquans. Différentes
efpeces de houx : le houx ordinaire , le houx hériffon, le
houx de Caroline à feuilles étroites, le houx de Caroline' à
feuilles dentelées. Ibid. b.
Houx. Noms de cette plante en différentes langues. Son
caraélere générique. Enumération de trois efpeces : lieux où
elles croiii'ent. Leur defcription, culture , qualités Sc ufages.
Leurs variétés. Suppl. III. 436. b. & fuiv.
H o u x , ( Mat. tnèdic. ) propriétés 8c ufage de la décoâion
de la racine 8c de l’écorce. V l l l . 3 29. b. Liqueur faite de houx ,
utile pour la colique. Utilité des baies pour la même maladie.
Ibïd. 3 30. a.
H o u x frelon. { Botan. ) Caraéleres de ce genre de plante.
Defcription du houx frelon ou petit houx. VIII. 330. a.
H o u x frelon, {Mat. médic. ) fa racine eft une des cinq
apéritives majeures. Divers ufages de cette racine. Décoélion
de cette racine utile pour l’hydropifie. Maniéré de la préparer,
en infufion & de Padminiftrer. Propriétés des baies. Compofi-
tions dans lefquelles on fait entrer la racine 8c les femences de
petit houx. VIII. 330.12.
H o u x frelon. {Botan. Jardin.) Noms de cette plante ea.
différentes langues. Son caraélere générique. Enumération de
huit efpeces. Suppl. III. 439 .a . Lieux où elies croiffent. Leur
defcription, culture, qualités 8c ufages .Ibid. b.
H o u x pétrifié. {Hift. nat. ) Dans le Cle v elg , en Angle-,
terre , eft un lieu nommé Achigniglium, où fe trouve un petit
ruiffeau qui change le houx en une pierre verdâtre. Ufages'
auxquels on l’emploie. Conjeélures fur la caufe de la vertu
pétrifiante de cette eau. Suppl. III. 460. a.
HO U ZA RD ER . ( Art milit. ) Maniéré d’efcarmoucher.
VII I. 330. <2.
H O Y , ( Géogr. ) une des ifles Orcades ; fa defcription ; fon
havre. Brebis fauvages de fes montagnes. Monument finguiier
qu’on trouve dans cette ifle , qu’on foupçonne avoir été la
cellule d’un hermite. V III. 330. b. .
HO ZIER , ( Pierre d’ ) v ie littéraire & ouvrages de ce fa-
vant : particularités fur fes fils. V II . 549.E
H U
H U A R T , morphnos, clanga, balbufardus, ( Ornith. ) oifeau
de proie. Sa defcription. VIU . 330. b. Lieux qu’il fréquente ;
fa nourriture : comment il niche. Quelle eft fa ponte. Ibid.
331 • et. . V
HU BA R1, {Ornith.) oifeau commun près de Damas. Comment
les auteurs arabes le décrivent. On conjeélure que c e t .
oifeau eft l’outarde. VIII. 331. a.
H U BER, {J . Jacques) anatomifte. Suppl. I. 409. a.
Hubert , ( Abbaye de Saint) Suppl. I. 343. b. '.
Hubert , ( Saint ) d’Aquitaine , fondateur & premier
évêque de Liege.’ IX. 480. b. Fêtes de S. Hubert, patron des
chaffeurs. X V I . 918. a. Fête de S.Hubert%our la grande véne-
rie.Largeffes de ce jour. 933. a , h/
HUBERT , ( l’ Ordre de S .) fon inftitution. Suppl. III. 460. a.
Croix 8c devife. Ibid, b. Voye£ vol, I I des planch. Blafon ,
planch, 2g.
HU CIPO CH O T .
H U C IPO CH O T . {Botan.-Mat. médic.) Defcription de cet
arbriffeau de la nouvelle Efpagne : ufage purgatif de fes amandes.
VII I. 331. a.
- HU D A-K EK ER , ( Botan. ) efpece d’arek. Suppl. I.
549. a.
HUDIBRAS. {Poèmed’ ) Obfervations fur cet ouvrage.
X V I I . 640. æ , b.
H U D SON , baie tf. {Géogr. ) Elle porte le nom de celui
qui l’a découverte en 1640. Etendue de cette baie. Sa déferi-
ption. Rai Ions d’intérêt qui attirent les Européens dans cet
affreux pays. Traite de pelleteries qui s’y fait. Defcription des
fauvages qui l’habitent. Leur maniéré de vivre. Effets fingu-
liers du froid exceffif qui régné dans l’habitation que les Anglois
ont établie dans cette contrée. Comment on s’éclaire pendant
la nuit. VII I. 3 3 1 .E
Hudfon. Froid rigoureux de la baie d’Hudfon. VII . 317.
b. Sauvages de ces contrées. VII I. 347. a. Montagnes de
glace vers le détroit d’Hudfon. X. 678. a. Les métaux peu
fujets à la rouille dans les pays voifins de ce détroit. X IV .
4° 7- b-
HUDSON , compagnie de la baie d’ , {Comm.') fociété de
négociant anglois. Comment elle fe forma & s’établit. Privilèges
accordés par Charles I I , au prince Robert 8c à fes affo-
c iés , en faveur du commerce de cette compagnie. Q u e l fut
fon p remier fonds capital. Combien ce fonds s’ eft enrichi. Les
Anglois & les F rançois fe font alternativement plufieurs fois
chaffés de leurs établiffemens. VIII. 332. a. Cette baie rendue
à l’Angleterre par le traité d’Utrecht. Augmentation des fonds
de la compagnie , au moyen de la paix dont elle a joui dès-
lors jufqu’en i720.Réflexion fur le commerce de cette fociété.
Ibid. b.
HU ET . ( Pierre-Daniel) Obfervations fur les principes &
les ouvrages de ce favant. X III. 612. a.
H U GH E S , ( Jean ) X V I I . 620. b.
HU GUES de S. Cher. Divifion qu’il fit de la bible en chapitres
& en verfets. X V II . 164. a. Obfervations fur ce dominicain.
164. b.
Hugues Capét. ( Hift. de Fran. ) Comment il s’empara
du trône. Principaux événemens de fon régné. Suppl. III.
460. b.
Hugues Capet. Comment il parvint au trône. Suppl. IIL 793*2
b. Lieu où il fe fit p roclamer roi : réflexion fur cet événement,
X I . 274. b.
H U G U E N O T , ( Hift. mod.) nom que les catholiques ont
donné pour fobriquet aux proteftans calviniftes. Son origine
tirée de l’hiftoire de Geneve. Fauffes étymologies de ce m o t ,
que quelques hiftoriens ont imaginées. V I I I . 333 .a . ~
Huguenots. Prohibition des mariages entr’eux & les catholiques.
X. m . b.
H U IL E , Chymie, Pharm. Mat. médic. Diete ) Les connoif-
fances chymiques nous portent à croire qu’il exifte une huile
générale univerfelle très-analogue au fourre commun. L ’huile
peut être conçue comme étant au fo u fre , ce qu’une huile
reélifiée eft à la même huile brute. Procédés chymiques, par
lêfquels on pourroit s’affurer de ce rapport. V II I. 3 3 3. a. C e
q u i les rend fur-tout difficiles, c’eft que la nature ne pré^
lente point de cette huile pure primitive ,' & que l’art n’a pu
dépouiller les moins compofées de tout alliage. Quelle eft la
v raie maniéré dé diftinguer les huiles félon leurs genres &
leurs efpeces. Il n’eft pas égal de dire qu’une telle huile eft
formée par l’union d’un principe huileux uhiv erfe l, & de
plus ou moins d’acide , ou, que cette huile admet plus ou
moins d’acide dans fa mixtion,, ou dans fa compofitioù primordiale.
Quelle eft la feule qualité qui convient à toute
huile. On diftingue les huiles en ejfentielles , graffes 8c empy-
réumatiques. Des huiles ejfentielles. O ù elles font contenues.
Comment on les retire. Ibid. b. Principe auquel elles- doivent
leur odeur & leur volatilité : méthode la plus ufitée qu’on
emploie pour obtenir les huiles effèntielles. Ibid. 334. a. U fage
de l’eau employée dans la diftillation des huiles effentielles.
Comment font retirées les huiles effentielles de citron , de
cédra , & dé tous les autres fruits de cette claffe qu’on nous
•pporte de To fcane & de la côte de Genes. Propriétés ch y-
miques des huiles ellentielles. Comment on les empêche de
s’épaifllr , & on les reffufeite , lorfqu’elles fe font épaifîles.
Ibid. b. Une différence très-générale, eft cellè qui diftingue
celles qui font naturellemeni concrètes , de celles qui font
très-fluides. Une autre dillinélion générale, eft celle qui divife
le s huiles effentielles en'plus légères que l’eau , 8c en plus
pefantes. H uiles analogues aux huiles effentielles : ufages médicinaux,
thérapeutiques 8c diététiques des huiles effentielles.
Propriétés qu’on leur attribue ; précautions avec lefquelles il
faut en ufer intérieurement: leur ufage extéme.^Ibid. 333. a.
Baume de foufre ; favon de Starkey ; efprits volatils , aromatiques
, huileux de Sylvius. Moyens dont fe fervent les
apoticaives pour aromatifer plufieurs de leurs préparations :
c ’eft à des huiles effentielles , que plufieurs liqueurs de nos
tables doivent leur parfum. Comment on parfume la limo-
jiade. Huiles grajfes. Différence entr’eUes 8c les huiles effeu-
Tofie I ,
tiellés, par rapport à la maniéré dont elles fe trouvent dans
les fujets qui les contiennent. Les femences emulfives, celles
de tous les fruits à noyau oü à coque de notre pays , la
pulpe de l’olive , contiennent des huiles graffes. Huile analogue
dans le jaune d’oeuf. Maniéré de retirer ces huiles des
fujets qui les contiennent. Pourquoi ces huiles font appellées
huiles par expreffion. Ibid. b. Huiles graffes, qui ne fe féparent
des corps qui les renferment, que par l’eau bouillante ou la
décoélion de ces corps. Propriétés chymiques des huiles
graffes : d’où dépend leur caraétere fpécifique. Vertus médicinales
8c ufages diététiques de ces huiles. La bonne huile
d’olives vaüdroit autant en médecine que celle d’amandes
douces. Ibid. 336. a. Huiles empyrcumatiques. L e principe huileux
eft un des matériaux univerfels de la compofition de
tout végétal ou ahimal. Pourquoi l’huile empyreumatique eft
anfli appellée feetide. Quels font les fujets qui donnent dans
la diftillation.'analytique de l’huile empyreumatique. Comment
les huiles empyreumatiques peuvent être rendues limpides,
volatiles , 8c perdre leur odéur étrangère 8c défagréable :
propriétés chymiques de ces huiles reélifiées. Ufages médicinaux
des huiles empyreumatiques. Quelles fout les plus employées
en médecine. Huile animale de Dippeliusu vertu
qu’on lui attribue contre l’épilepfie. Ibid. b.
Rapport des huiles en général, avec quelques autres fubftances.
Subftances avec lefquelles l’huile eft immifcible : celles avec
lefquelles on peut la mêler. M étaux qu’elle diffout. Les acides
minéraux agiffent puiffamment fur elle. Corps produit" par
l’acide vitriolique , combiné avec l’huile : effervefcence produite
par ce mélange , 8c par celui de l’acide nitreux avec
. l’huile. Inflammation des huiles , par leur mélange à froid,
avec un acide compofé. Ibid. 337. a. Inflammation de l’huile
de v it r io l, mêlée avec l’efpritde vin. L’huile de vitriol s’enflamme
avec l’huile de térébenthine. L ’efprit de nitre enflamme
l’huile de térébenthine : obfervations fur la certitude de
ces expériences. Diftinélion entre les huiles , relativement à
leurs djfférens degrés d’inflammabilité. Doétrine de M . Rouelle
fur les propriétés de produire l'a flamme, attribuées à l’acide
vitriolique 8c à l’acide nitreux. Ibid. b. Pour donner une
idée complété de toute la manoeuvre néceffaire dans l’exécution
du procédé de l’inflammation des huiles en g énéral,
l’auteur donne ici celui de M. Rouelle fur la plus difficile de
toutes les huiles , qui eft l’huile d’olives. Huiles pharmaceuti-
tiques., ou par infufion OU décoélion : procédés par lefquels
on fe les procure. Obfervation fur leur ufage oc leurs propriétés.
Huile d’antimoine , d’arfenie* de jupiter, de mars ,
de mercure, de faturne , de vénus. Huile de chaux , huile de
tartre , huile de tartre par défaillance, huile de vitriol. Falfi-
fication des huiles ejfentielles. Comment elles peuvent être fal-
fifiées. Ibid. 338. a. Celles des aromates des Indes le font
prefque .toujours. Maniéré de découvrir la fraude. Falfi-
fication qui confifte à mêler une huile effentielle de v il
prix à une autre plus chere. Comment cette fraude fe découvre.
Ibid. b.
Huile. Aélion de la chaux'fur les huiles. III. 267. b. Quelle
eft la plus volatile des huiles connues. Y I . 3*1. b. Méthode
qui fert de modèle pour tirer des huiles de toute forte d’a-
romates. VII. 672. a. D e la congélation des huiles. 677. b.
*679.' a. 682, b. Evaporation de l’huile. X. 192. a. Principe de
la faveur des huiles. X IV . 709. a. Inflammation des huiles
par les acides. X V I . 149: b. Les fubftances huileufes employées
contre les vers. X V II . 74. a. Des huiles ejfentielles :
celles des fleurs. V I . 83 3. a. U ne huile effentielle eft nue dans
les végétaux.XI. 273. b. U nion du principe odorant des végétaux
avec l’huile effentielle. 333. a. Effet de la diftillation des
diffolutions des différentes huiles eflVntielles dans l’efprir de
vin. X V I I . 287. b. Huiles effenticli es combinées avec du
fucre. V . 498. b. Des huiles par exprejfion. Moulins pour exprimer
l’huile des graines. X. 811 . a , b. 812. a , b. Les huilejMpar
expreffion ne participent en rien des qualités des priimpes
renfermés dans leurs enveloppes. 826. a. Huiles empyreùmati-
ques. Leur odeur. V . 601. b. — Sur les huiles , voyé^ O l éa gineux.
Huile des métaux , ( Chymie ) . VII I. 339. a.
Huiles de philojophes, XII. 31 1. a.
Huile d’OnSion, {Hift. fier. ) celle queMoïfe avoir com-
pofée pour la confécration du r o i, du fouverain facrifica-
teur 8c des vaiffeaux facréS. Moïfe ordonna de la garder pré-
cienfement. Chaque roi n’étoit pas o int, mais feulement le
premier de la famille pour lui Sc ies fucceffeurs de fa race.
On répétoit l’onélion fur celui de la famille auquel la fuc*
ceffion avoit été conteftée. Vaiffeaux 8c uftenfiles qu’on
oignoit a\ ec cette huile. L ’huile d’onétion ayant péri avec le
premier temple, cet accident caufa un défaut de fainteté
dans toutes les chofes qui appartinrent au fécond temple.
Cinq chofes principales dont le fécond temple fut privé :
l’arche de l’alliance; le fehekinna; l’nrim 8c le tluimmim.
VIII. 339. a. Le feu fac ré , l’efprit de prophétie. Comment
la gloire du fécond temple l’emporta cependant fur celle du
premier Ibid, b<
D D D D D d d d d d d