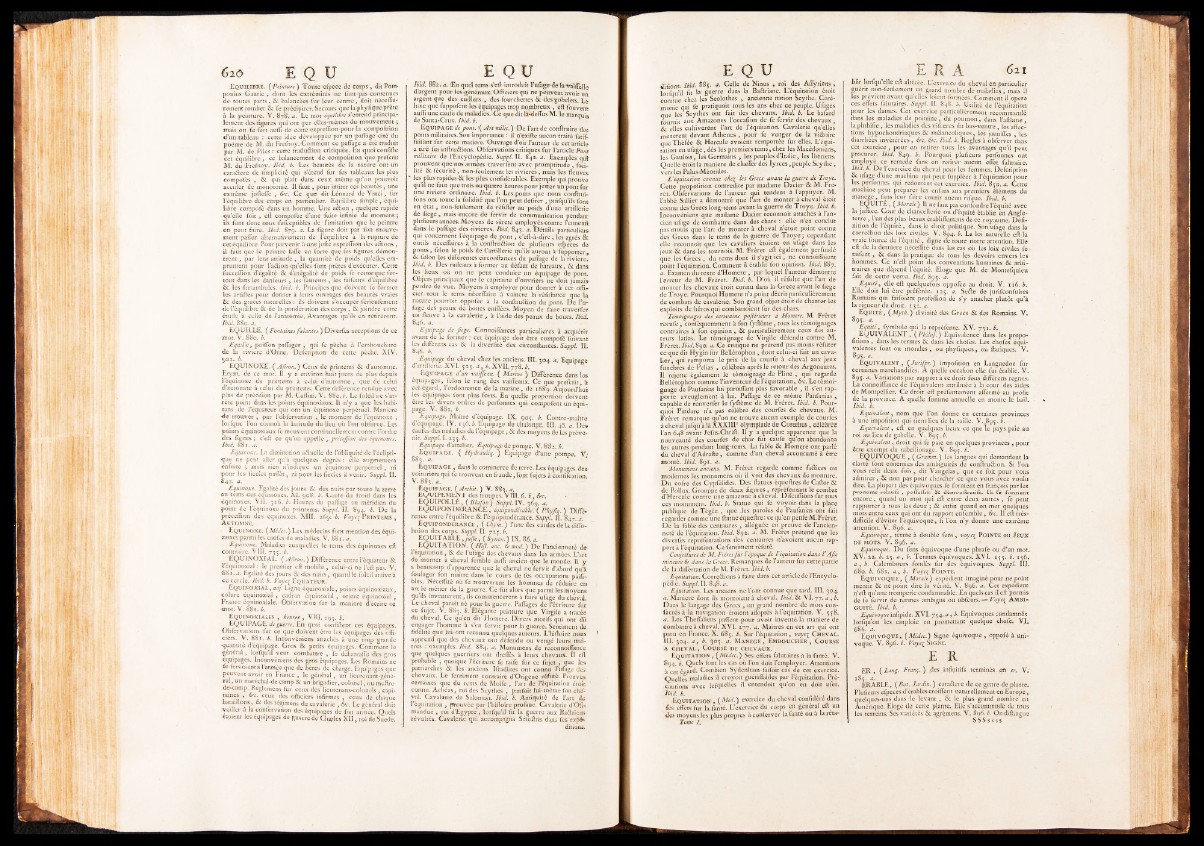
6i& E Q U
E q u il ibr e . .(''Peinture ) Toute-efpece-'de corps , ditPom-
ponius G au r ie , dont les 'extrémités ne font ipas contenues
de toutes parts, 8c balancées fur leur centre, doit néceffai-
renient tomber 8c fe précipiter: Secours que'la phyfiquepfête
à la peinture. V . 878. a. L e motéquilibre^ontenà principa-
leinent des figures qui ont,-par élles-mèmes du -mouvement ;
mais on fe fert auffi de cette expreffion pour 4a oompofttion
d’un tableau : cette idée développée par un partage -cité du
poëme de M. du F refnoy. Comment ce partage a été'traduit
par M. de Piles : cette traduction -critiquée. En quoi confifte
cet équilibre , ce balancement de compofition •queprefcrit
M. du Frefnoy. Ibid. b. Les beautés de la nature ont un
caraftere de Simplicité qui détend-fur fes tableaux les plus
compofés , & qui plaît dans ceux même qu’on pourroit
acculer de monotonie. Il fa u t , pour imiter ces beautés, une
extrême jofteffe , &c. 'C e que d it Léonard de V in c i, fur
l’équilibre des corps en particulier. Equilibre frniple, -équilibre
compofé dans un ‘homme. 'Une aétion , quelque rapide
qu’elle S o it , eft compofée d’une fuite infinie de momens ;
ils font donc -tous -fufceptibles -de limitation que le peintre
en peut faire. Ibid. 879. a. La ‘figure doit par fon mouvement
pafler alternativement de l ’équilibre à la rupture de
cetéquilibre. Pour parvenir à-une jufte expreffion des aétions ,
i l faut que le peintre farte en forte que -fes figures démontrent
, jpar leur attitude, la quantité de poids qu’elles empruntent
pour Taétion qu’elles font prêtes d’exécuter. Ce tte
ïiicceiTion d ’égalité & d’inégalité de poids fe remarque fur-
tout dans les danfeurs , les fauteurs , les faifeurs (l’équilibre
& les funambules. Ibid. b. -Principes que doivent fe former
les artiftes pour donner à leurs ouvrages des beautés vraies
6c des grâces naturelles : ils doivent s’occuper férieufement
de l ’équilibre & de la pondération des corps , & joindre cette
étude à celle de l’anatomie. Avantages qu’ils en retireront.
Ibid. 880. a.
EQUÎLLE. ( Fontaines fniantes ) D iv erfes acceptions de ce
mot. V . 880. b.
Equille, poi-ffon partager, qui ;fe pêche à l ’embouchure
de la riviers d’Orne. -Defcription de cette pêche. X IV .
30 a. b.
EQ UIN OX E. ■ ( Aflron. ) Ceux de printems 8c d’autompe.
Etym. de ce mot. Il y a environ ‘huit jours de plus depuis
l ’équinoxe du printems à celui d’automne , que de celui
d ’automne à celui du printems. Cette différence rendue avec
plus de précifion par M. Caffini. V . '880. b. L e fo le il ne s’arrête
point dans-les points équinoxiaux. Il n’y a que les hâbi-
tans de l’équateur qui ont un équinoxe perpétuel. Maniéré
«le trouver , par l’obfervation , le moment de l’équinoxe ,
lorfque l’on connoît la latitude du lieu où l’on obforve. Les
points équinoxiaux fe meuvent continuellement contre l ’ordre
des fignes ; c ’eft ce qu’on appelle , précejfion des équinoxes.
Ibid. 881. a.
Equinoxe. La diminution aéhielle de l’obliquité de l’édipti-
que ne peut aller qu’à quelques degrés : elle augmentera
enfuite ; mais rien n’indique tin équinoxe perpétuel, ni
"pour les iiecles palfés , ni pour -les fiecles à venir. Suppl. II.
842. a.
Equinoxe. Egalité des jours & des nuits par toute la terre
au tems des -équinoxes. X I. 908. b. Caufe du froid dans les
équinoxes. V II . 316. b. Heures du paffage au méridien du
point de l’équinoxe du printems. Suppl. i l . 894. b. D e la
préceffion des équinoxes. XIII. 269. b. Voye{ Printems ,
A utomne.
E q u in o x e . ( Médec.) Les médecins font mention des équinoxes
parmi les caufes de maladies. V . 881. a.
Equinoxe. Maladies auxquelles le tems des équinoxes eft
contraire. VII I. 733. b.
'■ EQ U IN O X IA L . ( Aflron. ) Différence entre l’équateur &
l ’équinoxial : le premier 'eft mobile , celui-ci ne l’eftpas. V .
€81. a. Egalité des jours Sc des nuits, quand le foleil arriveà
c e cercle. Ibid. b. Voyeç EQUATEUR)
E q u in o x ia l , adj. Ligne équinoxiale, points équinoxiaux,
colure équinoxial , cadran équinoxial , orient équinoxial,
France équinoxiale. Obfervatiou fur la maniéré d’écrire ce
mot. V . 88*. b.
E q u in o x ia l e s , heures, VIII. 193. b.
EQ U IPA G E de guerre. En quoi confident ces équipages.
Obfervations fur ce que doivent être les équipages des officiers.
V . 881. b. Inconvéniens attachés à une trop grande
•quantité d’équipage. Gros 8c petits équipages. Comment le
g én é ra l, lorlqu’il veut combattre , fe débarraffe des gros
équipages. Inconvéniens des gros équipages. Les Romains ne
fe fervoientà l’armée que de bêtes de charge. Equipages que
peuvent avoir en France , le g énéral, un lieutenant-généra
l, un maréchal-de-camp & un brigadier, co lon el, ou meftre-
de-camp. Réglemens fur ceux des lieutenans-colonels, ,eapi-
«ames , &c. ceux des officiers infirmes , ceux de chaque
bataillons , & des régimens de cavalerie , &c. Le général doit
v eiller à la confervation des équipages de fon armée. Quel?
étpient les équipages de guerre de Clw les X I I , roi de Suede.
E Q U
, Ibi'd. 88a- a. <En quel tems s’eft • introduit l ’ulàgfe'de'k•vâîfTello
I d’argent pour les'généraux.Officiers qui ne peuvent avoir cri
argent que des 5cuillers „ des fourchettes & des gobelets. Le
luxe que fuppofent les équipages trop nombreux , eft fouvent
] auffi une-caufe de maladies. C e que dit là-deffus M. le marquis
I de Santa-Crux. Ibid. b.
E q u ip a g e de pont. <( Art milit. ) -De l ’art de conftruire des
1 ponts militaires. Son importance : il n’exifte aucun traité fatif.
I faifant fur cette matière. O u vrag e d’où l’auteur de cet article
| a tiré fes inftruélions. Obfervations critiques fur l’article Pont
i militaire de l’Encyclopédie. Suppl. II. 842. a, Exemples qift
; prouvent que -nos armées -traverfent a v e c promptitude , faci-
| ïùé 8c fécurité, non-feulement les r ivières, mais 'les fleuves
j ‘ les plus-rapides & les plus confidérables. Exemple qui prouve
j qu’il ne faut que trois ou quatre heures pour'jetter un pont fur
j une riviere ordinaire. Ibid. b. Les ponts que nous conftrui-
fons qnt toute la folidité que l’on peut defirer , putfqu’ils font
; en é ta t , non-feülement .de réfifter au poids d’une artillerie
j de fiege , mais encore de fervir de communication pendant
plufieurs années. M oyens de sûreté employés contre/ennemi
dans le paffage des rivières. Ibid. '843. a. D étails particuliers
qui concernent l’équipage de .pont, c’eft-à-dire , les agrès &
outils néceffaires à la conftrnétion de plufieurs efpeces de
j ponts, félon le -poids de 'l’artillerie qu’ils auront à fuppo rter,
& félon les différentes circonftances du paffage de la r iviere.
Ibid. b. Des radeaux à former au défaut de bateaux , & dans
j les 'lieux ou on ne peut conduire un équipage de pont,
j Objets principaux que le capitaine d’ouvriers ne doit jamais
! perdre de vue. Moyens à employer pour donner à cet offi-
I c ie r to u t le tems néceffaire à vaincre la réfifiance que'la
j nature pourroit oppofer à la conftruftion du pont. D e l’u-
| fage des peaux ‘de boucs enfilées. Moyen de faire traverfer
un fleuve a la cavalerie , à l ’aide des peaux de 'boucs. HfiiL
] 846. a.
Equipage de fiege. Connoiffances particulières à acquérir
; avant de le former : ce t équipage doit être compofé fuivant
j les différens cas 8c la diverfité des circonftances. Suppl. TI.
! 846. b.
Equipage du cheval chez les anciens. III. 304. à. Equipage
! d’artillerie. X V I . 525. « , b. X V I I .778. b.
! , E q u ip a g e d'un var/feau. ( Marine ) Différence dans les
| équipages, félon le rang des vaiffeaux. C e que prefcrit, à
j ce t é ga rd, l’ordonnance de la marine, de 1689. Aujourd’hui
| les équipages font plus forts. En quelle proportion doivent
être les divers ordres de perfonnes qui compofent un éaui-
page. V . 882. b.
^Equipage. Maître d’équipage. IX. 903. b. Contre-maître
d’équipage. -IV. 136. b. 'Equipage de chaloupe. IH. 40. a. De»
I caufes des maladies de l’équipage, & des moyens de les prévenir.
Suppl. I. 2 3 3. b.
1 Equipage d’attdier. Equipage de pompe. V .8 82 . b.
j Eq u ip a g e . ( Hydrmdiq, ) Equipage d’une pompe. V ;
; 883. a.
É q u ip a g e , dans le commerce de terre. Les équipages, des
; voituriers qui fe trouvent en fraude, font fujets à corififcation.
j V .8 8 3 . *.
Eq u ip a g e . ( Archet. ) V . 883. a.
EQ UIPEM ENT des troupes. V IH. 6. b , &c.
: EQ U 1PO L L É , ( Blafon ) Suppl. IV . 369. a.
E Q U 1P O N D E R A N C E , éqàipondêratle:( Phyfiq. ) Diffé*
j rence entre l’équilibre & f équipondérance. Suppl, i l . 847. a
E q u ipo n d er an c e , ( Chym. ) l’une des caufes d e là dîffô-
1 lution des corps. Suppl. IL 723. b.
EQ U IT A B L E ,ju fle , ( Synon. ) IX. 86. a.
; ^ E Q U IT A T IO N . ( Hifl. anc. & mod. ) D e l’ancienneté de
. l ’équitation, & de l’ufage des chevaux dans les armées. L ’arc
; de monter à cheval femble auffi ancien que le monde. Il y
a beaucoup d’apparence que le cheval ne fervit d’abord qu’à
foulager fon maître dans le cours de fes occupations paîfi-
bles. Néceffité où fe trouvèrent les hommes de réduire en
art le métier de la guerre. C e fu t alors que parmi les moyens
qu’ils inventèrent, ils commencèrent à faire ufage du cheval.
L e cheval paroît né pour la guerre. Partages de l’écriture fur
ce fujet. V . 883. b. Elégante peinture que Virgile a tracée
du cheval. C e qu’en dit Homere. Divers motifs qui ont dû.
engager l’homme à s’en fervir pour la guerre. Sentiment de
fidelité que lui. ont reconnu quelques auteurs. L ’hiftoire nous
apprend que des chevaux ont défendu' ou vengé leurs maîtres
: exemples. Ibid. 884. a. Monumens de reconnoiffance
que quelques guerriers ont dreffés à leurs chevaux. Il eft
probable , quoique l’écriture fe taife fur ce fujet , que les
patriarches & les anciens Ifraélites ont connu l’ufage des,
chevaux. Le fentiment contraire d’Origene réfuté. Preuves
certaines que du rems de M o ïfe , Part de l’équitation étoîc ‘
connu. A ch éa s, roi des Scythes , panfoit lui-même fon cheval.
Cavalerie de Salomoa.'Ibid. b. Antiquité de Part de
Péquitarion , prouvée par Phiftoire profane. Cavalerie d’Ofi-i
manchié , roi d’Egypte , lorfqu’il fit la guerre aux Baétrierfs
I révoltés. Cavalerie qui accompagna Scfoftrk dans fes cxp&-
‘ dirions.
E Q U
dirions. Ibid. 883. e . Celle de Ninus , roî des Affyriens ,
lorfau’il fit la" guerre dans la Ba&riane. L’équitation étoit
connue chez les Scolothes , ancienne nation Scythe. Cérémonie
qui fe pratiquoit tous les ans chez ce peuple. Ufages
que les Scythes ont fait des chevaux. Ibid, b. L e hafard -
fournit aux Amazones l’occafton de fe fervir des chevaux,
& elles cultivèrent Part de l’équitation. Cavalerie qu’elles
menèrent devant A th èn es , pour fe venger de la victoire
que Théfée & Hercule avoient remportée fur elles. L’équitation
en u fage, dès les p remiers tems, chez les Macédoniens,
les Gaulois, les Germains , les peuples d’Italie, les Ibériens.
Quelle étoit la maniéré de charter des Iy rc es , peuple S cy th e ,
vers les Palus-Méotides.
L ‘équitation connue cher les Grecs avant la guerre de Troye.
Cette propofition contredite .par madame Dacier & M. Fre-
rët. Obfervations de l’auteur qui tendent à l’appuyer. M.
l’abbé Sallier a démontré que Part de monter à cheval étoit
connu des G recs long-téms avant la guerre de T roy e . Ibid. b.
Inconvéniens que madame Dacier reconnoît attaches à l’ancien
ufage de combattre dans des chars : elle n en conclut
pas moins que Part de monter à cheval n’etoit point connu
des Grecs dans le tems de la guerre de T r o y e ; cependant
elle reconnoît que les cavaliers étoient en ufage dans les
jeux & dans les tournois. M. F rére t eft également perfuadé
que les Grecs , du tems dont il s’agit i c i , ne connoiffoient
point l’équitation. Comment il établit fon opinion. Ibid. 887.
a. Examen du texte d’Homere , par lequel l’auteur démontre
l’erreur de M. Fréret. Ibid. b. D ’où il réfulte que Part de
monter les chevaux étoit connu dans la Grece avant le fiege
de T ro y e . Pourquoi Homere n’a point décrit particuliérement
de combats de cavalerie,. Son grand objet étoit de chanter les
exploits de héros qui combattoient fur des chars.
Témoignages des écrivains poflérieurs à Homere. M. Fréret
reeufe , conféquemment à fon fyftême , tous les témoignages
contraires à fon opinion, & particuliérement ceux des auteurs
latins. L e témoignage de Virgile défendu contre M.
Fréret. Ibid. 890. a. C e critique ne prétend pas moins réfuter
ce que dit Hygin fur Bellérophon, dont celui-ci fait un cavalie
r , qui remporta le prix de la courfe à cheval aux jeux
funèbres de Pelias , célébrés après le retour des Argonautes.
IJ rejette également. le témoignage de Pline , qui regarde
Bellérophon comme i’inventeur de l’équitation, &c. L e témoignage
de Paufanias lui paroiffant plus favorable , il s’en rapporte
aveuglement à lui. Paffage de ce même Paufanias ,
capable de renverfer le fyftême de M. Fréret. Ibid. b. Pourquoi
Pindare n’a pas célébré des courfes de chevaux. M.
Fréret remarque qu’on ne trouve aucun exemple de courfes
à cheval jufqu’à la X X X IIIe olympiade de Coroe bus, célébrée
l’an 648 avant Jefus-Chrift. Il y a quelque apparence que la
nouveauté des courfes de char fut caufe qu’on abandonna
les autres (pendant long-tems. La fable & Homere ont parlé
du cheval d’Adrafte, comme d’un cheval accoutumé à être
monté. Ibid. 891. a.
Monumens anciens. M. Fréret regarde comme faâices ou
modernes les monumens où il voit des chevaux de monture.
D u cofre des Cypfèlides. Des ftatues équeftres de Caftor &
de Pollux. Grouppe de deux figures , repréfentant le combat
d’Hercule contre une amazone à cheval. Difcuffions fur tous
ces monumens. Ibid. b. Statue qui fe v o yo it dans la place
publique de Té g é e , que J e s paroles de Paufanias ont fait
regarder comme une ftatue équeftre: ce qu’en penfe M. Fréret.
D e la fable des centaures , alléguée en preuve de l’ancienneté
de l’équitation. Ibid. 892. a. M. Fréret prétend que les
diverfes reprèfentations des centaures n’avoient aucun rapport
à l’équitation. C e fentiment réfuté.
Conjeélures de M. Fréret fur l ’époque de l ’équitation dans l ’Afie
mineure 6» dans la Grece. Remarques de l’auteur fur cette partie
de la differcation de M . Fréret. Ibid. b.
Equitation. C otre étions à faire dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. IL 848. a.
Equitation. Les anciens ne l’ont connue que tard. III. 304.
a. Maniéré dont ils montoient à cheval. Ibid. & V I . 77. a , b.
Dans le langage dés Grecs , un grand nombre de mots con-
facrés à la navigation étoient adoptés à l’équitation. V . 338.
a. Les Theffaliens partent pour avoir inventé-la maniéré de
combattre à cheval. X V I . 277. a. Maîtres en cet art qui ont
paru en France. X. 683. b. Sur l’équitation , voye{ C h e v a l .
III. 304. a , b. 303. a. Ma n e g e , Em b o u c h e r , C ourse
a c h e v a l , C o ur se de c h e v a u x .
E q u it a t io n , (Médec.) Ses effets falutaires à la fanté. V .
894. b. Quels font les cas où l’on doit l ’employer. Attentions
à cet égard. Combien Sydenham faifoit cas de cet exercice.
Quelles maladies il croyoit guériffables par l’équitation. Précautions
avec lefquelles il entendoit qu’on en doit ufer.
Ibid. b.
E q u it a t io n , (Med.) exercice du cheval confidéré dans
fes effets fur la fanté. L'exercice'du corps en général eft un
des moyens les plus propres àconferver la fanté ou à lareta-
Tome I,
E R A 621
blir lorfqu’elle eft -altérée. L’exercice du cheval en particulier
guérit non-feulement un grand nombre de maladies , mais il
les prévient avant qu’elles foient formées. Comment il 'opere
ces effets falutaires. Suppl. II. ,848. b. Utilité de l’équitation
pour les dames. C e t exercice particuliérement recommandé
dans les maladies de poitrine, du poumon, dans l’afthme
la phthifie, les maladies des vifeeres du bas-ventre, les affections
hypochondriaques & mélancoliques, les jauniffes , les
diarrhées invétérées, &c. &c. Ibid. b. Réglés à obferver dans
cet exercice , pour en retirer 'tous les avantages .qu’il peut
procurer. Ibid. 849. b. Pourquoi plufieurs perfonnes ont
employé ce remeae fans en retirer aucun effet falutaire.
Ibid. b. D e l’exercice du cheval pour les femmes. Defcription
& ufage d’une machine qui peut fuppléer à l ’équitation pour
les perfonnes qui redoutent cet'exercice. Ibid. 830. a. Cette
machine peut préparer les enfans aux premiers élémens du
manege, fans leur faire courir aucun rifque. Ibid. b.
E Q U IT E , ( Morale) Il ne faut pas contondre l’équité avec
la juftice. Cour de chancellerie ou d’équité établie en Angleterre
, l’un des plus beaux établiffemens de ce royaume. Définition
de l’équité, dans le droit politique. Son ufage dans la
correction des loix civiles. V . 894. b. La loi naturelle eft la
vraie fource de l’équité , digne de toute notre atténtion. Elle
eft de la derniere néceffité dans les cas où les loi* civiles fe-
taifent, & dans la pratique de tous les devoirs envers les
hommes. C e n’eft point des conventions humaines 8c arbitraires
que dépend l’équité. Eloge que M. de Montefquieu
fait de cette vertu. Ibid. 803. a.
Equité, elle eft quelquefois oppofée au droit. V . 116. b.
Elle doit lui être préférée. 123. a. SeCte de jurifeonfuhes
Romains qui faifoienr profeffion de - s’y attacher plutôt qu’à
la rigueur du droit. 13 2.«.
Eq u i t é , ( Myth. ) divinité des Grecs & des Romains. V .
895. ,*. ■
Equité, fymbole qui la repréfente. X V . 73 1 . b.
E Q U IV A L E N T , (P h ilo / .) Equivalence dans les propo-
fiuo ns, dans les termes & dans les chofes. Les chofes équivalentes
font ou morales , ou phyfrques, ou ftariques. V .
893. a.
Eq u iv a l e n t , (Jurifpr.) impofition en Languedoc fur
certaines marchandifes. A quelle occafion elle fut établie. V .
893. a. Variations par rapport à ce droit fous différens régnés.
La connoiffance de l’équivalent attribuée à la cour des aides
de Montpellier. C e droit eft préfentement affermé au profit
de la province. A quelle fomme annuelle en monte le bail.
Ibid. b.
Equivalent, nom que l’on donne en certaines provinces
à une impofition qui tient lieu de la taille. V . ,893. b.
Equivalent, eft en quelques lieux ce que le pays paie au
roi au lieu de gabelle. V . 893. b.
Equivalent, droit -qui fe paie en quelques provinces , pour
être exempt du tabellionage. V . 893. b.
E Q U IV O Q U E , ( Gramm.) les langues qui demandent la
clarté font ennemies des .ambiguités de conftruâion. Si l’on
vous relit deux fo i s , dit Vaugelas ', que ce foit pour vous
admirer, & non pas pour chercher ce que vous ayez voulu
dire. La plupart des équivoques f e forment en françois par les
pronoms relatifs, poffeffifs & démonftratifs. Ils fe forment
enco re , quand un mot qui eft entre deux autres , fe peut
rapporter à tous les deux ; & enfin quand on met quelques
mots entre ceux qui ont du rapport enfemble, &C. Il eft très-
difficile d’éviter l’équivoque, fi l’on n’y donne une excrême
attention. V . 896. a.
Equivoque, terme à double fens , voyeç Po in te ou Je u x
de mo t s . V . 896. a.
Equivoque. D u fens équivoque d’une phrafe ou d’un mot.
X V . 22. b. 23. a , b. Termes équivoques. X V I . 153. é. 136.
a , b. Calembours fondés fur des équivoques. Suppl. III.
680. b. 681. a , b. Voye^ POINTE.
E q u iv o q u e , ( Morale) expédient imaginé pour ne point
mentir 8c ne point dire la vérité. V . 896. a. Ce t expédient
n’eft qu’une tromperie condamnable. En quels cas il .eft permis
de fe fervir de termes ambigus ou obfcurs. — Voyes^ A m b i gu
ïté . Ibid. b. 1
Equivoque infipide. X V I . 734 .4 ,• b. Equivoques condamnés
lorfqu’on les emploie en promettant quelque chofe. V I ;
686. a. ’ ' ' ’ V . ' ' •
Eq u iv o q u e , (Médec.) Signe équivoque, oppofé à univoque.
V . 896. b. Voye£ Sig n e .
E R
ER , (Lang. Franç. ) d e s . infinitifs terminés en er. V ;
183. a.
ERA BL E, (Bot. Jardin.) caraélere de ce genre de plante.
Plufieurs efpeces d’érables croiffent naturellement en Europe,
quelques-uns dans'le levant , 8c le plus grand nombre .cn
Amérique. Eloge de cette plante. Elle s’accommode de tous
les terreins. Ses variétés 8c agr^mens. V . 896. b. On diftingue