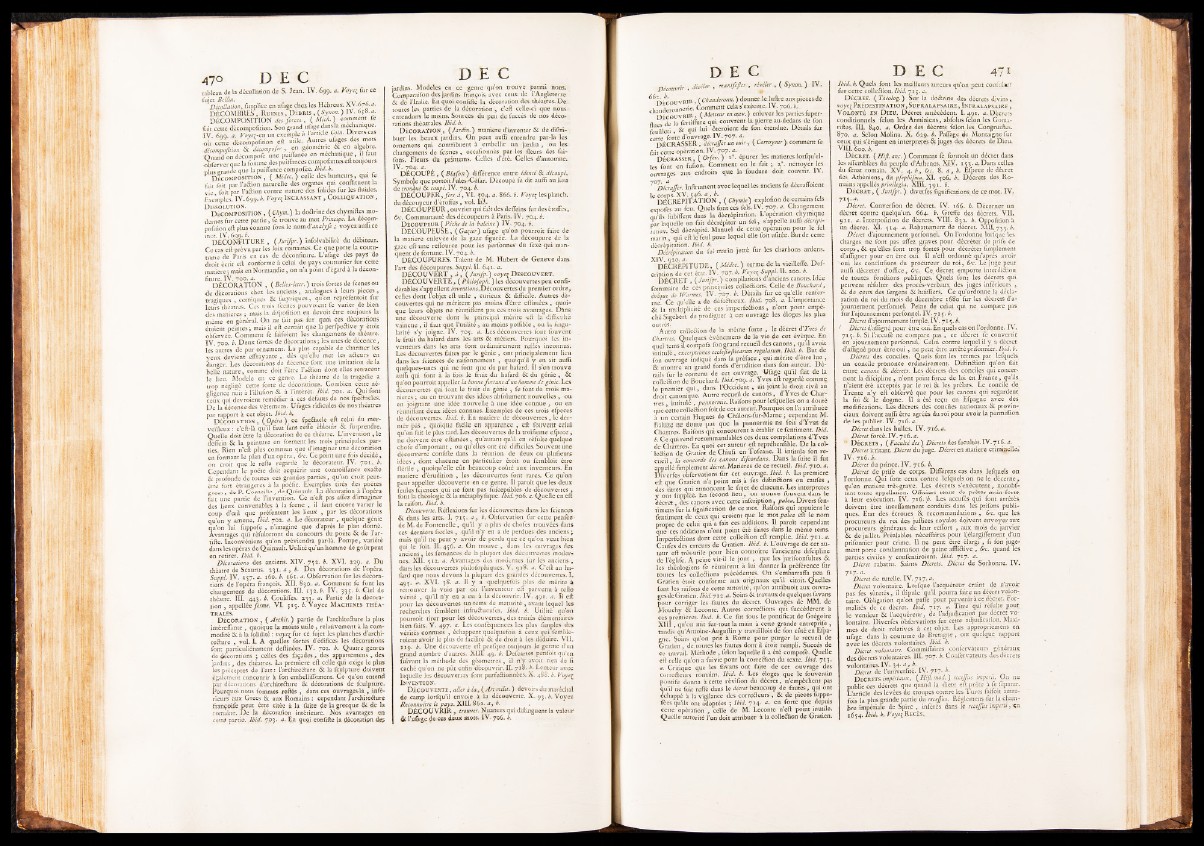
47° D E C
tableau de la décollation dé S, Jean. IV . 699, a. Voye^ fur ce
fujet jBellin. . . .
Décollation, fupplice en ufagc chez.les Hebreux. X v .070.a.
DÉCOMBRES, Ruines, Débris, ( Synon.) IV . 65 b.a.
D É C OM PO SIT IO N des forces , ( Méch. ) comment le
fait cette .dèeompofmon. Son grand ufage dans la mfehanique.
IV . 699. a. r » k - e .. un exemple à S g g l Corn. Divers cas m cette décompofrtion Eg B jgffî B
dccompufic'wn & décomposer, en g' lu trie c en g l' '
Q uand on décompofe nne, ■ H S en méchanique , .1 faut
•obferver que la foin me despuiffauces compofontes eit toujours
dIus grande que la puiffance coippofée. Ibid. b.
v D écompo sit io n , ( Médec. ) celle des humeurs, qui fe
fait loit par l’aftion naturelle des organes qui continuent la
v ie , foit par l’aftion contre nature des folides fur les fluides.
dissolution. wmmmm , ,
DÉCOMPOSITION, ( Cliyrn. ) la doftrine des chymilles modernes
fur cette partie, fe trouve au mot Principe. La décom-
pofition eft plus connue fous le nom à’analyfc ; v o y e z auflice
mot. IV . 69.9. b.
D É CO N F ITU R E , ( Jurifpr. ) infolvabilite du debiteur.
C e cas eft prévu par les loix romaines. C e que porte la coutu-
tume de Paris en cas de déconfiture. L’ufage des pays' de
droit écrit eft conforme à celui de pays coutumier fur cette
matière ; mais en Normandie, on n’a point d’égard à la déconfiture.
IV . 700. a.
D É C O R A T IO N , ( BclUs-lcttr. ) trois fortes de feenes ou
<le décorations chez les anciens, analogues à leurs pièces ,
tragiques , comiques & fotyriques, qu’on repréfentoit fur
leu?s théâtres. Ces trois feenes pouvoient fe varier de bien
des maniérés ; mais la difpofition en devoit etre toujours la
même en général. On ne fait pas fur quoi ces décorations
étoient peintes; mais il eft certain que la perfpeftive y étoit
obfervée. Comment fe foifoient les changemens de théâtre.
IV . 700. b. Deux fortes de décorations; les unes de décence,
les "autres de pur ornement. La plus capable de charmer les
y eu x devient effrayante , dès qu’elle met les afteurs en
danger. Les décorations de décence font une imitation de la
belle nature, comme doit l’être l’aftion dont elles retracent
le lieu. Modèle en ce genre. Le théâtre de la tragédie a
trop néglige cette forte de décorations. Combien cette négligence
nuit à l’illuflon 8c à l’intérêt. Ibid. 701. a. Q ui font
ceux qui devroient remédier à ces défauts de nos fpeftacles.
D e la décence des vêtemens. Ufages ridicules de nos théâtres
par rapport à cet objet. Ibid. b.
Décoration , ( Opéra ) ce fpeftacle eft celui du merveilleux
: c’eft-là qu’il faut fans ceffe éblouir & furprendre.
Q u elle doit être la décoration de ce théâtre. L’invention , le
deffein 8c la peinture en forment les trois principales parties.
Rien n’eft plus commun que d’imaginer une décoration
en formant le plan d’un opéra, &c. C e point une fois décidé,
on croit que le refte regarde le décorateur. IV . 701., b.
Cependant le poëte doit acquérir une connoiffance exafte
& profonde de toutes ces grandes parties, qu’on croit peut-
être fort étrangères à la poéfie. Exemples tirés des poètes
grecs , de P. Corneille, de Quinault. La décoration à l’opéra
fait une partie de l’invention. C e n eft pas affez d imaginer
des lieux convenables à la feene , il faut encore varier le
coup d’oeil que préfentent les lieux , par les décorations
qu’on y amene. Ibid. 702. a. L e décorateur , quelque génie
qu’on lui fuppofe , n’imagine que d’après le plan donné.
Avantages qui réfulteront du concours du poëte & de l’ar-
tifte. Inconvèniens qu’on préviendra par-là. Pompe, variété
dans les opéras de Quinault. Utilité qu’un homme de goût peut
en retirer. Ibid. b.
Décorations des anciens. X IV . 752. b. X V I . 229. a. D u
ihéatre de Scaurus. 231. a , b. D es décorations de l’opéra.
Suppl. IV . 157. a. 160. b. 161. a. Obfervation fur les décorations
de l’opéra françois. XII. 830. a. Comment fe font les
changemens de décorations. III. 132. A IV . 335. b. Ciel de
théâtre. III. 443. b. Couliffes. 233. a. Partie de la décoration
, appellée ferme. V I . 513. b. v o y e z Machines théa-
TKALts.
Décoration , ( Arch.it. ) partie de l’architefture la plus
intéreffante , quoique la moins utile , relativement à la commodité
8c à la lolidité : voyeç fur cé fujet les planches d’archi-
tefture , vol. I. A quelles fortes d’édifices les décorations
font particuliérement deftinées. IV . 702. b. Quatre genres
de décorations ; celles des façades, des appartenons , des
jardins, des théâtres. La première eft celle qui exige le plus
les préceptes de l’art : l’architefture & la fculpture doivent
également concourir à fon embelliffement. C e qu’on entend
par décorations d’architefture 8c décorations ae fculpture.
Pourquoi nous fonimes reftés , dans ces ouvrages-là , inférieurs
aux Grecs & aux Romains : cependant l’architefture
françoife peut être citée à 1? fuite {le I» grecque 8c de la
romaine. D e la décoration intérieure. Nos avantages en
cettê partie. Ibid. 703. a. En qufti confifte la décoration dg?
D E C
jardins. Modèles en ce genre qu’on trouve parmi nous.
Comparaifon des jardins françois avec ceux de l’Angleterre
& de l’Italie. En quoi confifte la décoration des théâtres. De
toutes les, parties de la décoration > ç’eft c.ellerci que nous>
entendons le moins. Sources, du peu de fuccès. de nos déco»
rations théâtrales. Ibid. b.
Décoration, {Jardin.) maniéré d’inventer & dediftri-
buer les, beaux jardins. Q n peut auffi entendre, par-là les
ornemens qui contribuent à embellir un jardin , ou les.
changemens de fesnes , occafionnés par les fleurs des foi-
fons. Fleurs du printems. Celles d’été. Celles d’automne»
IV . 704. a.
D É CO U PÉ , ( B laf0:1 ) différence entre édenté 8c découpé.
Symbole que portoit Jules-Céfar. Découpé fe dit auffi an lieu
de tronqué & coupé. IV . 7Q4. b.
D É C O U P E R , fers, à , V I . «04. a. 866. b. Voye^ les planch.
du découpeur d’étoffés, vol. l lL
D É C O U P E U R , ouvrier qui fait des deffeins fur des étoffes,
6>c. Communauté des découpeurs à Paris. IV . 704. b.
Découpeur ( Pêche de la baleine) IV . 704. b,
D É CO U PEU SE , ( Gabier) ufage qïi’on pourxoit faire de
la matière enlevée de la gaze figurée. La découpure de la
gaze eft une reffource pour les perfonnes- du fexe qui manquent
de fortune. IV . 704. b,
DÉCOUPURES. Talent de M. HuheEt de Geneve dans
Part des découpures. Suppl. II. 641. a.
D É C O U V E R T , à , ( Jurifp.) voyc[ Descouvert.
D É C O U V E R T E , ( Philofavk. ) les découvertes peu confi-
dérables s’appellent inventions.Découvertes du premier ordre,
celles dont l’objet eft utile , curieux & difficile. Autres découvertes
qui ne méritent pas moins d’être eftimées , quoique
leurs objets ne réunifient pas ces trois avantages. Dans
une découverte dont le principal mérite eft la difficulté
vaincue , il faut que, fu t ilité , au moins poffible, ou la Angularité
s’y joigne. IV . 705. a. Les découvertes font fouvent
le fruit du hafard dans les arts & métiers. Pourquoi les inventeurs
dans les arts font ordinairement reftés inconnus.
Les découvertes faites par le génie , ont principalement lieu
dans les feiences de raifonnement , quoiqu’il y en ait auffi
quelques-unes qui ne font que de pur hafard. Il s’en trouve
auffi qui font à la fois le fruit du hafard & du g én ie , &
qu’on pourroit appeller la bonne fortune d’un homme det génie. Les
découvertes qui font le fruit du génie , fe font de trois maniérés
; ou en trouvant des idées abfolument nouvelles , ou
en joignant une idée nouvelle à une idée connue , ou en
réunifiant deux idées connues. Exemples de ces trois efpeces
de découvertes. Ibid. b. En matière de découvertes, le dernier
pas , quoique facile en apparence , eft fouvent celui
qu’on fait le plus tard. Les découvertes de la troifieme eipece ,
ne doivent être eftimées, qu’autant qu’il en réfulte quelque
chofe d’important, ou qu’elles ont été difficiles. Souvent une
'd écouverte confifte dans la réunion de deux ou plufieurs
id é e s , dont chacune en particulier étoit ou fembloit être
ftérile , quoiqu’elle eût beaucoup coûté aux inventeurs. E11
matière d’érudition , les découvertes font rares. C e qu’on
peut appeller découverte en ce genre. Il parqît que les deux
feules feiences qui ne font pas fufceptibles de découvertes ,
fon t la théologie & la métaphyfique. Ibid. 706. ^. Q uelle en eft
la raifon. Ibid. b.
Découverte. Réflexions fur les découvertes dans les feiences
& dans les arts. I. 7 1 5 . a , b. Obfervation fur cette penfée -
de M. de F ontenelle, qu’il y a plus de chofes trouvées dans
ces demie« fiecles , qu’il n’y en a de perdues des anciens ;
mais qu’il ne peut y avoir de perdu que ce qu’on veu t bien
qui le foit. II. 456. a. On trouve , dans les ouvrages des
anciens, les femences de la plupart des découvertes modernes.
XII. 512. a. Avantages des modernes fur les anciens ,
dans les découvertes philofophiques. V . 918. a. C ’eft au hafard
que nous devons la plupart des grandes découvertes. I.
495. a. X V I . 38. a. Il y a quelquefois plus de mérite k
retrouver la voie par où l’inventeur eft parvenu à telle
vérité , qu’il n’y en a en à la découvrir. IV. 491. a. Il eft
pour les découvertes un tems de maturité , avant lequel les
recherches femblent infruftueufes. Ibid. b. Utilité qu’on
pourroit tirer pour les découvertes, des traités élémentaires
bien faits. V . 497. a. Les conféquences les plus Amples des
vérités connues , échappent quelquefois à ceux qui femble-
roient avoir le plus de facilité & de droit à les déduire. VII .
Ï19 . b. Une découverte eft prefqne toujours Je germe d’un
grand nombre d’autres. XIII. 49. b. Defcartes penfoit qu’en
fuivant la méthode des géomètres , il n’y avoir rien de Ai
caché qu’on ne pût enfin découvrir. II. 718. b. Lenteur avec
laquelle les découvertes font perfeftionnées. X . 488. b. Voye^
Invention. •
Découverte , aller à lu , ( Art rnilit. ) devoirs du maréchal
de camp lorfqu’il envoie à la découverte. X... 93. b. Vo y ez
Reconnaître le pays. X III. 862. a , b.
D É C O U V R IR , trouver. Nuances qui diftinguent la valeur
& l’nfege ÿe ces deux mots. IV . 706. b.
D E C
ÊicowAr i M * - , IV.
^ B i t o B V E IR ( Chaudersnn. ):doi::ier !e '.uüre ans p icces ib
M B I Comment « b s'sxteum. 1Y . 7o i . f c
décou« « , iu u ia r E H B R g g B H K m
_ (je ja (eftiffure qui couvrent la. pierre, au-xledans de Ion
feuilleti, & qui lui ôteroient de fon étendue. Détails, fur
cette forte d’ouvrage. IV . 707, a.
D É C R AS SER , décrajfer un cuir , ( Corrayeur), comment fe
fait cette opération- IV; 707.' a.
Décrasser , ( Orfev. ) 1°. épurer, les matières lorfqu elles
font en fufion. Comment on. le fait ; 21°. nettoyer les
ouvrages aux endr°its <Iue la (oudure doit couvrir. IV .
^ Dccrajfer. Inftrument avec lequel les anciens fe. décraffoient
,C D É C R É P IT A T IO N , ( Chymie ) explofion de certains fels
exnofés ;uï feu. Quels font ces fois. IV . 707..«. Changement
mrtls fubiffent dans la décrépitation. 1,’opéranûn. chynu^ne
nar laquelle on feit déérépiter u n lfe l, s’appelle auffi,dlcrtpi-.
W Ê Ê B R décrépité. Manuel de- ce ,te opèratitm pour le fel
marin,
M marin je tté fur les charbons, aidens.
^^DÉ^RÉPITU DE, ( Médec. ) terme de la vieilleffe. Def-
cription de cet état. IV . 7 ° 7- b- B U 200’ M T ,,
D É C R E T ( Jurifpr. ) compilations d anciens canons, ldee
fommaire d e ’ ces principales colleétions. Celle de Bouchard,
évêque déformés. IV . 70 7 . b. Détails fur ce quelle renfer-
me. C e qu’elle a de dèfeftueux. Ibid. 708. a. L’importance
& la multiplicité de ces imperfeétions, n’ont point empêché
Sigebert de prodiguer à cet ouvrage les éloges les plus
Autre colleâion de la même- forte , le décret d’Yves de
Chartres. Quelques événemens de la vie de cet évêque. En
quel tems il compofa fon grand recueil des canons, qu’il avoit
intitulé, excerptiones ecclefiafiicamm regularum. Ibid. b. But de
fon ouvrage indiqué dans la préface, qui m érite d’être lue ,
& montre un grand fonds d’érudition dans fou auteur. D e tails
fur le contenu de cet ouvrage. 'Ufage qu’il fait de la
collection de Bouchard. Ibid. 709. a. Y v e s eft regarde comiug
le premier q u i, dans l’O c c id en t, ait jo in t le d ro itc iv il au
droit canonique. Autre recueil de canons, d Y v e s de Chartres
intitulé , pannormie. Raifons pour lefqùel)es on a douté
que cette colleftion foit de cet auteur. Pourquoi on l’a attribuée
a un certain Hugues de Çhâlons-fur-Marne ; cependant M.
Raluzç ne doute pas que la pannormie ne foit d’Y v e s de
Chartres. Raifons qui concourent à établir ce fentiment. Ibid,
b. C e qui rend recommandables ces deux compilations d’Y v e s
de Chartres. En quoi cet auteur eft repréhenfible. D e la col-
'leftipn de Gratien de Chiufi en Tofcaiie. I l intitula fon recueil
la concordé des canons dijcordans. Dans la fuite il fut
appelîé Amplement décret. Matières de ce recueil. Ibid. 710. a.
Diverfes obfervations fur cet ouvrage. Ibid. b. La première
eft que Gratien n’a point mis à fes diftinCtions ou caufes ,
des titres qui annoncent le fujet de chacune. Les interprètes
y ont fupplèé. En fécond lie u , on trouve fouvent dans le
d é cret, des canons avec cette infeription, palea. Divers fen-
timens fur la fignification de ce mot. Raifons qui appuient le
fentiment de ceux qui croient que le mot palea eft le nom
propre de celui qui a fait ces additions. Il paroît cependant
que ces additions n’ont point été faites dans le même tems.
Imperfeétions dont cette colleftion eft remplie. Ibid. 7 1 1 . a.
Caufes des erreurs de Gratien. Ibid. b. L’ouvrage de cet auteur
eft très-utile pour bien connoître l’ancienne difeipline
de l’èglife. A peine vit-il le jour , que les jurifconfultes &
les théologiens fe réunirent à lui donner la préférence fur
toutes les" colleftions précédentes. On s’embarraffa peu fi
Gratien étoit conforme aux originaux qu’il citoit. Quelles
foqt les raifons de cette autorité, qu’on attribuoit aux ouvrages
de Gratien. Ibid. 712. a. Soins 8c travaux de quelques favans
pour corriger les -fautes du décret. Ouvrages de MM. de
Monchy & Leconte. Autres correétions qui fuccéderent à
ces premières. Ibid. b. C e fut fous le pontificat de Grégoire
X I I I , qu’on mit fur-tout la main à cette grande entreprise ,
tandis qn’Antoine-Auguftin y travafllbit de fon côté en Efpa-
gne. Soins qu’on prit à Rome pour purger le recueil de
Gratien, de.toutes les fautes dont il étoit rempli. Succès de
ce travail. Méthode , félon laquelle il a été compofé. Quelle
eft celle qu’on a fuivie pour la correftion du texte. Ibid. 713.
a. Critique que les favans ont faite de cet ouvrage des
correfteurs romains. Ibid. b. Les éloges que le fouverain
pontife donna à cette révifion du décret, n’empêchent pas
qu’il ne foit refté dans le décret beaucoup de fautes, qui ont
échappé à la vigilance des correfteurs , 8c de pièces fuppo-
fées qu’ils ont adoptées ; Ibid. 714- en forte que depuis
cette opération , celle de M. Leconte n’eft point inutile.
Quelle autorité l ’on doit attribuer à la colleftion de Gratien.
D E C 471
Ibid, h- Quels font les meilleurs auteurs qu’on peut confulær
fur cette colleftion. Ibid. 713 . a.
DÉCRET. ( Théolog. ) Sur, la doétririe des décrets divins,
wyeç Prédestination, Supralapsaire, Infralapsaire »
Volonté en Dieu. Décret antécédent. I. 491. Décrets
conditionnels félon les Arminiens,, abfolus félon les Goma-
riftes, III, 840. a. Ordre des décret?, félon les Congruiftes.
870, a. Selon. Molina. X . 629. b. Paffage qe Mpntaigne fur
ceuiç qui s’érigent en interprétés & juges des. décrets de Dieu.
V I I I .W i
D écret. ( Hiß. anç. ) Comment fe forinoit up décret dans
les affemblées du peuple d’Arfienps. X IV . 1 Ç3. a. Dans celles
du fénat romain. X V . 4. b , &c. 8. a , b. Éfpece de décret
des Athéniens., dit. pfephïfma. XÎ. 306. b. Décrets des Ro-
mains appellés.privilegi«*. XIII, 391, b.
Décret , ( Jurifpr. ) diverfes fignifiçations. de ce mot. IV .
7 M -f-
Décret, Conyerfion de décret. IV . 166. b. Décerner un
décret contre quelqu’un. 664, b. Greffe des décrets. V I I .
921. a. Interpofition de décrets. V I I I . 832. b. Oppofition à
un décret. XI. 314. a. Rabattement de décret. X I I I .733. A
Décret d’ajournement perfonnel. O n l ’ordonne lorfqae les
charges ne font pas affez graves pour décréter de prife de
corps, 8c qu’elles, font trop fortes, pour décréter Amplement
d!afljgne.r pour en être oiii'. Il n’eft ordonné qu’après avoir
' oui les conclufions du procureur du r o i, &c. Le juge peut
auffi décréter d’office, &c. Ce. décret emporte interdiction
de toutes fonftions publiques. Q uels font les décrets qui
peuvent réfultcr des. procès-verbaux des juges inférieurs ,
& de ceux des fergens 8c huiffiers. C e qu’ordonne la déclaration.
du roi du mois de décembre 1680 fur les décrets d’ajournement
perfonnel. Peine de celui qui ne compare pas
fur l’ajournement perfonnel. IV . 713. A
Décret d’ajournement Ample. IV . 7 13. A
! Décret d’affigné pour être, oui. En quels cas Oil l’ordonne. IV»
713 . b. S i l ’accufé ne compare pas , ce décret fe convertit
en ajournement perfonnel. Celui contre le q u e lily a décret
d’affigné pour être o.ui, ne peut être arrêté prifonnier. Ibid. A
Décrets des conciles. Q uels font les termes par lefquels.
un concile prononce ordinairement. Diftinftion qu’on fait
entre canons 8c décrets. Les décrets des conciles qui concernent
la difeipline , n’ont point force de loi en France, qu’ils,
n’aient été acceptés par le roi & les. prélats. Le concile de
Trente n’y eft obfervé que pour les canons qui regardent
la foi & le dogme. Il a été reçu en Éfpagne avec dés,
modifications. Les décrets des conciles nationaux & provinciaux
doivent auffi être agréés du roi pour avoir la permiffion
de les publier. IV . 7 1 6. a.
Décret dans les bulles. IV . 7 1 6. a.
Décret forcé. IV . 7 1 6. a.
'* DÉCRETS, (Faculté des) Décrets des facultés. IV . 716. a.
Décret irritant. Décret du juge. Décret en matière criminelle^
IV . 716. A.
Décret du prince. IV . 716. A
Décret de prife de corps. Différens cas dans lefquels on
l’ordonne. Q ui font ceux contre lefquels on ne le décerne,
qu’en matière très-grave. Les décrets s’exécutent, nonobf-
tant toute appellation. Officiers tenus de prêter main-forte,
à leur exécution. IV . 716. [b. Les accufés qui font arrêtés,
doivent être inceflamment conduits dans les prifons publiques.
Etat des éçroues. & recommandations 3 &c. que les
procureurs du roi des juffices royales doivent envoyer aux
procureurs généraux de leur refiort , aux mois de janvier
8c de juillet. Préalables néceffaires pour l’élargiffement d’un
prifonnier pour crime. I l ne peut être éla rg i, fi fon jugement
porte condamnation de peine affliftive , &c. quand Tes
parties civiles y confentiroient. Ibid. 7x7. a.
Décret rabattu. Saints Décrets. Décret de Sorbonne. IV .
Décret de tutelle. IV . 7 1 7 . a.
Décret volontaire. Lorfque l’acquéreur craint de n’avoir
pas fes sûretés , il ftipule qu’il pourra foire un décret volons
taire. Obligation qu’on pafle pour parvenir à ce décret. Formalités
de ce décret. Ibid. 7 17 . a. Titre qui réfulte pouf,
le vendeur & l’acquéreur, de l’adjudication par décret v o lontaire.
Diverfes obfervations fur cette adjudication. Maximes
de droit relatives à cet objet. Les appropnemens en
ufage dans la co.utume de Bretagne, ont quelque rapport
avec les décrets volontaires. Ibid. h. , ,
Décret volontaire. Commiffaires confervàteurs généraux
des décrété volontaires. III. 707. A Confervàteurs des décrets
volontaires. IV . 34. a , b.
Décret de runiverfite. IV. 7x7. A
DÉCRETS impériaux, ( Hift.mod.) rccejfus imperii. On ne
publie ces décrets que quand fo dicte eftprêtê à fe féparer.
L’article des levées de troupes contre les Tu rcs faifoit autrefois
la plus grande partie du recejfus. Réglemens Air la chambre
impériale de Spir.e inférés dans le receffis imperïï, <n
1654. Ibid. A Poy t[R eces,