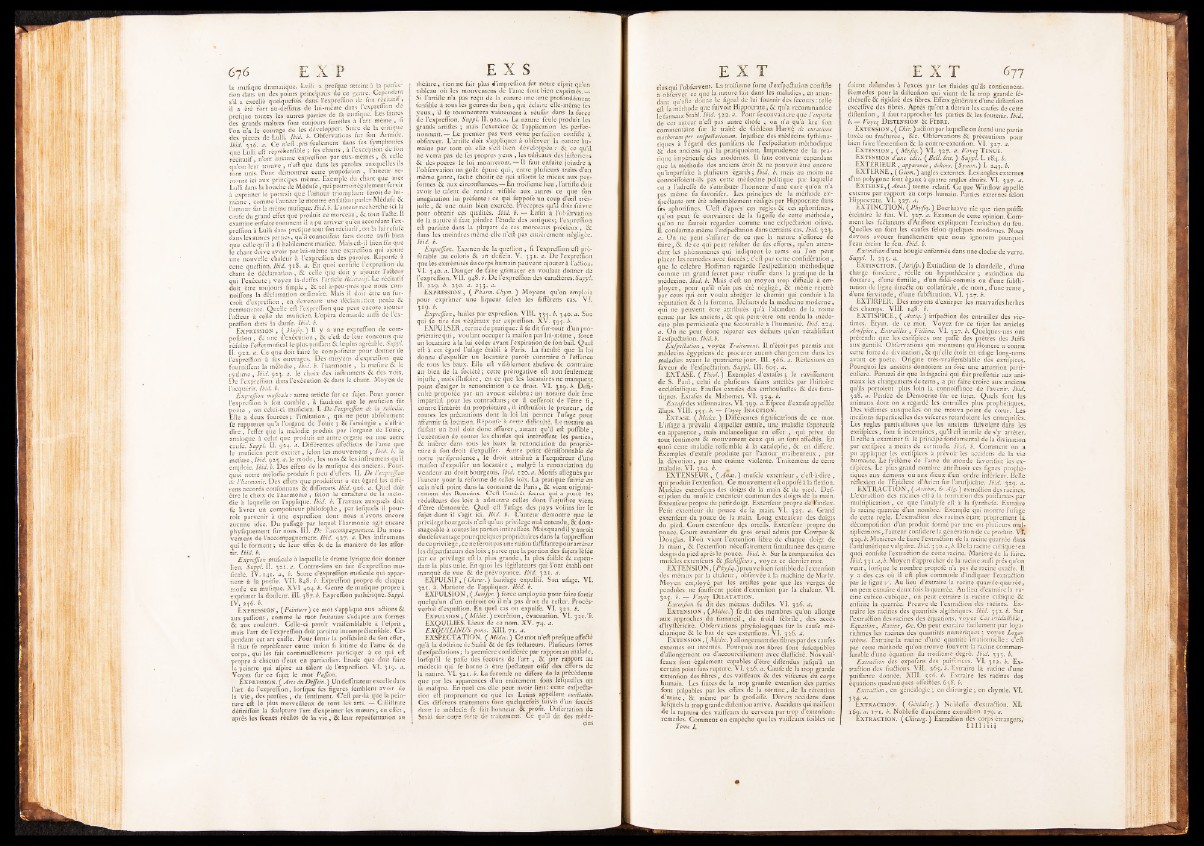
676 E X P
la mufique dramatique. Lulli a prefque atteint à la perfection
dans un des points principaux de ce genre. Cependant
s’il a excellé quelquefois dans Texpreflion de fon. r écitant,
il a été fort au-deflous de iui-même dans Texpreflion dé
prefque toutes les autres parties de fa mufiqiic. Les mutes
des grands maîtres font toujours funeftes à 1 art mente, i
l’on n’a le courage de les développer. Suite de la critique
«les pièces de HH Md . OUferVSBWB B fop Arnude.
Jbiâ a 16 a C e n’eft .pas feulement dans les fympbomes
oue Lulli eft répréhenfiblc ; fés chants , à l’exception de fon
récitatif, nom aucune cxprelnon par etn-méines , & celle
qu’on leur trouve , n’eft que dans le$ paroles auxquelles ils
lont unis. Pour démontrer cette propofition , l’auteur remonte
ici aux principes même. Exemple du chant qiie met
Lulli dans la bouche de M édufe, qui pourroit également fervir
à exprimer le portrait que l’amour triomphant feroit de lui- ,
même , comme l’auteur le montre en faifant parler M édufe &
l'amour fur la même mufique. Ibid. b. L’auteur recherche ici là
caufe du grand effet que'produit ce morceau, & tout l’aéle. Il
examine enfuite comment il a pu arriver qu’en accordant 1 expreflion
à Lulli dans prefque tout fon récitatif, on la luirefufè
dans les autres parties, qu’il connoiflbit fans doute âufli bien
que celle qu’il a fi habilement maniée. Maiseft-il bien fur que
le chant doive avoir par lui-même une expreflion qui ajouté
une nouvelle chaleur à l’expreflich des paroles. Réponfe à
cette queftion. Ibid. 318. a. En quoi confifte Texpreflion du
chant de déclamation , & celle que doit y ajouter l’afteur
qui l’exécute ; v o y e z là-deflùs Tarriclé Récitatif. Le récitatif
doit être toujours fimple, & tel à-peu-prês que nous con-
noiffons la déclamation ordinaire. Mais il doit être un fur-
croît d’expreffion , en devenant une déclamation notée &
permanente. Quelle eft Texpreflion que peut encore ajouter
l’aéleur à Celle du muficien. L ’opéra demande aufli de Texpreflion
dans la danfe. Ibid. b.
Expression , ( Mtifiq. ) Il y a une expreflïon de com-
pofirion , 6c une d’exécution , & c’eft de leur concours que
réfulte l’effet mufical le plus puiflant & l e plus agréable. Suppl.
II. 922. a. Ge que doit faire le compofiteur pour donner de
l’éxpreffion à fes ouvrages. Dès moyens d’expreflion que
fourniffent la mélodie, Ibid. b. l’harmonie , la méfiiré & le
ry thm e , Ibid. 923. a. le choix des inftrumens & des voix,
D e Texpreflion. dans l’exécution & dans le chant. Moyen de
l’acquérir. Ibid, b.
Exprtjfion muficale : autre article fur ce fujet. Pour porter
l’expreflion à fon comble , il faudroit que le muficien fût
poëte , ou- celui-ci muficien. I. D i texprejjion de la mélodie.
Elle a deux fôurces ; l’imitation , qui ne peut âbfolument
fe rapporter qu’à l’organe de l’oüie ; & l’ânâlogie , c efl-a-
d ir e , l’effet que la mélodie produit par l’organe de Toute,
analogue à celui que produit un aiitre organe ou une autre
caufe. Suppl. II. 924. a. Différentes affeétions de l’ame que
le muficien peut excite r, félon les mouvemens , Ibid. b. là
mefure, Ibid. 921. a. le mode, lès tons & les inftrumens qu’il
emploie. Ibid. b. Des effets de la mufique des anciens. Pourquoi
notre mélodie produit fi peu d’effets. II. De l'exprejfîon
de l'harmonie. Des effets que produifent à cet égard les différa
is accords confonnans 8c diffonans. Ibid. 926. a. Q u el doit
être le choix de l’harmonie , félon le carattere de la mélodie
à laquelle on l’applique. Ibid. b. Travaux auxquels doit
fe livrer un compofiteur philofophe , par lefquels il pourroit
parvenir à une expreflion dont nous n’avons encore
aucune idée. D u paffage par lequel l’harmonie agit encore
phyfiquement fur nous. l it . De l'accompagnement. D u mouvement
de l'accompagnement. Ibid. 917. a. Des inftrumens
qui le forment ; de leur effet & de la manière de les aflbr-
tir. Ibid. b.
Exprejjion muficale à laquelle le drame lyrique doit donner
lieu. Suppl. II. 321. a. Côntre-fèns en fait d’expreflion muficale.
rV .1 4 1 . a , b. Sorte d’êxprefîion muficale qui appartient
à la poéfie. V II . 848. b. Expreflion propre de chaque
mode en mufique. X V I 404. b-. Genre de nnifiquè propre à
exprimer la douleur. III. 387. b. Expreffiôn pathétique. Suppl.
IV . 256. b.
Expression , ( Peinture') ce mot s’applique aux aélions &
aux paflions, comme le mot Imitation s’adapte aux formes
& aux couleurs. C ë llè -d paroît vràifemblable à Tefprit,
mais l’art de l’expreflion doit paroîtré incompréhenfible. C e pendant
cet art exifte. Pour fentir la poflibilité de fon effet,
il faut fe repréfenter cette union fi intiAie de Tarne & du
corps, qui les fait continuellement participer à ce qui eft
propre à chacun d’eux en particulier. Etude que doit faire
le peintre qui afpire au talent de Texpreflion. V I . 319. a.
V o y ez fur ce fujet le mot Pajfion.
Expression. ( Arts du DéJJein. ) Un deflinateur excelle dans
l’art de Texpreflion, lorfque fes figures feinblem avoir de
la v ie , des penfées , du fentiment. C ’eft par-là.que la peinture
eft le plus merveilleux de tous les arts. — Galliftrate
définifloit la fculpture l’art d’exprimer les moeurs ; en e ffet,
après les fcenes réelles de la v ie , & leur repréfentation au
E X S
théâtre, rien né fait plus d’iinpreflion fur notre efprit qu’un
tableau où les mouvemens de l’anie font bien exprimés. —
Si l’artifte n’a pas reçu de la nature une ame profondément
fenfible à tous les genres du bon , qui éclaire elle-même fes
y e u x , il fe tourmentera vainement à réuflir dans la force
de Texpreflion. Suppl. IL 92p. a. La nature feule produit les
grands artiftes ; mais l’exercice 8c l’application les perfectionnent.
— L e premier pas vers cètte perfection confifte à
obferver. L’artifte doit s’appliquer à obferver la nature humaine
par tout où elle s’eft bien développée •; 8c 'ce qu’il
né v efra pas de fes propres yeux , les tableaux des hiftoriens
8c des poètes le lui montrerontîplfll faut enfuite joindre à
l ’obfervation un goût épuré qui ■, entre plufieurs traits d’un
même genre, fâche choifir ce qui aflortit le mieux aux per-
fonnes 8c aux circonftances.— En troifieme l ieu , l’artifte doit
avoir le talent de rendre vifible aux autres ce que fon
imagination lui préfente : ce qui fuppofe un coup d’oeil très-
ju fte , 8c une main bien exercée. Préceptes qu’il doit fuivre
pour obtenir ces qualités. Ibid. b. — Enfin à fobfervation
de la nature il faut joindre l’étude des antiques ; l’expreflion
eft parfaite dans la plupart de ces morceaux pré cieux, 8c
dans les moindres mèmé elle n’eft pas entièrement négligée.
Ibid. b.
■ Expreffiôn. Examen de la queftion, fi Texpreflion eft préférable
au coloris 8c aù defiein. V . 331. a. D e Texpreflion
que les extrémités du corps humain p euvent ajouter à Taétion.
V I. 340. a. Danger de faire grimacer en voulant donner de
Texpreflion. V II . 948. b. D e Texpreflion des caraélêres. Suppl.
II. £29. b. 230. a. 233. a.
Expression , ( Pharm. Chym. ) Moyens qu’on emploie
pour exprimer une liqueur félon les différens cas. V I .
319. é.
Exprejjion, huiles par expreflion. VII I. 33?. b. 340. a. Suc
qui fe tire des végétaux par expreflion. X V . 595. b.
EX PU L SER , terme de pratique : il fe dit fur-tout d’un propriétaire
q u i, voulant occuper la maifon par lui-même , force
un locataire à la lui céder avant l’expiration de fon bail. Q u e l
eft à cet égard l’ufage établi à Paris. La faculté que la loi
donne d’expulfer un locataire paroît contraire à l’effence
de tous lés baux. Elle eft vifiblement abufive 8c contraire
au bien de la fociétè ; cette prérogative eft non feulement
injufte , mais illufoire, en ce que les locataires ne manquent
point d’exiger la renonciation à ce droit. V I . 319. b. Difficulté
propofée par un avocat célébré : un notaire doit être
impartial pour les contraélans ; or il ceffetoit de l’être f l ,
contre l’in térêt du propriétaire, il inftruifôit le preneur, de
toutes les précautions dont la loi lui permet l’ufage pour
affermir fa location. Réponfe'à cette difficulté. Le notaire en
fàifânt un bail doit donc affûter, autant qu’il eft pôflible ,
l’exécution de toutes les claufes qui intéreffent les parties,
8c inférer dans tous les baux la renonciation du propriétaire
à fon droit d’expulfer. Autre point déraifonnable de
notre jurifprùdence, le droit attribué à l’acquéreur d’une
maifon d’expulfer un locataire , malgré la renonciation du
vendeur au droit bourgeois. Ibid, i 20. a. Motifs allégués par
Tàuteùr pour la réforme de telles loix. La pratique fuivie en
cela n’eft point dans la coutume de Paris, 8c vient originairement
des Romains. C ’en: l’intérêt fecret qui a porté les
rédacteurs des loix à admettre celles dont Tirijù’fticè vient
d’être démontrée. Q u e l eft l’üfàge des pays v'oifins fur le
fiijét dont il s’agit ici. Ibid. b. L’auteur démontre que le
privilège bourgeois n’eft qu’un privilège mal entendu, 8c dommageable
à toutes les parties intéreffées. Maisquandil yauro it
du défavantage pour quelques propriétaires dans la fuppreffion
de ce privilège, ce ne leroit pas une raifon fuffifante pour arrêter
les difpenfateurs des loix ; parce que la portion des fujets léfée
par ce privilège eft la plus grande, là plus foible 8c cependant
la plus utile. En quoi les légiflateurs qui l’ont établi ont
manqué de vue 8c de prévoyance. Ibid. 3 1 1 . a.
Ea PULSIF , ( Chirur. ) bandage èxpulfif. Son ufage. V I .
321. b. Maniéré de Tâppliqüer; Ibid. b.
E X PU L S IO N , ( Juhjpr. ) force employée pour faire fortir
quelqu’un d’un endroit où il n’a pas droit de reftër. Procès-
verbal d’èxpulfion. En quel cas On èxpulfe. V I . 321. b.
Expulsion, ( Médec.) excrétion, évacuation. V I. 321 . ‘b.
EXQUIL IES. Lieux dé ce nom. X V . 74. a.
E X Q U IL IN U S pons. XIII. 7 1 . a.
EX SP E C T A T IO N . ( Médec. ) C e mbt n’eft prefque affeflé
qu’à la doftrine de Stahl 8c de fes feûatéurs. Plufieurs fortes
d’exfpe&ations ; la première confldéréè par rapport au malade,
lorfqu’il fe pafle des fecours dé Tari , & par rapport au
médecin qui fe borne à être fpëéïateur oifif dés efforts de
la nature. V I. 321. b. La fecoiide ne diffère de la précédente
que par les apparences d’un traitement fous léfq«elles on
la mafque. En quel cas elle peut avoir liéu ï cette exfpeâa-
tion eft proprement ce que les Latins appellent cun&atio.
Ces différens traitemens font quelquefois ïuivis d’un fuccès
dont le médecin fe fait honneur 8c profit. Differtation de
Stahl fur cet,te forte de traitement. C e qu’il dit dés médecins
E X T E X T 677
cîns qui Pobfervent. La troifieme forte d’exfpeéhtion confifte
à obferver ce que la nature fait dans les maladies, en attendant
qu’elle donne le fignal de lui fournir des fecours : telle
eft la méthode que fuivoit Hippocrate * 8c qu’a recommandée
le fameux Stahl. Ibid. 322. a. Pour fe convaincre que l ’expcEla
de cet auteur n’eft pas autre chofe , on n’a qu’à lire fon
commentaire fur le traité de Gédéon Harvé de curatione
morborurn per exfpeflationem. Injuftice des médecins fyftéma-
tiques à l’égard des partifans de Texfpe&ation méthodique
8c des anciens qui la pratiquoient. Imprudence de la pratique
impérieufe des modernes. Il faut convenir cependant
que la méthode des anciens étoit 8c ne pouvoit être encore
qu’imparfaite à plufieurs égards 3 Ibid. b. mais au moins ne
connoiffoient-ils pas cette médecine politique par laquelle
on a l’adreffe de s’attribuer l’honneur d’une cure qu’on n’a
pas même fu favorifer. Les principes de la méthode ex-
fpe&ante ont été admirablement rédigés par Hippocrate dans
fes aphorifmes. C ’eft d’après" ces réglés 8c ces aphorifmes,
qu’on peut fe convaincre de la fagefle de cette méthode,
qu’bn ne fauroit regarder comme une exfpeâation oifive.
Il condamne même Texfpeélation dans certains Cas. Ibid. 323.
a. On ne peut s’affurer de ce que la nature-s’efforce de
faire, 8c de ce qui peut réfulter de fes efforts, qù’en attendant
les phénomènes qui indiquent le tems où Ton peut
placer les remedes avec fuccès ; c’eft par cette confidération ,
que le célèbre Hoffman regarde Texfpeélation méthodique
comme un grand fecret pour réuflir dans la pratique de la
médecine. Ibid. b. Mais c’eft un moyen trop difficile à emp
lo y e r , pour qu’il n’ait pas été négligé, 8c même rejetté
par ceux qui ont voulu abréger le chemin qui conduit à la
réputation 8c à la fortune. Defauts de la médecine m oderne,
qui ne peuvent être attribués qu’à l’abandon de la route
tenue par les anciens, 8c qui peut-être ont rendu la médecine
plus pernicieufe que fecourable à l’humanité. Ibid. 224.
a. O n ne peut donc réparer ces défauts qu’en rétabliffant
l’exfpeâation. Ibid. b.
Exfpeflation , v o y e z Traitement. Il n’étoit pas permis aux
médecins égyptiens de procurer aucun changement dans les
maladies avant le quatrième jour. HL 566.«. Réflexions en
faveur de l’exfpeâation, Suppl. III. 603. a.
EX T ASE. ( Théol. ) Exemples d’extafes ; le raviffement
de S. P au l, celui de plufieurs faints atteftés par Thiftofre
eccléfiaftique. Fauffes extafes des enthoufiaftes 8c des fanatiques.
Extafes de Mahomet. V I . 324. b.
Extafe des vifionnaires. V I. 399. a. Efpece d’extafe appellée
illaps. V I I I . <55. bi — Voyei Inaction.
Extase. ( Médec. ) Différentes lignifications de ce mot.
L ’ufage a prévalu d’appeller. extafe, une maladie foporeufe
en apparence, mais mélancolique en effet , qui prive de
tout fentiment 8c mouvement-ceux qui en font affeétés. En
quoi cette maladie reffemble à la catalépfie, 8c en différé.
Exemples d’extafe produite par l’ainour malheureux , par
la dévotion, par une crainte violente. Traitement de cette
maladie, V I . 3 24. b. .
EX T EN S EU R , ( Anat. ) mufcle extenfeur, c’eft-à-dire ,
qui produit l ’exfenfion. C e mouvement eft oppofé à la flexion.
Muicles extenfeurs des doigts de la main & du pied. De f-
cription du mufcle extenfeur commun des doigts de la main.
Extenfeur propre du petit doigt. Extenfeur propre de •Pindex.
Petit extenfeur du pouce de la main. V I . 325. a. Grand
extenfeur du pouce de la main. Long extenfeur des doigts
du pied. Cou rt extenfeur des orteils. Extenfeur ^propre du
pouce. Court extenfeur du gros orteil admis par Cowper 8c
Douglas. D ’où vient l’extenfion libre de chaque doigt de
la main , 8c l’extenfion néceffairement fimultanée des quatre
doigts du pied après le pouce. Ibid. b. Sur la comparaifon des
muicles extenfeurs 8c JUchiffeurs, v o ye z ce dernier mot.
E X T EN S IO N , ( Phyfiq.) preuve bien fenfible de l’extenfion
des métaux par la chaleur, obfervée à la machine de M arly.
Moyen employé par les artiftes pour que les verges de
pendkiles ne fouffrent point d’extenfion par la chaleur. V I .
325. b. — Voye^ D ilatation.
Extenjion fe dit des métaux duétiles. V I . 326. a.
Extension , (Médec.) fe dit des membres qu’on allonge
aux approches du fommeil, du froid fébrile, des accès
d’hyftéricité. Obfervations phyfiologiques fur la caufe mé-
chanique 8c le but de ces extenfions. V I . 326. a.
Extension , ( Mcdec. ) allongement des fibres par des caufes
externes ou internes. Pourquoi nos fibres font fufceptibles
d’allongement ou d’accourciflement avec élafticité. Nosvaif-
feaux font également capables d’être diftendus jufqu’à un
certàin point lans rupture. V I . 3 26. a. Caufe de la trop grande
extenfion des fibres, des vaifleaux 8c des vifeeres du corps
humain. Les fuites de la trop grande extenfion des parties
font palpables par -les effets de la torture, de la rétention
d’urine, 8c même par la groflefle. D ivers aceidens dans
lefquels la trop grande diftenfion arrive. Aceidens qui naiflent
de la rupture des vaifleaux du cerveau par trop d’extenfion :
remedes. Comment on empêché que les vaifleaux foibles ne
Tome /,
foient diftendus à l’excès par les fluides qu’ils contiennent.
Remedes pour la difienfion qui vient de la trop grande fé-
chérefle 8c rigidité des fibres. Effets généraux d’une diftenfion
exceflïve des fibres. Après qu’on a détruit les caufes de cette
diftenfion , il faut rapprocher les parties 8c. les foutenir. Ibid,
b.t— Voye{ D istension 8c Fibre.
Extension , ( Chir. ) a âion par laquelle on étend une partie
luxée ou fraéhirée, 8cc. Obfervations 8c précautions pour
bien faire l’extenfion 8c la contré-extenfion. V I . 327. a.
Extension, ( Mujiq. ) V I . 327. a. Voye^ T enue.
Extension d’une idée. (B e ll. lett. ) Suppl. I. 184. b.
EX T ÉR IEU R , apparence, dehors. ( Synon.) I. 243. b.
E X T E R N E , ( Géom. ) angles externes. Les angles externes
d’un polygone font égaux à quatre angles droits. V I . 327. a.
Externe, (Anat.) terme relatif. C e que W in flow appelle
externe par rapport au corps humain. Parties externes félon
Hippocrate. V I . 327. a.
E X T IN C T IO N . (Phyfiq.J Boerhaave nie que rien puifie
éteindre le feu. V I . 327. a. Examen de cette opinion. Comment
les feélateurs d’Ariftote expliquent l’extinâion du feu.
Quelles en font les caufes félon quelques modernes. Nous
devons avouer franchement - que nous ignorons pourquoi
l’eau éteint le feu .Ib id . b.
Extinélion d’une bougie enfermée dans une cloche de verre.
SÙM. I.. Ï3 S . a.
Extinction. (Jurifp.) Extinélion de la chandelle, d’une
charge fonc ière, réelle ou hypothécaire ; extinélion du
douaire , d’une famille , d’un fidéi-commis ou d’une fubfti-
tution de ligne"direéle ou collatérale, de nom , d’une rente ,
d’une fervitude, d’une fubftitution. V I . 3 27. b.
EXTIRPER. Des-moyens d’extirper les mauvaifes herbes
•des champs. VII I. 148. b.
E X T IS P IC E , ( Antiq. ) infpeélion des entrailles des victimes.
Etym. d e .e e mot. V o y e z fur ce fujet les articles
Arufpice , Entrailles , ViElime. V I. 327. b. Quelques-uns ont
prétendu que les extifpices ont pafle des prêtres des Juifs
aux gentils. Obfervations qui montrent qu’Homere a connu
cette forte de divination , & qu’elle étoit en ufage long-tems
avant ce poëte. Origine très-vraifemblable des extifpices.
Pourquoi les anciens donnoient au foie une attention particulière.
Peruzzi dit que la fagacité qui fait preffentir aux animaux
les changemens de tems, a pu faire croire aux anciens
qu’ils portoient plus loin la connoiffance de l’avenir. Ibid.
328. a. Penfée de Démocrite fur ce fujet. Q uels font les
animaux dont on a regardé les entrailles plus prophétiques.
D e s viélimes auxquelles on ne trouva point de coeur. Les
inciflons fuperficielles des vifeeres retardoient les entreprîfes.
Les réglés particulières que les" anciens fuivoient dans les
extifpices, font fi incertaines, qu’il eft inutile de s’y arrêter.
Il refte à examiner fi le principe fondamental de la divination
par extifpice a moins de certitude. Ibid. b. Comment on a
pu appliquer les extifpices à prévoir les aceidens de la vie
humaine. L e fyftême de Taine du monde favorifoit Tes extifpices.
L e plus grand nombre attribuoit ces Agnes prophétiques
aux démons ou aux dieux d’un ordre inférieur. Belle
réflexipn de l’Epiélete d’Arien fur Tarufpicine. Ibid. 329. a.
E X T R A C T IO N , (Arithin. & Alg. ) extraélion dès racines.
L ’extraélion des racines eft à la formation des puiffances par
multiplication , ce que l’analyfe eft à la fynthefe. Extraire
la racine quarrée d’un nombre. Exemple qui montre l’ufage
de cette réglé. L’extraélion des racines étant prbprement la
décompofition d’un produit formé par une ou plufieurs multiplications,
l'auteur confidere la génération de c e produit. V f .
3 29. b. Manières de faire l’extraélion de la racine quarrée dans
l’arithmétique vulgaire. Ibid. 3 30. <2, b. D e la racine cubique : en
quoi confifte l’extraélion de cette racine. Maniéré de la faire.
Ibid. 331 .a,b. M oyen d’approcher de la- racine aufli près qu’on
v e u t , lorfque le nombre propofé n’a pas de racine exaéle. Il
y a des cas où il eft -plus commode d’indiquer Textraélion
par le figne [/. Au-liéu d’extraire la racine quarrée-quarrée,
on peut extraire deux fdisfa quarrée. A u fieu d’extraire la racine
cubico-cubique, on peut extraire là racine cubique 8c
enfuite la quarrée. Preuve de Textraélion des racines. Extraire
les racines des quantités algébriques. Ibid. 332. b. Sut
Textraélion des racines des équations, v o y e z Cas irrèdu&ible ,
Equation, Racine, &c. On peut extraire facilement par logarithmes
les racines des quantités numériques j v o y e z Logarithme.
Extraire la racine d’une quantité irrationnelle : c’eft
par cette méthode qu’on trouve fouvent la racine commen-
lùrable d’une équation du troifieme degré. Ibid. 3 33. b.
Extraflion des expofans des puiffances. V I . 312. b. Extraélion
des fraélions. V II . 265. b. Extraire la racine d’une
puiffance donnée. XIII. Ç56. b. Extràire les racines des
équations quadratiques affeélées. 63.8, b.
Extraélion, en généalogie"; en chirurgie; en chymie. VI.
334- a-
Extraction. ( Généalog. ) NobleflV d’extraéHon. XI.
169. a. 17 1. b. Noblefle d’ancienne extraélion. 179. a.
Extraction. (Chirurg.) Extraélion des corps étrangers.'
I l I I i i i i