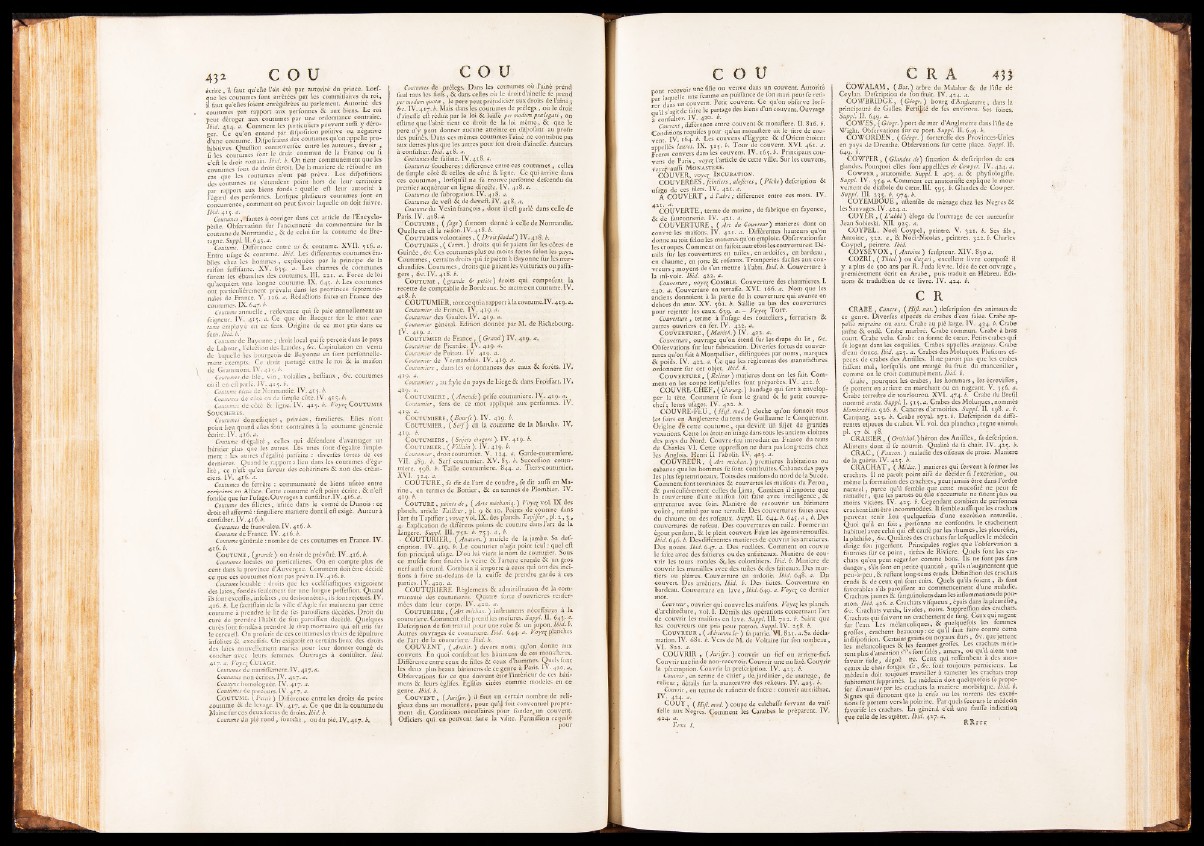
43* C O U
écrite , il faut qu’elle l’ait été par autorité du prince. Lorf-
que les coutumes font arrêtées par les commiiïaires du roi,
il faut qu’elles foient enrégiftrées au parlement. Autorité des
coutumes pat rapport aux perfonnes St aux biens. L e roi
peut déroger aux coutumes par une ordonnance contraire.
Ibid. 414. a. Comment les particuliers peuvent aufli y déroger.
C e qu’on entend par difpofition pofinve ou négative
d’une coutume. Difpofmons des coutumes qu on appelle prohibitives.
Queftion com row fé e enue les.ajiteuis,-favoir
fi les commuas font le droit u<»l!mu " « !a rtmcc ou fi
c ’eft le droit romain. Ibid. b. On tient communément que les
coutumes font de droit étroit. D e la maniéré de réfoudre un
cas que les coutumes n’ont pas prévu. Les difpofitions
des coutumes ne s’étendent point hors de leur territoire
par rapport aux biens fonds : quelle eft leur autorité à
fégard des perfonnes. Lorfque plufieurs coutumes^ font en
concurrence, comment on peutfavoir laquelle on doit fuivre.
Ibid. 4x5. a. . . . „P , Coutumes «fautes à corriger dans cet article de I ency clo pédie.
Obfervation fur l’ancienneté du commentaire fur la
coutume de Normandie., & d e celui fur la coutume de Bretagne.
Suppl, l l . 643.tf. Coutume. Différence entre us 8c coutume. X-V 11. 516. a.
Entre ufage Sc coutume. Ibid. Les différentes coutumes établies
chez les hommes , expliquées par le principe de la
raifon fuififante. X V . 635.. a. Les Chartres de communes
furent les ébauches des coutumes. III. 221. a. Force de l'ôi
qu’acquiert une longue coutume. IX. 645. b. Les coutumes
ont particuliérement prévalu dans les provinces feptemrio-
nales de France. V . 126. a. Réda&ions faites en France des
coutumes. IX. 647. b. . • Coutume annuelle , redevance qui fe paie annuellement au
feigneur. IV . 415. a. C e que dit Bacquet fur le mot coutume
employé en ce fens. Origine de ce mot pris dans ce
fens. Ibid.b. •
Coutumedtt Bayonne ; droit local qui fe perçoit dans le pays
de Labour, leleéliondes Landes, &c. Capitulation en vertu
de laquelle les bourgeois de Bayonne en font perfonnelle-
ment exempts. C e droit partagé entre le roi & la maifon
:de Grammont. IV . 4 1 5-é. .-.nvu ■«.
Coutumes de b lé , v in , volailles, beftiaux, &c. coutumes
OÙ il en eft parlé. IV . 415. b.
Coutume bleue de Normandie. IV . 4 15. b.
Coutumes de côté ou de fimple côté. IV . 415. b.
Coutumes de côté & ligne. IV . 4x5. b. Voyez COUTUMES
SOUCHERES.
Coutumes domeftiques , priv ée s , familières. Elles n’ont
point lieu quand elles font contraires à la coutume générale
écrite. IV . 4x6. a.
Coutume d’égalité , celles qui défendent d’avantager un
héritier plus que les autres. Lés unes font d’égalité Amplement
: les autres d’égalité parfaite : diverfes fortes de ces
dernieres. Quand le rapport a lieu dans les coutumes d’égalité
, ce n’eft qu’en faveur des cohéritiers 8c non des créanciers.
IV . 416. a. _ Coutumes de ferrête : communauté de biens ufitée entre
conjoints en A lface. Cette coutume n’eft point écrite, & n’eft
fondée que fur l’ufage. Ouvrages à confulter. IV . 41 G. a.
Coutume des filletes, ufitée dans le comté de Dunois : ce
droit eft affermé : finguliere maniéré dont il eft exigé. Auteur à
confulter. IV . 4 16. b.
Coutumes de franc-aleu. IV . 416. b.
Coutume de France. IV . 416. b.
Coutume générale : nombre de ces coutumes en France. IV .
'416. b-
COUTUME, (grande) ou droit de prévôté.TV. 4x6. b.
Coutumes locales ou particulières. On en compte.plus de
cent dans la province d’Auvergne. Comment doit être décidé
c e que ces coutumes n’ont pas prévu. IV . 416. b.
Coutume louable : droits que les eccléfiaftiques exigeoient
des laïcs, fondés feulement fur une longue pofTefîion. Quand
ilsfont exceflïs, infolites , ou deshonnêtes, ils font rejettés. IV .
416. b. Le facriflain de la ville d’Agde fut maintenu par cette
coutume à prendre le lit de fes paroifliens décédés. Droit du
curé de prendre l’habit de fon paroiflien décédé. Quelques
curés font fondés à prendre le drap mortuaire qui eft mis fur
le cercueil. On proferit de ces coutumes les droits de fépulture
infolites 8c exceflifs. On exigeoit en certains lieux des droits
des laïcs nouvellement mariés pour leur donner congé de
coucher avec leurs femmes. Ouvrages à confulter. Ibid.
417. a. Voyeç CuLAGE.
Coutumes d e nanriffement. IV . 417. a.
Coutumes non écrites. IV . 4 17. a.
Coutume homologuée. IV . 417. a.
Coutumes de parcours. IV . 417. a.
C outume. ( Petite ) Différence entre les droits de petite
coutume & de levage. IV . 417. a. C e que dit la coutume du
Maine fur ces deux fortes de droits. Ibid. b.
Coutume du pié rond , fourché , ou du pié, IV . 4x7. b.
C O U
Coutumes de prélegs. Dans les coutumes ou tl’aîné prend
feul tous.les fie fs , 8c dans celles où le droit d’aîneffe fe prend
per modum quota, le pere peut préjudicier aux droits de l ’aîné ;
6>c. IV. 4 17. b. Mais dans les coutumes de prélegs, où le droit
d’aîneffe eft réduit par la lo i.& la if fé per modum pralegqti, on
eftirne que l’aîné tient ce droit de la loi même, 8c que le
pere n’y peut donner aucune .atteinte en difpofant au profit
des puînés. Dans ces mêmes coutumes, l’aîné ne contribue pas
aux dettes plus que les autres pouf fon droit d’aîneffe. Auteurs
à confulter. Ibid. 4x8. a.
Coutumes de faifine; IV .4 18 . u.
Coutumes fouçheres : différence entre ces coutumes , celles
de fimple côté & celles de côté & ligne. C e qui arrive dans
ces coutumes, lorfqü’il. ne fe trouve perfonne delcendu du
premier acquéreur en ligne direéte. IV . 418. a. , •
Coutumes de lubrogation. IV . 418. a.
Coutumes de.veft & de deveft. IV . 418. it.
Coutume du V e x in fran ço is , dont il eft parlé dans celle de
Paris. IV . 418. d.
" 'C outume, ( fage ) furnom donné à celle de Normandie.’
Quelle en eft la railon. IV . 418. b.
Coutumes volontaires,."( Droit féodal') IV . 418. b.
C outumes , ( Comm. ) droits qui fe paient fur les côtes de
G u in ée , &c. C es coutumes plusou moins fortes félon les pays.
Coutumes, certains droits qui fe paient à B ayonne fur les mar-
chandifes. Coutumes, droits que paient les voituriers oupaffa-
gers , &C. IV . 418. é. .
COUTUME, ( grande & petite) droits qui çompofent, la
recette de comptablie de Bordeaux. Se mettre en coutume. IV .
418. b.
CO U TUM IER , tout ce qui a r apport à la coutume.IV. 419. <r.
Coutumier deFrance. IV . 419. 4.
Coutumier des Gaules. IV . 419. a.
Coutumier général. Edition donnée par M. de Richebourg.
IV . 419. a. .
Coutumier de Franc e, ( Grand) IV . 419. a.
Coutumier de Picardie. IV . 419. a.
Coutumier de Poitou. IV 419. n.
Coutumier .de Vermandois. IV . 419. a.
Coutumiers , dans les ordonnances des eaux & forêts. IV .
419, «, . . . . . _ : \ -
Coutumiers , au flyle du pays de L iege 6ç dans Froiffart. IV .
4I9i a• .
COUTUMIERE, {Amende) prife coutumière.IV. 419. a.
Coutumier, fens de. ce mot appliqué .aux perfonnes. IV .
419. a. . . . H H H
COUTUMIERE, (Bourfe). IV . 419. b.
Coutumier, (.Serf) en la coutume de la Marche. IV .
419. b.
Coutumiers, ( Sujets étagers). IV . 419. b.
Coutumier , ( Villain ) . IV . 419. b.
Coutumier, droit coutumier. V . 124. a, Garde-Coutumiere;
VII. 489. b. S e rf coutumier. X V . 83. b. Succeflion coutumière.
398. b. Taille coutumière. 844. a. Tiers-coutumier.
X V I . 324. a.
C O U T U R E , fe dit de l’art de coudre, fe dit aufli en Mar
ine , en termes de Bottier, & en termes de Plombier. IV .
419.
Couture , points de , ( Arts méchaniq. ) Voyez vol. IX des
planch. article Tailleur, pl. 9 & 10. Points de couture dans
l’art du Tapiflier ; voyez vol.'ÏX. des planch. TapiJJicr, pl. 2 ,3 ,
.4: Explication de différens points de couture dans l’art de la
Lingere. Suppl. III. 732. b. 7,33. a, b.
- CO U T U R IE R , ( Anatom. ) mufcle de la jambe. Sa description.
IV . 419. b. Le couturier n’agit point feul : quel eft
fon principal ufage. D ’où lui vient le nom de couturier. Sous
ce mufcle font fituées la veine & l’artere crurale & un gros
nerf aufli crural. Combien il importe à ceux qui ont des incitions
à faire au-dedans de la cuiffe de prendre garde à ces
parties. IV . 420. a.,
C O U T lÿ llE R E . Réglemens & adminiftration de la communauté
des couturières. Quatre forte d’ouvrieres renfermées
dans leur corps. IV . 420. a. u ^ _ ,
Couturière , ( Art mèchan. ) inftrumens néceffairps à la
couturière. Comment elle prend les mefures. Suppl. II. 643. a.
Defcription de fon travail pour une robe & un jupon. Ibid. b.
Autres ouvrages de couturière. Ibid. 644. a. Voyez planches
de l’art de la cbuturïere. Ibid. b.
C O U V E N T , ( Archit. ) divers noms qu’on donne aux
couvens. En quoi confiftent les bâtimens de çes monafteres.
.Différence entre ceux de filles & ceux d’hommes. Quels font
les deux plus beaux bâtimens de ce genre à Paris. IV . 420. a.
Obfervations fur ce que doivent être l’intérieur de ces bâtimens
& leurs églifes. Eglifes citées comme modèles en ce
genre. Ibid. b. . . t ■ . .-
Couvent , (Jurifpr.) il faut un certain nombre de religieux
dans un monaftere, pour qu’ij foit conventuel proprement
dit. Conditions néceflaires pour fonder^un couvent.
Officiers qui. en pcuYeat. faire la vifite. Permiflion requife
pour
C O U
e ôu ï recevoir une fille ou v eu v e dans un couvent. Autorité
‘ ar laquelle une femme en puiffance de fon mari peut fe retirer
dans un couvent. Petit couvent. C e qu’on obferve lorf-
’il s’agit de faire le partage des biens d’un couvent. O uvrage
1 eonfuitén IV . 420. b.
Couvent, différence entre couvent oc monaltere; II. 8x6. b.
Conditions requifes pour qu’un monaftere ait le titre de couvent.
IV . 164. b. Les couvens d’Egypte & d’Orient étoient
appeilés ïaures. IX. 215. L T o u r de couvent. X V I. 461. a.
Freres convers dans les couvens. IV . 163 . b. Principaux couvens
de Paris, voyez l’article de cette ville. Sur les couvens,
voycr- aufli MONASTERE.
CO U V E R , voyez Incubation.
CO U V E R T E S , feintiers, alofieres, ( Pêche ) defcription &
ufage de ces filets. IV . 421. a.
A C O U V E R T , à l’abri; différence entre ces mots. IV .
^ C O U V E R T E , terme de marine, de fabrique en fayence,
& de fauconnerie. IV . 421. a.
C O U V E R T U R E , (Art du Couvreur) matières dont on
couvre les maifons. IV . 421. a. Différentes hauteurs qu’on
donne au toit félon les matières qu’on emploie. Obfervationfur
les croupes. Comment on faifoit autrefois les couvertures1. D e tails
fur les couvertures en tuiles, en ardoifes, en bardeau,
en chaume, en jonc & rofeaux.Tromperies faciles aux couvreurs
; moyens de s’en mettre à l’abri. Ibid. b. Couverture à
la mi-voie. Ibid. 422. a.
Couverture, voyez C omble. Couverture des chaumières. I.
340. a. Couverture en terraflè; X V I . 166; a. Nom que les
anciens donnoient à la partie de la couverture qui avance en
dehors du mur. X V . 361. b. SailÜe au bas des couvertures
pour rejetter les eaux. 639. a. - Voyez T oit.
Couverture , terme à l’ufage des couteliers, ferruriers &
autres ouvriers en fer. IV . 422. a.
C ouverture, (Maréch.) IV . 422. a.
Couverture, ouvrage qu’on étend fur les draps du l i t , &c.
Obfervations fur leur fabrication. Diverfes fortes de couvertures
qu’on fait à Montpellier, diftinguées par noms, marques
& poids. IV . 422. a. C e que les réglemens des manufa&ures
ordonnent fur cet objet. Ibid. b.
Couverture , ( Relieur ) matières dont on les fait. Comment
on les coupe lorfqu’elles font préparées. IV . 422. b.
CO U V R E -CH E F , ( Chirurg.) bandage qui fert à envelopper
la tête. Comment fe font le grand & le petit couvre-
ch e f; leurs ufages. IV . 422. b.
C O U V R E -F E U , (Hifi. mod.) cloche qu’on fonnoit tous
les foirs en Angleterre du tems de Guillaume le Conquérant.
Origine d l cette coutume, qui devint un fujet de grandes
vexations. Cette loi étoit en ufage dans tous les anciens cloîtres
des pays du Nord. Couvre-feu introduit en France du tems
de Charles V I . Cette oppreflion ne dura pas long-tems chez
les Anglois. Henri I I l’abolit. IV . 423. a.
. C O U V R E U R , (Art mèchan.) premières habitations ou
cabanes que les hommes fe font conftruites. Cabanes des pays
les plus feptentrionaux. Toits des maifons du nord de la Suede.
Comment font terminées & couvertes les maifons du Pérou,
& particuliérement celles de Lima. Combien il importe, que
la couverture d’une maifon foit faite ?vec intelligence, &
entretenue avec foin. Maniéré de recouvrir un bâtiment
v o û té , terminé par une terraffe. Des couvertures faites avec
du chaume ou des rofeaux. Suppl. II. 644.b. 643.a, b. Des
couvertures de rofeau. D e s couvertures en tuile. Former un
égout pendant, & le plein couvert. Faire les égoutsretrouffés.
Ibid. 646. b. Des différentes maniérés de couvrir les arretieres.
D e s noues. Ibid. 647. a. Des ruellées. Comment on couvre
le faîte avec des faîtieres ou des enfaîteaux. Maniéré de couv
rir les tours rondes Su les colombiers. Ibid. b. Maniéré de
couvrir les murailles avec des tuiles & des faîteaux. Des mortiers
ou plâtres. Couverture en ardoife. Ibid. 648. a. D.u
couvert. Des arrêtiers. Ibid. b. D es faîtes. Couverture en
bardeau. Couverture en la v e , Ibid. 649. a. Voyez c e dernier
Couvreur, ouvrier qui couvre les maifons. Voyez les planch.
d’archite&ure, vol. I. Détails des opérations concernant l’art
de couvrir les maifons en lave. Suppl. III. 712. b. Saint que
les couvreurs ont pris pour patron. Suppl. IV. 238. b.
C ouvreur , (Adriennele-) fa patrie. VI. 821. a. Sa déclamation.
IV . 681. b. Vers de M. de Voltaire fur fon tombeau,
V I . 821. a.
C O U V R IR , (Jurifpr.) couvrir un f ie f ou arriere-fief.
Cou vrir une fin de non-recevoir. Cou vrir une nullité. C ouyrir
la péremption. Couvrir la prefeription. IV . 423 . b. .
: Couvrir, en terme de cirier, de;Jardinier, -de manege, de
relieur; détails fur la manoeuvre des relieurs. IV . 423. b.
Couvrir, en terme de rafineur de fucre : couvrir au triélrac.
IV . 424. *.
C O U Y , ( Hifi. mod. ) coupe de calebaffe fervant de vaif-
felle auxNegres. Comment les Caraïbes le préparent. IV .
424- ■ Tome I.
C R A 435
f cO W A L A M , ( Bot.) arbre du Malabar & de l’ifle dë
Ceylan. Defcription de fon fruit. IV . 424. a.
, C O W B R ID G E , (Géogr.) bourg d’Angleterre ; dans la
principauté de Galles; Fertilité de fes environs. Ses foires;
Suppl. II. 649. a.
C O W E S , ( Géogr. ) port de mer d’Angleterre dans l’ifle de
Wïght. Obfervations fur c e port. Suppl. II. 649. b.
C O W O R D E N , (Géogr.) fortereffe des Provinces-Unies
èn pays de Drenthe. Obfervations fur cette place; Suppl. II-.
649. b.. ,
CO V /P E R , (Glandes de) fituatiôri 8c defcription de ces
glandes. Pourquoi elles font appellées de Cowper. IV . 424. a.
Cowper , anatomifte. Suppl. I. 403. a. & phyfiolOgifte;
Suppl. IV . 3 34. a. Comment cet anatomifte explique le mouvement
de diaftole du coeur. III; 393. b. Glandes de Cowper.
Suppl. III. 233. b. 974. b.
CO Y EM BO U E , uftenfile de ihénage chez les Negres &
les Sauvages. IV . 424. a.
C O Y E R , ( L’abbé ) éloge de l’ouvrage de cet auteurfur
Jean Sobieski. XII. 923. a.
CO Y P E L . Noël C o y p e l, peintre. V . 321. b. Ses -fils;
Antoine3 322. a, & Noël-Nicolas, peintres. 322. b. Charles
C o y p e l, peintre; Ibidi
C O Y S E V O X , (Antoine) fculpteur. X IV ; 830a.
C O Z R I , ( Théol. ) ou Cuzuri, excellent livre compofé il
yy a plus de 300 ans par R. Juda lévite. Idée de cet ouvrage $
premièrement écrit en A ra b e , puis traduit en Hébreu. Edi-,
rions 8c traduélion de ce livre.- IV . 424. b.
C R
CR AB E , Cancre, (Hifi.nat.) defcription des animaux de
ce genre. Diverfes elpece's de crabes d’eau, falée. Crabe ap-
pellé migraine ou ours. Crabe au pié large. IV . 424. b. Crabe
jaune & ondé. Crabe marbré; Crabe commun. Crabe à bras
court. Crabe velu. Crabe en forme de coeur. Petits crabes qui
fe logent dans les coquilles. Crabes appeilés araignées. Crabe
d’eau douce. Ibid. 423. a. Crabes des Moluques. Plufieurs ef-
peces de crabes des Antilles. Il ne paroît pas que les crabes
faffent mal, lorfqu’ils ont mangé du fruit du manceniller,
comme on le croit communément. Ibid. b.
Crabe, pourquoi les crabes, les hommars, les é creviffes,
fe portent en arriéré en marchant ou en nageant. V . 3 36. a.
Crabe terreftre dit tourlourou. X V I . 474. b. Crabe du B refil
nommé aratu. Suppl. I. 313. a. Crabes des M oluques,nommés
blomkrabbes. 926. b. Cancres d’armoiries. Suppl. II. 198. a. b.
Cantjang. 215. b. Crabe royal. 2ji.b. Defcriptio'n de différentes
efpeces de crabes. V I . vol. des planches, régné animal,
pl. 37 & 38. •
CR A B IE R , ( Omithol. ) héron des Antilles, fa defcription.
Alimens dont il fe nourrit. Qualité de fa chair. IV . 423. b.
C R A C , (Faucon.) maladie desoifeaux deproie. Maniéré
de la guérir. IV . 423. b.
C R A C H A T , ( Médec. ) matières qui fervent à former les
crachats. Il ne paroît point aifé de décider fi l ’excrétion, ou
même la formation des crachats, peut jamais être dans l ’ordre
naturel, parce qu’il femble que cette mucofité ne peut fe
ramaffer, que les parties où elle s’accumule ne foient plus ou
moins viciées. IV . 423. b. Cependant combien de perfonnes
crachent fans être incommodées. U femble aufli que les crachats
peuvent tenir lieu quelquefois d’une excrétion naturelle.
Q u o i qu’il en fo i t , perfonne ne confondra le crachement
j habituel avec celui qui eft caufé par les rhumes, les pleuréfies,
la phthifie, &c. Qualités des crachats fur lefquelles le médecin
dirige fon jugerfent. Principales réglés que l’obfervation a
fournies fur ce point, tirées de Riviere. Q uels font les crachats
qu’on peut regarder comme bons. Ils ne font pas fans
danger, s’ils font en petite quantité, qu’ils 11’augmentent que
peu-à-peu, & relient long-tems cruels. Diftinâion des crachats
cruds & de ceux qui font cuits. Quels qu’ils fo ien t, ils font
favorables s’ils paroiffent au commencement d’une maladie.
Crachats jaunes & fanguinolensdans les inflammations du poumon.
Ibid. 426. a. Crachats v ifqueux, épais dans lapleuréfie,
&c. Crachats verds, livides, noirs. Suppreflion des crachats.
Crachats qui fuivent un crachement de fang. Ceux qui nagent
fur l’eau. Les mélancoliques, & quelquefois les femmes
groffes, crachent beaucoup : ce qu’il faut fane contre cette
m difpofition. Certains grains ou noyaux durs, &c. que jettent
les mélancoliques & les femmes groffes. Les crachats mentent
plus d’attention s’iss fontTalés, amers, ou qu il aient une
faveur fade , dégou )te. Ceux qui reffembent a des morceaux
de chair fonguUfe , &c. font toujours pernicieux. L e
médecin doit toujours travailler à ramener les crachats trop
fubitement fupprimés. L e médecin doit quelquefois fe propo-
fer d’avancer par les crachats la matière morbifique. Ibid. b.
Signes qui dénotent que la crife ou les torrens des excrétions
fe portent vers la poitrine. Par.quels fecours le médecin
fjrvorife les crachats. En général c’eft une fauffe indication
que celle de les ay èter. Ibid. 427. a%
RRrrt;