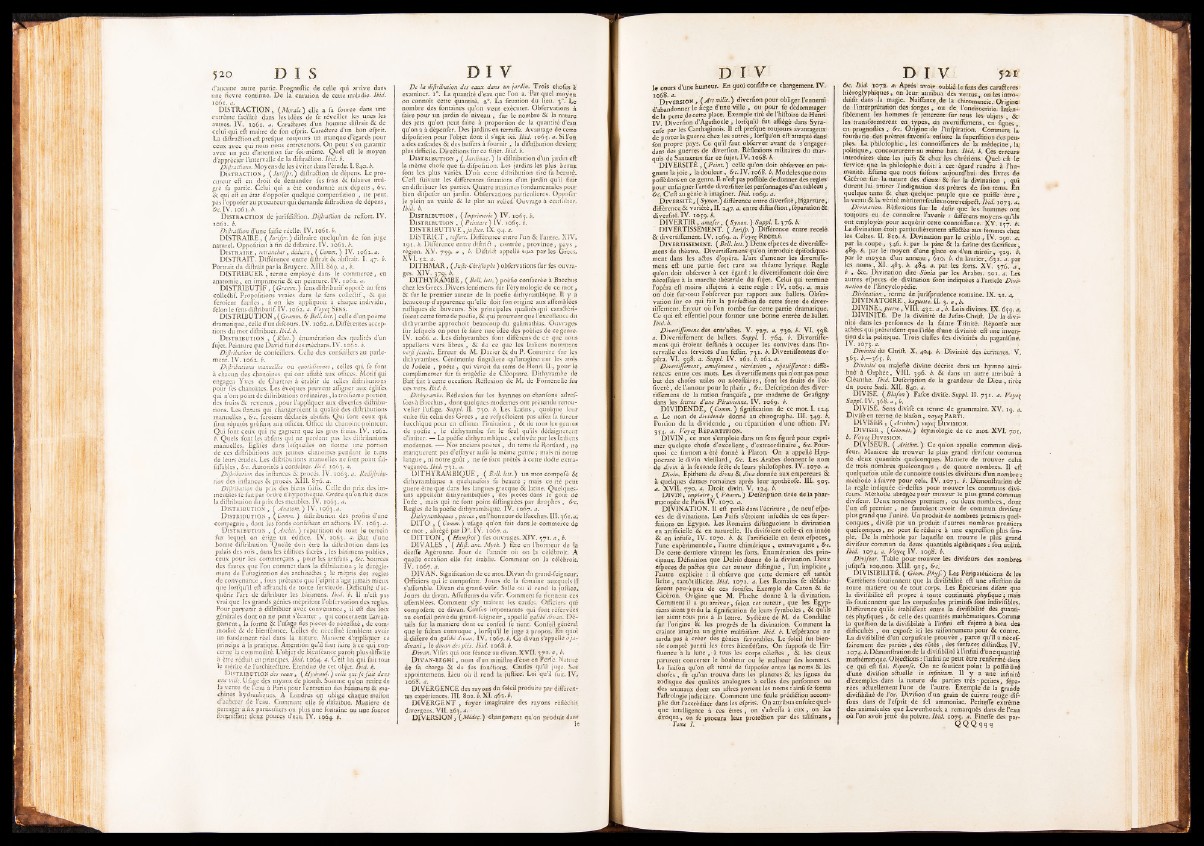
520 D I S D I y
d’aucune autre partie. Prognoftic de celle qui arrive dans
une fievre continue. D e la curation de cette maladie. Ibid.
ip 6 i . a.
D IS T R A C T IO N , (Morale ) elle a fa fource dans une
extrême facilité dans les idées de fe réveiller les.unes les
autres. IV . 1061. 4. Carafleres d’un hpmroe diftrait & de
celui qui eft maître de fon elprit. Caraâere d’un bon efprit.
La diftraâion eft prefque toujours un manque d’égards pour
ceux avec qui nous nous entretenons. On peut s’en garantir
avec un peu d’attention fur foi-même. Q u el eft le moyen
d’apprécier l’intervajle de la diftraâion. Ibid. b.
D.i(lraEüons. M oyens de les éviter dans l’étude. 1. 840. b.
D is tr a c t io n , ( Jurifpr. ) diftraâion de dépens. L e procureur
eft en droit de demander fes frais & falaires malgré
fa partie. Celui qui a été condamné aux dépens, &c.
ik qui eft en état d’oppofer quelque compenfatiop , ne peut,
pas l’oppofer au procureur qui demande diftraâion de dépens,
&ç. IV . 1061. b.
D i s t r a c t io n de jurifdiâion. Dijlratfion de reffort. IV .
2061. b.
DiflrafTion d’une faifie réelle. IV . 1061. b.
D IS T R A IR E , {Jurifpr.) diftraire quelqu’un de fon juge
naturel. Oppolition à fin de diftraire. IV . 1061. b.
D istraire , retrancher , déduire, ( Comm. ) IV . 1062. a.
D ISTR A IT . Différence entre diftrait & abftrait. I. 47. b.
Portrait du diftrait par la R ruyere. XIII. 869. a , b.
DISTR IBU ER , terme employé dans le commerce, en
anatomie, en imprimerie & en peinture. IV . 1062. a.
D IS T R IB U T IF , ( Gramm.) lens diftributif oppofé au fens
cplleâ if. Propofitions vraies dans le fens c o lle â i f , & qui
feroient fimffes , fi on les appliquoit à chaque individu,
félon le fens diftributif. IV . 1062. a. Voyeç Sens.
D IS T R IB U T IO N , {Gramm. (t Bell, lett.) celle d’un poème
dramatique, celle d’un difeours. IV . 1062. a. Différentes acceptions
du mot diftribuer. Ibid. b.
D is tr ib u t io n , {Rhét.) énumération des qualités d’un
fujet. Peinture que Dav id fait des méchans. IV . 1062. b.
Dijlribution qe confeillers. Celle des confeillers au parlement.
IV . 1062. b.
Dijlributions manuelles ou quotidiennes, celles qui fe font
à chacun des chanoines qui ont afiifté aux offices. Mo tif qui
engagea Y v e s de Chartres à établir de telles diftributions
pour fes chanoines. Les évêques peuvent aflïgner aux églifes
qui n’ont point de diftributions ordinaires, la troifieme portion
des fruits & revenus , pour l’appliquer aux diverfes diftributions.
Les flatuts qui changeroient la qualité des diftributipns
manuelles, &c. feroient déclarés abufifs. Q ui font ceux qui
font réputés préfens aux offices. Office du chanoine-pointeur.
Q u i font ceux qui' ne gagnent que les gros fruits. IV . 1062.
b. Quels font les abfens qui ne perdent pas les diftributipns
manuelles. Eglifes dans lefqueÙes on donne une portion
de ces diftributions aux jeunes chanoines pendant le tems
de leurs études. Les diftributions manuelles ne font point fai-
Jiffables, &c. Autorités à confulter. Ibid. 1063. a.
Dijlribution des inftapces & procès. IV . 1063. a- RediJlribjt-
tion des inftanççs & procès. X lII. 876. a.
Dijlribution du prix des biens faifis. Celle du prix des immeubles
fe fait par ordre d’hypotheque. Ordre qu’pn fuit dans
la diftributïon du prix des meubles. IV . 1063. a.
D i s t r ib u t io n , {Anatom.) IV . 1063.4.
D is tr ibu tio n , ( Comm. ) diftribution des profits d’une
compagnie, dont les fonds confident en aâjons. IV . 1063.4.
D is tr ibu tio n , ( Archit. ) répartition de tout le terrein
fqr lequel on érige un édifice. IV . 1,063. a- $ÙJ d’une
bonne diftribution. (Quelle doit être la diftribution daps les
palais des ro is , dans les édifices facrés , les bâtimens publics,
ceux pour les commerçans , pour les arrifans , &c. Sources
des fautes que l’on commet dans la diftribution ; le déréglement
de l’imagination des architeâes ; le mépris des réglés
de convenance , fous prétexte que l ’efprit n’agit jamais mieux
que Jorfqu’il eft affranchi de toute fervitude. Difficulté d’aç-
quérir l’art de diftribuer les bâtimens. Ibid. b. Il n’eft pas
Vrai que les grands génies méprifent l’obfervatipn des réglés.
Pour paryenir à diftribuer avec convenance, il eft des loix
générales dfint Op ne peut s’écarter , qui concernent Uarran-
gement, la forme & l’ufage des pièces de néceffité, dp commodité
& de bienféance. Celles de néceffité fcmblent avoir
un fondement réel dans la nature. Maniéré d’appliquer ce
principe à Ja pratique. Attention qu’il faut faire à ce qui concerné
la commodité. L ’objet de bienféance paroît plus difficile
à être réduit en principes. Ibid. 1064. a. C ’eft lui qui fait tout
le mérite de rar,chiteâure. Etendue de cet objet. ÆM A
D is tr ib u t io n des eaux , ( ifydraid. ) celle qui fe fa it dan?
une ville. Ufage des tuyaux de plomb. Somme qu’pn retire de
la vente de feau à Paris pour l’entretien des bâtimeng §ç machines
hydrauliqups, A Londres on oblige chaque maifon
d’acheter d e l’eau. Comment elle fe diûribue. Maniéré de
partager à fix particuliers ou plus une fontaine ou une fource
touçpiftaut deux pouces d’eau. IV . 1964. h.
De la dijlribution des eaux dans un jardin. Trois chofes à'
examiner. 1°. La quantité d’eau que l’on a.. Par quel moyen
pu cpnnoît cette quantité. 20. La fituation du Heu. 30. Le
nombre des fontaines qu’on v eu t exécuter. Obfervations à
faire pour un jardin de niveau , fur le nombre & la nature
des jets qu’on peut faire à proportion de la quantité d’eau
qu’on a à dépenfer. Des jardins en terraffe. Avantage de cette
difpofition pour l’objet dont il s’agit ici. Ibid. 1063. a. Si l’on
a des cafcades & des buffets à fournir , la diftribution devient
plus difficile. Direâions fur ce fujet. Ibid. b.
D is t r ib u t io n , ( Jardinas.) la diftribution d’un jardin eft
la même chofe que fa difpofition. Les jardins les plus beaux
font les plus variés. D ’où cette diftribution tire fa beauté.
C ’eft fuivant les différentes firuations d’un jardin qu’il faut
en diftribuer les parties. Quatre maximes fondamentales pour
bien difpofer un jardin. Obfervations particulières. Oppofer
le plein au vuide & le plat au relief. Ouvrage à confulter.
Ibid. b.
D i s t r ib u t io n , (Imprimerie) IV . 1063. A
D is tr ib u t io n , ( Peinture ) IV . 1063. b.
D IS TR IBU T IV E Juftice. IX. 94.4.
D IS T R IC T , reffort. Différence entre l’un & l’autre. X IV .
191. b. Différence entre diftriâ , con trée, pro vince, pays ,
région. X V . 739. a , b. D iftriâ appellé »(/sa p arles Grecs.
X V I . 32. 4.
D IT H M A R , ( Jufie-Chrifiophe ) obfervations fur fes ouvrages.
X IV . 379. A
D IT H Y R AM B E , {Bell, lett.) poéfle confacrée à Bacchus
chez les Grecs. Divers fentimens fur l’étymologie de ce m o t ,
& fur le premier auteur de la poèfie dithyrambique. Il y a
beaucoup d’apparence qu'elle doit fon origine aux affemblées
ruftiques de buveurs. Six principales qualités qui caraâéri-
foient cette forte de poéfie, & qui prouvent que l’excellence du
dithyrambe approchoit beaucoup du galimathias. Ouvrages
fur lefquels on peut fe faire une idée des poéfies de ce genre.
IV . 1066. 4. Les dithyrambes fönt différens de ce que nous
appelions vers lihres , & de ce que les Italiens nomment
yerfi fciolti. Erreur de M. Dacier &. du P. Commire fur les
dithyrambes. Cérémonie fingnliere qu’imaginerent les amis
de Jodele , p o è te , qui vivo it du tems de Henri II , pour {e
complimenter fur fa tragédie de Cléopâtre. Dithyrambe de
Ba ïf fait à cette occafion. Réflexion de M. de Fontenelle fur
ces vers. Ibid. A
Dithyrambe. Réflexion fur les hymnes ou chanfons adref-
fées à Bacchus , dont quelques modernes ont prétendu renou-
v ellër l’ufage. Suppl. II. 730. b. Les. Latins , quoique leur
culte fut celui des Grecs , ne refpeâoient pas affez la fureur
bacchique pour en eftimer l’im itation ; & de tous les genres
de poéfie , le dithyrambe fut le feul qu’ils dédaignèrent
d’imiter. — La poéfie dithyrambique, cultivée par les Italiens
modernes. — Nos anciens p oètes, du tems de Ronfard , na
manquèrent pas d’effayer aufli le même genre j mais ni notre
langue, ni notre g o û t , ne fe font prêtés à cette d o âe extravagance.
Ibid. 73 1 . a.
D IT H Y R AM B IQ U E , ( Bell. lett. ) un mot compofé &
dithyrambique a quelquefois fa beauté ; mais ce .né peut
guère être que dans les langues g recque & latine. Quelques'*
uns appellent dithyrambiques , des pièces dans le goût de
l’ode , mais qui ne font point diftinguées par ftrophes , &c.
Réglés de la poéfie dithyrambique. IV . 1067* A
Dithyrambiques , pièces, en l’honneur de Bacchus. III. 361.4.'
D IT O , ( Comm. ) ufage qu’on fait dans le commerce de
ce m o t , abrégé par D ° . IV- 1067. a.
D I T T O N , ( Humfroi ) fes ouvrages. X IV . 3 7 1 .4 , b.
D I Y A LES , ( Hiß. anc. Myth. ) fête en l’honneur de la
déeffe Agéronne. Jour de l’année où on la célébroit. A
quelle occafion elle fut établie. Comment on la célébroit.
IV. 1067. 4.
D IV A N . Signification de ce mot. Divan du grand-feigneur.
Officiers qui le compofent. Jours de la femaine auxquels il
s’affemble. Divan du grand-vifir. Salle où il rend la juftice.
Jours du divan. Affefleurs du vifir. Comment fe tiennent ces
affemblées. Comment s’y traitent les caufes. Officiers qui
compofent ce divan. Caufes importantes qui font réfervées
au confeil privé du grand-feigneur, appellé galibé divan. D é tails
fur la manierç dont ce confeil fe tient. Confeil général
que le fultan convoque , lorfqu’il le juge à propos. En quoi
il différé du galibé divan. IV . 1067. b. C e divan s’appelle oja-r
divani, le divan des piés. Ibid. 1068. b.
Divan. Vifirs qui ont féance au divan. XV II . 3 7 t .4 , A
D iv a n -BEGHI , nom d’un miniftre d’ état en Perfe. Nature
de fa charge & de fes fonâions. Caufes qu’il juge. Ses
appointemehs. Lieu où il rend la juftice'. Loi qu’il fuit, IV .
xo68. 4.
D IV E R G EN C E des rayons du foleil produite par différentes
expériences. III. 802. b. X I. 462. A
D IV E R G E N T , foyer imaginaire des rayons réfléchis
divergens. V II . 263. a. ■
D JV ER S IQ N , { Mideç. ) changement qu’on produit dans te
D I V
Diversion , ( Artmilit. ) diverfion pour obliger l ’ennemi
d’abandonner le fiege d’une v ille , ou pour fe dédommager
d e là perte de cette-place. Exemple tiré .de l’hiftoire de Henri
IV . Diverfion d’A ga thocle, lorfqu’il fu t affiégé dans Syra-
eufe par les Carthaginois. Il eft prefque toujours avantageùx' >
de porter la guerre chez les autres , lorfqu’on eft attaqué dansl
fon propre pays. C e qu’il faut obfervet avant de s’engager
dans des guerres de diverfion. Réflexions militaires du ma rquis
de Santaçrux fur ce fujet. IV . 1068. A
D IV E R S ITÉ , {P e int.) celle qu’on doit obferver- en peignant
la joie ,- la douleur, &c. IV . 1068. A Modèles que nous
poffédons en ce genre. Il n’eftpas poflible. de donner des regles'
pour enfeigner l’art de diverfiner les perfonnages d’un, tableau,
&c. C ’eft au génie à imaginer. Ibid. 10691 4i.
D iv er s it é , ( Synon.) différence entre diverfité, bigarrure,i
différence,& v ariété, II. 247. a. entre diftiaâion, féparationÔc
diverfité. IV . 1039.
D IV E R T IR , amufer, ( Synon. ) Suppl. I. 376. A
DIVERTISSEMENT . ( Jurifp. ) Différence entre recelé.
& divertiflement. IV . 1069. a. Voye^ RECELÉ.
D ivertissement. ( Bell.lett.) Deuxefpeees de divertiffe-
mens de théâtre» Divertiffemens1 qu’on introduit épifodique-
nient dans les aâ es d’opéra. L’art d’amener les divertifle-
mens eft une partie fort rare au théâtre lyrique. Réglé-:
qu’on doit obferver à cet égard : le divertiflement doit être
néceflaire à la marche théâtrale du. fujet.. Celui qui terminé
l’opéra eft moins affujetti à cette réglé : IV . 1069. a. mais
on doit fur-tout l’obferver par rapport aux ballets. Obfer-
vation fur ce qui fait la perfeâion de cette forte de diver-
tiffement. Erreur où l’on tombe fur cette partie dramatique.
C e qui eft effentiel pour former une bonne entrée de ballet;
Ibid. A
Divertiffemens des entr’àâes. V . 727. a. 730. A V I . 398:
4. Divertiflement de ballets. Suppl. I. 764; A Div e rtme-
mens qui étorent deftinés à occuper les oonvives dans l’intervalle
des. fervices d’un feftin. 731. A Divertiffemens d’o péra.
V I . 398; 4. Suppl. IV . 16 1. A 262.4.
Diverliffement, amufement, récréation , réjouiffance : différences
entre ces mots. Les divertiffemens qui n’oatpas pour
but des chofes utiles ou néceflàires, font les fruits de l’oir
fiv e té , de famour pour leplaifir , &c. Defcripdon.des diver-
tiffemens de la nation françoife, par madame de Grafigny
dans les lettres d’une Péruvienne. IV . 1069. b.
D IV ID E N D E , {Comm.) lignification de ce mo t.I. 124.
4. L e nom de dividtnd.e donné au chirographe. III. 349; A
Portion de la dividende , ou répartition d’une- aâion. IV .
334. 4. Voye^ R é p a r t it io n .
D IV IN , ce mot s’emploie dans un fens figuré pour exprimer
quelque chofe d’excellent, d’extraordinaire , &c. Pourquoi
ce furnom a été donné à Platon. On a appellé Hyp-
pocrate le divin vieillard, &c. Les Arabes donnent le nom
de divin à la fécondé fe â e de leurs philofophes. IV . 1070. a.
Divin. Epithete de divus & diva donnée aux empereurs &
à quelques dames romaines après leur apothéofe. III. 903.
4. X V I I . 770. 4. Droit divin. V . 124. A .
D i v in , emplâtre t { Pharm.) Defcription tirée de la pharmacopée;
de Paris. IV . 1070» a.
D IV IN A T IO N . I l eft parlé dans l’é criture, de neuf efpe-
ces de divinations. Les Juifs s’étoieat infeâés de ces fuper-
ftitions en Egypte. Les Romains diftinguoient la divination
en artificielle & en naturelle. Us divifoient celle-ci en innée
& en infufe, IV . *070. A & l’artificielle en d euxefpeees,
l’une expérimentale, l’autre chimérique , extravagante , &c.
D e cette derniere vinrent les forts. Enumération des principaux.
Définition que Delrio donne de la divination. D eu x
efpeces de paâes que cet auteur diftingue , l’un implicite ,
l’autre explicité : il obferve que cette derniere eft tantôt
lic it e , tantôt illicite. Ibid. 107*. a. Les Romains fe défabu-
ferent peu-à-peu de ces fottifes. Exemple de Caton & de
Cicéron. Origine que M. Pluche donne à la divination-.
Comment il a pu arriv e r, félon cet auteur, que les Egyptiens
aient pérdu la lignification de leurs fymbolés , & qu’ils
les aient tous pris à la lettre. Syftême de M. de Conaillae
fur l’origine & les progrès de la divination. Comment la
crainte imagina un génie malfàifant. Ibid. b. L’efpérance ne
tarda pas à créer des génies favorables. Le foleil fut bientôt
compté parmi les êtres bienfaifans. O n fuppofa de l’influence
à la lune , à tous les corps céleftes , & les deux
parurent concerter le bonheur ou le malheur des hommes.
La liaifon qu’on eft tenté de fuppofer entre las noms & les
chofes , fit qu’on trouva dans les planètes & les fignes du
zodiaque des qualités analogues à celles des perfonnes ou
des animaux dont ces aftres portent les noms : ainfi fe forma
l’aftrologie judiciaire. Comment une feule prédiâlon accomplie
dut l’accréditer dans les efprits. On attribua enfuite quelque
intelligence à ces êtres , on s’adreffa à e u x , - on les
évo qua, on fe procura leur protection par des tatiûnans,
Tome I,
d i v m 6k. Ibid. 107a. 41 Après avoir oublié 1&fens des caraâeres
hiéroglyphiques, on le u r attribua des v er tu s, on lesimro-
duifit dans- la ma^e. Naiffance.de la chiromancie..Origine-'
de l'interprétation des- longes , o it de. l’ondropritie. Infen-
fiblement- les hommes' fe j jètterént fur toiis les objets 8c
les- transformèrent en typ és , én avenifièmens, en fignes,
en prognoftics , &c. Origine; de l ’ihfpiration. Comment lai
fourberie- de$! prêtres-Éworifa^ enfuite-la fuperftition des peuples;
La philofophief, les! connoiffances de la- médecine, laq
politique),. conçoururentau -même bu t. Ibid. A Gés erreurs
introduites' chez- les juifs 8c chez les chrétiens; Q u el eft le
fervicer que la. philofophie. doitl à cet égard rendre à l’humanité.
Eftime que nous faifons . aujourd’hui, dés livres de
CiçérQmfür la-nature des.dieux:-Se fur- la-divination , qui
durent lui attirer l’indignation des. prêtres d e fon- tems. En
quelque tejtis. 8c. chez quelque peuple que ce puiffe être ,
la'vertu 8cla vér.ité m èritentfeules'jiotrerefpeâ.-iAA 1073. 4.
Divination. Réflexions fur 'l e defir- que les^ hommes ont
toujours eu de connoître l ’avenir : différens-moyens, qu’ils
ont employés! -pour acquérir cette connoiffance. X V . 137. b.
La divination iétoit particuliérement affeâêe aux femmes chez
les Celtes. II. 810. A Divination par l e crible , IV . 290-. a.
par la cou p e , 346; A par la pâte 8c la farinedesTaCrifices;
489. A par le* moyen d’une glace ou d’un miroirr 329. A
par le mo yen d’un, anneau ^ 6101 A du laurier,. 63 ï; a. par
le s noms , X L 483. A 484. 4. par le s forts.- X V . 376» 4 ,
b ,. 8cc. Divination dite Simia par les Arabes.. 201. a. Les
autres efpeces de divination font indiquées à l’article D iv ination
de l’Encyclopédie.
Divination-i terme de jurifprùdence romaine.. IX. 21. a,
D IV IN A TO IR E ., baguette. II. 3. 4 , A.
D IV IN E !, pierre l i t 432; a ,.A Loix-divines EX. 639. a.
D IV IN IT É . D e la divinité de Jefus-Chrift. D e la-divinité
dans les perfonnes de la fainte- Trinité. Réponfe aux
athées qui- prétendent que l’idée d’une divinité eft une invention
de la politique. T ro is claffes des. divinités: du paganifmé.
IV . 1073.4.
Divinité, àxe Çhrift. X. 404. A Divinité dès écritures. V .
363. A— 363. A
Divinité ou majefté divine décrite dans un hymne attrib
u é à Orphée, VIII; 396. A 8c dans un autre attribué à
Cléanthe'. Ibid. Defcription de la grandeur de Dieu , tirée
du poète Sadi. XIÏ. 840. a.
DIVISE. {Blafon ) Fafcc divi(ç. Suppl. II. 731 . 4. Vovez
Suppl. IV . 368. a , A .. , t
D IVISÉ. Sens divifé en terme de grammaire. X V . 19. 4.
D iv ifé en terme.de blafon,. voyeçParti.
D IV ISE R , ( Arithm. ) v.oyeç DIVISION.
D iviser , {Géomét.) étymologie de ce mot X V I . 701.
A Voyez DIVISION.
D IVISEUR. ( Arithm. ) C e qu’on appelle commun divr-
feur. Maniéré de trouver le plus grand divifeur commun
de deux quantités quelconques.. Maniéré de trouver celui
de trois nombres, quelconques ,. de quatre nonfor.es II eft
quelquefois utile de connoître tous les- divifours d’un nombre:
méthode à fuivre pour cela. IV . 1073» A Démonftration de
la réglé indiquée ci-deffus pour trouver les communs divi-
feurs. Méthode abrégée;pour trouver le plus grand-commun
divifeur. D eu x nombres premiers, ou deux nombres, dont
l’un eft premier , ne fauroient avoir de commun divifeur
plus grand que l’unité. Un produit de nombres premiers quelconques
, divifé par un produit d’autres nombres premiers
quelconques, ne peut f e réduire à une expreflion plus Ample.
D e la méthode par laquelle on trouve le plus grand
divifeur commun de deux quantités algébriques : fon utilité
Ibid. 1074. 4. Voye^ IV . 1098. b.
Divffeur. Table pour trouver les diviféurs des nombres
jufqu’à 100,000. XIII. 913 , &c.
DIVISIBILITÉ. ( Géonu P h y f.) Les Péripatéticiens 8c les
Cartéfiens louriennent que la divifibilité eft une affeâion de
toute matière ou de tout corps. Les Epicuriens difent que
la divifibilité eft propre à toute continuité phyfique ; mais
ils foutiennent que les corpufcules primitifs font indivifibles.
Différence qu’ils établiffent entre la divifibilité des quantités
phyfiques , 8c celle des quantités mathématiques. Comme
la queftion de la divifibilité à l’infini eft fujette à bien des
difficultés , on expofe ici les raifonnemens pour & contre.
La divifibilité d’un corpufcule prouvée , parce qu’il a nécef-
fairement des parties , des côtés , des furfaces diftinâes. IV .
z 074. A Démonftration de la divifibilité à l’infini d’une quantité
mathématique. O bjeâions : l’infinine peut être renfermé dans
ce qui eft fini. Réponfe. On ne foutient point la poffibilité
d’une divifion aâuelle in injmitum. I l y a une infinité
d’exemples dans la nature de parties trè s -pe t ites , fépa-
rées aâuellement l’une de l’autre. Exemple de la grande
divifibilité de l’on Divifion d’un grain de cuivre rouge dit-
fous dans de l’efprit de fe l ammoniac. Petiteffe extrême
des- animalcules que Lewenhoeck a remarqués dans de l’eau
où l’on avoit jette du p oivre. Ibid. 1073. a. Fineffe des par-
Q Q Q i q q