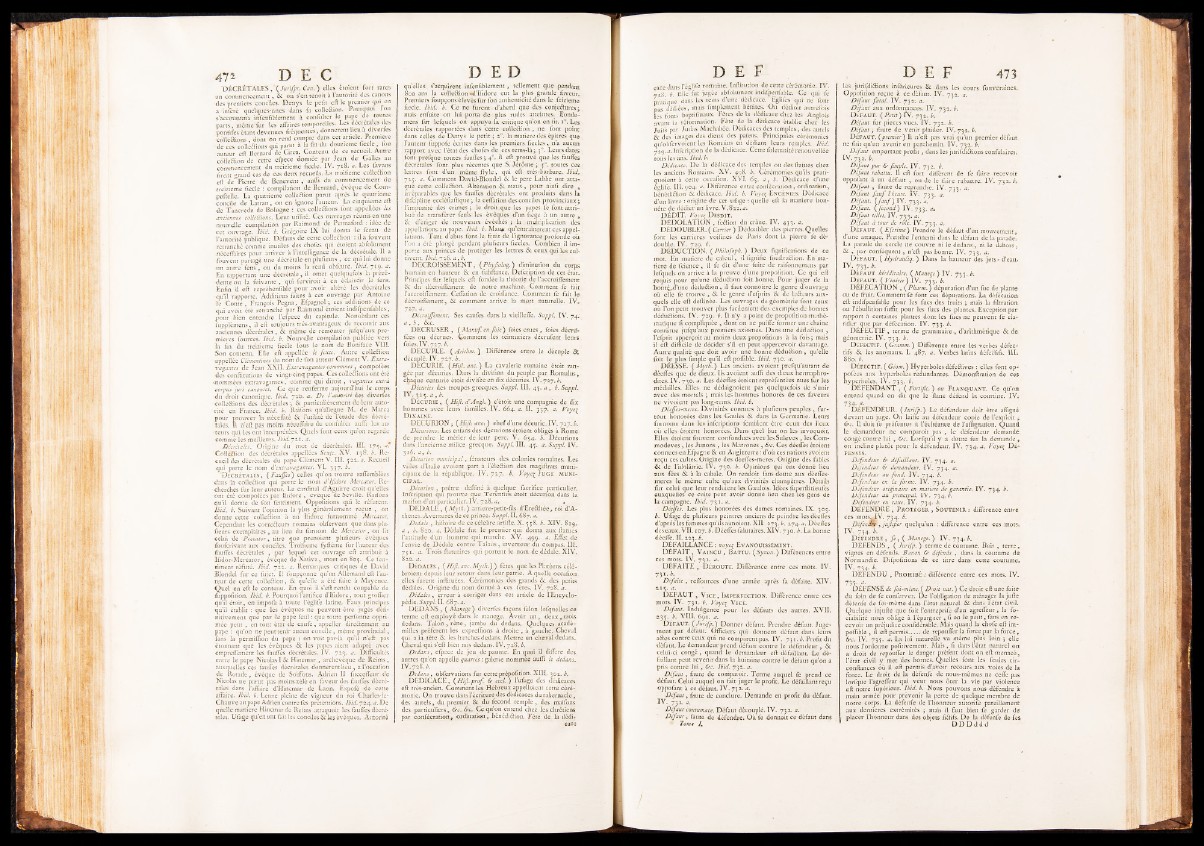
47* D E C
D É C R É T A L E S , '(Jurifpr. Can. ) elles ètoiôttt fort rares
au commencement, & oh s’en tehoit à l’autorité des canons
<les premiers conciles. D en ys le petit eft le premier qui en
a inféré quelques-unes ‘dans -fa colleélion. Pourquoi Ion
s'accoutuma. infenfiblement à confulter le pape de toutes
parts, même'fur les affaires temporelles. Les dtcieta es ces
pontifes étant devenues fréquentes, donnèrent lieu a divertes
collerions , dont on rend compte dans cet article. Première
de ces collerions qui parut à la fin du douzième fie c le , Ion
auteur eft Bernard de Cire*. Contenu de çe recueil. Autre
côlleétion de cette efpece donnée par Jean d e Galles au
commencement du treizième fiecle. IV . 718. a. Les fovans
firent <*rand cas de c e s deux recueils. La troifieme collerion
eft cIe°Pierre de Benevent , aufli du commencement du
treizième fiecle : compilation de Bernard, évêque de Com-
poftelle. La quatrième collerion parut après le quatrième
concile de.Latran, on en ignore l’auteur. La cinquième eft
de Tancrede de Bologne : ces collerions font appellées les
anciennes colleBions. Leur utilité. Ces ouvrages réunis en une
nouvelle compilation par Raimond de Pennaford : idée de
cet ouvrage. Ibid. b. Grégoire IX lui donna le fceau de
l'autorité publique. Défauts de cette collerion : il a fouvent
retranché comme inutiles des chofes qui étoient abfolument
méceffaires pour arriver à l’intelligence de la décrétale. Il a
Couvent partagé une décrétale en plufieurs , ce qui lui donne
un autre fe n s , ou du moins la rend obfcure. Ibid. 719. a.
En rapportant une décrétale, il omet quelquefois la précéd
en te ou la fuivante, qui ferviroit à en éclaircir le fens.
Enfin il eft repréhenfible pour avoir altéré les décrétales
qu’il rapporte. Additions faites à cet ouvrage par Antoine
le C o n te , François Pegna, Efpagnol ; ces additions de ce
qui avoit été retranché par Raimond étoient indifpenfables,
pour bien entendre l’elpece du capitule. Nonobftant ces
fiipplémens, il eft toujours très-avantageux de recourir aux
anciennes décrétales, & même de remonter jufqu’aux premières
fources. Ibid. b. Nouvelle compilation publiée vers
la fin du treizième fiecle fous le nom de Bonifoce VIII.
Son contenu. Elle eft appellée le fexte. Autre colleftion
appellée Clémentines du nom de fon auteur Clément V . Extravagantes
de Jean XXII. Extravagantes communes, compofées
des conftitutions de vingt-cinq papes. Ces colle&îons ont été
■ •nommées extravagantes, comme qui d iro it , vagantes extra
corpus juri canonici. C e que renferme aujourd’hui le corps
du droit canonique. Ibid. 72x>.-a. D e l autorité des diverfes
collections des décrétales; & particuliérement de leur autorité
en France. Ibid. b. Raifons qu allégué M. de Marca
pour prouver la néceffité & l’utilité de l’étude des décrétales.
Il n’eft pas moins nèceffaire de confulter aufli les au-
’teurs qui les ont interprétées. Quels font céux qu’on regarde
comme les meilleurs.. Ibid. 721. a.
,Décrétales. Origine du mot de décrétales. III. 175.a .
'C olleïtion des décrétales appellées Sexte. X V . 138. b. Recueil
des décrétales du pape Clément V . III. 522. a. Recueil
qui porte le nom d’extravagantes. V I. 337. b.
D é cr é ta le s, ( Fauffes) celles qu’on trouve raffemblées
dans -la collection qui porte le nom d‘Ifidore Mercator. Recherches
fur leur auteur. Le cardinal d’Aguirre croit qu’elles
ont été compofées .par Ifidore, évêque de Séville. Raifons
qu’il donne de fon fentiment. Oppoiitions qui le réfutent.
Ibid. b. Suivant l’opinion la plus généralement reçue , on
donne cette 'collection à un Ifidore furnommé Mercator.
Cependant les correcteurs romains obfervent que dans plufieurs
exemplaires, au lieu du furnom de Mercator, on lit
celui -de -Peccator, titre que prenoient plufieurs évêques
foufcrïvant aux conciles. Troifieme fyftême fur l’auteur des
fauffes décrétales , par lequel cet ouvrage eft attribué à
Ilidor-Mercator, évêque de Xativa, mort en 805. Ce fentiment
réfuté. Ibid. 722. a. Remarques critiques de David
Blondel fur ce fujet. Il foupçonne qu’un Allemand eft l’auteur
de cette çolleCtion, & qu’elle a été faite à Mayence.
Q u e l en eft le contenu. En quoi il s’eft rendu coupable de
fuppôfition. Ibid. é. Pourquoi l’artifice d’Ifidore, tout groflier
qu’il étoit, en impofa à toute l’églife latine. Faux principes
qu’il établit : -que les évêques ne peuvent être jugés définitivement
que par le pape feul : que toute perfonne opprimée
p e u t , en tout état de cau fe, appeller directement au
pape : qu’on ne peuttenir aucun concile, même provincial,
fans la permiflïon du pape : on voit par-là qu’il n’eft pas
étonnant que les évêques •& les papes aient adopté avec
empreffement les fauffes décrétales. IV . 723. a. Difficultés
entre le pape Nicolas I & Hincmar , archevêque de Reims,
auxquelles ces fauffes décrétales donnèrent lieu , à l’occafion
de Rotade, évêque de Soiffoijs. Adrien II fucceffeur de
Nicolas ne parut pas moins zélé en faveur des fauffes décrétales
dans l’affaire d’Hincmar de Laon. Expofé -de cette
affaire. Ibid. b. Lettre pleine de vigueur du roi Charlcs-le-
Chauve au pape Adrien contre fes prétentions. Ibid.yzq. a. D e
quelle maniéré Hincmar de Reims attaquoir les fauffes décrétales.
Ufage qu’en ont fait les conciles 6c les évêques. Autorité
D E D
qu’elles., s’acquirent infenfiblement, tellement que pendant
800 ans la colleCÜon -Sd’Ifidore eut la plus grande faveur.
Premiers foupçons é levés fur fon authenticité dans le feizieme
fiecle. Ibid. b. C e ne furent d’abord que des conjectures ;
mais enfuite on lui porta de plus rudes atteintes, Fonde-
mens fur lefquels on appuya la critique qu’on en fit. i° . Les
décrétales rapportées dans cette colleCtioji , ne font point
dans celles de Denys le petit ; 2°. la matière des épîtres que
l’auteur fuppofe écrites dans les premiers fiecles, n’a aucun
rapport avec l’état des chofes de ces tems-là; 30. Leurs dates
font prefque toutes fauffes ; 40. il eft prouvé que les fauffes
décrétales font, plus récentes que S. Jérôme ; 5°. toutes ces
lettres font d’un même ftyle ; qui eft très-barbare. Ibid.
725. a. Comment David-Blondel 8c le pere Labbe ont attaqué
cette colleCfioiï. Altération & maux, pour ainfi dire ,
irréparables que les fauffes décrétales ont produits dans la
difeipline eccléfiaftique ; la ceffation des conciles provinciaux ;
l ’impunité des crimes ; . le droit que les papes fe font attribué
de transférer feuls les évêques d’un fiege à un autre ,
& d’ériger de nouveaux- évêchés ; la multiplication des
appellations au pape. Ibid. b. Mau* qu’entraînerent ces appellations.
Tant d’abus .font le fruit de l’ignoraiice profonde où
l’on a été plongé pendant plufieurs fiecles. Combien il importe
aux princes de protéger les lettres & ceux qui les cultivent.
Ibid. 726. a , b.
D ECROIS SEM EN T , (Phyfiolog.) diminution du corps
humain en hauteur & en fubftance. Defcription de cet état.
Principes fur lefquels eft fondée la théorie de l’accroiffement
& du décroiffement de notre machine. Comment fe fait
l’accroiflement. Ceffation de croiffance. Comment fe fait le
décroiffement, & comment arrive la mort naturelle. IV .
7a7v*- . ,
Décroiffement. Ses caufes -dans la vieillcffe. Suppl. IV . 74;
a , b , &c.
D ECRUSER , (Mar.uf. en.foie') foies crues , foies déertf-
fées ou décrues. Comment les teinturiers décrufent leurs
foies. IV . 727. b.
DECUPLE. ( Arithm. ) Différence entre le décuple Sc
décuplé. IV . 727. b.
DECURIE. (H iß. anc. ) La cavalerie romaine étoit rangée
par décuries. Dans la divifion du peuple par Romulus,
chaque centurie étoit divifée eû dix décuries. IV . 727. b.
Décuries des troupes grecques. Suppl. III. 45. a , b. Suppl.
IV , 315. a , b.
D é curie , ( Hiß. d'Angl. ) c’étoit une compagnie de dix
hommes avec leurs familles. IV . 664. a. IL 337. a. Voye^
Dixaine.
D E C U R IO N , ( Hiß. anc. ) chef d’une décurie. IV . 727. b.
Décurions. Les enfans des décurions étoient obligés à Rome
de prendre le métier de leur pere. V . 6,54. b. Décurions
dans.l’ancienne milice grecque. Suppl. III. 43, a. Suppl. IV .
316. a , b.
Dècurion municipal, fénateurs des colonies romaines. Les
villes d’Italie avoient part à l’éleélion des magiftrats municipaux
de la république. IV . 72 7 , b. Voyeç Juge municipal.
Dècurion, prêtre deftiné à quelque facrifice particulier.
Infcription qui prouve que Terentius étoit dècurion dans la
mai fon d’un particulier. IV . 728. a. ,
D E D A L E , ( Myth. ) arriere-petit-fils d’E re âh ée , roi d’A -
thenes. Aventures de ce prince. Suppl. IL 687. a.
Dédale , hiftoire de ce célébré artifte. X . 558. b. X IV . 819.
a , b. 820. a. Dédale fut le premier qui donna aux ftatties
l’attitude d’un homme qui marche. X V . 499. a. Effet de
l’envie de Dédale contre Ta laiis, inventeur du compas. III.
7Ç1. a. Trois ftatuaires qui portent le nom de dédale. X IV .
820. ƒ.
D é d a l e s , ( Hiß. anc. Myth. ) ) fêtes que les Platèens célé-
broient depuis leur retour dans leur patrie. A quelle occafion.
elles furent inftituées. Cérémonies des grands & des petits
dédales. Origine du nom donné à ces fêtes. IV . 728. a. ,
Dédales, erreur à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 687. a.
D E D A N S , ( Manege ) diverfes façons félon lefquelles c®
terme eft employé dans le manege. A v o ir u n , d eu x , trois
dedans. T a lo n , rêne, jambe du dedans. Quelques açadé-
miftes préfèrent les expreflïons à d ro ite , à gauche. Cheval
qui a la tête 8c les hanches dedans. Mettre un chpval dedans.
Cheval qui s’eft bien mis dedans. IV . 728. b.
Dedans, efpece de jeu de paume. En quoi il différé des,
autres qu’on appelle quarrés : galerie nommée auffi le dedans.
IV . 728,b. _
Dedans, obfervations fur cette prèpofition. XIII. 302. b.
D E D IC A C E , (H iß .prof, b cccl.) l’ufage des dédicaces
eft très-ancien. Comment les Hébreux appeïloient cette cérémonie.
On trouve dans l’écriture des dédicaces du tabernacle,
des autels, du premier & du fécond temple, des maifons
des particuliers, b c . b c . C e qu’on entend chez les chrétiens
par confécration, ordination, bénédiâion. Fête de la dédij
cace
D E F
cace dans i’èfflifé'romaine. Inftitution de cétte céré'mbhie. IV .
728. b. Elle tut jugée abfolument indifpenfable. C e qui fe
pratique dans les teins d’uné dédicacé. Eglifes qui né font
pas dédiées, mais Amplement bénites. O n dédioit autrefois
les fonts baptifmaux. Fêtes d e là dédicace chez les Anglois
avant la réformation. Fête de la dédicace établie chez les
Juifs par Judas Machabée. Dédicaces des temples, des autels
& des images des dieux des païens. Principales cérémonies
qu’obfervoient les Romains en dédiant leurs temples. Ibid.
729. a. Infcription de la dédicace» Cette folemnité renouvellée
tous les ans. Ibid. b-.
Dédicace. D e la dédicace des temples ou des ftatuës chez
les anciens Romains» X V . 498. b-. Cérémonies qu’ils prati-
quoient à cette occafion. XVJ. 65. a ,■ b. Dédicace d’une
églife. III. 904. n. Différence entre confécration , ordination,
bènédi&ion 6c dédicace» Ibid. b. Voye[ Encénies. Dédicacé
d’un livre : origine de cet ufage : quelle eft la maniéré honnête
de dédier un livre. V . 822» a»
D ÉD IT . Voyc^ D esd it .
D É D O L A T IO N , feélion du crâne. IV . 433. a.
D ÉD O UBL ER. ( Carrier ) Dédoubler des pierres. Quelles
font les carrières voifines de Paris dont la pierre fe dédouble.
IV . 729. b.
D ÉD U C T IO N . ( Philofioph. ) Deux fignifications de ce
mot. En matière de calcul , il fignifie fouftraftion. En matière
de fcience , il fe dit d’une fuite de raifonnemens par
lefquels oh arrive à la preuve d’une propofition. C e qui eft
requis pour qu’une déduction foit bonne. Pour juger de la
bonttLd’une déduélion, il faut connoître le genre d’ouvrage
où elle fe trouve , 6c le genre d’efprits 6c de le&eurs auxquels
elle eft deftinée. Les ouvrages de géométrie font ceux
où l’on peut trouver plus facilement des exemples de bonnes
déductions. IV . 729. b. Il n’y a point de propofition mathématique
fi compliquée , dont on ne puiffe former une chaîne
conrinue jufqu’aux premiers axiomes. Dans une déduélion ,
l’efprit apperçoit au moins deux prôpofitions à la fois; mais
il eft difficile de décider s’il en peut appercevoir davantage.
Autre qualité que doit avoir une bonne déduélion , qu’elle
foit le plus fimple qu’il eft poffible. Ibid. 730. a.
DÉESSE. ( Myth. ) Les anciens avoient prefqu’autant de
déeffes que de dieux. Ils avoient auffi des dieux hermaphrodites.
IV . 730. a. Les déeffes étoient repréfentèes nues lur les
médailles. Elles ne dédaignoient pas quelquefois de s’unir
avec des mortels ; mais les hommes honorés de ces faveurs
ne vivoient pas long-tems. Ibid. b.
Déeffes-meres. Divinités connues à plufieurs peuples , fur-
tout honorées dans les Gaules 8c dans la Germanie. Leurs
furnoms dans les inferiptions femblent être ceux des lieux
où elles étoient honorées. Dans quel but on les invoquoit.
Elles étoient fouvent confondues a vec lesSuleves , lesCom-
modeves, les Junons , les Matrones , b c . Ces déeffes étoient
connues en Efpagne 6c en A ngleterre : d’où ces nations avoient
reçu ces cultes. Origine des déeffes-meres. Origine des fables
& de l’idolâtrie. IV . 730. b. Opinions qui ont donné lieu
aux fées 8c à la cabale. On rendoit fans doute aux déeffes-
meres le même culte qu’aux divinités champêtres. Détails
fur celui que leur rendoient les Gaulois. Idées fuperftitieufes
auxquelles ce culte peut avoir donné lieu chez les gens de
la campagne. Ibid. 73 1 .a.
Déejfes. Les plus honorées des dames romaines. IX. 305.
b. Ufage de plufieurs peintres anciens de peindre les déeffes
d’après les femmes qu’ils aimoiènt. X II. 273. b. 274. a. Déeffes
des eaux. V II . 107. b. Déeffes falutaires. X IV . 730. b. La bonne
déeffe. II. 223. b.
D É FA IL L AN C E : voye^ Ev an ou is sem en t .
D É F A IT , V a in c u , B a t t u . ( Synon. ) Différences entre
ces mots. IV . 731. a.
D É F A IT E , D érou te . Différence entre ces mots. IV .
7 3 1 . é.
Défaite , reffources d’une armée après fa défaite. X IV .
a i 5- a.
D E F A U T , V ic e , Im per fe c t io n . Différence entre ces
mots. IV . 731. b. Voyeç V ic e .
Défaut. Indulgence pour les défauts des autres. XVII .
tt3 5. b. VII I. 6 9 !. a.
D é fau t . ( Jurifp. ) Donner défaut. Prendre défaut. Jugement
par défont. Officiers qui donnent défaut dans leurs
aéies contre ceux qui ne comparent pas. IV . 731. /-. Profit du
défaut. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, &
celui-ci con gé , quand le demandeur eft défaillant. Le défaillant
peut revenir dans la huitaine contre le. défaut qu’on a
pris contre lui , bc . Ibid. 732. a.
Défaut, foute de coniparoir. Terme auquel fe prend ce
défaut. C elui auquel on fait juger le profit. L e défaillant reçu
oppofant à ce défaut. IV . 73 2. a.
Défaut, foute de conclure. Demande en profit du défaut.
IV - 73.2. a.'
Défaut contumace. Défaut découplé. IV . 73 2. a.
Défaut, fome de défendre. Où fe donuoit ce défaut dans
Tome I.
D E F 473
les juri(diélioris inferieures 8c dans les cours fouvéraineS;
Oppofnion reçue à ce défaut. IV . 722. a
Défaut fatal. IV . 732; ' '
Défaut aux ordonnances. IV . 732. b.
D é fau t -. (P e tit ) TV. 732. b.
Defaut fur pièces vues. IV ; 732. b. -
Défaut ; fauté de venir plaider. IV . 73 2. b.
D e fau t , (premier) Il n’eft pas vrai qu’un premier défaut
ne foit qu’un avenir en parchemin. IV . 732. b.
Défaut emportant pro fit, dans les jurifdiélions confùlaires.
IV . 732. b-. . . . ■
Defaut pur b fimple. IV . 732. b.
Défaut rabattu. 11 eft fort différent de fe faire recevoir
oppolant ,à un défaut , ou de le foire rabattre. IV . 73 a. b.
Défaut , foute de reprendre. IV. 722. a\
Défaut fa u f Iheure. IV . 733. a
Défaut, ( fa u f ) IV . 7 3 3 .* .
Défaut. ( fécond) IV . 733.
Défaut tillet. IV . 733. a;
Défaut à tour de rôle. IV . . 73 3. à.
^ D é fau t . (Efcrime) Prendre le défaut d’un mouvemerit,
d’utie attaque. Prendre l’ennemi dans le défaut de la parade;.
La parade du cercle ne couvre ni le dedans, ni le dehors,
8 c , par conféquent, n’eft pas bonne. IV . 733. a.
D e fau t . ( Hydrauliq. ) Dans la hauteur des jets - d’eau#
IV . 733. b.
DÉFAUT héréditaire. ( Manege ) IV . J ) ) - b.
D é fau t . (Vèn èÿ e) IV . 733. b.
D É F É C A T IO N , (Pharm.) dép uration d’un fuc de plante
ou de fruit; Comment fe font ces dépurations. La défécation
eft 'indifpenfable pour les fucs des fruits ; mais la .filtration
ou l’ébullition fufnt pour les fucs des plantes. Exception par
rapport à certaines plantes dont les fucs ne peuvent fe clarifier
que par défécation. IV . 733. b.
D É F E C T IF , terme de grammaire -, d'arithmétique 8c de
géométrie. IV . 733. é.
D éfectif. ( Gramm. ) Différence entre lés verbes défectifs
8c les anomaux» I. 487. a. Verbes latins dèfe&ifs. III;
880. b.
D é fe ct if . ( Géom. ) Hyperboles dèfeélives : elles font op-
pofées aux hyperboles redundantes. Démonftration de ces
hyperboles. IV . 733. b.
D É F EN D AN T , ( Fortifie. ) ou Fl a n q u a n t . C e qu’on
entend quand on dit que le flanc défend la courtine. IV;
73 4-/ -
DÉFENDEUR» (Jurifp.) L e défendeur doit être affigné
devant un juge. On laifle au défendeur etmie de l’exploit ;
b c . U doit lé préfenter à l’échéance de l’affignation. Quand
le demandeur ne comparoît pas , le ’ défendeur demandé
congé contre lui , b c . Lorfqu’il y a doute fur la demande *
on incline plutôt pour le défendeur. IV . 734. a. Voyeç DÉ-4
FENSES.
Défendeur b défaillant. IV . 734. a-
Défendeur b demandeur. IV . 734. a.
Défendeur au fond. IV . 734. b.
Défendeur en la forme. IV . 734. bi
Défendeur originaire en matière de garantie. IV . 734. b.
Défendeur ail principal. IV . 734. b.
Défendeur en taxe. IV . 734. b.
D E F EN D R E , Pr o té g e r , So u t en ir : différence entre
ces motSjJV. 734. b.
DéfcnaQj?, juflifier quelqu’un : différence entre ees mots;
IV . 734. b.
D é fen d r e , y è , ( Manege.) IV . 734. b.
D ÉFEN DS , ( Jurifp. ) . terme de coutume. Bois , terre,
vignes en défends. Banon b défends , dans là coutume de
Normandie. Difpofitions de ce titre dans cette coutume;
IV . 734. b.
D É F EN D U , P r o h ib é ; diffé rençe entre ces mots. IV .
mM W H I I
DÉFENSE de foi-même. ( Droit nat. ) C e droit eft une fuite
du foin de fe conferver. D e l’obligation de ménager la jufte
défenfe de foi-même dans l’état naturel & dans l’état civil»
Quelque injnfte que foit i’entreprife d’un agreffenr, la fo-
ciabilité nous oblige à l’épargnei*, fi on le p eu t, fans en recevoir
un préjudice confidérable. Mais quand la chofe eft impoffible
, il eft permis........de repouffer la force par la fo r c e ,
b c . IV . 73 5. a. La loi naturelle v a même plus loin ; elle
nous l’ordonne pofitivement. Mais, fi dans l’état naturel on
a droit de repoüffer le danger préfent dont on eft menacé,
l’état civil y met dés bornes. Quelles font: les feules cir-
conftanccs où il eft permis d’avoir recours aux voies de la
force. Le droit dé la défenfe de nous-mêmes ne ceffe pas
lorfque l’agreffeur qui veut nous ôter la v ie par violence
eft notre fiipérieur. Ibid. b. Nous pouvons nous défendre à
main armée, pour prévenir la perte de quelque membre de
notre côfps. La défenfe de l’honneur autorité pareillement
aux dernieres extrémités ; mais il faut bien fe garder de
placer l’honneur dans des objets fiâifs. D e la défenfe de fes
D D D d d d
i