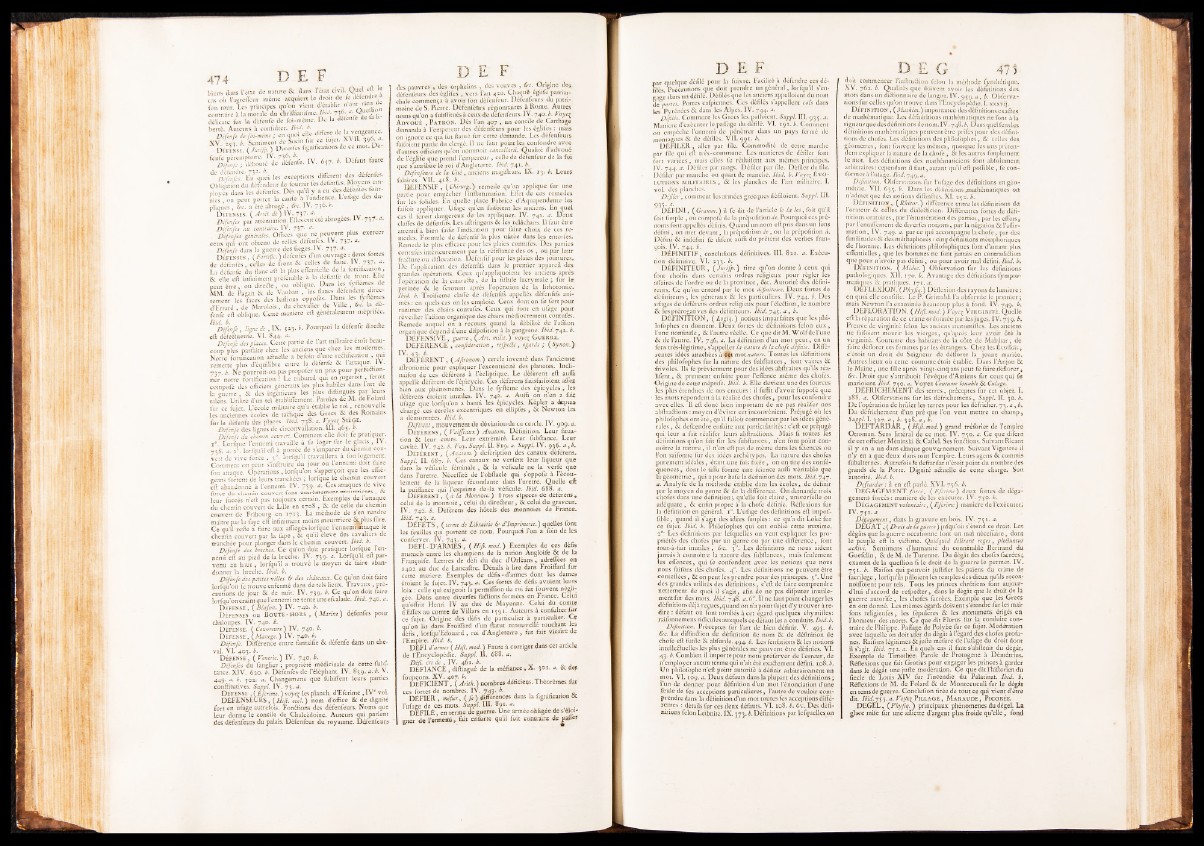
474 D E F
l i a » dans Vètat de nature & dans l’itat civil. Q u el eft 1*
cas où l’agrefleur même acquiert le droit de le derenar -
fon tour. Les principes qu'on vient d’établir n’ont nen.
contraire à la morale du chriûknifme. Ibid. 736. ^ Q j *• ..
délicate fur k dèfenfe de foi-même. D e la défenfe d é la i .
’ ‘S B S f l j diffère de la vengeance.
X V { s{ . b. Sentiment de^octn fur ce fujet. X V I I . 396. ».
DÉFENSE. ( Jurifp.) Diverlos i.gmltcanons de ce mot. De
IV . 657. *• D ifc u t fame
^ D d S r ^ qnoi les exceptions different des défenfes.
Obligation du détendeur de fournir les défenfes. Moyens employés
dans les défenfes. Dès qu’il y a eu des défenfes four-
nies on peut porter la caufe à l’audience. L ufage des dupliques
6-c. a été abrogé , 6*c. IV . 73 6 . b.
DÉFENSES. ( Arrêt de) IV . 737- a- TV
Défenfes par atténuation. Elles ont été abrogées. IV . 737.. •
Défenfes au contraire. IV . 737. a.
Défenfes générales. Offices que ne peuvent plus exercer
ceux qui ont obtenu de telles défenfes. IV . 737. a.
Défenfe dans la guerre des fieges. IV . 737. a.
D fffnses ( Fortifie. ) défenfes d un ouvrage : deux lortes
de défends / celles de L i t & celles de flanc. IV . 737- -•
La défenfe du flanc eft la plus effenuelle de la fortification,
& elle eft infiniment préférable à la defenfe de front. El e
peut être , ■ ou direéte, ou oblique. Dans les fyftemes de
MM. de Pagan & de Vauban , les flancs détendent direc-
tement les faces des ballions oppofis. Dans les fyftêtnes
d’Errard , de Marolois, du chevalier de V ille , 6-c. la dé-
fcnfe eft oblique. Cette maniéré eft généralement mépnfèe.
^ 'Défenfe , ligne de , IX. 523 .b . Pourquoi la défenfe directe
eft défedueufe. V I . 844. a. .
Défenfe des places. Cette partie de 1 art militaire etoit beau-
coup plus parfaite chez les anciens que citez 1 « modernes.
Notre fortffication aftuelle a befoin d’une r eM c an o n , qui
remette plus d'équilibre entre la défenfe & 1 attaque. IV .
737 . b. Ne pourroit-on pas propofer un prix pour perfectionner
notre fortification ? Le tribunal qui en jugeroit , feroit
compofé des officiers généraux les plus habiles dans 1 art de
la ouerre , 8c des ingénieurs les plus diftingués par leurs
tnlcns. Utilité d'un tel érabliffcment. Paroles de M. deFolard
fur ce fuiet. L’école militaire qu'a établie le r o i , renouvelle
le s anciennes écoles de radique des Grecs & des Romains
fur la défenfe des places. Ibid. 738. a. SlÉGE.
Défenfe des lignes de circonvallation. 111. 465. b.
Défenfe du chemin couvert. Comment elle doit fe pratiquer.
l ° . Lorfque l’ennemi travaille à fe loger fur le glacis , IV .
738. a. 2". lorfqu’il eft à portée de s’emparer du chemin couv
ert de v iv e force , 30. lorfqu’il travaillera à fon logement.
Comment on peut s’inftruire du jour où l’ennemi doit foire
fon attaque. Opérations, lorfqu’on s’apperçoit que les afüe-
geans fortent de leurs tranchées ; lorfque le chemin couvert
eft abandonné à l’ennemi. IV . 73 9. a. Ces attaques de viv e
force du chemin couvert font extrêmement meurtrières , &
leur fuccès n’eft pas toujours certain. Exemples de l’attaque
du chemin couvert de Lille en 1708 , & de celle du chemin
couvert de Fribourg en i 7 I 3- Fa méthode de s en rendre
maître par la fope eft infiniment moins meurtrière QLplus lure.
C e qu’il refte à foire aux afliégés lorfque l’ennemrottaque le
chemin couvert par la fope , & qu’il éleve des cavaliers de
tranchée pour plonger dans le chemin couvert. Ibid. b.
Défenfe des breches. C e qu’on doit praüquer lorfque 1 ennemi
eft au pied de la breche. IV . 739. a. Lorfquil eft parvenu
au h a u t , lorfqu’il a trouvé le moyen de faire abandonner
la breche. Ibid. b. . .
Défenfe des petites villes & des châteaux. C e qu’on doit faire
lorfqu’on fe trouve enfermé dans de tels lieux. T r a v a u x , précautions
de jour & de nuit. IV . 739. b. C e qu’on doit faire
lorfqu’on craint que l’ennemi ne tente une efcalade. Ibid. 740. a.
D éfense, ( Blafon. ) IV . 740. b.
D éfenses ou B o u t e - h o r s , ( Marine ) defenfes pour
chaloupes. IV . 740. b.
DÉFENSE, f Couvreurs') IV . 740. b.
D éfense, (Manege.) IV . 740. b.
Défenfe. Différence entre fontaifie 8c défenfe dans un cheval.
V I . 403. b.
DÉFENSE, ( Venerie. ) IV . 740. b.
Défenfes du fanglier ; propriété médicinale de cette fubf-
tance. X IV . 620. b. Défenfes de l’éléphant. IV . 839. a. b. V.
449. a. b. <502: a. Changemens que fubiffent leurs parties
conftitutives. Suppl. IV . 73. a.
D éfense , ( E [crime. ) voyeç les planch. d’Efcrime , I V e vol.
DÉFEN SEUR S, (Hifl. eccl.) nom d’office 8c de dignité
fort en ufoge autrefois. Fondions des défenfeurs. Noms que
leur donne le concile de Chalcédoine. Auteurs qui parlent
des défenfeurs du palais. Dèfenfeur du royaume. Défenfeurs
D E F
des pauvres , des orphelins , des veuves , &c. Origine des
défenfeurs des éslifes , vers l’an 420. Cliaquê églife patriar-
chale commença a avoir fon dèfenfeur. Défenfeurs du patrimoine
de S. Pierre. Défenfeurs régionnaires à Rome. Autres
noms qu’on a fubllitués à ceux de défenfeurs. IV . 740. b. Voye^
A d v o u é , P a t r o n . Dès l’an 407 , un concile de Carthage
demanda à l’empereur des défenfeurs pour les églifes : mais
on ignore ce qui fut ftatué fur cette demande. Les défenfeurs
foifoient partie du clergé. Il ne faut point les confondre avec
d’autres officiers qu’on nommoit cancellarii. Qualité d’advoué
de l’églife que prend l’empereur, celle de dèfenfeur de la fo i
que s’attribue le roi d’Angleterre. Ibid. 741 . b.
Défenfeurs de la Cité, anciens magiftrats. IX. 13. b. Leurs
falaires. V II . 418. b.
DÉFENSIF , ( Chirurg. ) remede qu’on applique fur une
partie pour empêcher l’inflammation. Effet de ces remedes
fur les folides. En quelle place Fabrice d’Aquapendente les
foifoit appliquer. Ufage qu’en foifoient les anciens. En quel
cas il feroit dangereux de les appliquer. IV . 741. a. Deux
claffes de défenfifs. Les aftringens & les relâchans. U fout être
attentif à bien faifir l’indication pour foire choix de ces remedes.
Formule de défenfif la plus ulitée dans les entorfes*
Remede le plus efficace pour les plaies coptufes. Des parties
contufes intérieurement par la réfiftance des os , ou par leur
fraéhirè ou diflocation. Défenfif pour les plaies des jointures.
D e l’application des défenfifs dans le premier appareil des
grandes opérations. Ceux qu’appliquoient les anciens après
Popération de la çatara&e, de la fiftule lacrymale ; fur le
perinée & le ferotum après Popération de la lithotomie.
Ibid. b. Troifieme claffe de défenfifs appellés défenfifs animés
: en quels cas on les emploie. Ceux dont on fe fert ppur
ranimer des chairs contufes. Ceux qui font en ufage pqur
réveiller l’aélion organique des chairs médiocrement contufes.
Remede auquel on a recours quand la débilité de l’aétion
organique dépend d’une dilpofition à la gangrené. Ibid. 742. b.
D É FEN S IV E , guerre, (A r t. rnilit.) v'oye[ GUERRE.
D É F É R EN C E , confidération , refpeils, égards ; ( Synon. )
IV . 43- b. ....................................
D É F É R EN T , ( Afironom. ) cercle inventé dans l’ancienne
aftronomie pour expliquer l’excentricité des planètes. Incli-
naifon de ces déférens à l’écliptique. Le déforent eft aufli
appellé déférent de l’épicycle. Ces déférens fotisfoifoient affez
bien aux phénomènes. Dans le fyftème des epicy c les , les
déférens étoient inutiles. IV . 742. a. Aufîi on n’en a foiz
ufage que lorfqu’on a banni les épicycles. Képler a depuis
changé ces cercles excentriques en ellipfes , 8c Newton les
1 a démontrées. Ibid. b.
Déférent, mouvement de déviation de ce cercle. IV . 909.«.
DÉFÉRENS, ( Faiffeaux) Anatom. Définition. Leur fitua-
tion 8c leur cours. Leur extrémité. Leur fubftance. Leur
cavité. IV . 742. b. Voy. Suppl. II. 8x9. a. Suppl. IV . 936. a , b.
D é fé r en t , ( Anatom. ) defeription des canaux déférens.
Suppl. II. 687. b. Ces canaux ne verfent leur liqueur que
dans la véficule féminale , & la veficule ne la verfe que
• dans l’uretre. Néceflité de l’obftacle qui s’oppofe à l’écoulement
de la liqueur fécondante dans l’uretre. Q u elle eft
la puiffance qui l’exprime de*la véficule. Ibid. 688. a.
D é f é r en t , l à la Monnoie. ) Trois efpeces de déférens\
celui de la monnoie, celui du directeur, Sc celui du graveur.
IV . 742. b. Déférens des hôtels des monnoies de France.
Ibid. 743. a.
D É F E T S , ( terme de Librairie 6* <TImprimerie. ) quelles font
les feuilles qui portent ce nom. Pourquoi l’on a foin de les
conferver. IV . 743. a.
D É F I -D ’A RM E S , ( Hifl. mod. ) Exemples de ces défis
mutuels entre les champions de la nation Angloife & de la
Françoife. Lettres de défi du duc d’Orléans , adreffées en
7402 au duc de Lancaftre. Détails à lire dans Froiffard fur
cette matière. Exemples de défis-d’armes dont les dames
étoient le fujet. IV . 743. a. Ce s fortes de défis av.oient leurs
loix : celle qui exigeoit la permiflion du roi fut fouvent négligée.
Défis entre diverfes foftions formées en France. Celui
qu’offrit Henri IV au duc de Mayenne. Celui du comte
d’Effex au comte de Villars en 1591. Auteurs à confulter fur
ce fujet. Origine des défis de particulier à particulier. C ç
qu’on lit dans Froiffard d’un ftatut renouvellé touchant les
défis , lorfqu’Edouard , roi d’Angleterre , fut fait vicaire de
l’Empire. Ibid. b. ' . ,
D É F I d’armes ( Hifl. mod.) Faute à corriger dans cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. II. 688. a.
Défi, cri de , IV . 461. b. ■
D EF IAN C E , diftingué de la méfiance, X. 301. a. 8c des
foupçons. X V . 407. b. '
D E F IC IE N T , ( Arith. ) nombres déficiens. Théorèmes fur
ces fortes de nombres. IV . 743. b.
DÉFIER , méfier, ( f e ) différences dans la lignification oC
l’ufage de ces mots. Suppl. III. 89x. a. .
I D É F IL É , en terme de guerre. Une armee obligée de s éloigner
de l’ennemi, foit enfbrte qu’il fuit contraint de gaffer
D E F
par quelque défilé pour la fuivre. Facilité à défendre ces défilés.
Précautions que doit prendre un général, lorfqu’il s’engage
dans un défilé. Défilés que les anciens appelloient du nom
de portes. Portes cafpiennes. Ce s défilés s’appellent cols dans
k s Pyrénées & dans les Alpes. IV . 744. a.
Défilés. Comment les Grecs les paffoient. Suppl. III. 935. <7.
Manière d’exécuter le paffage du défilé. V I. 192. b. Comment
on empêche l’ennemi de pénétrer dans un pays fermé de
montagnes & de défilés. V I I . 991. b.
D É F IL E R , aller par file. Commodité de cette marche 1
par file qui eft très-commune. Les maniérés de défiler font
fort v ar ié e s , mais elles fe réduifent aux mêmes principes.
IV : 744. a. Défiler par rangs. Défiler par file. Défiler de file.
Défiler par manche ou quart de manche. Ibid. b. Foyc{ Évolutions
militaires , & les planches de l’art militaire. I.
vol. des planches.
Défiler, comment les armées grecques défiloienr. Suppl. III.
S3M F IN I , (G™».«.) il fe dit de l'article fe h f a , f o i t qu’il
foit fimple , ou compofé de la prépofition de. Pourquoi ces prénoms
font appellés cféfinis. Quand un nom eft pris dans un fens
défini, on met devant, la prépofition de, ou la prépofition à.
Défini & indéfini fe difenc aufli du prétérit des verbes fran-
çois. IV . 744. b.
D É F IN IT IF , conclufions définitives. III. 821. a. Exécution
définitive. V I .-Z J Î , i.
D É F IN IT E U R , ( Jurifp. ) titre qu on donne a ceux qui
font choifis dans certains ordres religieux pour régler les
affaires de l’ordre ou de la province, & c . Autorité des défini-
teurs. C e qu’on entend par le mot définitoire. Deux fortes de
définiteurs ; les généraux & les particuliers. IV . 744. b. Des
ufoges de différais ordres religieux pour l’é le â io n , le nombre
& les prérogatives des définiteurs. Ibid. 745. a , b.
D É F IN IT IO N , ( Logiq. ) notions imparfaites que les phi-
lofophes en donnent. D eu x fortes de définitions félon e u x ,
l’une nominale, & l’autre réelle. C e que dit M. W o l f de l’une
& de l’autre. IV . 746. a. La définition d’un mot p eu t, en un
fens très-légitime, s’appeller la nature de la chofie définie. Différentes
idées attachées à é ft mot nature. Toutes les définitions
des philofophes fur la nature des fubftances, font vaines &
frivoles. Ils fe p réviennent pour des idées abftraites qu’ils réa-
lifent, & prennent enfuite ppur l’effence même des chofes.
Origine de cette méprife. Ibid. b. Elle devient une des fources
les plus étendues de nos erreurs : il fuffit d’avoir fuppofé que
les mots répondent à la réalité des chofes, pour les confondre
avec elles. Il eft donc bien important de ne pas réalifer nos
abftraâions : m oyen d’éviter cet inconvénient. Préjugé où les
philofophes ont été , qu’il folloit commencer par les idées générales
, oc defeendre enfuite aux particularités : c’eft ce préjugé
qui leur a fait réalifer leurs abftraâions. Mais fi toutes les
définitions qu’on foit fur les fubftances, n’en font point con-
noître la nature, il n’en eft pas de même dans les fciences où
l’on raifonne fur des idées archétypes. La nature des chofes
purement idéales, étant une fois f ix é e , on en tire des confé-
quences, dont le tiffu forme une fcience aufli véritable que
la géométrie, qui a pour bafe la définition des mots. Ibid. 747.
a. Analyfe de la méthode établie dans les écoles , de définir
par le m oyen du genre & de la différence. On demande trois
chofes dans une définition ; qu’elle foit claire, univerfelle ou
adéquate , & enfin propre a la chçfe définie. Réflexions fur
la définition en général. l° . L’ufoge des définitions eft impof-
fib le , quand il s’agit des idées fimples : ce qu’a dit Loke fur
ce fujet. Ibid. b. Philofophes qui ont oublié cette maxime.
a 9- Les définitions par lefquelles on veu t expliquer l‘es propriétés
des chofes par un genre ou par une différence, font
tout-à-foit inutiles , &c. 30. Les définitions ne nous aident
jamais à connoitre la nature des fubftances, mais feulement
les effences, qui fe confondent avec les notions que nous
nous foifons des chofes. 40. Les définitions ne peuvent être
conteftées, & on peut les prendre pour des principes. 50. Une
des grandes utilités des définitions, c’eft de foire comprendre
nettement de quoi il s’ag it, afin de ne pas difputer inutilement
fin: des mots. Ibid. 748. a. 6°. Il ne fout point changer les
définitions déjà reçues, quand on n’a point fujet d’y trouver à redire
: défaut où font tombés à cet égard quelques chymiftes:
raifonnemens ridicules auxquels ce défaut les a conduits. Ibid. b.
Définition. Préceptes fur l’art de bien définir. V . 493. b.
&c. La diftinélion de définition de nom & de définition de
chofe eft futile & abfurde. 494. b. Les fenfations & les notions
intelle&uelles les plus générales ne peuvent être définies. V I .
43. b. Combien il importe pour nous préferver de l’erreur, de
n’employer aucun terme qui n’ait été exaâement défini. ip § . b.
Un plulofophe n’eft point autorifé à définir arbitrairement uq
mot. V I . 109. a. Deux défauts dans la plupart des définitions ;
l’un dp donner pour définition d’un mot l ’énonciation d’une
feule de fes acceptions particulières, l’autre de vouloir comprendre
dans la définition d’un mot toutes fes acceptions différentes
: détails fur ces deux défauts. V I . 108. b. &c. Des définitions
félon Leibnitz. IX. 373. b. Définitions par lefquelles on
D E G 47 5
doit commencer l’inflruftion félon la méthode fynihétiquci,
X V . 762. b. Qualités que doivent avoir les définitions des
mots dans un diétiônnaire de langue. IV. 959. <*, b. O bferva1
tions fur celles qu’on trouve dans l’Encyclopédie. L xxxvij.
D é f in it io n , ( Mathém.) importance des définitions exaéles
de mathématique. Les définititions mathématiques ne font à la
rigueur que des définitions de nom. IV . 748. b. Dans quel fens les
définitions mathématiques peuvent être prifes pour des définb
rions de chofes. Les définitions des philofophes, & celles des.
géomètres * font fouvent les m êmes, quoique les uns prétendent
expliquer la nature de k c h o fe , oc les autres fimpleinent
le mot. Les définitions des mathématiciens font abfolument
arbitraires : cependant il fout, autant qu’il eft poffible, fe conformer
à l’ufage. Ibid. 749. a.
Définition. Obfervations fur l’ufoge des définitions en g éo-
métrie. V II . 635. b. Dans les définitions mathématiques on
n’admet que des notions diftinéles. XI. 2x2'. b.
D é f in it io n , ( Rhétor. ) différence entre les définitions da
l’orateur & celles du diale&icien. Différentes fortes de définitions
oratoires, par l’énumération des parties, par les effets*
par l’entaffement de diverfes notions, par la négation & l’affirmation
, IV . 749. a. par ce qui accompagne la chofe, par des
fimilitudes 8c des méthaphores : cinq définitions métaphoriques
de l’homme. Les définitions philofophiques font d’autant plus
effentielles, que les hommes ne font jamais en contradiaion
que pour 11’avoir pas défini, ou pour avoir mal défini. Ibid, b-,
DÉFINITION; ( Médec. ) Oblervation fur les définitions
pathologiques. XII. 170. b. Avantage des définitions fympto-
matiques 8c pratiques. 17 1. a.
D ÉFLEXION . ( Plryfiq.) Déflexion des rayons de lumière :
en quoi elle confiftc. Le P. Grimaldi l’a obfervèe le premier ;
mais Newton l’a examinée beaucoup plus à fond. IV . 749. b.
D E F LO R A T IO N . (Hifl. mod.) Voycç V ir g in it é . Quelle
eft la réparation de ce crime ordonnée par les juges. IV . 739. b.
Preuve de virginité félon les anciens anatomiftes. Les anciens
ne foifoient mourir les v ierges, qu’après leur avoir ôté la
virginité. Coutume des habitans de la côte de Malabar, de
foire déflorer ces femmes par les étrangers. Chez les Écoffois,
ç ’étoit nn droit du Seigneur de déflorer la jeune mariée.
Autres lieux où cette coutume étoit établie. Dans l’Anjou 8c
le Maine, une fille après vingt-cinq ans peut fe foire.déflorer *
6fc. Droit que s’attribuoit l’évêque d’Amiens fur ceux qui fe
marioient. Ibid. 750. a. V o y e z Coutume louable 8c Culage.
D É FRICHEM ENT des terres, préceptes fur cet objet. L
188. a. Obfervations fur les défrichemens, Suppl. II. 30. b.
D e l’opération de brûler les terrés pour les défricher. 73. a , b.
D u défrichement d’un pré que l’on veut mettre en champ *
Suppl. I .3 27. a , b. 328. a , b.
D E F T A R D A R , (Hifl.mod.) grand tréforier de l’enlpirè
Ottoman. Sens littéral de ce mot. IV . 750. a. C e que difent
de cet officier Méninski 8c Caftel. Ses fonctions. Suivant Ricant
il y en a un dans chaque gouvernement. Suivant Vigenere il
n’y en a que deux dans tout l’empire. Leurs agens & commis
fubalternes. Autrefois le deftardar n’étoit point du nombre des
grands de la Porte. Dignité aéhielle de cette charge* Son
autorité. Ibid. b.
Deftardar : il en eft parlé. XVI.- 75 6. b.
D E G A G EM E N T forcé, (Efcrime) deux fortes de déga-
gemens forcés : maniéré de les exécuter. IV . 750. b.
D égag em en t volontaire, (Efcrime) maniéré de l’exécuter,’
I V . 7 f i . t f
Dégagement, dans la gravure en bois. IV . 7 5 1 . a.
D E G A T j (Droit de la guerre) jufqu’où s’étend ce droit. Les
dégâts que la guerre occatjonne font un mal néceffaire, dont
le peuple eft la viétime. Quidquid délirant reges, pleEluntur
achivi. Sèntimens d’humanité du connétable Bertrand du
Guefclin , 8c de M . d eTurenne. Du dégât des chofes facrées ;
examen de la queftion fi le droit de la guerre le permet. IV .
7 5 1 . b. Raifon qui pouvoit juftifier les païens du crime de
focrilege, lorfqu’ils pilloient les temples des dieux qu’ils recon-
noiffoient pour tels. To us les princes chrétiens font aujourd’hui
d’accord de refpeéter, dans le dégât que le droit de H
guerre autorifé, les chofes facrées. Exemple que les Grecs
en ont donné. Les mêmes égards doivent s’étendre fur les mai?
fons religieufes, les fépulcres 8c les monumens érigés en
l’honneur des njorts. C e que dit Florus fur la conduite contraire
de Philippe. Paffage de Polybe fur ce fujet. Modération
avec laquelle on doit uler du dégât à l’égard des chofes profanes.
Raifons légitimes 8c jufte mefure de l’ufoge du droit dont
il s’agit. Ibid. 752. a. En quels cas il fouts’abftenir du dégât*
Exemple de Timothée. Parole de Protogene à Démétrius.
Réflexions que foit Grotius pour engager lès princes à garder
dans le dégât une jùfte modération. C e que dit l’hiftorien du
fiecle de Louis X IV fur l’incendie du Palatinat. Ibid. b.
Réflexions de M. de Folard 8c de MontecucuÙ fur le dégâù
en teins de guerre. Conclufion tirée de tout ce qui vient d’être
dit. Ibid. 753. tf. Foyer PlLLAGE, MARAUDE, PlCORÉE.
D E G E L , (Phy fiq.) principaux phénomènes du dégel. La
glace rnife fur une afiiette d’argent plus froide qu’e lle , fond