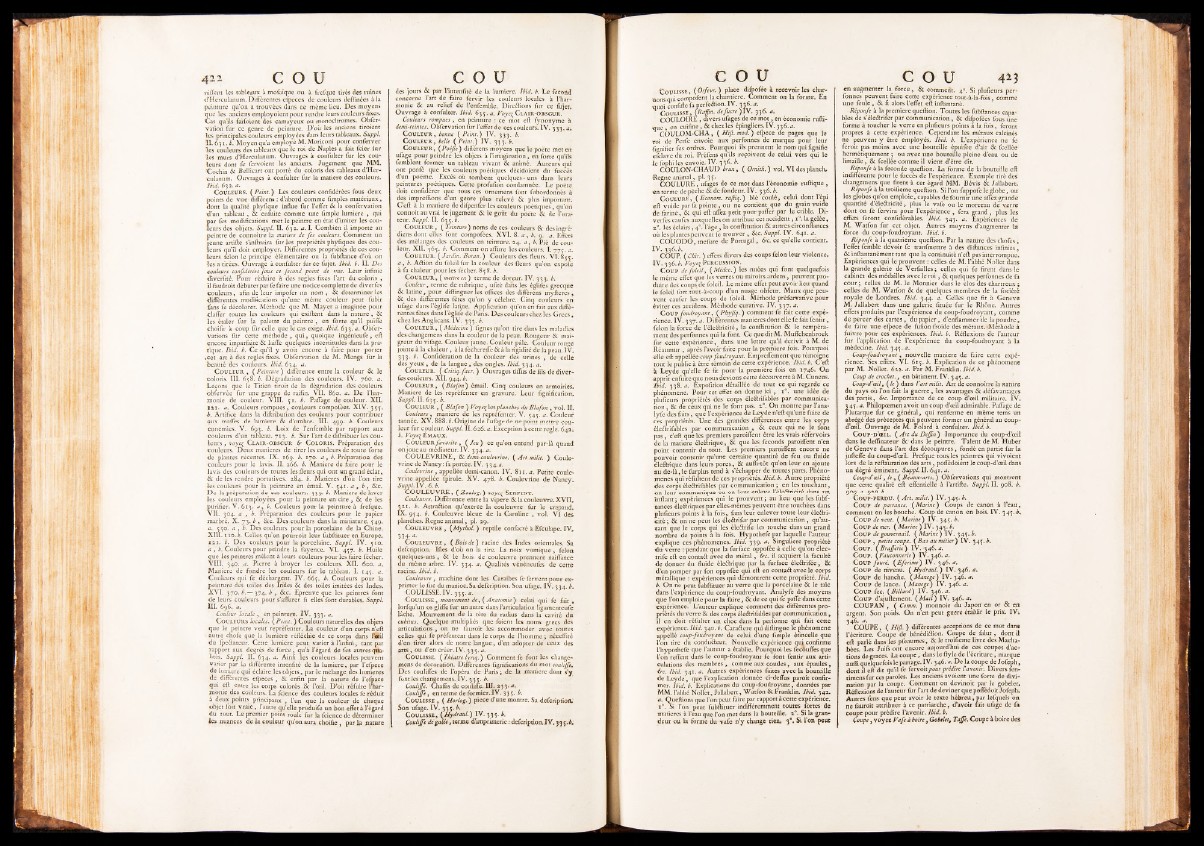
4 2 2 C O U c o u
Tiiflent les tableaux à moûiïque ou à frefque tirés des ruines
d’Herculanum. D ifférentes efpéces de couleurs deftinées à la
peinture qu’on a trouvées dans ce même lieu. D es moyens
que les anciens employoient pour rendre leurs couleurs fixes.
Cas qu’ils faifoient des camayeux ou monochromes. Obfer-
varion fur ce genre de peinture. D ’où les anciens tiroient
les principales couleurs employées dans leurs tableaux. Suppl.
II. 631 . Z>. Moyen qu’a employé M . M oriconi pour conferver
le s couleurs des tableaux que le roi de Naples a fait feier fur
le s murs d’Herculanum. Ouvrages à confulter fur les couleurs
dont fe fervoient les anciens. Jugement que MM.
Co chin & Bellicart ont porté du coloris des tableaux d’Herculanum.
Ouvrages à confulter fur la matière des couleurs.
Ibid. 632.«.
C o uleurs. ( Peint. ) Les couleurs confidérées fous deux
points de vue-différens : d’abord comme {impies matériaux,
dont la qualité phyfique influe fur l’effet & la confervation
d ’un tableau, oc enluite comme une fimple lumière , qui
Îiar fes modifications met le peintre en état d’imiter les cou-
eurs des objets. Suppl. II. 63 2. a. I. Combien il importe au
peintre de connoître la matière de fis couleurs. Comment un
jeune artifte s’inftruira fur les propriétés phyfiques des couleurs
qu’il doit employer. Différentes propriétés de ces couleurs
félon le principe élémentaire ou la fubftance d’où on
les a tirées. Ouvrage à confulter fur c e fujet. Ibid. b. II. Des
couleurs confidérées fous ce fécond point de vue. Leur infinie
diverfité. Pour réduire à des réglés fixes l ’art du coloris ,
il faudroit débuter par fe faire une notice complette de diverfes
couleurs, afin de leur impofer un nom , oc déterminer les
différentes modifications qu’une même couleur peut fubir
fans fe décolorer. Méthode que M. Mayer a imaginée pour
d a lle r toutes les couleurs qui exiffent dans la na ture, &
les étaler fur la palette du peintre , en forte qu’il puiffe
choifir à coup fur celle que le cas exige. Ibid. 633. a. Obfer-
vations fur cette méthode , q u i, quoique ingénieufe, eft
encore imparfaite & laiffe quelques incertitudes dans la pratique.
Ibid. b. C e qu’il y avoit encore à faire pour porter
»cet art à des réglés fixes. Obfervation de M. Mengs fur la
beauté des couleurs. Ibid. 634. a.
C o u l eu r , ( Peinture ) différence entre la couleur & le
Coloris. III. 638. b. Dégradation des couleurs. IV . 760. a.
Leçons que le Titien tiroit de la dégradation des couleurs
«bfervèe fur une grappe de raifin. VII. 860. a. D e l’harmonie
de couleur. VII I. 31. b. PafTage de couleur. XII.
12 1 . a. Couleurs rompues, couleurs compofées. X IV . 333.
b. Artifice dans la diftribution des couleurs pour contribuer
aux maffes de lumière & d’ombre. III. 499. b. Couleurs
ennemies. V . 693. b. Loix de l’enfemble par rapport aux
couleurs d’un tableau. 713. b. Sur l’art de diffribuer les couleurs
, voye^ C l a ir -o b scu r & C o lo r is . Préparation des
couleurs. D eu x maniérés de tirer les couleurs de toute forte
de plantes récentes. IX. 169. b. 170. a, A Préparation des
couleurs pour le lavis. II. 266. b. Maniéré de faire pour le
lavis des couleurs de toutes les fleurs qui ont un grand éclat,
& de les rendre portatives. 284. b. Matières d’où l ’on tire
les couleurs pour la peinture en émail. V . 341. a , b, &c.
D e la préparation de ces couleurs. 339. b. Maniéré de laver
les couleurs employées pour la peinture en cire , & de les
purifier. V . 613. a , b. Couleurs pour la peinture à frefque.
V I I . 304. a , b. Préparation des couleurs pour le papier
marbré. X. 73. b , & c. D es couleurs dans la miniature. 349.
a. 330. a , b. Des couleurs pour la porcelaine de la Chine.
X III. 1 10. b. Celles qu’on pourroit leur fubftituer en Europe.
12 1 . b. Des couleurs pour la porcelaine. Suppl. IV . 310.
a , ' é. Couleurs pour peindre la fayence. V I . 437. b. Huile
que les peintres mêlent à leurs couleurs pour les faire fécher.
V I I I . 340. a. Pierre à broyer les couleurs. XII. 600. a.
Manière de fondre les couleurs fur le tableau. I. 143. a.
Couleurs qui fe déchargent. IV . 663. b. Couleurs pour la
peinture des toiles des Indes 8c des toiles imitées des Indes.
X V I . 370. b. t— 374. b , 8cc. Epreuve que les peintres font
de leurs couleurs pour s’affurer fi elles font durables. Suppl.
III. 696. a.
Couleur locale , . en peinture. IV . 333. a.
C o uleurs locales. ( Peint. ) Couleurs naturelles des objets
que le peintre veut repréfenter. La couleur d’un corps n’eft
■ autre chofe que la lumière réfléchie de ce corps dans l’üfeil
du fpeélateur. Cette lumière peijt varier à l ’infini, tant par
rapport aux degrés de fo r c e , qu’à l’égard de fes autres qualités.
Suppl. 11. 634. a. Ainfi -les couleurs locales peuvent
varier par la différente intenfité de la lumière, par l’efpece
de lumière qui éclaire les objets , par le mélange des lumières
de différentes efpeces, 8c enfin par la nature de i’efpace
qui pfi entre les corps colorés 8c l’oeil. D ’où réfulte l’harmonie
des couleurs. La fcience des couleurs locales fe réduit
à deux points principaux , l’un que la couleur de chaque
objet foit v r a ie , l’autre qu’elle produife un bon effet à l’égard
du tout. L e p remier point roule fur la fcience de déterminer
les nuances de la couleur qu’on aura choifie , par la nature
des jours 8c par l’intenfitè de la lumière. Ibid. b. Le feCortd
concerne l’art de faire fervir les couleurs locales à l’harmonie
8c au relief de l’enfemble. Directions fur ce fujet»
Ouvrage à confulter. Ibid. 633. a. Voye{ CLAIR-OBSCUR.
Couleurs rompues, en peinture : ce mot eft fynonyme à
demi-teintes. Obfervation lur l’effet de ces couleurs. IV . 333. a.
C o u l e u r , bonne (Peint.) IV . 333» b.
C o u l e u r , belle (Peint.) IV . 333. b.
C o u l eu r , (Poéfie) différens moyens que le poète met en
ufage pour peindre les objets à l’imagination, en forte qu’ils
femblent former un tableau vivant oc animé. Auteurs qui
ont penfé que les couleurs poétiques décidoient du fuccès
d’un poème. Excès où tombent quelques-uns dans leurs
peintures poétiques. Cette profufion condamnée. L e poète
doit confidérer que tous ces omemens font fubordonnés à
des impreflions d’un gehre plus relevé 8c plus important.
C ’eft à la maniéré de difpenfer les couleurs poétiques, qu’on
connoît au v rai le jugement 8c le goût du poète 8c de l’orateur.
Suppl. II. 633.b.
C ouleu r , ( Teinture ) noms de ces- couleurs 8c des ingré»
diens dont elles font compofées. X V I . S. a, b. 9. a. Effets
des mélanges des coideurs en teinture. 24. a, b. Pié de couleur.
XII. 363. b. Comment on affure les couleurs. I. 773. a.
C o u l eu r . ( Jardin. Botan. ) Couleurs des fleurs. V I . 833.
a, b. Aélion du foleil fur la couleur des fleurs qu’on expofe
à fa chaleur pour les fécher. 838. b.
C o u l eu r , ( mettre en) terme de doreur. IV . 333 .b.
Couleur, terme de rubrique, ufité dahs les églifes grecque
8c latine, pour diftinguer les offices des différens myfteres,
8c des differentes fêtes qu’on y célébré. Cinq couleurs en
ufage dans l’églife latipe. Application qu’on en fait aux différentes
fêtes dans l’églife de Paris. Des couleurs chez les G rec s ,
chez les Anglicans. IV . 333 .b.
C o uleu r , ( Médecine ) fignes qu’on tire dans les maladies
des changemens dans la couleur de la peau. Rougeur 8c maigreur
du v ifage. Couleur jaune. Couleur pâle. Couleur rouge
jointe à la chaleur, à la féchereffe 8c à la rigidité de la peau. IV .
333. b. Confidération de la couleur des urines , de celle
des y e u x , de la langue, des ongles. Ibid. 334. a.
C o uleu r . ( Critiq.facr. ) Ouvrages tiffus de fils de d iverfes
couleurs. XII. 944 .b.
C o u l eu r , (BlaJ'on) émail. Cinq couleurs en armoiries.
Maniéré de les repréfenter en gravure. Leur fignification, Suppl. H. 633. b.
COULEUR , ( B la fin ) Voyeç les planches du Blafin , vol. II.
Couleurs, maniéré de les repréfenter. V . 343. a. Couleur
tannée. X V . 888. b. Origine de l’ufage de ne point mettre couleur
fur couleur. Suppl. I I. 626. a. Exception à cette réglé. 642.
b. VoyeftiMAUX.
C ouleu r favorite, (Jeu) ce qu’on entend par-là quand
on joue au médiateur. IV . 334. a.
CO U L E V R IN E , 8c. demi-coulevrine. (Artmilit. ) Coule-
vrine de Nancy: fa portée. IV . 3 3 4. a.
Coulevrine , appellée demi-canon. IV . 811. a. Petite coule-
vrine appellée fpirole. X V . 478. b. Coulevrine de Nancy.
Suppi. r v . 6. b.
C O U L E U V R E , ( Zoolog.) voyeç Serpent.
Couleuvre. Différence entre la vipere 8c la couleuvre. X V I I .
321. b. Attraftion qu’exerce la couleuvre fur le crapaud.
IX. 934. b. Cou leuvre bleue de la Caroline , vol. V I des
planches. Régné animal, pl. 29.
C o u leu v re , (Mythol. ) reptile confacré à Efculape. IV .
m i W È È B
C o u l e u v r e , (Boisde) racine des Indes orientales. Sa
defeription. Ifles d’où on la tire. La noix vomique, félon
quelques-uns, 8c le bois de couleuvre prennent naiflance
du même arbre. IV . 334. a. Qualités vénéneufes de cette
racine. Ibid. b.
Couleuvre , machine dont les Caraïbes fe fervent pour exprimer
le fu c du manioc. Sa defeription. Son ufage. IV . 334. b.
COULISSE. IV . 335. a.
COULISSE, mouvement de, (Anatomie) .-celui qui fe fa i t ,
lorfqu’un os gliffe fur un autre dans l’articulation ligamenteufe
lâche. Mouvement de la tête du radius dans la cavité du
cubitus. Quelque multipliés que foient les noms grecs des
articulations , on ne fauroit les accommoder avec toutes
celles qui fe préfentent dans le corps de l’homme : néceflité
d’en tirer alors de notre langue, d’en adopter de ceux des
arts , ou d’en c réer.IV. 333.a.
C oulisse. ( Théâtre lyriq. ) Comment fe font les changemens
de décoration. Différentes lignifications du mot couliffe.
D e s couliffes de l’opéra de Paris; de. la maniéré dont s’y
font les changemens. IV , 3 3 3, b.
Couliffe. Chaflis de couliffe. HL 233. a.
Couliffe, en terme de fermier. IV . 333. b.
C o ulis se , ( Horlog. ) pièce d’une montre. Sa defeription.'
Son ufage. IV . 333. b.
C o u l is se , l Hydraul.) IV . 333. b.
Çoulijfc degalée, terme d’imprimerie : d efeription,IV. 335.£,
C O U
C oulisse , ( Orfivr. ) place difoofée à recevoir les charbons
qui compofent la charnière. Comment on la forme. En
«uoi confifte fa perfeRion. IV . 336. a.
- Coulisse, (Raffut. defucre)ÎV. 336. a.
CO ULOIR E , divers ufages de c e m o t , en économie rüfti-
w ue , en cuifine, & chez les épingliers. IV . 336. a.
C O U L OM -C H A , ( Hifi. mod. ) efpece de pages que le
roi de Perfe envoie aux perfonnes de marque pour leur
fignifier fes ordres. Pourquoi ils prennent le nom qui fignifie
eiclave du roi. Préfens qu’ils reçoivent de celui vers qui le
le fophi les envoie; IV . 3 36. b.
CO U LO N -CH A U D brun, ( Omtth. ) vo l. V I des planch.
Régné animal, pl. 33*
C O U L U R E , ufages de ce mot dans l’économie ruftique ,
«n terme de pêche & de fondeur. IV . 3 3 6. b.
C o u l u r e , (Econom. ruftiq.) blé cou lé , celui dont l’épi
eft vuide par fa pointe, ou ne contient que du grain vuide
de farine, 8c qui eft affez petit pour parier par le crible. D iverfes
caufes auxquelles on attribue cet accident , i° . la g elée,
20. les éclairs, 40. l’â g e , la conftitution & autres circonffances
où les plantes peuvent fe trouver , 8cc, Suppl. IV . 641. a.
C O U O D O , mefure de Portugal, Grc. ce qu’elle contient.
IV . 336. é. ■ I
CO U P . ( Chir. ) effets divers des coups félon leur violence»
IV . 336. b. Voyez P ercus s io n.
C o u p de foleil, (Médec.) les nuées qui font quelquefois
le même effet que les v erres o u miroirs ardens, peuvent produire
dei coups, de foleil. Le même effet peut avoir lieu quand
le foleil fort tout-à-coup d’un nuage obfcur. Maux que peuven
t caufer les coups de foleil. Méthode préfervative pour
éviter ces accidens. Méthode curative. IV . 337 .a.
C o u p foudroyant, ( Phyfiq. ) comment f e fait cette expérience.
IV . 3 37. a. Différentes maniérés dont elle.fe fait fentir,
félon la force de l’éleâ ricité , la conftitution & le tempérament
des perfonnes qui la font. C e que dit M. Muflchenbroek
fur cette expérience, dans une lettre qu’il écrivit à M. de
Réaumur , après l’avoir faite pour la première fois. Pourquoi
elle eft appellée coup foudroyant. Empreffement que témoigne
tout le public à être témoin de cette expérience. Ibid. b. (/eft
à Leyde quelle fe fit pour la première fois en 1746. On
apprit enfuite que nous devions cette découverte à M. Cuneus.
Ibid. 338. a. Expofirion détaillée de tout ce qui regarde ce
phénomène. Pour cet effet on donne i c i , i° . une idée de
plufieurs propriétés des corps éleârifables par communication
, 8c de ceux qui ne le font pas. 20. O n montre par l ’ana-
ly fe des faits, que l’expérience de L e yde n’eft qu’une fuite de
ces propriétés. Une des grandes différences entre les corps
éleétrifables par communication , 8c ceux qui ne le font
p a s , c’eft que les premiers paroiflent être les vrais réfervoirs
de la matière éleélrique, 8c que les féconds paroiflent n’en
point contenir du tout. Les premiers paroiflent encore ne
pouvoir contenir qu’une certaine quantité de feu ou fluide
éleftrique dans leurs pores, 8c aufli-tôt qu’on leur en ajoute
au d e -là ,le furplus tend à s’échapper de toutes parts. Phénomènes
qui réfultent de ces propriétés. Ibid. b. Autre propriété
des corps éle&rifables par communication ; en les touchant,
on leur communique ou on leur erileve l’éleétricité dans un
înftant ; expériences qui le prouvent ; au lieu que les fubf-
tances éleftriques par elles-mêmes peuvent être touchées dans
plufieurs points à la fo is, fans leur enlever toute leur électricité
; 8c on ne peut les éleétrifer par communication, qu’au-
tant que le corps qui les éleétrife les touche dans un grand
nombre de points à la fois. Hypothefe par laquelle l’auteur
explique ces phénomènes. Ibid. 339. a. Singulière propriété
d u verre : pendant que la furface oppofée à celle qu’on élec-
trife eft en contaét avec du mé tal, Grc. il acquiert la faculté
de donner du fluide éleélrique par la furface éleétrifée, 8c
d’en pomper, par fon oppofée qui eft en contaét avec le corps
métallique : expériences qui démontrent cette propriété. Ibid,
b. On ne peut fubftituer au verre que la porcelaine 8c le talc
dans l’expérience du coup-foudroyant. Anàly fe des moyens
que l’on emploie pour la faire, 8c de ce qui fe pafle dans cette
expérience. L’auteur explique comment des différentes propriétés
du verre 8c des corps éleétrifables par communication ,
il en doit réfulter un choc dans la perlbnne qui fait cette
expérience. Ibid. 340. b. Caraétere qui diftingue le phénomène
appellé coup-foudroyant de celui d’une fimple étincelle que
l ’on tire du conduéteur. Nouvelle expérience qui confirme
l’hypothefe que l’auteur a établie. Pourquoi les fecouffes que
l’on reffent dans le coup-foudroyant fe font fentir aux articulations
des membres ,, comme aux coudes, aux épaules,
&c. Ibid. 341. a. Autres expériences faites avec la bouteille
de L e y d e , que l’explication donnée ci-deflus paroît confirmer.
Ibid. b. Explications du coup-foudroyant, données par
MM. l’abbé N o lle t, Jallabert, Watfon 8c Franklin. Ibid. 342.
a. Queftions que l’on peut faire par rapport à cette expérience.
i° . Si l’on peut fubftituer indifféremment toutes fortes de
matières à l’eau que l’on met dans la bouteille. 20. Si la grandeur
ou la forme du vafe n’y change rien. 3°. Si l’on peut
C O U 4*3
en augmenter la fo r c e , 8c commeftt. 40. & plufieurs per-
fonnes peuvent faire cette expérience tout-à-la-fois comme
une feu le , 8c fi alors l’effet eft inftantané.
Réponfi à la première queftion. Toutes les fubftances capables
de s’élcélriler par communication, 8c difpofées fous une
ferme à toucher le verre en plufieurs points à la fo is , feront
propres à cette expérience. Cependant les métaux calcinés
ne peuvent y être employés. Ibid. b. L’expérience ne fe
feroit pas moins avec une bouteille épuifée d’air 8c fcellée
hermétiquement ; ou avec une bouteille pleine d’eau ou de
limaille, 8c fcellée comme il vient d’être dit.
Réponfi à la fécondé queftion. La forme de la bouteille eft
indifférente pour le fuccès de l’expérience. Exemple tiré des
Changemens que firent à cet égard MM. Bévis 8c Jallabert.
Réponfi à la troifieme queftion. Si l’on fnppofe le g lo b e , ou
les globes qu’on emploie, capables de fournir une affez grande
quantité d’éleélricité, plus le vafe ou le morceau de verre
dont on fe fervira pour l’expérience , fera grand, plus les
effets feront confidérables. Ibid. 343. a. Expériences de
M. Watfon fur cet objet. Autres moyens d’augmenter la
force du coup-foudroyant. Ibid. b.
Réponfi à la quatrième queftion. Par la nature des chofes ,
l’effet femble devoir fe tranfmettre à des diftances infinies,
8c inftantanément tant que la continuité n’eft pas interrompue»
Expériences qui le prouvent : celles de M. l’abbé Nollet dans
la grande galerie ae Verfailles; celles qui fe firent dans le
cabinet des médailles a vec le r o i , 8c quelques perfonnes de fa
cour ; celles de M. le Monnier dans le clos des chartreux ;
celles de M. Watfon 8c de quelques membres de la fociété
royale de Londres. Ibid. 344. a. Celles que fit à Geneve
M. Jallabert dans une galerie, fituée fur le Rhône. Autres
effets produits par l’expérience du coup-foudroyant, comme
de percer des ca rte s , du p apier, d’enflammer de la poudre,
de faire une efpece de fufion froide des métaux.«Méthode à
fuivre pour ces expériences. Ibid. b. Réflexions de l'auteur
fur l’application de l’expérience du coup-foudroyant à la
médecine. Ibid. 343. fl.
Coup-foudroyant, nouvelle maniéré de faire cette expérience.
Ses effets. V I . 613. b. Explication de ce phénomène
par M. Nollet. 622. a. Par M. Franklin. Ibid, b.
Coup de crochet.3 en bâtiment. IV . 343. a.
Coup-d'cùl, (le) dans Vart milit. A r t de connoître la nature
du pays où l ’on fait la gu erre , les avantages 8c défavantages
des partis, 6*c. Importance de ce coup d'oe il militaire. IV .
343. a. Philopoemen avoit un coup d’oeil admirable. Paffage de
Plutarque fur ce général, qui renferme en même tems un
abrégé des préceptes qui peuvent former un général au coup-
d’oeiL Ouvrage de M. Folard à confulter. Ibid. b.
CoUP-D’<EIL. ( Art du DeJJin ) Importance du coup-d’oeil
dans le deflinateur 8c dans le peintre. Talent de M. Huber
de Geneve dans l’art des découpures, fondé en partie fur la
juftefle du coup-d’oeil. Prefque tous les peintres qui vivoient
lors de la reftauration des arts, poffédoient le coup-d’oeil dans
un dégré éminent. Suppl. U . 641. a.
Coup-d'ail, le, ( Beaux-arts. ) Obier varions qui montrent
que cette qualité eft eflentielle à l’artifte. Suppl. II. 908. b.
909. a. 920. b.
C o u p -per d u. (Art. milit.) I V . 343.b.
COUP de partance. (Marine) Coups de canon à l’eau,
comment on les bouche. Coup de canon en bois. IV . 343. b,
COUP de vent. (Marine) IV . 343. b.
C o u p de mer. ( Marine ) IV . 343. b.
, C o u p de gouvernail. (Marine) I V . 343. b.
C o u p , petits coups. ( Bas au métier ) IV . 343. b.
COUP. (Brafferie ) I V . -346. fl.
COUP. (Fauconnerie) IV . 346. a.
COUP fouré. (Efirime) IV . 346. a.
C o u p de niveau. ( Hydraul. ) IV . 346. fl.
■ Co u p de hanche. (Maneee) IV . 346. a»
C o u p de lance. (Maneee) IV . 346. a.
C o u p fec. ( Billard) IV . 346. a.
C o u p d’ajuftement. (Mail) IV . 346. a.
CO U P A N , ( Comm. ) monnoie du Japon1 en or 8c en
argent. Son poids. O n n’en peut guere établir le prix. IV .
346. fl.
C O U P E , •( Hifi. ) différentes acceptions de ce mot dan*
l’écriture. Coupe de bénédiérion. Coupe de fa lu t , dont il
eft parlé dans fes pfeaumes, & l e troifieme livre des Macha-
bées. Les Juifs ont encore aujourd’hui de ces coupes d’actions
de grâces. La c oupe, dans le û yle de l’é criture, marque
auffi quelquefois 1e partage. IV . 3 46. a. D e la coupe de Jofeph,
dont il eft dit qu’il fe fervoit pour prédire C avenir. D ivers ien-
timens fur ces paroles. Les anciens avoient une-forte de divination
par la coupe. Comment on devinoit par le gobelet.
Réflexions de l’auteur fur l’art de deviner que peffédoit Jofeph.
Autres fens que peut avoir le texte héb reu, par lefquels on
ne fauroit attribuer à ce patriarche, d’avoir fait ufage de fa-
coupe pour prédire l’avenir. Ibid. b.
Coupe, v o ye z Vafe d boire, Gobelets Taffe, Coupe à boire des