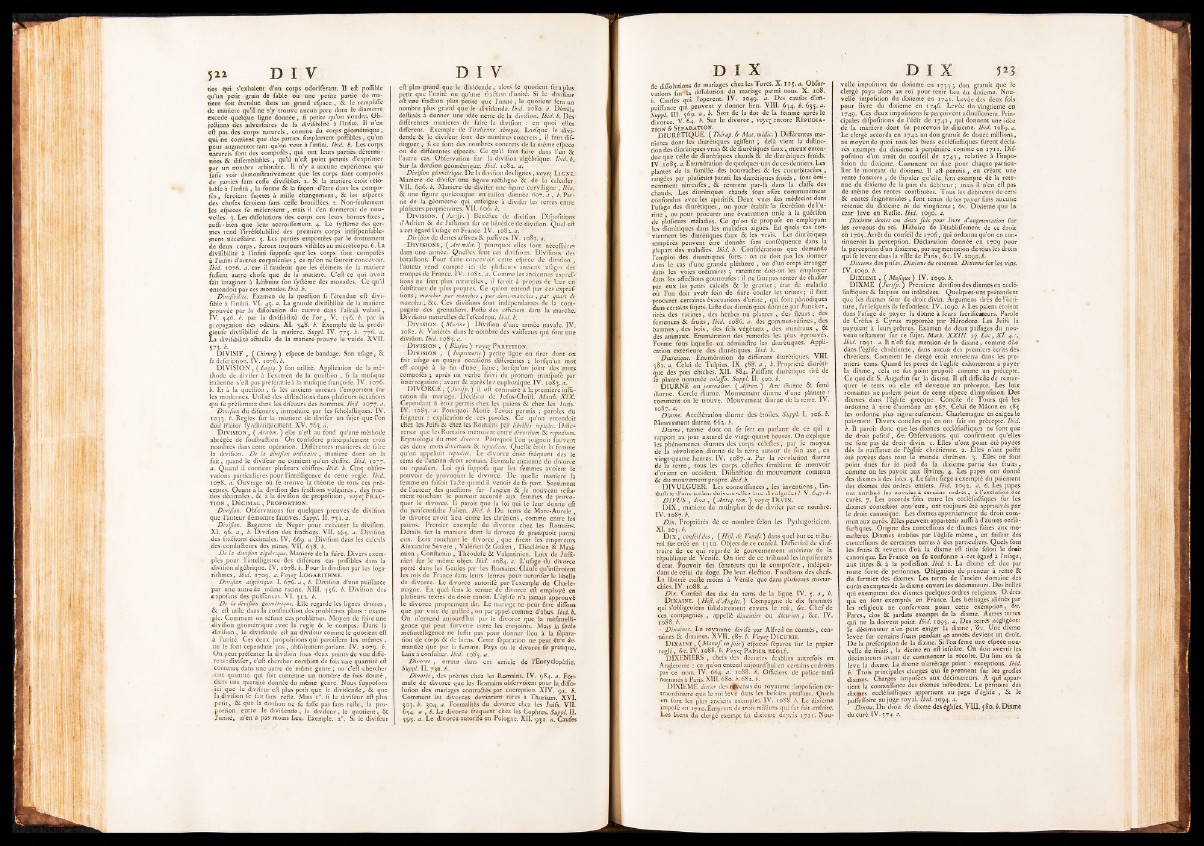
512 D I V D I V
ties qui s’exhalait d’un corps odoriférant. Il eft poflible
qu'un petit grain de fable ou une petite partie de matière
fo it étendue dans un , grand efpace , 8c le rempliffe
de maniéré qu’il ne s’y trouve aucun pore dont le diamètre
excédé quelque ligne donnée, fi petite qu’on voudra. O b jections
des adversaires de la divifibilité à l ’infini. Il n en
eft pas des corps naturels >, comme du corps géométrique,
qui ne contient que des parties Amplement poflîbles , qu on
peut augmenter tant qu’on veut à 1 infini. Ibid. b. Les corps
naturels font des compofés, qui ont leurs parties déterminées
8c diffemblables , qu’il n’eft point permis d’exprimer
par un nombre arbitraire. Il n’y a aucune expérience qui
faffe voir démonftrativement que les corps font compofés
de parties faits ceffe divifibles. i . Si la matière étoit rélb-
Iuble à l’in fini, la forme & la façon {d’ètre dans les compofés
, feroient fujetes à mille changemens, 8c les efpeces
des chofés feroient fans ceffe brouillées. 2. Non-feulement
les efpeces fe mèleroienr, niais il s’en formeroit de nouvelles.
3. Les diffolutions des corps ont leurs bornes fixes ,
aufli-bien.qu e leur accroiffement. 4. Le fyftême des germes
rend L’irrèfolubilité des premiers corps indifpenfable-
ment néceffaire. 3. Les parties emportées par le frottement
de deux corps, feront toujours vifibles au microfcope. 6. La
divifibilité à l’infini fiippofe que les corps font compofés
à l’infini d’autres corpufcules ; ce qu’on ne fauroit concevoir.
Ibid. 1076. a. car il faudroit que les élémens de la matière
fuffent autre chofe que de la matière. C ’eft ce qui avoit
fait imaginer à Léibnitz fon fyftême des monades. C e qu’il
entendoit par ces monades. Ibid. b.
Divifibilité. Examen de la queftion fi l’étendue eft divi-
fible à l’infini. V I . 45. a. La grande divifibilité de la matière
frouvée par la diffolution du cuivré dans l’alkali vo la t il,
V. 546. b., par la divifibilité de l’o r , V . 156. b. par la
propagation des odeurs. XI. 348. b. Exemple de la prodi-
gieufe divifibilité de la matière. Suppl. IV . 775. b. 776. a.
La divifibilité aâuelle de la matière prouve le vuide. XV II .
573- b- % W Ê Ê Ê Ê M
D IV ISIF , ( Chirurg. ) efpece de bandage. Son ufage, 8c
fa defeription. IV . 1076. b.
D IV I S IO N , ( Logîq. ) fon utilité. Application de la méthode
de divifer à l’examen de la queftion , fi la mufique
italienne H p as préférable à la mufique françoife. IV . 1076.
b. Et à la queftion, fi les anciens auteurs l’emportent fur
les modernes. Utilité des diftinâions dans plufiéurs oçcàfions
qui fe prèfentent dans les difeours des hommes. Ibid. 1077. a.
Divifion du difeours , introduite par les fcholafiiques. IV .
1033. b. Réglés fur. la maniéré de divifer un fujet que l’on
doit traiter lynthétiquement. X V . 763. a.
D iv is io n , ( Arithm. ) elle n’eft au fond qu’une méthode
abrégée de fouftra&ion. On confidere principalement trois
nombres dans cette opération. Différentes maniérés de faire
la divifion. De la divifion ordinaire , maniéré dont on la
fa i t , quand le divifeur ne contient qu’un chiffre. Ibid. 1077.
a. Quand il contient plufiéurs chiffres. Ibid. b. Cinq obfer-
-vations particulières pour l’intelligence de cette réglé. Ibid.
1078. a. Ouvrage où fe trouve la théorie de tous ces préceptes.
Quant à la divifion des fraflions vulgaires, des frac-
tios décimales, 8c à la divifion de propofition, voyezF r a c t
io n , D é c ima l , Pr o p o r t io n .
Divifion. Obfervations fur quelques preuves de divifion
que l’auteur démontre fautives. Suppl. II. 731 . a.
Divifion. Baguette de Néper pour exécuter la divifion.
XI. 96. a , b. Divifion des fraâions. V II . 265. a. Divifion
des fraôions décimales. IV . 669. a. Divifion dans les calculs
des conducteurs des mines. VIÏ . 638. b.
De la divifion algébrique, Maniéré de la faire. Divers exemples
pour l’intelligence des différens cas poflîbles dans la
divifion algébrique. IV . 1078. b. Pour la divifion par les logarithmes,
Ibid. 1709. a. Voye{ LOGARITHME.
Divifion algébrique. I. 676. a , b. Divifion d’une puiffance
par une autiede même racine. XIII. 336. b. Divifion des
£xpofans des puiffances. V I . 312. b.
De la divifion. géométrique. Elle regarde les lignes droites,
& eft utile dans la conftruétion des problèmes plans : exemp
le . Comment on réfout ces problèmes. Moyen de faire une
.divifion géométrique avec la réglé 8c le compas. Dans la
.divifion, le dividende eft ^u. divifeur comme le quotient eft
-à l’unité. Ces deux propositions qui paroiffent les mêmes ,
.ne le font cependant pas , abfolument parlant. IV . 1079. b.
-On peut préfenter la divifion fous deux points de vue diffé-
.rens : divifer, c’eft chercher combien de fois une quantité eft
:.contenue dans une autre de même genre ; ou c’e ll chercher
•une quantité, qui foit contenue un nombre de fois donné ,
dans une quantité donnée du même genre. Nous fuppofons
fic i que le divifeur eft plus petit que le dividende, 8c que
. la divifion fe fait fans refte. Mais i° . fi le divifeur eft plus
p et it , 8c que la divifion ne fe faffe pas fans refte, la proportion
entre le dividende, le divifeur , le quotient, 8c
l ’unité, n’en a pas moins lieu. Exemple. 20. Si le divifeur
eft plus grand que le dividende, alors le quotient fera plus,
petit que l’unité ou qu’une fraétion d’unité. Si le divifeur
eft une fraâion plus petite que l’unité, le quotient fera un
nombre plus grand que le dividende. Ibid.. 108b. a. Détails
dèftinés à donner une idée nette de-la divifion. Ibid. b. Des
différehtes manières’ de faire-la ‘divifion : en quoi elles
different. Exemple de l’italienne abrégée. Lorfque le dividende
8c le divifeur font des nombres concrets , ,‘il faut dif-
tinguer , f i ce font des nombres concrets de la même elpece
ou de différentes efpeces. C e qu’il faut faire dans l’un 8c
l’autre cas. Obfervation fur- la divifion algébrique. Ibid. 'b.
Sùr;la divifion géométrique; Ibid. 1082. a.
Divifion géométrique. D e la divifion des lignes, voyez L igne .
Maniéré de divifer une.: figure reftiligne 8c de la calculer.
V I I . 666. b. Maniéré' de ;divifer une figure curviligne , Ibia.
8c une figure quelconque' èn raifon donnée. 607. 4 , b. Partie
de la géométrie qui enfeigne à divifer les terres entre
plufiéurs.propriétaires. VII; 606'. b. :
D iv is io n . ( Jurifip. ) Bénéfice de divifion. Difpofitions
d’Adrien 8c de Juftihien fur ce bénéfice de divifion. Q u el eft
à cet égard l’ufage en France. IV . 1082. a.
Divifion de dettes âétives 8c paflives. IV . 1082. a.
D iv is io n s , ( Art milita) !, pourquoi elles font néceffaires
dans une armée. Quelles font ces divifions. Divifions des
bataillons; Pour faire concevoir cette efpece de divifién ,
l’auteur rend compte • ici de plufiéurs anciens ufages des
troupes de France. IV . 1082. a. Comme les anciennes expref-
fioiis ne font plus n a tu r e lle s il feroit à propos de leur en
fubftituer de plus propres. C e qu’on entend par ces expref-
fions , marcher par manch.es , par derni-ma/iches , par quart de
manches , &c. Ces divifions font indépendantes de la compagnie
des grenadiers. Pofte des officiers dans la marche;
Divifions naturelles de l’efcadron. Ibid. b.
D iv is io n . ( Marine ) Divifion d’une armée navale. IV .
1082. b. Variétés dans le nombre des vaiffeaux qui font une
divifion. Ibid. 1083. a.
■ D iv is io n , ( Blafion ) voyez Pa r t it io n ,
D iv is io n , ( Imprimerie ) petite ligne ou tiret dont'on
fait ufage en quatre occafions différentes ; lorfqu’un mot
eft coupé à la fin d’une aligne; lorfqu’on joint des mots
compofés ; après un verbe fn'ivi du pronom tranfpofé par
interrogation ; avant 8c après le t euphonique. IV . 1083. a.
D IV O R C E , ( Jurifip. ) il eft contraire à la première infti-
tution du mariage. Décifion de Jefus-Chrift. Matth. X IX .
Cependant il étoit permis chez les païens 8c chez les Juifs.
IV . 1083. a. Pourquoi Moïfe l’aVoit permis ; paroles du
feigneur :: explication de cés paroles. C e qu’on entendoit
chez les Juifs 8c chez les Romains par libellus repudii. Différence
que les Romains mettoient entre divortium 8c repudium.
Etymologie du mot divorce. Pourquoi l’on joignoït fouvent
ces deux mots divortium Sc repudium. Q u elle étoit la femme
qu’on appelloit répudiée. L e divorce étoit fréquent dès le
tems de l’ancien droit romain. Formule ancienne du divorce
ou repudium. Loi qui fuppofa que les femmes avoient le’
pouvoir de provoquer le divorce. D e quelle maniéré la
femme en faifoit l’afte quand il venoit de la part. Sentiment
de l’auteur des queftions fur l’ancien & le nouveau tefta-
ment touchant le pouvoir accordé aux femmes de provoquer
le divorce. I l paroît que la loi qui le leur donne eft
du jurifconfulte Julien. Ibid. b. D u tems de Marc -Aurele,
le divorce avoit lieu entre les chrétiens, comme entre les
païens. Premier exemple du divorce chez les Romains.
Détails fur la maniéré dont le divorce fe pratiquoit parmi
eux. Loix touchant le divorce , que firent les empereurs
Alexandre Sévere , Valérien 8ç Galien, Dioclétien & Maximien
, Conftantin , Théodofe 8c Valentinien. Loix de Jufti-
nien fur le même objet. Ibid. 1084. a. L’ufage du divorce
porté dans, les Gaules par les Romains. Claufe qu’inféroient
les rois de France dans leurs lettres pour autorifer le libelle
de divorce. Le divorce autorifé par l’exemple de Charlemagne.
En quel fens le terme de divorce eft employé en
plufiéurs textes du droit canon. L’églife n’a jamais approuvé
le divorce proprement dit. Le mariage ne peut être diffous
Îue par vo ie de nullité, ou par appel comme d’abus. Ibid, b,
>n n’entend aujourd’hui par le divorce que la méfintelli-
gence qui peut furvenir entre les conjoints. Mais la feule
méfintelligence ne fuffit pas pour donner lieu à la fépara-
tion de corps 8c de biens. Cette féparation ne peut être demandée
que par la femme. Pays où le divorce fe pratique.
Loix à confulter. Ibid. 1083. a.
Divorce , erreur dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 73«. b.
Divorce, des prêtres chez les Romains. IV . 984. a. Formule
de divorce que les Romains obfervoient pour la. diffolution
des mariages contractés par coemption. X IV . 91 . b.
•Comment les divorces devinrent rares à Thurium. X V I.
-303. b. 304. a. Formalités du divorce chez les Juifs. VII.
034. a y b. L e divorce fréquent chez les Cophres. Suppl. II.
593. a. Le divorce autorifé en Pologne. XIL 931. a, Çaufes
D I X
de diffolutions de mariages chez les Turcs. X. 1 1 5 .4 . Obfervations
fur*la diffolution du mariage parmt nous. X . 108.
b Caufes qui l’operent. IV . 1049. a. Des caufes d’im-
puiffance qui peuvent y donner lieu. VII I. 634. b. 635 .4.
Suppl. III. 369. 4 , b. Sort de la dot de la femme apres le
divorce. V. 64. b. Sur le div o r c e , voyez èncore RÉPUDIATION
6* SÉPARATION.
D IU RÉTIQU E. ( Thirap. 6* Mat. tnéiic. ) Différentes maniérés
dont les diurétiques agiffent ; delà vient la diftinc-,
tion des diurétiques vrais 8c de diurétiques fau x , mieux entendue
que celle de diurétiques chauds & de diurétiques froids.
IV . 1083.4. Enumération de quelques-uns de ces derniers. Les
plantes de la famille des bourraches 8c les cucurbitacées ,
rangées par plufiéurs parmi les diurétiques froids, font éminemment
nitreufes, 8c rentrent par-là dans la claffe des
chauds. Les diurétiques chauds font allez communément
confondus avec les apéritifs. Deux vues des médecins dans
l’ufage des diurétiques, ou pour établir la fecrétion de l ’u rine
, ou pour procurer une évacuation utile à la guérifon
de plufiéurs .maladies. C e qu’on fe propofe en employant
les diurétiques dans les maladies aiguës. En quels cas conviennent
les diurétiques faux 8c les vrais. ^ Les diurétiques
tempérés peuvent être dohnés fans conféquence dans la
plupart des maladies. Ibid. b. Confidérations que demande
l’emploi des diurétiques forts : on ne doit pas les donner
dans le cas d’une grande pléthore , ou d’un corps étranger
dans les voies ordinaires ; rarement doit-on les employer
dans les affeftions goutteufes : il ne faut pas tenter dé chaffer
par eux les petits calculs 8c le gravier ; état dé maladie
où l’on doit avoir foin de faire couler les urines; il faut
procurer certaines évacuations d’urine, qui, font .périodiques
dans certains fujets. Lifte des diurétiques donnée par Juncker,
tirés des racines, des herbes où plantes , des fleu rs , des
femences & fruits,; Ibid: 1086. a. des' gommes-réfines, des.
baumes , des b o is , des fels végétaux , des minéraux , 8c
des animaux. Enumération des remedés les plus éprouvés..
Forme fous laquelle. on adminiftre les diurétiques. Application
.extérieure des diurétiques. Ibid. b. . ,
Diurétique. Enumération de différens - diurétiques. VHI.
381. 4.. Celui de Tulpius. IX. 588. a , b. Propriété diurétique
dés pois chiches. XII. 884. Puiffant diurétique tiré de
la plante nommée colafifb. Suppl. II. 300. b.
D IU RN E ou journalier. ( Afiron. ) A rc diurne 8c femi
diurne. Cercle diurne. Mouvement diurne d’une plànete :
comment on le trouve. Mouvement diurne de la terre. IV .
10 8 7 .4 .;. , , r '
Diümé. Accélération diurne des étoiles. Suppl. I. 106; b.
Mouvement diurne. 662. b.
Diurne, terme dont on fe fert en parlant» de ce qui a
rapport au jour naturel de vingt-quatre heures. O n explique
les phénomènes diurnes des corps céleftes, par le moyen
de la révolution- diurne- de la terre autour de fon a x e , en
vingt-quatre heures. IV . 1087. a. Par • la révolution diurne
de la ter re , tous les corps céleftes femblent fe mouvoir
d’orient en occident. Diftinétion du mouvement commun
8c du m ouvement propre. Ibid. b.
D IVU LG U ER . Les connoiffances , le s inventions , l’in-
duftrie d’une nation doivent-elles être divulguées ? V . 647. b.
• D I VU S , diva , ( Antiq. rom. j voyez D l VIN.
D IX , maniéré de multiplier oc de divifer par ce nombre.
IV . 1087. E
D ix . Propriétés de ce nombre félon les Pythagoriciens.
XI. 205. E :
D i x , confeil des, ( Hiß. de Venife ) dans quel but ce tribunal
fut créé en 1310. Objets de c e confeil. Difficulté'de s’iuf-
truire de ce qui regarde le gouvernement intérieur de la
république de Venile. O n tire de ce tribunal les inquifiteurs
d’état. Pouvoir des fénateurs qui le compofent, indépendant
de celui* du doge. D e leur eleftion. Fondions des chefs.
La liberté exifte moins à Venife que dans plufiéurs monarchies.
IV . 1088. 4.
D ix . Confeil des dix du tems de la ligue. IV . 3. 4 , b.
D ix a in e . {Hiß. d’A nglet.) Compagnie de dix hommes
qui s’obligeoient folidairement envers le r o i , &c. C h e f de
ces compagnies , appellé dixainier ou décurion ; 8cc. IV .
1088. b.
-■ Dixaines. L c royaume divifé par Alfred en comtés, centaines
8c dixaines. X V I I . 387. b. Voyez D écurie.
D iXAINE , ( Manuf. en jo ie ) efpaces féparés fur le papier
réglé, 6t . IV . 1088. b. Voyez Pa p ie r ,r églé.
DIXENIERS , chefs des décuries établies autrefois en
Angleterre : ce qu’on entend aujourd’hui en certains endroits
par ce nom. IV . 664. a. 1088. b. Officiers de police äinfi
■ nommés à Paris. XIII. 680. b. 682. b.
DIXIEME denier des revenus du royaume : impofition extraordinaire
que le . roi levé dans les befoins preffans. Quels
en font les plus anciens exemples, IV . 1088. b. Le dixième
impofè en 1710. Emprunt de trois millions qui fut fait énfuite.
Les biens du clergé exempt du dixième depuis 17 1 1 , Nou-
D I X 523
velle impofition du dixième en 1733 ; don gratuit que le
clergé paya alors au roi pour tenir lieu du dixième. Nouvelle
impofition du dixième en 1741. Levée des deux fols
pour livre du dixième en 1746. Le v ée dû vingtième eri
1749. Ces deux impofitions fe p erçoivent aéluellement. Principales
difpofitions de l’édit de 1 7 4 1 , qui donnent une idée
de la maniéré dont fe percevoit le dixième. Ibid. 1089.4.
'L e clergé accorda en 1 7 4 2 un don gratuit de douze millions,
au m oyen de quoi tous les biens eccléfiaftiqueS furent déclarés
exempts du dixième à perpétuité comme en 17 11.. Dif-
pofition d’un arrêt du confeil de 1743 , relative à l’impo-
fition du dixième. Comment on fixe pour chaque particulier
le montant' du dixième. Il eft permis, en Créant urte
rente fonc ière, de ftipuler qu’elle, fera exempte de la retenue
du dixième de la.part du débiteur; mais il n’en eft pas
de même des rentes conftituées. Tous les débiteurs de cens
■ 8c rentes feigneuriales , font tenus de lès payer fans aucune
retenue du dixième ni du vingtième ; &c. Dixième que le
czar le v e en Ruffie. Ibid. 1,090. a.
Dixième denier ou deux fo ls pour livre d'augmentation fur
lés revenus du roi. Hiftoire de Pétabliffement de ce droit
eh 1703. Arrêt du confeil de 1706, qui ordonna qu’on en cor.-’
tinueroit la perception. Déclaration donnée en 1709 pour
la perception d’un dixième, par augmentation de tous les droits
qui fe lèvent dans la ville de Paris, &c. IV . Î09o.b.
Dixième des prifes. Dixième de retenue. Dixième fur les vins.
IV . 1090. b.
D ixième , ( Mufique ) IV . 1090. b.
DIXME. {Jurifip. ) Première divifion des dixmes en ecclé-
fiaftiques 8c laïques ou inféodées. Quelques-uns prétendent
que les dixmes font de droit divin. Argumeiis tires de l’écritu
re , fur lefquels ils fe fondent. IV . 1090. b. Les païens étoient
, dans l’ufage de payer la tiiXme à leurs facrificateurs. Parole
de Créfus à Cy rus rapportée par Hérodote. Les Juifs la
payoient à leurs prêtres. Examen de deux paffages du nouveau
teftament fu r ce fujet. Math. X X I I I . 23. Luc, XI. 4 .;.,
Ibid. 1091. 4. Il n’eft fait mention de la dixmè, comme due
dans l’églife chrétienne, dans aucun des premiérs écrits des
Chrétiens. Comment le clergé étoit entretenu dans les premiers
tems. Quand les peres de l’églife exhortèrent à payer
la dixme, cela ne fut point propofé comme Un précepte.
C e que dit S. Auguftin fur la dixme. Il eft difficile dé remarquer
le tems où elle eft devenue un précepte. Les loix
romaines ne parlent point de cette efpece d’impofition. Des
dixmes dans l’églife grecque. Concile de Tours qui les
ordonne à titre d’aumône en 367. Celui de Mâcon en 385
les ordonne plus rigoureufement. Charlemagne en exigea le
paiement. D ivers conciles qui en ont fait lin précepte. Ibid.
b. U paroît donc que les dixmes eccléfiaftiqueg ne font que
de droit pofitif, &c. Obfervations qui confirment qu’elles
ne font pas de droit divin. 1. Elles n’ont point été payées
dès la naiffance de l’églife chrétienne. 2. Elles n’ont poifit
été payées dans tout le monde chrétien. 3. Elles ne 'font
point dues fur le pied de la dixième partie des fruits,
comme on les payoit aux lévites. 4. Les papes ont donné
des dixmes à des laïcs. 3. L e faiht fiege a exempté du paiement
des dixmes des ordres entiers. Ibid. 1092. a. 6. Les papes
ont attribué les novales à Certains ordres, à l’exclufion dés
curés. 7. Les accords faits entre les eccléfiaftiques fur les
dixmes conteftées entr’e u x , ont toujours été approuvés par
le droit canonique. Les dixmes appartiennent de droit commun
aux curés. Elles peuvent appartenir aufli à d’autres eccléfiaftiques.
Origine des conceflions de dixmes faites aux mo-
nafteres. Dixmes établies par l’églife même, en faïfant dés
conceflions de certaines terres à des particuliers. Quels font
les fruits & revenus d’où la dixme eft tirée félon le dreit
canonique. En France on fe conforme à cet égard à l’ufage,
aux titres & à la poffeflion. Ibid. b. La dixme eft due par
toute forte de perfonnes. Obligation du'preneur à rente &
du fermier des dixmes. Les terrés de l’ancièn domaine des
curés exemptes de la dixme envers les décimateurs. Des bulles
qui exemptent des dixmes quelques ordres religieux. Ordres
qui en font exemptés en France. Les héritages aliénés par
les religieux ne confervent point cette exemption, 6-c.
Parcs, clos & jardins exempts de la dixme. Autres terres"
qui ne la doivent point. Ibid. 1093. a. Des terres négligées:
le décimateur n’en peut exiger la dixme, ’6,c. Une dixme
levée fur certains fruits pendant 40 années devient un droit.
D e la prefeription de la dixme. Si l’on feme une efpece nouvelle
de finiits , la dixme en eft infolite. On doit avertir les
décimateurs avant de commencer la récolte. D u lieu où fe
leve la dixme. La dixme n’arrérage point : exceptions. Ibid,
b. Trois principales charges qui fe prennent fur les groffes
dixmes. Charges impofées aux décimateurs. A qui appartient
la connoiffance des dixmes inféodées. Le pétitoire des
dixmes eccléfiaftiques appartient au juge d’églife , & le
poffeffoire au juge royal. Ibid. 1094. a.
Dixme. D u droit de dixme des églifes. YU I . 380. b. Dixme
du curé. IV . 574.4.