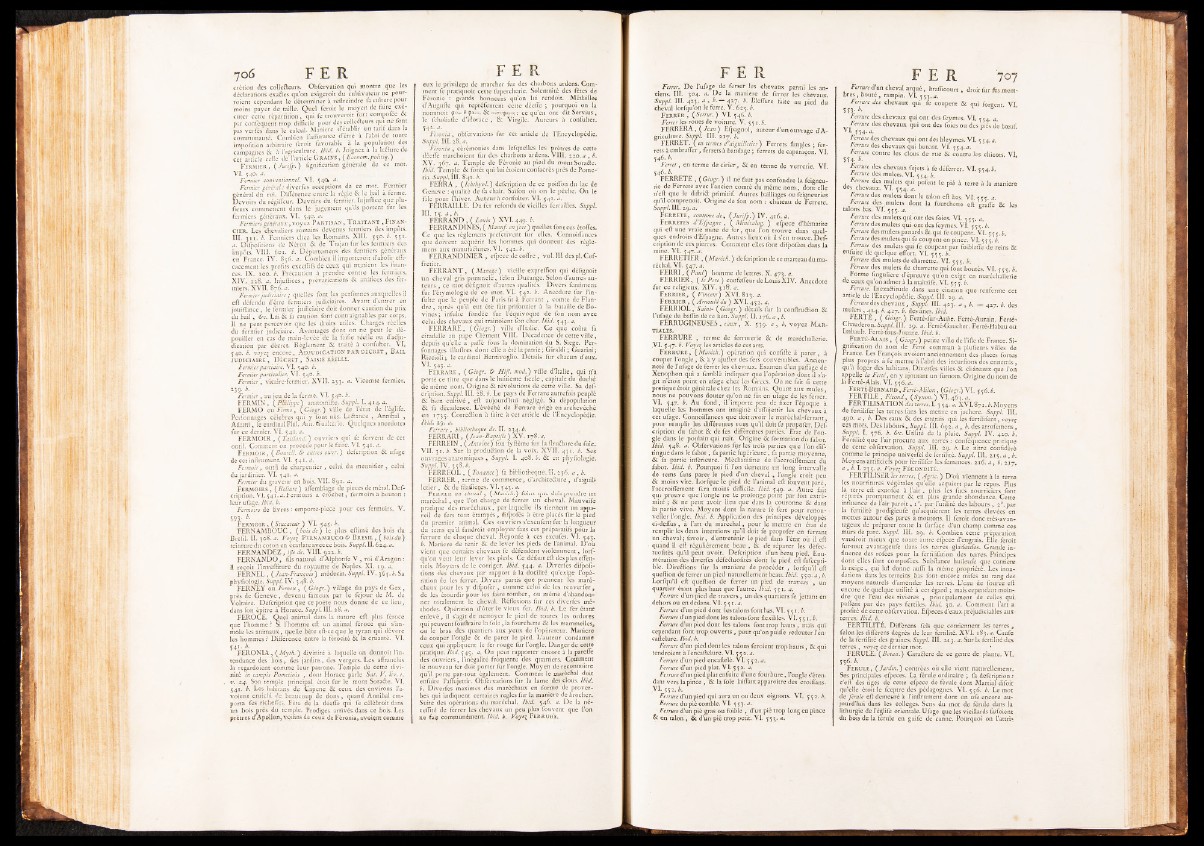
7 o 6 FER
crétion des collecteurs. Obfervation qui montre que les
déclarations exaétes qu’on exigeroit du cultivateur ne pour-
roient cependant le déterminer à reftreindre fa culture pour
'moins payer de taille. Q u e l feroit le moyen de faire exécuter
cette répartition, qui fe trouverait fort compofée oc
par conféquent trop difficile pour des collecteurs qui ne font
pas v crfés dans le calcul. Maniéré d établir un tarif dans la
i d’êt , l’abri de toute
population des
, T raitant ,F inancommunauté.
Combien l’affuran
impofition arbitraire feroit favorable
campagnes & à l’agriculture. Ibid. b. Joignez a la lecture
cet article celle de l’article Grains , ( Econom.pohtiq. )
Fermier , ( Jurifp. ) fignifiçation générale de ce mot.
V I . 540. a.
Fermier conventionnel. V I . 54c* a.
Fermier général : diverfes acceptions de ce mot. Fermier
général du roi. Différence entré la régie & le bail à ferme.
Devoirs du régiffeur. Devoirs du fermier. Injuftice que plu-
fieurs commettent dans le jugement qu’ils portent fur les
fermiers généraux. V I . 540. a.
Fermiers généraux, v o ye z Partisan
CIER. Les chevaliers romains devenus fermiers des imp.01
III. 3 1 1 . b. Fermiers chez les Romains. XIII. 350. 6. 551.
a. Difpofnions de Néron 8c (Je Trajan fur les fermiers >'
impôts. VIII. 601. b. Départemens des fermiers générr
en France. IV . 856. a. Combien il importerait d’abolir efficacement
les profits exceffifs de ceux qui manient les finances.
IX. 100. b. Précaution a prendre contre les fermiers.
X IV . 228. a. Injuftices, prévarications & artifices des fermiers?
X V II . 876. a.
Fermier judiciaire ; quelles font le,s perfonnes auxquelles il
eft défendu d’être fermiers judiciaires. Avant d’entrer en
jouiffance, le fermier judiciaire doit donner caution du prix
du b a i l, &c. Lui & fa caution font contraignables par corps.
Il ne peut percevoir que les droits utiles. Charges reelles
du fermier judiciaire. Avantages dont on ne peut le dépouiller
en cas de ma inlevée de la faifie réelle ou d adjudication
par décret. Réglement ,8c traité à confuher. V I .
540. b. voye^ encore, A djudication par decret, Bail
judiciaire , D écret , Saisie rçelle.
Fermier partiaire.YÏ. 540. b .,
Fermier particulier. V I . 5 40. b. .
Fermier, vicaire-fermier. XVII . 233. a. Vicomte fermier.
239. b. _
Fermier , au jeu.de la ferme. V I . 540. b.
F ERM IN , {Philippe) anatomifte. Suppl. I. 4 1 4 .a.
FERMO o u f ™ , ( Géogr. ) v ille de l’état de l’églife.
Perfonnages célébrés qui y font nés. Laâance , Annibal ,
Ad ami, le cardinal Phil. Ant. Gualtefio. Quelques anecdotes
fur ce dernier. VI. 341. a.
F E RM O IR , ( Tailland.-) ouvriers qui fe fervent de cet
outil. Comment on procédé ppur le faire. V I . 541 .a.
Fermoir, ( Bourell. & autres oùyr.) defeription 8c ufage
de cet inftrument. V I . 541. a.
Fermoir j outil de charpentier , celui du menuifier , celui
du jardinier. V I . 341. a.
Fermier du graveur en bois,. V I I . 891. a.
Fermoirs , ( Reliure ) affemblage de pièces de métal. D e feription.
V I . 341. a. Fermoirs à croche t, fermoirs à bouton :
leur ufage. Ibid. b. .
Fermoirs de livres : emporte-pie.ee pour ces fermoirs. V .
59T
Fermoir, (Stucateur) V I . 343. b.
F E R N AM B O U C , {bois d e) le plus eflimé des bois du
Brefil. II. 308.0. Voyei PERNAMBUCO & BRESIL, ( bois du)
teinture du coton en écarlate avec ce bois. Suppl. II. 624. a.
F E R N AN D E Z , ifU de. VII I. 922. b.
F E R N AN D O , ms naturel d’AIphonfe V , roi d’Aragon :
H reçoit l’invefHture du royaume de Naples. XI. 19. a.
FERNEL , {Jean-François) médecin. Suppl. IV . 363. b. Sa
phyfiologie. Suppl. IV . 348. b.
FERN E Y ou Fernex, ( Géogr. ) village du pays de Gex ,
près de G e n e v e , devenu fameux par le féjour de M. de
Voltaire. Defeription que ce poète nous donne de ce lieu,
dans fon épître à Horace. Suppl. III. 28. a.
F ERO CE. Q u el animal clans la nature eft, plus féroce
que l’homme ? Si l’homme eft un animal féroce qui s’immole
les animaux, quelle bête eft-ce que le tyran qui dévore
les hommes ? Différence entre la férocité 8c la cruauté. VI.
54!- b-
F E R O N IA , {M yth.) divinité à laquelle on donnoit l’intendance
des b ois, des jardins, des vergers. Les affranchis
la regardoient comme leur patrone. Temple de cette divinité
in campis Pometinis , dont Horace parle Sat. V. liv. 1.
v . 24. Son temple principal étoit fur le mont Soracle. VI.
341. b. Les habitans de Capene 8c ceux des environs l’a-
voient enrichi de beaucoup de dons , quand Annibal emporta
fes richeffés. Fête de la déeffe qui fe célébrait dans
un bois près du temple. Prodiges arrivés dans ce bois. Les
prêtres d’Apollon, voifins de ceux deFéronia, avoient comme
F E R
eux le privilège de marcher fur des charbons ardens. Comment
fe pratiquoit cette fupercherie. Solemnité des fêtes de
Fèronie : grands honneurs qu’on lui rendoit. Médaille«
d’Augufte qui repréfentent cette déeffe ; pourquoi on la
nommoit çjxoc ô çavo, 8c am ’ipopoç ; ce qu’en ont dit Servius ,
le feholiafte d’Horace , 8c Virgile. Auteurs à confulter.
lift: d. " ;
Feronia, obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 28. a.
Feronia, cérémonies dans lefquelles les prêtres de cette
déeffe marchoient fur des charbons ardens. V I I I . 220. a , b.
X V . 367. a. Temple de Féronie au pied du mont Soraéle.
Ibi'd. Temple 8c forêt qui lui étoient conlacrés près de Pome-'
tia. buppl. III. 841. b.
FERRA , {Ichthyol.) defeription de ce poiffon du lac de
Geneve : qualité de fa chair. Saifon où on le pèche. On le
fale pour l’hiver. Auteur à confulter. V I . 342. a.
FERRAILLE. D u fer refondu de vieilles ferrailles. Suppl.
III. 13. a , b.
F E R R A N D , (L o u is ) X V I . 449. b.
FERRANDINES, ( Manuf. en J'oie) quelles font ces étoffes.
C e que les réglemens preferivent fur elles. Connoiffances
que doivent acquérir les hommes qui donnent des réglemens
aux manufaélures. V I . 342. b.
FERRANDINIER , efpece de co ffre , vol. III d espl.Cof-
fretier.
FE R R AN T , ( Manege ) vieille expreffion qui défignoit
un cheval gris pommelé, félon Ducange. Selon d’autres auteurs
, ce mot défignoit d’autres qualités. Divers fentimens
fur l’étymologie de ce mot. V I . 542. b. Anecdote fur l’in -
fulte que le peuple de Paris fit à Ferrant , comte de Flandre
, après qu’il eut été fait prifonnier à la bataille de Bo v
in e s ; infulte fondée fur l’équivoque de fon nom avec
celui des chevaux qui traînoient fon char. Ibid. 343. a.
FE R R A R E , (Géogr.) ville d’Italie. C e que coûta fa
citadelle ait pape Clément VII I. Décadence de cette v ille ,
depuis qu’elle a paffé fous la domination du S. Siege. Per-
fonnages illuftres dont elle a été la patrie ; G iraldi ; Guarini ;
Ricciôli ; le cardinal Bentivoglio. Détails fur chacun d’eux.
V I . 343.0.
Ferrare , ( Géogr. & Hiß. mod. ) v ille d’Italie, qui n’a
porté ce titre que dans le huitième fie c le , capitale du duché
de même nom. Origine 8c révolutions de cette ville. Sa defeription.
Suppl. III. 28. b. Le pays de Ferrare autrefois peuplé
8c bien cultivé , eft aujourd’hui négligé. Sa dépopulation
8c fa décadence. L’évêché de Ferrare érigé en archevêché
ên 1733. Correétion à faire à cet article dé l’Encyclopédie.
Ibid. 29! a.
Ferrare , bibliothèque de. II. 234. b.
FE R R A R I , {JeanrBaptiftc) X V . 178.0.
F ER R E IN , {Antoine) fon fyftême fur la ftruélure du foie.'
VII. 31. b. Sur la produéïion de la voix. X V I I . 431. b. Ses
ouvrages anatomiques, Suppl. I. 408. b. 8c eh phyfiologie.
Suppl. TV. 338.6.
FERREOL , ( Tonance ) fa bibliothèque. II. 236. a , b.
FERRER , terme de commerce, d’architeßure, d’aiguil»
letier , 8c de filaûièçes. V I . 3 43. a.
Ferrer un cheval, (Maréch.) foins que doit prendre un
maréchal, que l’on charge de ferrer un cheval. Mauvaife
pratique des maréchaux, par laquelle ils tiennent un appareil
de fers tout étampés, difpofés à être placés fur le pied
du premier animal. Ces ouvriers s’exeufent fur la longueur
du tems qu’il faudrait employer fans ces préparatifs pour la
ferrure de chaque cheval. Réponfe à ces excufes. V I . 343.
b. Maniéré de tenir 8c de le ve r les pieds de l’animal. D ’où
vient que certains chevaux fe défendent violemment, lorf-
qu’on veut leur lever les pieds. C e défaut eft des plus effen-
tiels. Moyens, de le corriger. Ibid. 344. a. Diverfes difpofi-
tions des chevaux par rapport à la docilité qu’exige l’opération
de les ferrer. Divers partis que prennent les maréchaux
pour les y difpofer, comme celui de les. renverfer,
de les étourdir pour les faire tomber, ou même d’abandonner
totalement le cheval. Réflexions fur ces diverfes méthodes.
Opération d’ôter le vieux fer. Ibid. b. Le fer étant
en le v é , il s’agit de nettoyer le pied de toutes les ordures
qui peuvent fouftraire la fo ie , la fourchette 8c les mamnidles,
ou le bras des quartiers aux y eu x de l’opérateur. Maniéré
de couper l’ongle 8c de parer le pied. L’auteur condamne
ceux qui appliquent le fer rouge fur l’ongle. Danger de cette
pratique. Ibid. 343. a. On peut rapporter encore à la pareffe
des ouvriers, l’inégalité fréquente des quartiers. Comment
lè nouveau fer doit porter fur l’ongle. Moyen de reconnoître
qu’il porte par-tout également. Comment le maréchal doit
enfuite l’aflujettir. Obfervations fur la lame des clous. Ibid,
b. Diverfes maximes des maréchaux en forme de proverbes
qui indiquent certaines réglés fur la maniéré de brocher.
Suite des opérations du maréchal. Ibid. 346. a. D e la né-
ceffité de ferrer les chevaux un peu plus fouvent que l’on
ne fait communément. Ibid. b. Voyeç Ferrure,
F E R
Ferrer. D e l’ufage de feriser les chevaux parmi les anciens.
III. 304. a. D e la maniéré de ferrer les chevaux.
Suppl. III. 423. 0 , b. — 427. b. Bleffure faite au pied du
cheval lorfqu’on le ferre. V . 623. b.
F errer , ( Serrur. ) V I . 346. b.
Ferrer les roues de voiture. V . 331 .b.
FER R E R A , {J ean ) Efpagnol, auteur d’un ouvrage d’A-
griculture. Suppl. III. 2 17. b.
FERRET, (en termes d.’aiguilletier) Ferrets Amples; fer-
rets à embraffer, ferrets à bandage ; ferrets dé caparaçon. VI.
546. b.
Ferret, en terme de cirier, 8c en terme de verrerie. V I.
546. b.
FERRETE , {Géogr. ) il ne faut pas confondre la feigneu-
rie de Ferrete avec 1 ancien comté du même nom., dont elle
n’eft que le diftriél primitif. Autres bailliages ou feigneuries
qu’il comprenoit. Origine de fon nom : château de Ferrete.
Suppl. III. 29. a.
FERRETE, coutume de, (Jurifp.) I V . 416. a.
FeRRETES d’Efpagne , ( Minéralog. ) efpece d’hématite
qui eft une vraie mine de fe r , que l’on trouve dans quelques
endroits d’Efpagne. Autres lieux où il s’en trouve. D e f eription
de ces pierres. Comment elles font difpofées dans la
mine. V I. 347. a.
FERRETIER , (Maréch. ) defeription de ce marteau du maréchal.
V I . 347.0.
F E R R I , ( Paul) homme de lettres. X. 473.0.
FF.RRIER, ( le P e r e ) confeffeur de Louis X IV . Anecdote
fur ce religieux. X IV . 3 18. 0.
Ferrier, ( Vincent) X V I . 813. 0.
Ferrier , ( Arnould du ) X V I . 432. 0.
F E R R IO L , Saint- ( Géogr. ) détails fur la conftruétion 8c
l’ufage du balfin de ce lieu. Suppl. II. 176.0 b.
FERRU GIN EUSES, eaux, X. 339. 0 , b. v o y e z Martiales.
FERRURE , ferme de ferrurerie 8c de maréchallerie.
.VI. 347. b. Voye^ les articles de ces arts.
Ferrure , ( Maréch.) opération qui eonfifte à p arer, à
couper l’ongle , 8c à y ajufter des fers convenables. Ancienneté
de l’ufage de ferrer les chevaux. Examen d’un paffage de
Xenophon qui a femblé indiquer que l ’opération dont il s’agit
n’etoit point en ufage chez lès Grecs. On ne fait fi cette
pratique étoit générale chez les Romains. Quant aux mules,
nous ne pouvons douter qu’on ne fut en ufage de les ferrer.
V I . 347. b. A u fo n d , il importe peu de fixer l’époque à
laquelle les hommes ont imaginé d’affujettir les chevaux à
cet ufage. Connoiffances que doit avoir le maréchal-ferrant
pour remplir les différentes vues qu’il doit fe propofer. D e feription
du fabot 8c de fes différentes parties. Etat de l’ong
le dans le poulain qui naît. Origine 8c formation du fabot.
Ibid. 348. 0. Obfervations fyr les trois parties que l ’on distingue
dans le fab o t, fa partie.fupérieure, fa partie moyenne
8c fa partie inférieure. Méchanifme de raccroiffement du
fabot. Ibid. b. Pourquoi fi l’on demeure un long intervalle
de tems fans parer le pied d’un cheval , l’ongle croît peu
8c moins vite. Lorfque le pied de l’animal eft fouvent p aré,
l’accroiffement fera moins difficile. Ibid.-349. a. Autre fait
qui prouve que l’ongle ne fe prolonge point par fon extrémité
; 8c ne peut avoir lieu que dans la couronne 8c dans'
la partie viv e . Moyens dont la nature fe fert pour renou- •
veller l’ongle. Ibid. b. Application des principes développés
ci-deffus, à Fart du maréchal, pour le mettre en état de
remplir les deux intentions qu’il doit fe propofer en ferrant
un Achevai ; favoir, d’entretenir le pied dans l’état où il eft
quand il eft régulièrement beau , 8c de réparer les défee-
tuofités qu’il peut avoir. Defeription d’un beau pied. Enumération
des diverfes défefluofités dont le pied eft fufeepti-
ble. Direélions fur la maniéré de p ro c é d e r ? lo r fq 11’il eft
queftion de ferrer un pied naturellement beau. Ibid. 330.0, b.
Lorfqu’il eft queftion de ferrer un pied de travers , un
quartier étant plus haut que l’autre. Ibid. 331. 0.
Ferrure d’un pied de tra vers, un des quartiers fe jettant en
dehors ou en dedans. V I . 331.0.
Ferrure d’un pied dont les talons font bas. V I . 331 .b.
Ferrure d’un pied dont les talons font flexibles. V I. 3 3 r. b.
Ferrure d’un pied dont les talons font trop hauts,'mais qui
cependant font trop o u v e rts , pour qu’on puiffe redouter l’en-
caftelure. Ibid. b.
Ferrure d’un pied dont les talons feraient trop hauts, 8c qui
tendraient à l’encaftelure. V I . 5 3 2.0.
Ferrure d’un pied encaftelé. V I . 3 3 2.0.
Ferrure d’un pied plat. V I . 332. 0.
Ferrure d’un pied plat enfuite d’une fourbure, l ’ongle s’étendant
v ers la pince , 8c la foie laiffant apparaître des croiffans.
VI-S !2- i - , ■ ■ ■ ■ ■
Ferrure d’un pied qui aura un ou deux oignons. V I. 332. b.
Ferrure du pié comble. V I . 333.0.
Ferrure d’un pié gras ou foible , d’un pié trop long en pince
& en ta lo n , 8c d’un pié trop petit. V I . 333. 0.
F E R 707
Ferrure d’un cheval arqué, brafiieourt, droit fur ffes membres
, b outé , rampin. V I. 333.0.
Ferrure des chevaux qui fe coupent 8c qui forgent V I
553- b-
Ferrure des chevaux qui ont des feymes. V I . 334. 0.
Ferrure des chevaux qui ont des foies ou des piés de boeuf.
VI. 334.0.
Ferrure des chevaux qui ont des b leymes. V I . 3 34.0.
Ferrure des chevaux qui butent. V I. 334.0.
Ferrure contre les clous de rue 8c contre les chicots. V L
334- b.
Ferrure des chevaux fujets à fe déferrer. V I. 334. b.
Ferrure des mulets. V I. 3 34. b.
H H * • Ü Ü E «pi (Ofent le- pié à terre à la maniéré
des chevaux. V I. 334. 0.
Ferrure des mulets dont le talon eft bas; V I. 333. 0.
Ferrure des mulets dont la fourchette eft graffe 8c les
talons bas. V I . 333.0. 6
Ferrure des mulets qui ont des foies. V I. 3 3 3. a.
Ferrure des mulets qui ont des feymes. V I. 3 3 3 . b.
Ferrure des mulets panards 8c qui fe coupent. V I. 333.6.
Ferrure des mulets qui fe coupent en pince. V I . 3 3 3. b.
Ferrure des mulets qui fe coupent par foibleffe de reins 8c
enfuite de quelque effort. V I . 333. b.
Ferrure des mulets de charrette. VI. 533.6.
Ferrure des mulets de charrette qui font boutés. VI. 333. b.
Forme finguliere d’épreuve qu’on exige en maréchallerie
de ceux qu’on admet à la maîtrife. V I . 3 3 3. b.
Ferrure. Inexactitude dans une citation que renferme cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. III. 29. 0.
Ferrure des chevaux, Suppl. III. 423. a , b. — 427. b. dés
mulets, 424. b. 427. b. desânes. Ibid.
FERTË , ( Géogr. ) Ferté-fur-Aube. Ferté-Aurain. Ferté-
Chauderon. Suppl. III. 29. 0. Ferté-Gaucher. Ferté-Habau ou
Imbault. Ferté-fous-Jouare. Ibid. b.
Ferté-Alais , ( Géogr. ) petite ville de Fille de F rance. Signification
du nom de Ferté commun à plufieurs villes de
France. Les François avoient anciennement des places fortes
plus propres à fe mettre à l’abri des incurfions des ennemis,
qu a loger des habitans. Diverfes villes Sc châteaux que l’on
appelle la Ferté, en y ajoutant un furnom. Origine du nom de
la F erté-Alais. V I . 336, 0.
Ferté-Bernard , Ferté-Milon, (Géogr.) V I . 3 36. b.
FERT ILE , Fécond, ( Synon. ) V I. 46-5 .0.
FER T IL ISA T IO N des terres. I. 3 34. 0. X V I .871.6. Moyens
de fertilifer les terres fans les mettre en jachere. Suppl. III.
490. 0 , b. Des eaux 8c des engrais qui les fertilifent, voyeç
ces mots. D es labours, Suppl. III. 692. a , b. des arrofemens ,
Suppl. I. 376. b. &c. Utilité de la pluie. Suppl. IV . 420. b.
Fertilité que l’air procure aux terres : conféquence pratique
de cette obfervation. Suppl. III. 29. b. Le nitre confidéré
comme le principe univerfel de fertilité. Suppl. 111. 2 1 3 .0 ,6 .
Moyens artificiels pour fertilifer lesfemences. 216! 0 , 6. 2 17,
0 , 6 .1. 23 3.0. Voyei FÉCONDITÉ.
FERTILISER les terres. ( Agric. ) D ’où viennent à la terre
les nourritures végétales qu’elle acquiert par le repos. Plus
la terre eft expofée à l’a ir , plus les fucs nourriciers font
réparés promptement 8c en plus grande abondance. Cette
influence de l’àir paroît,' i° . par l’utilité des labours , 20. par
la fertilité prodigieufe qu’acquierent les terres élevées en
mpttes autour des parcs à moutons. Il feroit donc très-avantageux
de préparer toute la furface d’un champ comme ces
murs de parc. Suppl. III. 29. 6. Combien cette préparation
vaudroit mieux que toute autre efpece d’engrais. Elle feroit
fur-tout avantageufe dans les terres glaifeufes. Grande influence
des rofées pour la fertiüfation des terres. Principes
dont elles font compofées. Subftanee huileufe que contient
la ne ig e , qui lui donne auffi la même propriété. Les inondations
dans les terreins bas font encore mifes au rang des
moyens naturels d’amender les terreé. L’eau de fource eft
encore de quelque utilité à cet égard ; mais cependant moindre
que l’eau des rivières , principalement de celles qui
paffent par des pays fertiles. Ibid. 30. 0. Comment l’art a
profité de cette obfervation. Elpeces d’eaux.préjudiciables aux
terres. Ibid. b.
FERT ILITÉ. Différens fels que contiennent les terres ,
félon les différens degrés de leur fertilité. X V I. 183.0. Caufe
de la fertilité des graines. Suppl. III. 213. 0. Sur la fertilité des
terres , voye^ ce dernier mon
FERULE:- ( Botan. ) Caraélere de ce genre de plante. V I . DDFerule , ( Jardin. ) contrées ou elle vient naturellement.
Ses principales efpeces. La férule ordinaire ; fa defeription :
c’eft des tiges de cette efpece de férule dont Martial difoit
qu’elle étoit. le feeptre des pédagogues. V I . 3 36. 6. Le mot
de férule eft demeuré à l’inffrument dont on ufe encore aujourd’hui
dans les colleges. Sens du mot de férule dans la
lithurgie d e l’églife orientale. Ufage que les vieillards faifoient
du bois de la férule en guife de canne. Pourquoi on l’attri