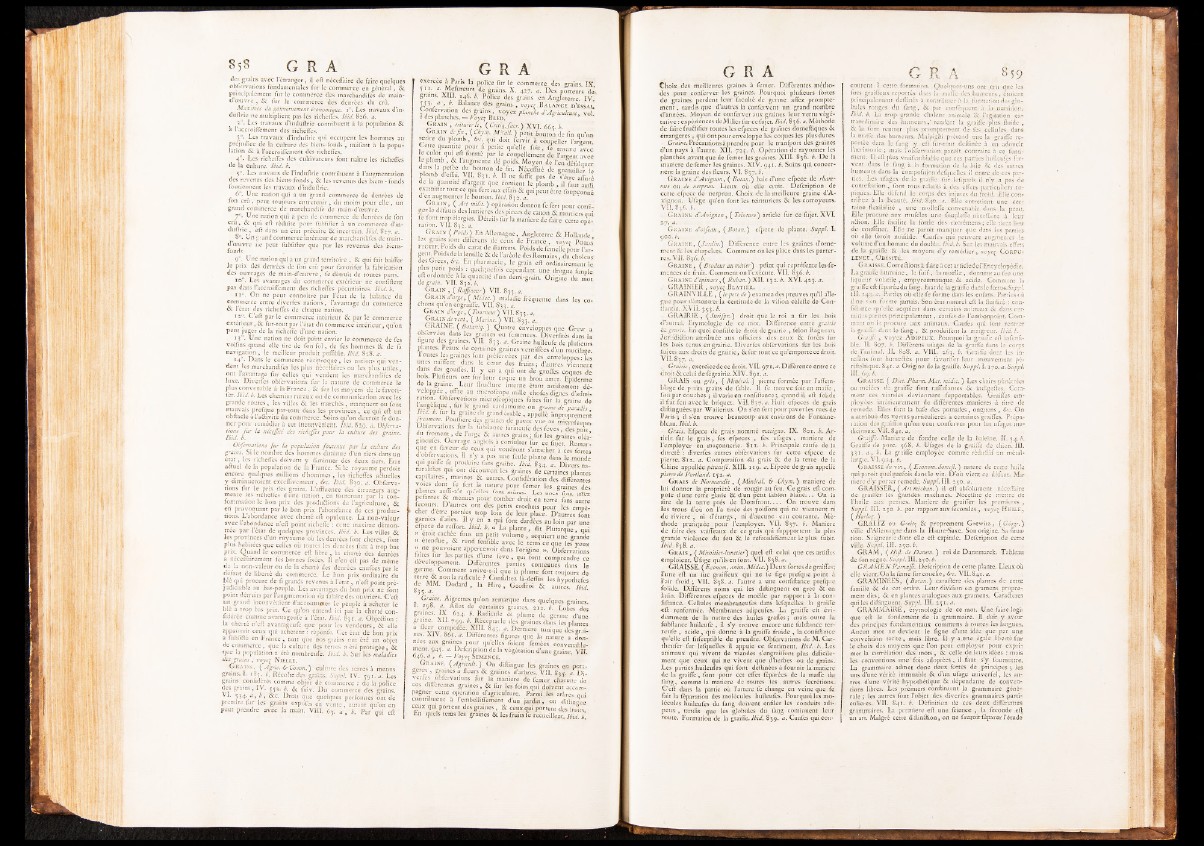
M G R A
des grains avec l’étranger, il eA néceffaire de faire quelques
obfervations fondamentales fur le commerce en général, &
principalement fur le commerce des marchandifes de main-
d oeuvre , & fur le commerce des denrées du crû.
Maximes du gouvernement économique. i°. Les travaux d’in-
duArie ne multiplient pas les richeflcs. Ibid. 826. a.
2 . Les travaux d’induArie contribuent à la population &
à l’accroiffement dès richeffes.
30. Les travaux d’induArie qui occupent les hommes au
préjudice de la culture des biens-fonds , nuifent à la population
& à l’àceroiffement des richeAes.
4°. Les richeAes des cultivateurs font naître les richeAes
de la culture. Ibid. b.
5°. Les travaux de l’induArie contribuent à l’augmentation
des revenus des biens-fonds , & les revenus des biens-fonds
fouqennent les travaux d’induArie.
6°. Une nation cjui a un grand commerce de denrées de
fon c rû , peut toujours entretenir , du moins pour e l le , un
grand commerce de marchandife de main-d’oeuvre.
7°. Une nation qui a peu de commerce de denrées de fon
c ru , & qui eA réduite pour fubAAer à un commerce d’induArie
, éA dans un état précaire & incertain. Ibid. 827. a.
8°. Un grand commerce intérieur de marchandifes de main-
d’oeuvre ne peut fubAAer que par les revenus des biens-
fonds.
'90. Une nation qui a un grand territoire , & qui fait baiffer
le prix des denrées de fon crû pour favorifer la fabrication
des ouvrages de main-d’oe u v re , fe détruit de toutes parts.
10". Les avantages du commerce extérieur ne conAAent
pas dans l’accroiffement des richeAes pécuniaires. Ibid. b.
i i °. On ne peut connoître par l’état de la balance du
commerce entre diverfes nations, l’avantage du commerce
& l ’état des richeAes de chaque nation.
12®. C ’eA par le commerce intérieur & par le commerce
extérieur, & fur-tout par l’état du commerce intérieur, qu’on
peut juger de la richeffe d’une nation.
^S0- U ne nation ne doit point envier le commerce de fes
Voifins quand elle tire de fon f o l , de fes hommes & de fa
navigation , le meilleur produit poAible. Ibid. 828. a.
140. Dans le commerce réciproque, les nations qui v endent
les marchandifes les plus néceffaires ou les plus utiles,
ont l’avantage fur celles qui vendent les marchandifes de
liixe. Diverfes obfervations fur la nature de commerce le
plus convenable à la Franc e, & fur les m oyens de le favori-
fer. Ibid. b. Les chemins ruraux ou de communication avec les
grande routes, les villes & les marchés, manquent ou font
mauvais prefque par-tout dans les pro vinces, ce qui eA un
obAacle à l ’aâ ivité du commerce. Soins qu’on devroit fe donner
pour remédier à cet inconvénient. Ibid. 829. a. Obferva-
iions fur la nécejjitê des richeffes pour la culture des grains.
Ibid. b.
Obfervations Jur la population foutenue par la culture des
grains. Si le nombre des hommes diminue d’un tiers dans un
é ta t , les richeAes doivent y diminuer des deux tiers. Etat
aâ u el de la population de la France. Si le royaume perdoit
encore quelques millions d’hommes , les richeffes aAuelles
y diminueroient exceffivement', &c. Ibid. 830. a. Obfervations
fur le prix des grains. L’affluence des étrangers augmente
les richeffes d’une nation , en foutenant par la con-
fommation le bon prix des productions de l’agriculture, &
en provoquant par le bon prix l’abondance de ces produc- '
lions. L ’abondance avec cherté eA opulence. La non-valeur
avec 1 abondance n’eA point richeffe : cette maxime démontrée
par l’état de quelques provinces. Ibid. b. Les villes &
les provinces d’un royaume ou les denrées font cheres, font
plus habitées que celles où toutes les denrées font à trop bas j
prix. Quand le commerce eA libre , la cherté des denrées
a néceffairement fés bornes Axées. Il n’en eA pas de même
de la non-valeur ou de la cherté des denrées caufées par le
défaut de liberté du commerce. L e bon prix ordinaire du
bié qui procure de A grands revenus à l’é ta t, n’eA point p réjudiciable
au bas-peuple. Les avantages du bon prix ne font
point détruits par l’augmentation dji falaire des ouvriers. C ’eA
un grand inconvénient d’accoutumer le peuplé à acheter le
blé à trop bas prix. C e qu’on entend ici par là cherté con-
Aderée comme avantageufe à l’état. Ibid. 831. a. Objeéfion :
la cherté n’eA avantageufe que pour les vendeurs, & elle
appauvrit ceux qui achètent : réponfe. C e t état de bon prix
a fubAAé en France , tant que nos grains ont été un objet
de commerce, que la culture dqs terres a été pro tégée, &.
que la population-a été nombreufe. Ibid. b. Sur les maladies
des grains, voyeç NlELLE.
Grains ( Agric. & Cornm.) culture des terres à menus
grains. I. 185. b. Récolte des grains. Suppl. IV . c9 i. a. Les
grains confidérés comme objet de commerce : de la police
des grains, IV . 53a. b. & fuiv. D u commerce, des grains.
VI. 5 3 4 .a , b , & c . Droit que quelques perfonnès ont dé
prendre fur les grains expofés en v en te , autant qu’on en
peut prendre avec la main. VIII. 63. a , b. Par qui eA
G R A
exercée à Paris la police fur le commerce des grains. IX
H 1.- ^ f u r e u r s de grains. X. 427. <r. Des porteurs dey
grains. XIII. 146. b. Police des grains en Angleterre. IV .
333. b. Balance des grains , voyez Balance d’essai»
Confervation des grains, v o ye z planche dAgriculture, vol. 1 des planches. — Voye^ Bled. ,
G rain triturer le, {C r it iq .f ic r f fX V l. 66 e. 1 ,
Grain de fin { Chyin. Ml: a il.) petit bouton de An qu’on
« t ire du plomb, &c qui doit fervir, à coupeller l’argent,
t^ette quantité pour, A petite qu’elle fo i t , fe trouve avec
e cu lo t qui ■ formé pnr ic cmmclicmcm ,!c ,1'argcut avec
“ JP"“ * > “ 1 augmente d i p.oids. Moyen de l'en dé<raer
dans la pelée du bouton de fin. Nécefiité de nrcnaillcr lo
Plomb trefiai. VII. M Il né fuffl, pas de s'èneklTuré
de la quantité d argent que contient lé.plomb , il faut aufii
examiner ro.it c e qui fert aux effais& qui peut être lbupconné
d en augmenter le bouton. Ibid. 832. a.
Gr ain, ( A r tm ilit.) opération donton fe fert pour corriger
le défauts des lumières des pièces de canon & mortiers qui
fe font trop elarg.es. Détails fur la maniéré de faire cette opération.
V IL 832. a. r
Grain (P o id s) En Allemagne, Angleterre Sc Hollande à
les grains font differens de ceux de France , voyez Poid s
FICTIF- | 3B ,dl! carat de diamans. Poids de femelle pour l’argent
Poids de la lentille & de l’aréole desRomains, du cholcus
des Grec s, &c. En pharmacie, le grain eA ordinairement le
plus petit poids : quelquefois cependant une drogue Ample
eA ordonnée a la quantité d’un demi-grain. Origine du mot
de grain. V i l. 832 .b.
G r a in , {Raffineur) VII. 833.1*.
Grain d orge, ( Médec.) maladie fréquente dans les cochons
qu on engraiffe. V I I . 833. a.
Grain dlorge, ( Tourneur) VII. 833.0.
Grain devent, ( Marine. ) VII . 833. a..
GRAINE. ( Botan: q. ) Quatre enveloppes que G rew a
ob.ervees dans les graines ou femences. Diverfités dans la
Agure des graines. V II . 833. a. Graine huileufe de plufieurs
plantes. Peaux de certaines graines verniffées d’un mucilage.
1 outes les graines font préfervées par des enveloppes: les
unes naiffent dans le cceur des fruits ; d’autres viennent
, , s des gouffes. 11 y en a qui ont de groffes coques de
hois. rumeurs ont fur leur coque un brou amer. Epiderme
de la graine. Leur Aruélure interne étant artiAement dév
elo p p ée , offre au microfcope mille chofes dignes d’admi,
ration. Obfervations microfcopiques faites fur la graine de
i angélique , fur le grand cardamome ou graine de paradis
Ibid. b. fur la graine du grand érable , appellé improprement
PomfieredB gr.tii.es de pav.o/vue a,, microfcope.,
Obfervations fur la fiiM ta c e farineqïj dés fè v e s , des pois
du froment, de l’orge & autres grains; fur les graines oîéa-
gineufes. Ouvrage aiiglois à cotiliilter fur ce fuièt. Remar-
qne eu faveur de ceux qui voudront s’attacher, it ces forrcs
dobfervauons. Il n’y a pas une feule plante dans, le monde
qui pu.fle fe produire fais graille. Ibid. 834. a. D ivers naturalises
qui ont découvert les graines de certaines plantes
capillaires, marines & autres. Confidération des diffirentes
votes dont fe fort ,1a natmé pour femér les grëines des
plantes aufli-tôt qu elles foui rnures. Lés unes font allez
pelantes Sc menues pôpr fomjiei droit en terré fans autre
lecours. D autres ont des petits crochets pour les emuê-
cher d e tte portées trop foin de leur place. D ’autres font
garnies d ailes. Il y en a qui font dardées aù ïom par une
efpece de rd ion . lbiJ. b. « La plante., dit. Plutarque, qui
” etoit cachée fous un petit v o lum e , acquiert une grande
» etendue, & rend fenfible avec le tems ce que les yeux
» ne pou voient appercevoir dans l’origine ». Obfervations
faites fur les parties, d’une feve , qui font comprendre ce
développement. Differentes parties contenues dans le
germe. Gomment arrive-t-il que la plume fort toujours de
jerre™ Y,n °A la,raC^Cule ? C onlultez là-deffus les hypothefes
de MM. D o d a rd , la H i r e , Geoffroi & autres. Ibid
83 3. a.
Graine. Aigrettes qu’on remarque dans quelque? graines.
1. 198. a Ailes de certaines graines. 212. b. Lobes des
graines. IX 624. b Radicule Sc plume de germe d’une
graine. A i l . 799. * Réceptacle des graines dans les plantes wBsBm3Sm MmËâ nés. A 1V . iSôi.a. Differentes Agures que la nature a données
aux graines pour qu’elles foient femées convenablement.
945. a. Defcription de la végétation d’une graine. VII.
046. a , b. — Voye[ SEMENCE.
Graine. ( Agricult. ) On diAingue les graines en potagères
, graines à fleurs & graines d’arbres. VÏI. 83 K f a . D i-
Ver p o .^ ervat‘ 0ns ^ur *a maniere dé femer chacune de
ces differentes graines, & fur les foinvqui doivent accom-
pagnej- cette opération d’agriculture. Parmi lès arbres qui
contribuent à l’embelliffement d’un jardin, on diAingue v
ceux qui portent des graines , & ceux qui portent des fnii*s
En quels tems les graines & les fouies fé recueillent. Ibid V
G R A
Choix des meilleures graines à femer. Differentes méthodes
pour conferver les graines. Pourquoi plufieurs fortes
de graines, perdent leur faculté de germe affez promptement
, tandis que d’autres là confervent un grand nombre
d’années. Moyen de conferver aux graines leur vertu v ég étative
: expériences de Miller fur ce fujet. Ibid. 83 6. a. Méthode
de faire fruftiAér toutes lesefpeces de graines domeAiques. 8c
étrangères , qui ont pour enveloppe les coques les plus dures.
Graine. Précautions,à^prendre pour le tranfport des graines
d’un pays à l’autre. X ll. 723. b. Opération de rayonner les
planches avant que de femer.les graines. XIII. 830. b. D e la
maniéré de femer les graines. X IV . 941. b. Soins qui concernent
la graine des fleurs. V I. 837. b.
G r a in e d’Avignon, ('Botan.) baie d’une efpece de rham-
nus o u . de nerprun. Lieux où elle croît. Defcription de
cette efpece de nerprun. Choix de la meilleure graine d’A -
vignon. Ufage qu’en font les teinturiers & les corroyeurs.
V IL 836. b.
G r a in e d'A vignon, ( Teinture) article fur ce fujet. X V I .
G r a in e doifèau, {Botan.) efpece de plante. Suppl. I.
900' b.: u i,-
G r a in e , {Jardin.) Différence entre les graines d’ornement
& les chapelets. Comment On les place dans les parterres.
V IL 836. b.
G r a in e , {Brodeur au métier) pdint qui repréfente les-fe-
mcnees.de fouit. Comment on l’exécute. V II . 8.36..b. .
G r a in e dépinars, ( Ruban. ) XII. 13 2. b. X V I. 423. a.
. GR A IN IER , voye^ Bl a t ie r . . .
G R A IN V IL LE , ( le pere de ) examen des preuves qu’il allégué
pour démontrer la certitude de la vifton célefle de Con-
il.iniin..XVII. 353. i . , .
G R A IR IE , ( Jurifpr.') droit que le roi a fur les..bois
d’autrui. Etymologie de ce mot. Différence entré graine
griiric. En quoi confifle le droit de grairic , félon Ràgueau.
Jurifdiétion attribuée aux officiers des eaux & forêts fur
lès bois tenus engrairie. Diverfes obfervations fur les.bois
fujets aux droits de grairie, Stfur tout ce qu’emporte ce droit.
V IL 837. a. . .
» Grairie, exercice de ce droit. V II . 971 . a. Différence entre ce
droit & celui de fégrairie. X IV . 891, a.
GRA IS ou grès, ( Minéral. ) pierre formée par l’affem-
blage de petits grains de fable. .11 fe trouve foit en maffe ,
foit par couches j il varie en coiiAAance ; quand il eA folide
il fait.fcu avec le briquet. VLI. 837. a. H uit efpeces de grais
diAinguées par Wallerius. O n s’en fert pour paver les rues de
Paris ; il s’en trouve ' beaucoup aux envii ons de Fontainebleau.
Ib id. b. .
- Grais. Efpece de grais nommé macigno. IX. 801. b. A r ticle
fur le g rais , fes efpeces , fes ufages , manière de
l ’employer en maçonnerie. 8 x1. b. Principale caufe de fa
dureté : diverfes autres obfervations fur cette efpece. de
pierre. 812. a. Comparaifon du grais & de la terre de la
Chine appellée pétuntfé. XIII. 119. a. Efpece de grais appellé
pierre de Portland. 13 2. a.
G r a is de Normandie , .{Minéral. 6*.Chyin. ) maniere de
lui donner la propriété de rougir au feu. C e grais eA com-
pofé d’une terre glaife & d’un petit fablon blanc.. . O n la
tire de la terre près de Domfront.. . . O n trouve dans
les trous d’où on l’a tirée des poiflbns qui ne viennent , ni
de riv ie re', ni d’étangs, ni d’aucune. eau courante. Méthode
pratiquée j pour l’employer. V IL 837., b. Maniere
de faire des vaiffeaux de ce grais qui fuppportent la plus
grande violence du feu & le refroidiflement le plus fubit.
Ibid. 838. æ.
G r a i s , ( Miroitier-lunetier) quel eA celui que cesartiAes
emploient. Ufage qu’ils en font. V IL 838. a.
GRAISSE. {Econom. anim. Médec.)D e u x fortes de graiffes;
l ’une eA un fuc graiffeux qui ne fe Age prefque point à
Pair froid ; V IL 838. a. l’autre a une confiAance prefque
folide. Différens noms qui les • diAinguent en grec & en
latin. Différentes efpeces de moelle par rapport à la confiAance.
Cellules membraneufes dans lefquelles la graiffe
-eA renfermée. Membranes adipeufes. La graiffe eft é videmment
de la nature des huiles grades; mais outre la
fùbAance huileufe , il s’y trouve encore une fubAance. ter-
reufe , ac ide, qui donne à la graiffe froide , la confiAance
qu’elle eA fufceptible de prendre. Obfervations de M. Car-
theufer fur lefquelles il appuie ce fentiment. lbid. .b. ,h c s
animaux qui v ivent de viandes s’engraiflènt plus difficilement
que ceux qui ne viv ent que d’herbes ou de grains.
Les parties huileules qui font deAinées à fournir la matière
de la g raiffe, font pour cet effet féparées de la maffe.du
Aing, comme la matière de toutes les .autres fecrétions..
C ’eA dans la partie où l’artere fe change en veine que fe
fait la féparation des molécules huileufes. Pourquoi les molécules
huileufes du fang doivent enfiler les conduits adipeux
, tandis que les globules du fang continuent leur
route. Formation de la graiffe. Ibid. 839. a. Caufes qui con- I
G R A 859
coûtent a cette, formation. Quelques-uns ont .cru que les
Aies, geaifieux reportés dans la maffe des humeurs , -étoient
principalement deAinés à contribuer à la formation des g lobules
rouges du fang, & par conféquenï: à la .nutrition,
Ibid. b. La trop grande .clialeur animale & i ’agjtation ex-
tfaordioaire. des humeurs , r rendènt la graiffe plus fluide 9
Sc la font rentrer plus .promptement de fes cellules, dans
la maffe . des humeurs. Malplghi prétend que la graiffe reportée
dans le fang y eA fur-tout deAinée à en adoucir
l ’acrimonie ; mais l’obfervation .parjoît contraire à ce fentiment.::%
eA plus vraifemblable que ces parties huileufes fervent
dans le fang à la. formation de la bile & des "autres
bumeuts dans la compofition defquclles il entre de ccs parr
ties., Les. ufages. de. la gtaifle for le fq u e l^ l n’y a pas de
ContéOation ,, font tous .relatifs à des, effets particuliers tor
piqueSi Elle defend le corps des injures du fooitl. Ellèconr
tribye a 1 lav;b'eauté. Ibid. 840. a. Elle entretient, une certaine
flexibilité , une mioïleffe..convenable, dans .la peau.
Elle procure aux mufcles une; foupleffe néceflaire à leur
aélion. Elle facilite la .fortie dès excrémens --..elle tient lieu
de eouAinet. Elle ne paroît manquer: que dans les parties
où eljle fe.roit nuifible. Caufes qui peuvent augmenter le
volume d’un homme du double. Ibid. b. Sur les mauvais effets
d e là graiffe Sc Jes moyens d’y remédier, voyeç Corpulence
,,Obésité.
G raisse. Corrections à faire à cet article de l’Encyclopédie;
La.graiffe humaine, le fu i f , la moelle , donnent au feu une
liqueur volatile , empyreumatique & acide. Comment la
graiffe èA féparée du fang. Etat.de la graiffe dans le (oetns.Siipp1..
l l l . 249. a. Parties où élle-fe forme dans les enfans. Parties où
i! ne s’en forme jamais. Son état naturel eA la fluidité : confiAance
qu’elle .acquiert dans. certains animaux .& dans certaines
parties principalement , caufes de l’embonpoint. Comment
on ie procure aux. animaux. Gaufes qui font rentrer
la graiffe dans le fang , & produifent la maigreut . Ibid. b.
. Graiffe , v o y e z A dipeux. Pourquoi la graiffe eft infenfL
ble.. IL 807. b. Différens ufages de la graille dans le corps
de, l’animal. IL 808. a. V I I I . 263,. b. Graiffe dont les in-
teflins font humeétés pour favorifer leur mouvement pé-
riflaltique. 841. a. O rigine de la graiffe. Suppl. 1. 170. a. Suppl.
III. 6cf.'b'r ii;
Graissé. ( Dïet. Pharm. Mat. médic. ) Les chairs pénétrées
ou mêlées de, graiflè font raffafiantes & indigeAes. Comment
.ces . viandes -deviennent. fupportables. Graiffbs employées
intérieurement de différentes maniérés à titre de
reuiede.-Elles font la bafe.des pomades, onguens, &.c. On
a attribué des vertus particulières à certaines graiffes. Préparation
des graiffes qu’on veut conferver pour les ufages médicinaux.
VU . 841. a. -
Graiffe. Maniere de fondre celle de la baleine. IL 34. b.
Graiffe de porc. 568. b. Ufages de la graiffe de chien. III.
331. a , b. La graiffe employée comme réduétif en métal-
iu rg 1 c .v 1 .9 14 . i.
G raisse du vin., ( Econom. dornefl. ) nature de cette huile
qui paroît quelquefois dans le vin. D ’où vient ce défaut. Ma-
niere d’.y porter remede. Suppl. III. 250. a.
G RA ISSER, {Artméchan.) il eA abfolument néceffaire
de graiffer les grandes machines. Nécefiité de mettre de
l’huile aux petites. Manière de graiffer les premic-res ,
Suppl. III. 230. b. par rapport aux fécondés , voye£ Huile ,
{Horlog. )
G R A lT Z ou Greit^ & proprement Grewirz , .( Géogr.)
ville d’Allemagne dans la Haute-Saxe. Son origine. Sa fitua-
tion. Seigneurie dont elle eA capitale. Defcription de cette
ville. Suppl. III. 230. b.
. G R A M , ( Hifi. de Danem. ) roi de Danemarck. Tableau
de fon régné. Suppl. III. 230. b.
G R AM E N Parnajfi. Defcription de cette plante. Lieux où
elle vient»On la feme fur couche, &c. V IL 841. a.
G RAMIN ÉES, {Botan.) caraétere des plantes de cette
famille & de cet ordre. Leur divifion en gramens proprement
dits ; & en plantes analogues aux gramens. Caraéleres
qui les diAinguent. Suppl. III. 231.17.
G R AM M A IR E , étymologie .de ce mot. Uue faine logique
eA ■ le fondement de . la grammaire. II. doit y avoir
des principes fondamentaux communs à toutes les langues,-
Aucun mot ne devient le figne d’iuie idée; que par uae
conyention tacite, mais, libre. Il y a.une. égale liberté fur
le choix- des moyens que l’on peut employer pour exprimer
la corrélation des . mots , & celle de leurs idées :.mais
les conventions une*fois adoptées , il.fau t , s’y- foumettre,
La grammaire admet donc deux fortes de principes ; les
uns d’une vérité immuable & d’un ufage univerfel, les autres
d’une vérité hypothétique & dépendante de conventions
libres. Les premiers conAituent la grammaire généra
le ; les autres font l’objet des. d iverfes .grammaires particulières.
VII. 841. b. Définition de ces deux différentes
grammaires. La première eA .une. feience , . la. fécondé eA
un art. Malgré cette diAinéHon, on ne fauroit féparer l’étude