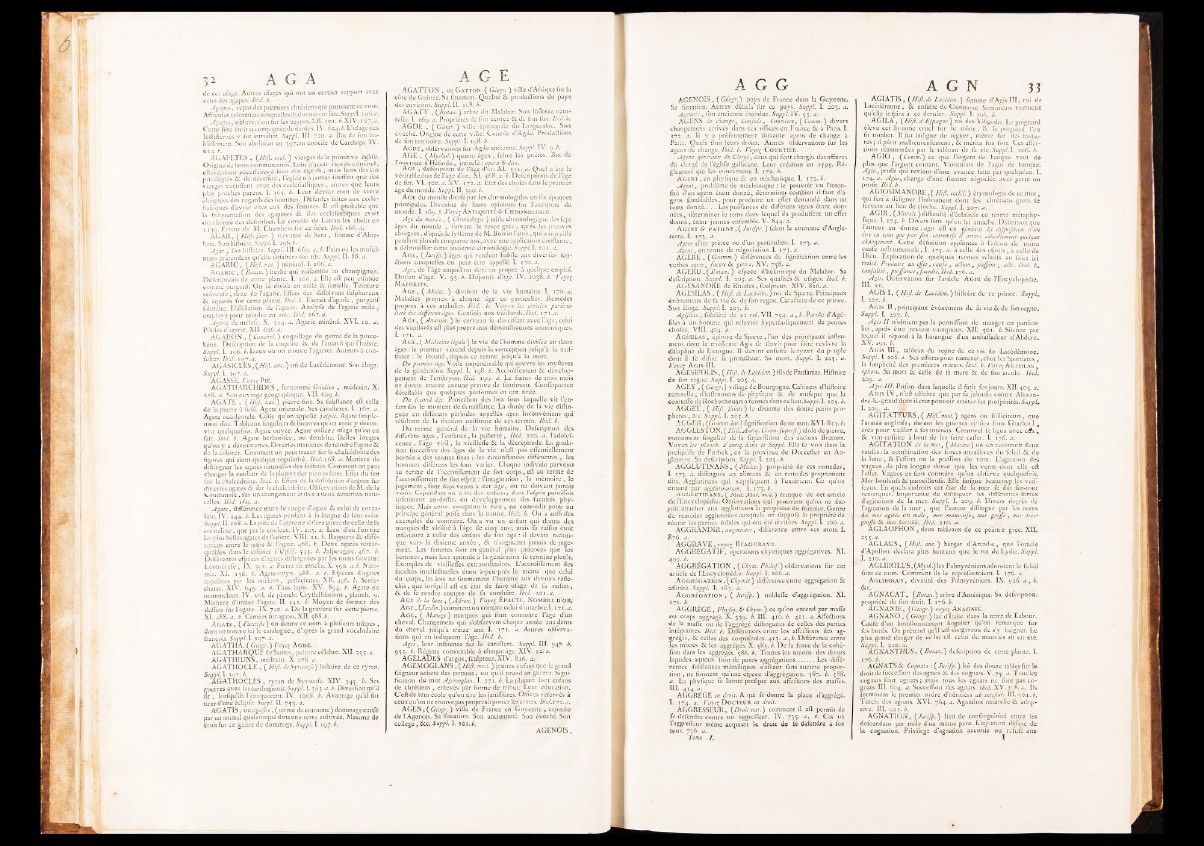
3^ A G A
de cet ufagè. Autres ufages qui ont un certain rapport avec
celui des agapes. Ibid. b.
Agapes, repas des premiers chrétiens qui portoient ce nom.
Aftreufes calomnies auxquelles ils donnèrent lieu.Swpp. 1. 196.0.
Agapes, oblervation lur les'agapes. XII. 501. b. X IV . 127.0.
Cette fête étoit accompagnée de danfes. IV . 624. é. L’ufagcdes
leétifternes y fut introduit. Suppl. III. 720. a. But de fon éta-
bliffement. Son abolition en 397ijau concile de Cartilage. IV .
624. b.
A G A P E T E S , (Hijl. eccl. ) vierges de la primitive églife.
Origine de leurs communautés. Loin d’avoir rien de criminel,
elles croient néceflàiresà bien des égards ; mais hors des cas
privilégiés & de nécefliré , l’églifen’a jamais fouffert que dés
vierges vécuffent avec des eccléfiaftiques , autres que leurs
plus proches parens. I. 165. b. Leur devoir étoit de v ivre
éloignées des regards des iiommes. Défenfes faites aux eccléfiaftiques
d’avoir chez eux des femmes. Il eft probable que
la fréquentation des agapetes & des eccléfiaftiques avoit
occafionné des défordres. Le concile de Latran les abolit en
1139. Erreur de M. Chambers fur ce fujet. Ibid. 166. a.
A G A R , ( Hijl.facr. ) fervante de Sara , femme d’Abra-
ham. Son hiftoire. Suppl. 1. 19 6. b.
A«ar , fon hiftoire. Suppl. III. 669. a, b. Puits où les m ufuL
mans prétendent qu’elle délaitera fon fils. Suppl. II. 88. a.
A G A R IC , (H ijl. nat. ) minéral. I. 166. a.
A g a r i c , ( Botan. ) herbe qui reffemble au champignon.
Defcriptions de cette plante. I. 166. a. Elle eft peu emmée.
comme purgatif. O n la divife en mâle & femelle. Teinture
léfineufe, tirée de l’agaric. Effets des diffolvans fulphureux
& aqueux fur cette plante. Ibid. b. Extrait d’agaric , purgatif
falutaire. Diftillation de l’agaric. Analyfe de l’agaric mâ le ,
employé pour teindre en noir. Ibid. 167. a.
Agaric de mélefe. X. 314. a. Agaric minéral. X V I . 10. a.
Pilules d’agaric. XII. 626. a'.
A G A R O N , ( Conchyl. ) coquillage du genre xle la porcelaine.
Delcription de la coquille & de l’animal qui l ’habite.
Suppl. I. 196. b. Lieux où on trouve l’agaron. Auteurs à con-
fulter. Ibid. 197.0.
A G A S IC L È S , ( Hijl. anc. ) roi de Lacédémone. S on éloge.
Suppl. 197- I ’
AG ASSE. Voyez Pif..
A G A TH A R CH ID E S , furnommé Gnidien , médecin. X.
278. a. Son ôuvrage géographique. VII . 609. b.
A G A T E , ( Hijl. nat?) pierre-fine. Sa fubftance eft celle
de la pierre à fufil. Agate orientale. Ses caraéteres. I. 167. a.
Agate occidentale. Celle qu’on appelle jafpée. Agate fin ale ment
dite. T ableaux finguliers & bizarres qu’on croit y découv
rir quelquefois. Agate onyce. Agate oeillée ; ufage qu’on en
fait. Ibid. b. Agate herborifée, ou dendrite. Belles images
qu’on y a découvertes. Diverfes maniérés de teindre l’agate &
de la colorer. Comment on peut tracer fur la chalcédoiné des
figures qui aient quelque régularité. Ibid. 168. a. Maniéré de
diftinguer les agates naturelles des faéfices. Comment on peut
changer la couleur de la plupart des pierres fines. Effet du fen
fur la chalcédoiné. Ibid. b. Effets de la di/Tolurion d’argent fur
diverfes agates & fur la chalcédoiné. Obfervations de M. de la
Condamine, fur un changement arrivé à deux dendrites naturelles.
Ibid. 169. a.
Agate, différence entre le rouge d’agate & celui de cornaline.
IV . 244. b. Les agates perdent à la longue de leur éclat.
Suppl. II. 108. a. La pâte de l’agare ne différé guere de celle de la
' cornaline, que par la couleur. IV . 245. a. Lieu d’où l’on tire
les plus belles agates de l’orient. V II I. 21. b. Rapports & différences
entre le jafpe & l’agate. 466. b. Deux agates remarquables
dans le cabinet d’Upfal. 53s. b. Jafpe-agate. 467. b.
Différentes efpeces d’agates diftinguèes par les noms fuivans :
Léontérefe , IX. 39r. a. Pierre de mocka.X. 590. a. b. Nico-
mia. XI. 136. b. Agate-onyx. 488. a. b. Efpeces d’agates
appellées par les anciens, paflachares. XII. 496. b. Sarda-
chates. X IV . 649. a. b. Taos lapis. X V . 894. b. Agate en
mammeloçt,s. IV . vol. de planch. Cryftallifations , plancli. 9.'
Maniéré d’imiter l’agate. II. 542. b. M oy en de former des
deflins fur l’agare. IX. 740. a. D e la gravure fur cette pierre.
X I. 488. a. b. Camées fur agates. X II. 588.b.
A g a t e , ( Fleurijle) on donné ce nom à plufieürs tulipes ,
dont on trouve ici le catalogue, d’après le grand vocabulaire
françois. Suppl. I. 197. a.
A G A T H Â . ( Géogr. ) Voyez A g d e .
A G A T H A R Q U E de Samos, peintre célébré. XII. 255.0.
A G A T H IU N S , médecin. X. 278. a.
A G A T H O C L E , ( Hijl. deSyracufe) hiftoire de ce tyran.
Suppl. 1. 197. b.
A G A TH O C L È S , tyran de Syracufe. X IV . 245. b. Ses
guerres avec les carthaginois. Suppl. I. 563.0. b. D iverfion qu’il
f i t , lorfqu’ils l’attaquerent. IV . 1068. b. Avantage qu’il fut
tirer d’une éclipfe. Suppl. II. 753. 0.
A G A T I S , ou agajlis, (terme de coutume) dommage caufé
par un animal quelconque dans une terre cultivée. Maxime de
droit fur ce genre dç dommage. Suppl. 1. 197. b.
A G E
A G A T T O N , ou Gatton ( Géogr. ) v ille d’Afrique fur la
côte de Guinée. Sa fituation. Qualité & productions du pays
des environs. Suppl. II. 198. b.
A G A T Y , (Botan.) arbre du Malabar. Son hiftoire naturelle.
I. 169. a. Propriétés de fon écorce & de fon fuc. Ibid. b.
A G D E , ( Géogr. ) v ille épifcopale du Languedoc. Son
évêché. Origine de cette ville. Concile d’Agde. Productions
de fon territoire. Suppl. 1. 198. b.
A gde , obfervations fur Agde ancienne. Suppl. ïV . 9. b.
A G E , ( Mythol. ) quatre âges , . félon les postes. But de
l’ouvrage d’H éfiode, intitulé : opéra 6» dies.
A ge , defeription de l’âge d’or. XI. 531. a. Q uel a été le
véritable état de l ’âge d’or. XI. 368. a. b. Defcriptions de l’âge
de fer. V I . 500. a. X V . 172. a. État .des chofes dans le premier
âge du monde. Suppl. II. 3 90. b.
A ge du monde divifé par les chronologifîes en fix époques
principales. -Diverfité de leurs opinions- fur l'antiquité du
inonde. 1. 169. b. Voyez A ntiquité «S1 C hronologie.
Age du monde, ( Chronologie ) table chronologique des fept
âges du monde , fuivant le texte g r e c , après les preuves
abrégées, d’après le fyftême de M. Boivin l’aîné, qui a travaillé
pendant plus de cinquante ans, avec une application confiante,
à débrouiller cette ancienne chronologie. Suppl.l. 201. a.
A ge, (Jurifp.) âges qui rendent habile aux diverfes fonctions
auxquelles on peut être appellé. L 170. a.
Age, de l’âge auquel on devient propre à quelque emploi.
D o y en d’âge. V . 93. b. Difpenfe d’âge. IV . 1038. b. Voyez
Majorité.
A ge , ( Médec. ) divifion de la vie humaine.-1. 170.0.
Maladies propres à chaque âge en particulier, Remedes
propres à ces maladies. Ibid. b. V o y e z les articles particuliers
des différens âges. Confeils aux vieillards. Ibid. 171.0.
A ge, ÇAnatom. ) le cerveau fe durciflàfit avec l’âg e, celui
des vieillards eft plus propre aux démonftrations anatomiques.
I. 17 1. a . _■ , v ' ■ '
A ge, (Médecinelégale) la vie de l’homme divifée en deux
âges : le premier s’étend depuis la conception jufqu’à la naif-
fance : le fécond, depuis ce terme jufqu’à la mort.
Du premier âge. V o ile impénétrable qui couvre lés myfteres
de la génération. Suppl. I. 198. b. Accroiffement & développement
de l’embryon. Ibid. 199, a. L e foetus de trois mois
ne donne encore aucune preuve de fentiment. Conféquence
déteftable que quelques perfonnes en ont tirée.
D u fécond âge. Protection des loix fous laquelle v it l’enfant
dès le moment de fa naiffance. La durée de la v ie diftin-
guée en différens périodes appellés âges. Inconvéniens qui
réfultent de. la fixation uniforme de ces termes. Ibid. b. .
D u terme général de la v ie humaine. Defeription des
différons âges , l’enfance, la puberté , Ibid. 200. 0. l’adolef-
cence , l’âge v i r i l , la vieilleffe & la décrépitude. La gradation
fucceflive des âges de la v ie n’eft pas effentiellemént
bornée à des termes fixes : les circonftances différentes , les
hommes différens les font varier. Chaque individu parvenu
au terme de raccroiffement de fon corps, eft au terme de
l’accroiffement de fon efprit : l’imagination , la mémoire , le
jugement, font déjà venus à cet âg e , ou ne doivent jamais
venir. Cependant on a v ii des enfans, dont Fefbrit paroiffoit
infiniment au-deflùs du développement des facultés phy-
fiques. Mais cette exception fi rare., ne contredit point un
principe général puifé dans la. nature. Ibid. b. On a aufti des
exemples du contraire. O n a vu un enfant qui donna des
marques de virilité à l’âge de cinq ans ; mais fa raifon étoit
inférieure à celle des enfans de fon âge : il devint rachitique
vers la dixième année , & n’augmenta jamais de jugement.
Les femmes font en général plus précoces que les
hommes, mais leur aptitude à la génération fe termine p lutôt;
Exemples de vieilleuës extraordinaires. L’accroiffement des
facultés intellectuelles étant à-peu-près le même que celui
du corps, les loix ne foumettent l’homme aux devoirs réfléchis
, que lorfqu’il eft en état de faire ufage de fa raifon,
& de le rendre compte de fa conduite. Ibid. 201.0.
A ge de la lune, ( AJlron. ) Voyez Épacte, Nombre d’or.’
A g e , (Jardin?) comment on compte celui d’unarbre.1. 17 1.0.
A ge , ( Manège ) marques qui font connoître l’âge d’un
cheval, Changemens qui s’obfervent chaque année aux dents
du cheval jufqu’à treize ans. I. 17 1. 0. Autres obfervations
qui en indiquent l’âge. Ibid. b.
Ages, leur influence fur le caraCtere. Suppl. III. 947. bl
952. b. Régime convenable à chaque âge. X IV . 12. a.
AG E L A D È S d’argos, fculpteur. X IV . 816. 0.
A G ÉM O G L A N S , (Hijl. mod. ) jeunes enfans que le grand
feigneur acheté des tartares, ou qu’il prend en guerre. Signification
du mot Agèmoglan. I. 17 1. b. La plupart font enfans
de chrétiens , enlevés par forme de tribut.; Ifeur éducation.
C ’eft de leur école qu’on tire les janiffaires. Offices réfervés à
ceux qu’on ne trouve pas propres à porter les armes. Ib td .iji.a .
A G E N , ( Géogr. ) v ille de France en.-Guyenne , capitale
de TAgenpis. Sa fituation. Son ancienneté. Son évêché. S on
co lle g e , & c , Suppl. I. 202. b.
A G E N O ÏS ,
A G G
A G E N O IS , ( Géogr. ) pays de France dans la Guyenne.
Sa fituation. Autres details fur ce pays. Suppl. I. 203. 0.
Agenois, fon ancienne étendue. Suppl. IV . 53. 0.
A G EN S de change, Confuls, Courtiers, (Comm.) divers
changemens arrivés dans ces offices en France 8c à Paris. I.
172. æ. Il y a préfentement foixante agens de change à
Paris. Q uels font leurs droits. Autres obfervations fur les
agens de change. Ibid. b. Voye\[ Courtier.
Agens généraux du Clergé, ceux qui font,chargés des affaires
du clergé de l’églifo gallicane. Leur création en 1595. Ré-
glemens qui les coricernènt. I. 172. b.
A gent , en phyfique 8c en méchanique. I. 172. b.
Agent, problème de méchanique : 1e pouvoir ou l’inten-
fité d’un agent étant donné, déterminer combien il faut d’a-
gens femblables, pour produire un effet demandé dans un
tems donné.. . . Les puiffances de différens agens étant données
, déterminer le tems dans lequel ils produifent un effet
donné, étant jointes enfemble. V . 844.0.
A gent 6* patient , ( Jurifpr. ) félon la coutume d’Angle-
• Agent d’un prince ou d’un particulier. I . 173. a.
Agent, en terme de négociation. I. 173. 0.
A G E R E , (Gramm.) différences de fignification entre les
verbes agere, facere 8c gerere. X V . 758. 0.
A G E R U , ( Botan. ) efpece d’héliotrope du Malabar. Sa
defeription. Suppl. I. 203. 0. Ses qualités & ufages. Ibid. b.
A G E SA N D R E de Rhodes, fculpteur. X IV . 816.0.
A G E S ILA S , ( Hijl. de Lacédém. ) roi de Sparte. Principaux
«tvénemens de fa vie & de fon régné. Caraétere de ce prince.
Son éloge. Suppl. I. 203. b.
Agèfilas , fobriété de ce roi. V I L 754. a , b. Parole d’A gé -
filas à un homme qui relevoit hyperboliquement de petites
chofes. VIII. 404. 0.
A gésilas , éphore de Sparte , l’un des principaux inftru-
xnens dont le troifieme Agis fe fervit pour faire rev ivre la
difcipline de Licurgue. Il devint enfuite le tyran du peuple
dont il fe difoit le protecteur. Sa mort. Suppl. I. 205. 0.
Voyez A gis III.
AGÉSIPOLIS ,(HiJl. de Lacédém.) filsdePaufanias. Hiftoire
de fon régné. Suppl. I. 205.0.
A G E Y , ( Géogr. ) village de Bourgogne. Cabinets d’hiftoire
naturelle, d’inftrumens de phyfique 8c de mufique que la
comteffe de R ochechouart a formés dans ce \ïeu.Suppi.l. 205. b.
. A G G É E , ( Hijl. faïnte) le dixième des douze petits prophètes
, 8cc. Suppl. I. 205. b.
A G G E R , (Gramm. lat.) fignification de ce mot. X V I . 823. b.
A G G L E S T O N , ( Hijl. Antiq. Cérém.fuperjl.) idole de pierre,
monument fingulier de la fuperftition des anciens Bretons.
V o y e z les planch. d’antiq. dans le Suppl. Elle fe voit dans la
prefqu’ile de P u rb ek , en la province de Dorcefter en A ngleterre.
Sa defeription. Suppl. I. 205. b.
A G G L U T IN A N S , (Médec.) propriété de ces remedes, .
I. 173. 0. diftingués en alimens 8c en remedes proprement
dits. Agglutinans qui s’appliquent à l’extérieur. C e qu’on
entend par agglutination. I. 173. b.
A g g lu t in a n s , ( Méd. Mat. méd.) critique de cet article
de l’Encyclopédie. Obfervations. qui prouvent qu’on n e fau-
xo it attacher aux agglutinans la propriété de fortifier. Genre
de remedes agglutinans auxquels on fuppofe la propriété de
réunir les parties folides qui ont été divifées. Suppl.1. 206.0.
A G G R Â N D IR , augmenter, différence entre ces mots. I.
.876. 0.
A G G R A V E , voyez R é a g g r a v e .
A G G R É G A T IF , opérations chyiniques aggrégatives. XI.
‘499- .
■ A G G R É G A T IO N , ( Chym. Philof. ) obfervations fur cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. I. 206. a.
A ggrégation , ( Chymie) différence entre aggrégation 8c
affinité. Suppl. I. 183. 0.
A ggrégation , ( Jurifp. ) nobleffe d’aggrégadon. XI.
;Ï7XA
G G R É G É , Phyjiq. & Chym. ) ce qu’ on entend par maffe
•ou corps aggrégé. X. 339. b. III. 410.'^; 4 1 1 . 0. AffeCtions
d e la maffe ou de l’aggregé diftinguèes de celles des parties
intégrantes. Ibid. b. Différences entre les affrétions des ag-
grégés, & celles des corpufcules. 413. a , b. Différence entre
le s mixtes 8c les aggréges. X . 585. b. D e la force de la cohé-
ik>n- dans les aggrégés. 586. b. Toutes les unions des divers
liquides aqueux font de pures aggrégations............Les différentes
fubftances métalliques s’alliant <ans aucune proportion
, ne forment qu’une efpece d’aggrégation.. 587. b. 588.
a. La phyfique fe borne prefque aux affrétions des maffes. '
III. 414.0. •••*' - ^
A G G R ÉG É en droit. A qui fe donne la place d’aggrégé.
I . 174. 0. Voyez.D o c te u r en droit..
A G G R E S S E üR , (Droit nat.) comment il eft permis de
fe défendre contre un aggreffeur. IV . 735- a, b.. Cas où
l ’aggreffeùr même acquiert le drpit de fe défendre à fon
îpur. 736. 0.
Tome ƒ,
A G N 33
A G IA T I S , (H ijl.d e Lacédém.) femme d’A gis m , roi de
Lacédémone, & enfuite de Cléomene. Semimens vertueux
qu’elle infpira à ce dernier. Suppl. I. 2.06. b.
A G I L A , (Hijl. d'Efpagne ) roi des Vifigoths. Le poignard
élev a cet homme cruel lu r le trô ne, & le poignard l’en
fit tomber. 11 fut indigne de régner, même fur des barbares
; il périt malheureufement, oc mérita fon fort. Ces affer-
tions démontrées par le tableau de fa vie. Suppl. I. 206. b.
A G I O , (Comm.) ce que l’argent de banque vaut de
plus que l’argent courant. Variations de l’agio de banque.
A gio , profit qui revient d’une avance faite par quelqu’un. I.
174. 0. Agio, change d’une fomme négociée avec perte ou
profit. Ibid.b..
AG IO S IM AN D R E , ( H ifila cÜ f. ) étymologie de ce mot
qui fort à défigner l’inftrument dont les chrétiens grecs fo
fervent au lieu de cloche. Suppl. I. 207. 0.
A G IR , (Morale ) difficulté d’éclaircir c e terme mètaphy-
fique. I. 174. b. D ivers fens qu’on lui "attache. Définition que
1 auteur en donne : agir eft -en général la difpofition d’un
etre en tant que par fon. entremife il arrive afluellement quelque
changement. Cette définition appliquée à l’aétion de toute
caufe inftrumentale, I. 17 c. 0. à celle,, des efprits, à celle de
Dieu. Explication de quelques termes relatifs au fujet ici
traitè. Produire un effet, caufe , aflion, pajjion , a(le. Ibid. b.
caufalité , putffançe , faculté. Ibid. 176. a.
Agir. Obfervation fur l’article A gir de l’Encyclopédie.
III. xv .
A G IS I , (H ijl. de Lacédém. ) hiftoire d e ce prince. Suppl.
I. 207. b.
A gis I I , principaux événemens de fa vie & de fon régné.'
Suppl. I. 2.07. b.
Agis I I n’obtient pas la permiflïon de manger en particulier,
après être revenu vainqueur. XII. 501. b. Silence par
lequel il répond à la harangue d’un ambaffadeur d’Abdere.
X V . 191. b.
A gis I I I , tableau du régné de ce roi de Lacédémone.
Suppl. 1. 208.0. Ses efforts pour ramener, chez les Spartiates ,
la fimplicité des premières moeurs. Ibid. b. Voyez A gésilas „
éphore. Sa mort 8c celle de fa mere & de fon aïeule. Ibid.
209. 0.
Agis I II . Prifon dans laquelle il finit fes jours. XII. 503.0;
À Gis I V , n’eft célébré que par fa jaloufie contre Alexan-
dre-lc'-grand dont il crut pouvoir arrêter les profpérités. Suppl.
I. 200. 0. a
| A G IT A T E U R S , (Hijl?m od.) agens ou folliçiteurs, que
l’armée angJoife, durant les guerres civiles fous Charles I ,
créa pour v eiller à fes intérêts. Cromwel fe ligua avec effx ,
& vint enfuite à bout de les. faire cafter. I. 176. 0.
. A G IT A T IO N de la mer, (Marine)jon en reconnoît deux
eau fes : la combinaifon des forcés attractives du foleil 8c de
la lu n e , & l’effort ou la preflion du vent. L’agitation des
v agu es , de plus longue durée que les vents dont elle eft
l’effet. Vagues en fens contraire qu’on obferve quelquefois.
Me r houleufe 8c patouilleufo. Elle fatigue beaucoup les vaifi-
féaux. En quels endroits cet état de la mer fe fait fur-tout
remarquer. Importance de diftinguer les différentes fortes
d’agitations de la mer. Suppl. I. 209. b. Divers degrés de
l’agitadon de la mer , que l’auteur diftingue par les noms
de mer agitée ou mâle, mer mauvaife, mer grojfe, mer tr'es-
groffe 8c mer horrible. Ibid. 210. a.
A G L A O P H O N , deux tableaux de ce peintre grec. XII.
À G L A U S , (H ijl. anc.) berger d’A rc ad ie , que l’oracle
d’Apo llon déclara plus heureux ,que le roi fie Lydie. Suppl.
I. 21Q. 0..
A G L IB O LU S , (Myth.) les Palmyréniens adoroient le foleil
fous ce nom. Comment ils le repréfentoient. I. 176. 0.
AGLIBOLUS, divinité des Palmyréniens. IX. 926. 0 , b.
8c c.
A G N A C A T , (Botan.) arbre d’Amérique. Sa defeription.
propriété de fon fruit. 1 . 176. b.
A G N A N IE , (Géogr.) voyez A n a gn ie .
A G N A N O , ( Géogr. ) lac d’Italie dans la terre de Labour.
Caufe d’un bouillonnement fingulier qu’on remarque fur
fes bords. On prétend qu’il eft dangereux de s’ y baigner. L e
.plus grand danger de ce lac eft celui du mauvais air en été.
Suppl. I. 210. 0,..
A G N A N T H U S , (Bo ta n.) defeription de cette plante. I.
176. b.
A G N A T S & Comats : ( Jurifp. ) loi des douze tables fur le
droitdefucceffion desagnatsSc des cognats. V . 75. a. Tous les
cognats font agr.ats ; mais tous les agnats ne font pas cognats.
III. 604. 0. Succeflion des agnats. Ibid. X V . 200. a. Us
formoient le premier ordre d’héritiers ab intejlat. IlL 901.
Tutele des agnats. X V I . 764. 0. Agnation naturelle 8c adoptive.
HI. 901. b.
A G N A T IO N , (Jurifp. ) lien de confanguinité entre les
defeendans par mâle d’un même pere. L ’agnation différé de
la cognation. Privilège d’agnation accordé ou refùfé aux