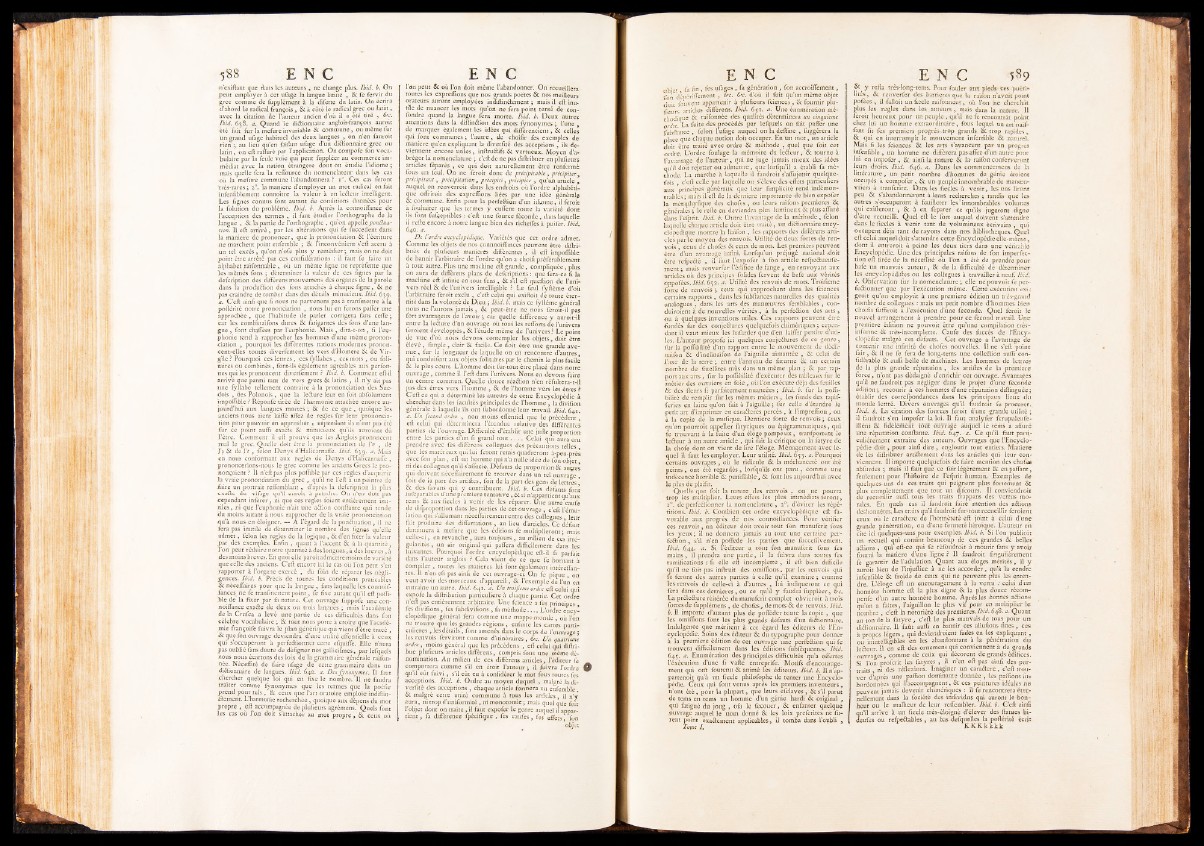
1«8 E N C
■ n’exiftant que dans les auteurs , ne change plus. Ibid. b. On
jpeut employer à cet ufage, la langue latine , 8c fe fervir du
grec comme de fupplèment à la difette du latin. On écrira
d’abord le radical François., 8c à côté le radical grec ou latin,
a v e c la citation de l’auteur ancien d’où il a été tiré , &c.
Ibid. 638. a. Quand l e diélionnaire anglois-françois auroit
été fait fur la mefure invariable & commune , ou même fur
un grand ufage habituel des deux langues , on n’en fauroit
rien ; au lieu qu’en faifant ufage d’un diéHonnàire grec ou
latin on eft raffuré par l’application. O n compoFe fon vocabulaire
par la feule voie qui peut ûippléer au commerce immédiat
avec la nation étrangère dont on étudie l’idiome ;
mais quelle fera la reffource du nomenclateur dans les cas
où la mefure commune l ’abandonnera ? i° . Ces cas feront
'très-rares ; 20. la maniéré d’employer un mot radical en fait
infenfiblement connoître la valeur à un leéteur intelligent.
Les figues connus font autant de conditions données pour
la folution du problème. Ibid. b. Après la connoiffance de
l’acception des termes , il faut étudier l’orthographe de la
langue , 8c la partie de l’orthographe , qu’on appelle ponElua-
tion. U eft arriv é, par les altérations qui fe fuccedent dans
la maniéré dé prononcer, que la prononciation 8c l’écriture
11e marchent point enfemble ; 8c l’inconvénient s’eft accru à
un tel e xcès, qu’on n’ofe plus y remédier ; mais on ne doit
point être arrêté par ces confidérations : il faut fe faire un
alphabet raifonnable , où un même figne ne repréfente que
le s mêmes fons ; déterminer la valeur de ces fignes par la
defeription des différens mouvemens des organes de la parole
dans la produélion des fons attachés à chaque figne, 8c ne
pas craindre de tomber dans des détails minutieux./Æid. 639.
a. C ’eft ainfi que fi nous ne parvenons pas à tranfmettre à la
poftérité notre prononciation , nous lui en ferons paffer une
approchée, que l’habitude de parler corrigera fans cèfTe ;
car les combinaifons dures 8c fatigantes des fons d’une langue
, font chaffées par l’euphonie. Mais , dira-t-on, fi l’euphonie
tend à rapprocher les hommes d’une même prononciation
, pourquoi les différentes nations modernes prononcent
elles toutes diverfement les vers d’Homere 8c de V ir g
ile ? Pourquoi ces le ttres , ces fyllabes , ces mots , ou foli-
taires ou combinés, font-ils également agréables aux perfon-
hes qui les prononcent diverfement ? Ibid. b. Comment eft-il
arrivé que parmi tant de vers grecs & latins , il n’y ait pas
line fyllabe tellement contraire à la prononciation des Suédois
, des Polonois , que la leéture leur en foit abfolument
impoffible ? Réponfe tirée de l’harmonie attachée encore aujourd’hui
aux langues mortes ; 8c de ce q u e , quoique les
anciens nous aient laiffè allez de réglés fur leur prononciation
pour pouvoir en approcher , cependant ils n’ont pas été
fur ce point auffi exaéts 8c minutieux qu’ils auroient dû
l ’être. Comment il eft prouvé que les Anglois prononcent
mal le grec. Quelle doit être la prononciation de 1’» , de
l ’p 8c de IV , félon Denys d’Halicarnalfe. Ibid. 63 9. a. Mais
en nous conformant aux réglés de Denys d’Halicarnaffe ,
prononcerions-nous le grec comme les anciens Grecs le pro-
nonçoient ? Il n’eftpas plus poffible par ces réglés d’acquérir
la vraie prononciation du grec , qu’il ne l’eft à un peintre de
faire un portrait reffemblant, d’après la defeription la plus
exaéte du vifage qu’il auroit à peindre. On n’en doit pas
cependant inférer, ni que ces réglés foient entièrement inutiles,,
ni que l’euphonie n’ait une aétion confiante qui tende
du moins autant à nous rapprocher de la vraie prononciation
.qu’à nous en éloigner. — A l’égard de la ponéluation, il ne
fera pas inutile de déterminer le nombre des fignes qu’elle
admet, félon les réglés de la logique , 8c d’en fixer la valeur
p a r des exemples. Enfin , quant à l’accent 8c à la quantité ,
l ’on peut réduire notre quantité à des longues, à des b rèves, à
des moins brèves. En quoi elle paroît ad mettre moins de variété
que celle des anciens. C ’eft encore ici le cas oii l'on peut s’en
rapporter à l’organe exercé du foin de réparer les-nègli-
gences. Ibid. b. Précis de toutes les conditions praticables
8c néceffaires pour que la langue , fans laquelle les connoif-
iances ne fe tranfmettent p oint, fe fixe autant qu’il eft poffible
de la fixer par fa nature. Cet ouvrage fuppofe une con-
noïffance exaéte de deux ou trois langues ; mais l’académie
de la Crufca a levé une partie de ces difficultés dans fon
célébré vocabulaire ; 8c tout .nous porte à croire que l’académie
françoife fuivra le plan générique qui vient d’être tracé ,
8c que fon ouvrage deviendra d’une utilité effentielle à ceux
qui s’occuperont à perfeélionner cette efquiffe. Elle n’aura
pas oublié fans doute de défigner nos gallicilmes, .par lefquels
nous nous écartons des loix de la grammaire générale raifon-
née. Néceffité de faire ufage de cette grammaire dans un
diélionnaire de langues. Ibid. 64O. a. Des fynonymes. Il faut
chercher quelque loi qui en fixe le nombre. Il ne faudra
traiter comme fynonymes que les termes que la poéfie
prend pour .tels , 8c ceux que l’art oratoire emploie indiflin-
crement. L’harmonie recherchée, quoique aux dépens du mot
propre , eft accompagnée de plufieurs àgrémens. Quels font
les cas où l’on doit s’attacher au mot propre , 8c ceux où
E N C
l'en peut & où l’on doit même l’abandonner. On recueillera
toutes les expreffions que nos grands poètes 8c nos meilleurs
orateurs auront employées indiftin élément ; mais il eft inutile
de nuancer les mots qu’on-ne fera point tenté de confondre
quand la langue fera morte. Ibid. b. Deux autres
attentions dans la diflinélion des mots fynonymes.; l’une
de marquer également les idées qui différencient, 8c celles
qui font communes ; l’au tre , de choifir. fes exemples de
maniéré qu’en expliquant la diverfité des acceptions , ils deviennent
encore utiles, inftruétifs 8c vertueux. Moyen d’abréger
la nomenclature ; c’eft de ne pas diftribuer en plufieurs
articles féparés , ce qui doit naturellement être renfermé
fous un feul. On ne feroit donc de précipitable, précipiter,
précipitant, précipitation . précipité, précipice , qu’un article ,
auquel on renverroit dans les endroits où l’ordre alphabétique
offriroit des^ expreffions liées par une idée générale
8c commune. Enfin pour la perfe&ion d’un idiome, il feroit
a fouhaiter que les termes y euffent toute la variété dont
ils font fufçeptibles : c’eft une fource féconde, dans laquelle
il refte encore à notre langue bien des richeffes à puifer. Ibid.
640-a- , , . , /
De l ’ordre encyclopédique. Variétés que cet ordre admet.
Comme les objets de nos connnoiffances peuvent être diftri-
bués de plufieurs maniérés différentes , il eft impoffible
de bannir l’arbitraire de l’ordre qu’on a choifi préférablement
à tout autre. Plus une machine eft grande, compliquée, plus
on aura de différens plans de deferiptions : que fera-ce fi la
machine eft infinie en tout fens , 8c s’il eft queftion de l ’univers
réel 8c de l’univers intelligible ? Le feul fyftême d’où
l’arbitraire feroit exclu , c’eft celui qui exiftoit de toute éternité
dans la v olonté de Dieu ; Ibid. b. mais ce fyftême général
nous ne l’aurons jamais , 8c peut-être ne nous feroit-il pas
fort avantageux de l’avoir ; car quelle différence y auroit-il
entre la leéture d’nn ouvrage où tous les refforts de l’univers
feroient développés, 8c l’étude même de l’univers? Le point
de vue d’où nous devons contempler les objets , doit être
élevé , fimple , clair 8c facile. C e doit être une grande avenue
, fur la longueur de laquelle on en rencontre d’autres,
qui çonduifent aux objets folitarres par le chemin le plus facile
8c le plus court. L’homme doit fur-tout être placé dans notre
ouvrag e, comme il l’eft dans l’univers. Nous en devons faire
un centre commun. Quelle douce réaétion n’en réfultera-t-il
pas des êtres vers l’homme , 8c de l’homme vers les êtres ?
C ’eft ce qui a déterminé les auteurs de cette Encyclopédie à
chercher dans les facultés principales de l’homme , la divifion
générale à laquelle ils ont fubordonné leur travail. Ibid. 641.
a. Un fécond ordre , non moins effentiel que le précédent
eft celui qui déterminera l’étendue relative des différentes
parties de l’ouvrage. Difficulté d’établir une jufte proportion
entre les parties d’un fi grand to u t . . . . Celui qui aura cru
prendre avec fes différens collègues des précautions telles
que les matériaux qui lui feront remis quadreront à-peu-près
avec fon plan, eft un homme qui n’a nulle idée de fon o b je t,
ni des collègues qu’il s’affocie. D éfauts de proportion 8c autres
qui doivent néceffairement fe trouver dans' un tel ouvrage , '
foit de la part des artiftes, foit de la part des gens de lettres
8c des favans qui y contribuent. Ibid. b. Ces défauts font
inféparables d’une première tentative, 8c il n’appartient qu’aux
tems 8c aux fiecles à venir de les réparer. Une autre caufe
de difproportion dans les parties de cet ouvrage , c’eft l ’émulation
qui s’allumant néceffairement entre des collègues , leur
fait produire des differtations , au lieu d’articles. C e défaut
diminuera à mefure que les éditions fe multiplieront; mais
celle-ci, en revanche , aura toujours , au milieu de ces irrégularités
, un air original qui paffera difficilement dans les
fuivantes. Pourquoi l’ordre encyclopédique eft-il fi parfait
dans l’auteur anglois ? Cela vient de ce que fe bornant à
compiler , toutes les matières lui font également iotéreffan-
tes. I l n’en eft pas ainfi de cet ouvrage-ci. On fe pique , on
veut avoir des morceaux d’appareil, 8c l’exemple de l’un en
entraîne un mtre. Ibid. 641. a. Un troifieme ordre eft celui qui
expofe la diftribution particulière à chaque partie. Ce t ordre
n’eft pas entièrement arbitraire. Une fçience a fes principes ,
fes d ivifions, fes fubdivifions , fa m éthode. . . . L’ordre encyclopédique
général fera comme une mappe-monde où l’on
ne trouve que les grandes régions , enfuite les cartes particulières
, les détails, font amenés dans le corps de l’ouvrage ;
les renvois ferviront comme d’itinéraires , &c. Un quatrième
ordre, moins général que les précédens , eft celui qui diftri-
bue plufieurs articles différens, compris fous une même dénomination.
A u milieu de ces différens articles, l’éditeur fe
comportera comme s’il èn étoit l’auteur fuivra l’ordre 0
qu’il eut fu iv i, s’il eût eu à confidérer le mot fous toutes fes
acceptions. Ibid. b. Ordre au moyen duquel , malgré la d iverfité
des acceptions , chaque article formera un enfemble
8c malgré cette unité commune à tous les articles, il n’y
aura, ni trop d’uniformité, nimonotomie; mais quel que foit
l’objet dont on traite, il faut expofer le genre auquel il appartient
, fa différence fpécifique , fes caufcs, fes effets fon
objet
E N C E N C 589
«biet fa fin > fes ufag e s , fa génération , fon accroiffemeilt,
fon dépériffement, bc . &c. d’où il fuit qu’un même objet
doit fouvent appartenir à plufieurs fciences , 8c fournir plu-
fieurs articles différens. Ibid. 651. a. Une énumération méthodique
8c raifonnée des qualités déterminera un cinquième
ordre. La fuite des procédés par lefquels on fait paffer une
fubftance , félon Image auquel on la deftine , fuggérera la
place que chaque notion doit occuper. En un mo t, un article
doit être traité, avec ordre 8c méthode , quel que foit cet
ordre. L’ordre foulage la mémoire du leéteur, 8c tourne à
l’avantage de l’auteur, qui ne juge jamais mieux des idées
qu’il doit rejetter ou admettre, que lorfqu’il a établi fa méthode.
La marche à laquelle il faudroit s’affujettir quelquefois
, c’eft celle par laquelle on.s’élève des effets particuliers
aux principes généraux que leur fimplicité rend indémontrables
; mais il eft de la derniere importance de bien expofer
la métaphyfique des ch o fe s , ou leurs raifons premières 8c
générales ; le refte en deviendra plus lumineux 8c plus affuré
dans Fefprit. Ibid, b. Outre l’avantage de la méthode, félon
laquelle chaque article doit être traité, un diélionnaire encyclopédique
montre la liaifon , les rapports des différens articles
par le moyen des renvois. Utilité de deux fortes de renvois
, ceux de chofes St ceux de mots. Les premiers peuvent
être d’un avantage infini. Lorfqu’un préjugé national .doit
être refpeété , il faut l’expofer à fon article refpeétueufe-
ment ; mais renverfer l’édifice de fange , en renvoyant aux
articles où des principes folides fervent de bafe aux vérités
oppofées. Ibid. 65 a. a. Utilité des renvois de mots. Troifieme
forte de renvois ; ceux qui rapprochant dans les fciences
certains rapports , dans les fubftances naturelles des qualités
analogues, dans les arts des manoeuvres femblables , conduiraient
à de nouvelles vérités , à la perfeélion des arts ,
ou à quelques inventions utiles. Ces rapports peuvent être
fondés fur des conjeétures quelquefois chimériques ; cependant
il vaut mieux les hafarder que d’en laifiër perdre d’utiles.
L’auteur propofe ici quelques conjeétures de ce g en re,
fur la poffibilité d’un rapport entre le mouvement de décli-
naifon 8c d’inelinaifon de l’aiguille aimantée , 8ç celui de
l ’axe de la terre ; entre l’anneau de faturne 8c un certain
nombre de fatellites mûs dans un même plan ; 8c par rapport
aux ar ts , fur la poffibilité d’exécuter des tableaux fur le
métier des ouvriers en foie , où l’on exécute déjà des feuilles
8c des fleurs fi parfaitement nuancées ; Ibid. b. fur la poffibilité
de remplir fur les mêmes métiers, les fonds des tapif-
feries en laine qu’on fait à l’aiguille ; fur celle d’étendre le
petit art d’imprimer en caraéleres percés , à- l’impreffion , ou
à la copie de la mufique. Derniere forte de renvois ; ceux
qu’on pourroit appeller fatyriques ou épigrammatiques, qui
fe trouvant à la fuite d’un éloge pompe u x , tranfportent le
leéteur à un autre article , qui fait la critique ou la fatyre de
la chofe dont oii vient de lire l’éloge. Ménagement avec lequel
il faut les employer. Leur utilité. Ibid. 653. «.Pourquoi
certains ouvrages, où le ridicule 8c la méchanceté ont été
peints , ont été regardés, lorfqu’ils ont paru , comme une
indécence horrible 8c puniffable , 8c font lus aujourd’hui avec
le plus de plaifir.
' Q u elle que foit la nature des renvois , on ne pourra
trop les multiplier. Leurs effets les plus immédiats feront,
i° . de perfeétionner la nomenclature , z°. d’éviter les répétitions.
Ibid. b. Combien cet ordre encyclopédique eft favorable
aux progrès de nos connoiffances. Pour vérifier
çes ren vo is , un éditeur doit avoir tout fon manuferit fous
les y e u x ; il 11e donnera jamais au tout une certaine perfeélion
, s’il n’en poffede les parties que fucceffivement.
Ibid. 644. a. Si l’éditeur a tout fon manuferit fous fes
mains, il prendra une partie, il la fuivra dqns toutes fes
ramifications : fi elle eft incomplette , il eft bien difficile
qu’il ne foit pas inftruit des omiffions, par les renvois qui
te feront des autres parties à celle qu’il examine ; comme
les renvois de celle-ci à d’autres , lui indiqueront ce qui
fera dans ces dernieres, ou ce qu’il y faudra fuppléer, ère.
La préleélure réitérée du manuferit complet obvieroit à trois
fortes de fupplém.cns, de chofes , de mots 8c de renvois. Ibid,
b. Il im porte d’autant plus de pofféder toute la copie , que
les omiffions font les plus grands défauts d’un diétionnaire.
Indulgence que méritent à cet égard les éditeurs de l ’Encyclopédie.
Soins des éditeur 8c du typographe pour donner
à la première édition de cet ouvrage une perfeélion qui fe
trouvera difficilement dans les éditions fubféquentes. Ibid.
645. a. Enumération des principales difficultés qu’a offertes
l’éxécution d’une fi vafte entreprife. Motifs d’encouragement
qui ont foutenu 8c animé les éditeurs. Ibid. b. Il n’ap-
partenoit qu’à un fiecle philofophe de tenter une Encyclopédie.
Ceux qui font venus après les premiers, inventeurs,
n’ont é té , pour la plupart, que leurs efclaves , 8cs’il parut
de tems en tems un homme d’un génie hardi 8c original ,
qui fatigué du joug , ofa le fecouer, 8c enfanter quelque
puvrage auquel le nôm donné 8c les loix preferites ne furent
point exaélement applicables, il tomba dans l’oubli ,
Tome /.
8c y relia très-long-tems. Pour fouler aux pieds ces puérilités
, 8c renverfer des barrières que la raifon n’avoit point
pofées , il falloit un fiecle raifouneur, où l’on 'ne cherchât
plus les réglés dans les auteurs, mais dans la nature. Il
feroit heureux pour ün peuple , qu’il ne fe rencontrât point
chez lui un homme extraordinaire , fous lequel un art naif-
fant fît fes premiers progrès ^trop grands & trop rapides,
& qui en in terrompît le mouvement infenfible 8c naturel.
Mais fi les fciences 8c les arts s’avancent par un progrès
infenfible , un homme ne différera pas affez d’un autre pour
lui en impofer , 8c ainfi la nature 8c la- raifon eoüferyeront
leurs droits. Ibid. 646.. a. Dans les coinmencemens de la
littérature, un petit nombre d’hommes de génie étoient
occupés à compofer , 8c un peuplé innombrable de manoeuvriers
à tranferire. Dans les fiecles à v en ir , les uns liront
peu 8c s’abandonneront à leurs recherches ; tandis que les
autres s’occuperont à feuilleter le s ‘ innombrables volumes
qui exifteront ; 8c à en féparer ce qu’ils jugeront digne
d être recueilli. Q u e l eft le fort auquel doivent s’attendre
dans le fiecles à venir tant de volumineux écrivains , qui
occupent déjà tant de rayons dans nos bibliothèques. Q u e l
eft celui auquel doit s’attendre cette Encyclopédie elle-même,
dont il entreroit à peine les deux tiers dans une véritable
Encyclopédie. Une des principales raifons de fon imperfection
eft tirée de la néceffité où l’on a été de prendre pour
bafe un mauvais auteur , 8c de la difficulté de déterminer
les encyclopédiftes ou les collègues à travailler à neuf. Ibid,
b. Obfervation fur. la nomenclature ; elle ne pouvoir fe perfeélionner
que par l’exécution même. Cette exécution exi •:
geoit qu’on employât à une première édition un très-grand
nombre de collègues : mais un petit nombre d’hommes bien
choifis'fuffiroit à l’exécution d’une fécondé. Q u el feroit le
nouvel arrangement à prendre pour ce fécond travail. Une
première édition ne pouvoit être qu’une compilation très-
in forme 8c très-incomplette. Caufe des fuccès de l’Encyclopédie
malgré ces défauts. Ce t ouvrage a l’avantage ae
contenir une infinité de chofes nouvelles. Il ne s’eft point
fa i t , 8c il ne fe fera de long-tems une colleéUon auffi con-
fidérable 8c auffi belle de machines. Les hommes de lettres
de la plus grande réputation , les artiftes de la premier^
force, n’ont pas dédaigné d’enrichir cet ouvrage. Avantages
qu’il ne faudroit pas négliger dans le projet d’une fécondé
édition ; recourir à ces hommes d’une réputation diftinguée;
établir des correfpondances dans les principaux lieux du
monde lettré. D ivers ouvrages qu’il faudroit fe procurer*.
Ibid. b. L a citation des fources feroit d’une grande utilité ;
il faudroit s’en impofer la loi. Il faut analyfer fcrupuleufe-
ment 8c fidèlement tout ouvrage auquel le tems a affuré
une réputation confiante. Ibid. 6 4 j. ii. C e qu’il faut particuliérement
extraire des auteurs. Ouvrages que l’Encyclopédie
d o i t , pour ainfi dire , engloutir tout entiers. Maniéré
de les diftribuer artiftement dans les articles qui leur conviennent.
Il importe quelquefois défaire mention des chofes
abfurdes ; mais il faut que ce foit légèrement 8c en paffant,
feulement pour J’hiftoire de l’efprit humain. Exemples de
quelques-uns de ces traits qui peignent plus fortement 8c
plus complettement que tout un difeours. Il conviendroit
de recueillir auffi tous les traits frappans des vertus morales.
En quels cas il faudroit faire mention des aélions
deshonnêtes. Les traits qu’il faudroit fur-tout recueillir feroient
ceux où le caraélere de l’honnêteté eft joint à celui d’une
grande pénétration, ou d’une fermeté héroïque. L’-auteur en
cite ici quelques-uns pour exemples. Ibid. b. Si l’on publioit
un recueil qui contînt beaucoup de ces grandes 8c belles
aélions , qui eft-ce qui fe réfoudroit à mourir fans y avoir
fourni la matière d’une ligne ? I l faudroit finguliérement
fe garantir de l’adulation. Quant aux éloges mérités, il y
auroit bien de l’injuftice à ne les accorder, qu’à la cendre
infenfible 8c froide de ceux qui ne peuvent plus les entendre.
L ’éloge eft un encouragement à la vertu : celui d’un
honnête homme eft la plus digne 8c la plus douce récom-
penfe d’un autre honnête homme. Après les bonnes aélions
qu’on a faites, l’aiguillon le plus v i f pour en multiplier le
nombre , c’eft la notoriété des premières. Ibid. 648. a. Quant
au ton de la fa t y r e , c’eft le plus mauvais de tous polir un
diélionnaire. I l faût auffi en bannir ces allufions fines , ces
à propos lé ge rs, qui deviendroient fades en les expliquant,
ou inintelligibles en les abandonnant à la pénétration du
lefteur. Il en eft dès ornemens qui conviennent à de grands
-ouvrages, comme de ceux qui décorent de grands édifices.
Si l’on- proferit les fatyrès , il n’en eft pas ainfi des portraits
ni des réflexions. Imaginer un caraélere , 'c’eft trouv
e r d’après un,e paffion dominante donnée ', les piffions fu-
bordonnées qui Faccompagnent, 8c ces peintures idéales ne
peuvent jamais devenir chimériques : il fe rencontrera éternellement
dans la fociété des individus qui auront le ■ bonheur
ou le malheur de leur reffembler. Ibid. b. C ’eft aihfi
qu’il arrive à un fiecle très-éloigné d’élever des ftatucs hi-
deuîes ou refpeélables, au bas defquelles la poftérité écrit
K K K k k k k
Ffi y