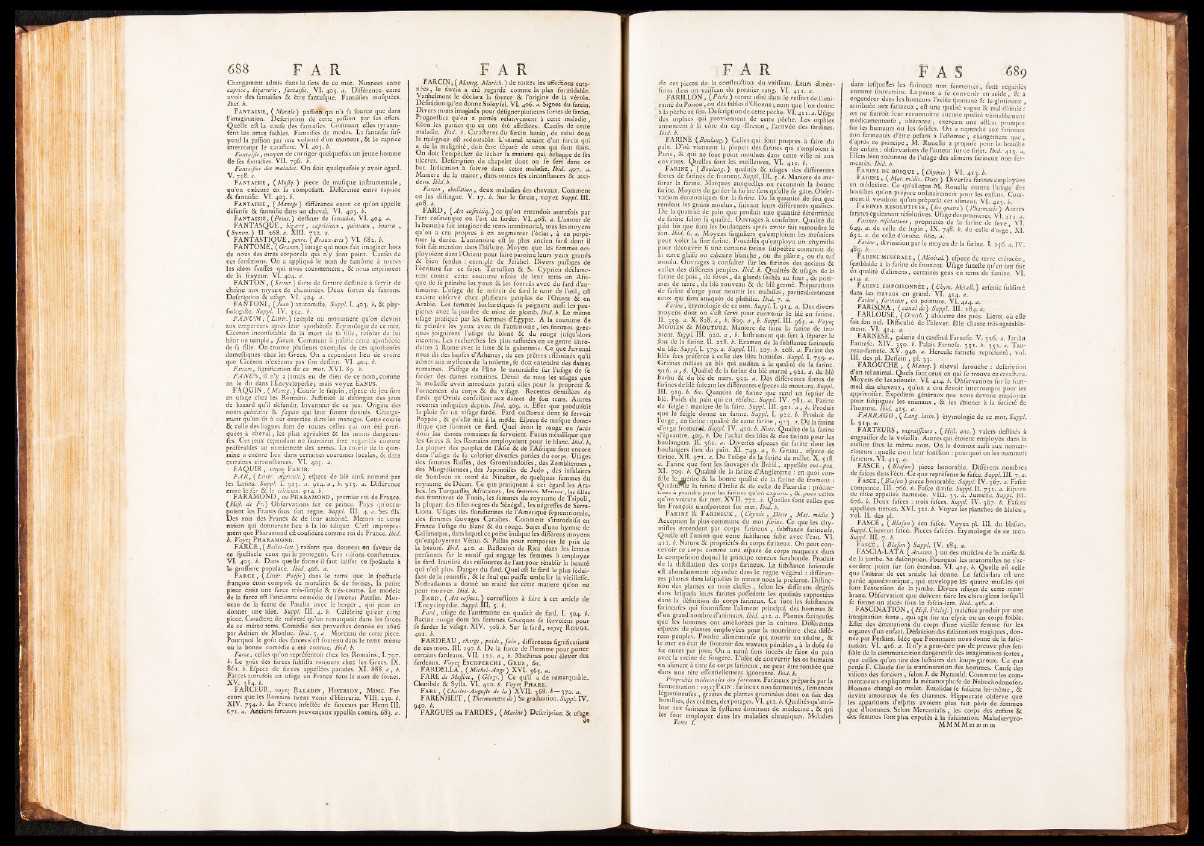
588 F A R F A R
Changement admis dans le fens de ce mot. Nuances entre
caprice, bizarrerie, fantaifie. V l . 403. a. Différence» entre
avoir des fantaifies & être fantafque. Fantaifies riîufquèes.
Ibid. b.
F a n t a is ie , ( Morale ) palïicflrqui n’a fa fourCe que dans
l’imagination. Defcription de cette paiîion par fes effets.
Q u elle eft là caufe des fantaifies. Comment elles tyranni-
fent les âmes foibles. Fantaifies de modes. La fantaifie fuf-
pend la paflion par une volonté d’un moment» & le caprice
interrompt le caraélere. VI. 4O3. b.
Fantaifie , moyen de corriger quelquefois un jeune homme
fle fes fantaifies. VII. 796. b.
Fantaifies des malades. O n doit quelquefois y avoir égard. yjpM I l F a n t a i s ie , ( Mufiq. ) piece de mufique inftrumentale,
qu’on exécute en la compofant. Différence entre caprice
oc-fantaifie. V I . 403. b.
F an t a isie , ( Manege ) différence entre ce qu’on appelle
défenfe & fantaifie dans un cheval. V I . 403. b.
F a n t a is ie , (P eint.) deffiner de fantaifie. V I . 404. a.
F A N T A S Q U E , bizarre , capricieux , quinteux , bourru ,
(Synon .) II. 268. *. XIII. 722. à.
F A N T A S T IQ U E , genre. (Beaux-ârti) V I . 68 i. b.
F A N T O M E , ( Gramm. ) image quitious fait imaginer hors
de nous des êtres corporels qui n’y font point. Caufes de
ces fenfations. O n a appliqué le nom de fantôme à toutes
les idées faillies qui nous tourmentent, & nous impriment
de la frayeur. V I. .404. a.
F A N T O N , ( Serrur.) forte de ferrure deftinée à fervir de
chaîne aux tuyaux de Cheminées. Deux fortes de fantons.
Defcription 8c ufage. VI. 404. a.
F A N T O N I , ( Jean ) anatomifte. Suppl. I. 4Ô3. b. & phy-
fiologiffe. Suppl. IV . 334. b.
F A N U M , (Littér.) temple ou mônument qu’on élevoit
aux empereurs après leur apothéofe. Etymologie de ce mot.
Cicéron inconfolable de la mort de fa fille , réfolut de lui
bâtir un temple, fanum. Comment il juftifie cette apothéofe
dé fa fille. O n trouve plufieurs exemples de ces apothéofes
domefiiques chez les Grecs. O n a cependant lieu de croire
que Cicéron n’exécuta pas fon deffein. V I . 404. b.
Fanum, lignification de ce mot. X V I . 89. b.
FANU-S, il n’y a jamais eu de dieu de ce nom,comme
on le dit dans l’Encyclopédie; mais v o y e z Ea n ü S.
F A Q U IN , (Maneg.) Courir le faquin, efpece de jeu fort
en ufage chez les Romains. Juftinien le diltingua des jeux
de hazard qu’il défendit. Inventeur de ce jeu. Origine des
noms~quintaine & faquin qui leur furent donnés. Changement
qu’ôir-fit à cet exercice dans les maneges. Cette courfe
& celle des bagues font de toutes celles qui ont été pratiquées
à che va l, les plus agréables 8c les moins dangereu-
fes. C e s jeux cependant ne fauroient être regardés comme
préférables au maniement des armes. La courfe de la quinfaine
a encore lieu dans certaines coutumes locales, 8c dans
certaines circonftance's. V I . 405. a.
F A Q U IR , voye{ Fak ir .
F A R , (Littér. Agricult.) efpece de blé ainfi nommé par
les Latifis. Suppl: I. 913. a. 914. a , b. 913. a. Différence
entre le fa r & le triticum. 914. b.
F A R AM O N D , ouPharamond, premier roi de France.
(Hift. de Fr.) Obfervations fur ce prince. Pays qu’occu-
poient les Francs fous fon régné. Suppl. III. 4. a. Ses fils.
Des rois des Francs 8c de leur autorité. Moeurs de cette
nation qui donnèrent lieu à la loi falique. C ’eft improprement
que Pharamond eft confidéré comme roi de France. Ibid,
b. Foyer Pharamond.
F A R C E , ( Belles-lett. ) raifons que donnent en faveur de
ce fpeétacle ceux qui le protègent. Ces raifons combattues.
V I . 403. b. Dans quelle forme il faut laiffer ce fpeâacle à
la gromere populace. Ibid. 406. a.
Fa r c e , (Littér. Poéfie) dans le tems que le fpeélacle
françois étoit compofé de moralités & de fouies, la petite
piece étoit une farce très:fimple & très-courte. Le modèle
de la farce eft l’ancienne comédie de l’avocat Patelin. Morceau
de la feene de Patelin avec le berger , qui peut en
donner une idée. Suppl. III. 4. b. Célébrité qu’eut cette
piece. Caraélere, de naïveté qu’on remarquoit dans les farces
de ce même tems. Comédie des proverbes donnée en 1616
par Adrien de Monluc. Ibid. 3. a. Morceau de cette piece.
Pourquoi le goût des farces s’eft foutenu dans le tems même
où la bonne comédie a été connue. Ibid. b.
■ Farce, celles qu’on repréfentoit chez les Romains, 1. 797.
b. Le goût des farces fubfifta toujours chez les Grecs. IX.
8 5 1. b. Efpece de farces appellées parades. XI. 888. a , b.
Farces autrefois en ufage en France fous le' nom de fotties.
X V . 384. b.
-F A R C E U R , voye^ Baladin, Histrion, Mime. Farceurs
que les Romains firent venir d’Hétrurie. VII I. 230. b.
X IV . 734. b. La France infeétée de farceurs par Henri III.
671 . a. Anciens farceurs provençaux appellés comirs, 683. a.
FA R C IN -, ( Maneg. Mitréch.) de toutes les affrétions cutanées
, le farcin a été regardé comme la plus formidable.
Vanhelmont le déclara la fource 8c l’origine de la vérole.
Définition qu’en donne Soleyfel. V I . 406. a. Signes du farcin.
Divers noms imaginés pour défignerplufieurs fortes de farcin.
Prognoftics qu’on a portés relativement à cette maladie,
félon les parties qui en ont été afieétées. Caufes de cette
maladie. Ibid. b. Caraéteres du farcin bénin, de celui dont
la malignité eft redoutable. L’animal atteint d’un farcin qui
a de la malignité, doit être féparé de ceux qui font fakis.
On doit l’empêcher de lécher la matière qui échappe de fes
ulcérés. Defcription du chapelet dont on fe fert dans ce
but. Indication à fuivre dans cette maladie. Ibid. 407. a.
Maniéré de la traiter, dans toutes fes circonftances & acci-
déns. Ibid. b.
Farcin, ébullition, deux maladies des chevaux. Comment
on les diftingue. V . 17. b. Sur le farcin, v o y e z Suppl. III.
408. a.
F A R D , ( Art cofmétiq. ) ce qu’on entendoit autrefois par
l’art cofmétique ou l’art de farder. V I . 408. a. L’amour de
la beauté a fait imaginer de tems immémorial, tous les moyens
qu’on a cru propres à en augmenter l’é c la t , à en perpétuer
la durée. L ’antimoine eft le plus ancien fard dont il
foit fait mention dans l’hiftoire. M oy en que les femmes em*
ployoient dans l’Orient pour faire paroître leurs y eu x grands
& bien fendus : exemple de Jefabel. Divers paffages de
l’écriture fur ce fujet. Tertullien 8c S. Cyprien déclamèrent
contre cette coutume ufitée de leur tems en A frique
de fe peindre les y eu x & les fonreils avec du fard d’antimoine.
L ’ufage de fe noircir de fard le tour de l’oe il, eft
encore obfervé chez plufieurs peuples de l’Orient & en
Arabie. Les femmes barbarefques fe peignent auffi les paupières
avec la poudre de mine de plomb. Ibid. b. Le même
ufage pratiqué par les femmes d’Egypte. A la coutume de
fe peindre les yeux avec de l’antimoine, les femmes grecques
joignirent l’ufage du blanc 8c du rouge jufqu’alors
inconnu. Les recherches. les plus raffinées en ce genre introduites
à Rome avec le luxe & la galanterie. C e que Juvenal
nous dit des bapfes d’Athènes, de ces prêtres efféminés qu’ii
admet aux m yfteres de la toilette, fe doit entendre des dames
romaines. Paffage de Pline le naturalifte fur l’ufage de fe
farder des dames romaines. Détail de tous les ufages que
la molleffe avoit introduits parmi elles pour la propreté 8c
l’ornement du corps 8c du vifage. Recettes détaillées de
fards qu’Ovide confeilloit aux dames de fon tems. Autres
recettes indiquées depuis. Ibid. 409. a. Effet que produifoil
la pluie fur un vifage fardé." Fard onâueux dont fe fervoit
Poppée, 8c qu’elle mit à la mtfde. Efpece de mafque dôme-
ftique -que formoit ce fard. Q u e l étoit le rouge ou fucus
dont les dames romaines fe fervoient. Fucus métallique que
le$ Grecs 8c les Romains employoient pour le blanc. Ibid. b.
La plupart des peuples de l’A fie 8c de l’A frique font encore
dans l’ufage de fe colorier diverfes parties du corps. Ufages
des femmes Ruffes, des Groenlandoifes, des Zembliennes ,
des Mingréliennes, des Japonoifes de Jedo , des infulaires
de Sombréo au nord de Nicobar, de quelques femmes du
royaume de Décan. C e que pratiquent à cet égard les Arabes,
les Turqueffes Africaines, les femmes Maures, les filles
des frontières de Tu nis, les femmes du royaume de T r ip o li,
la plupart des filles negres du Sénégal, les négrefles de Serra-
Liona. Ufages des floridiennes de l’Amérique feptentrionale,
des femmes fauvages Caraïbes. Comment s’introduifit en
France l’ufage du blanc 8c du rouge. Sujet d’une hymne de'
Çallimaque, dans lequel ce poëte indique les différens m oyens
qu’employereht Vénus 8c Pallas pour remporter le prix de
la beauté. Ibid. 410. a. Réflexion de Rica dans les lettres
perfannes fur le mo tif qui engage les femmes à employer
le fard. Inutilité des reffources de l’art pour rétablir la beauté
qui n’eft plus. Danger du fard. Q u e l eft le fard le plus fédui-
fant de la jeunefie, 8c le feul qui puiffe embellir la vieillefle.
Noftradamus a donné un traité fur cètte matière qu’on ne
peut trouver. Ibid. b.
Fard, (A r t cofmet.) correélîons à faire à cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. III. 3. b.
Fard} ufage de l’antimoine en qualité de fard. I. 304. b.
Racine rouge dont les femmes Grecques fe fervoient pour
fe farder le vifage. X IV . 308. b. Sur le fard , voye^ R o u ge .
401. b.
F A R D E A U , charge , poids, fa i x , différentes fignifications
de ces mots. III. 107. b. D e la force de l’homme pour porter
certains fardeaux. V II . 121. a , b. Machines pour élever des
fardeaux. Voye[ ËSCOPERCHE , GRUE, bc .
FA RD E L LA , (Michel-Ange) X V I . 365. a.
FA RE de Mejfint, ( Géogr. ) C e qu’il a de remarquable..
Charibde 8c Sylla. V I. 410. b. Voyez Ph a r e .
Fa r e , (Charles-Augufte de la ) X V I I . 368. A— 370. a.
F A R EN H E IT , ( Thermomètre de) Sa graduation. Suppl. IV .
FARGUE S ou F A R D E S , ( Marine) Defcription & ufagede
F A R
de ces pièces de ,1a conftruélion dii-, yaiffeaii. Leül’s diméri-
fions dans un yaiffeau du premier , rang. V I. 4 1 1 . a.
F A R IL L O N , ( Pêche) terme ufité.dans le re flb r td e l’ami-
^ rauté du Poitou, ou dès fables d’Olonne ; nom que l ’on donne
[ à la pêche au feu. Defcription de cette pêche; V I. 4 1 1 . a. Ufage
'd e s orphies qui, proviennent de cette pêche. Les orphies
annoncent à la cote du ca p-B re ton, l’arrivée des fardinès
Ibid, b.
FA R IN E (Boulang.) Celles qui font propres à faire’.du
pain. D ’où viennent la plupart des farines qui s’emploient à
Paris, 8c qui ne font point moulues dans cette ville ni aux
environs; Quelles font les meilleures; V L 4 1 1 . b-.
F a r in e , ( Boulang. ) qualités 8c ufages des différentes
fortes de farines de froment. Suppl. IIÎ, 3; bt Maniéré de mesurer
la farine; Marques auxquelles on rë.connoît la bonne
farine. Moyens de garder la farine fans qu’elle fe gâte>.Obier-
Vations économiques fur. la farine. D e la quantité ^de? fon qtic
rendent les grains moulus, fuivant leurs différentes ..qualités.
D e la quantité de pain que produit une quantité déterminée
de farine félon fa qualité. Ouvrages à confulter, Qualité du
pairi bis que font les boulangers après avoir fait rempudre.le
fon. Ibid. 6. a. Moyens finguliers qu’emploient les meûnièrs
pour voler la fine farine. Procédés qu’employa un chymifte
pour découvrir fi une certaine farine fufpeétée contfinoit de
la terre glaife ou calcaire blanche , où du plâtre , ou du tuf
moulu. Ouvragés à confulter fur les farines des anciens 8c
celles des différens peuples. Ibid. b. Qualités 8c ufages de la
farine de pois , de fe v e s , de glands féchés au fo u r , de pommes
d<î terre , dé blé n ouveau 8c de blé germé. Préparations
de farine d’orge pour nourrir les malades, particuliérement
ceux qui font attaqués de phthifie. Ibid■. 7 . a.
Farine, étymologie de ce mot. Suppl. I. 914. a. D e s divers
moyens dont on , s’eft fervi pour convertir le blé en farine.
II. 339. a. X. 8?8. a , b. 829. a , b. Suppl. III. 963. a. Voyez
Moulin 8c Mouture. Maniéré de faire la farine de froment.
Siîppl. III. 620. a , b. Infiniment qui fert à féparer le
fo n de la farine. IL 228; b. Examen de la fubftance farineufe
du blé. Suppl. I. 379. a. Suppl. III. 207. b. 208. a. Farine des
blés fecs préférée à celle des blés humides. Suppl. I. 739. a.
Graines mêlées au blé qui nuifent à la qualité de la farine.
9 16 . a , b. Qualité de la farine du blé marné , 921; a. du blé
barbu 8c du blé de mars. 922. a. Des différentes fortes de
farines de blé fuiyant les différentes efpeces de mouture. Suppl.
III . 919. b. bc . Quantité de farine que rend un feptier de
blé. Poids du pain qui en réfulte. Suppl. IV . 781. a. Farine
de feigle : manière de la faire. Suppl., III. 921. a , b. Produit
que le féigle donne en farine. Suppl. I. 922. b. Produit de
l ’o rg e , en fariné : qualité de cette farine, 923. a. D e la farine
d ’orge fromenaé. Suppl. IV . 410. b. Note. Qualité de la farine
d’épeautré. 409. b. D e l’achat des blés 8c des farines pour les
boulangers. II. 361. a. Diverfes efpeces de farine dont les
boulangers font du pain. XI. 749. <z, A. Gruau * efpece de
farine. XII. 971. a. D e l’ufage de la farine de millet. X. 318.
a. Farine que font les fauvages du Eré fil, appellèe ovi-pou.
X I. 709. b. Qualité de la farine d’Angleterre : en quoi çôn-
'lifte le_mérite 8c la bonne qualité de la farine de froment :
Qu alit” e lâ farine d’Italie Sc de celle ;de Picardie : précautions
à prendre pour les farines qu’on e xporte, 8c pour celles
qu’on voiture fur mer. X V I I . 772. a. Quelles font celles que
les Français tranfportent fur mer. Ibid. b.
Farine 8c Farineux , ( Chymie, D ic te , Mat. médic. )
'Acception la plus commune du mot farine. C e que les chy-
miftes entendent par Corps farineux , fubftance farineufe.
Q u elle eft l’union que cette fubftance fubit avec l’eau. V L
4 1 1 . b. Nature 8c propriétés du corps farineux. On peut concevoir
ce corps comme une efpece de corps muqueux dans
la compofition duquel le principe terreux furabonde. Produit
de la diftillation des corps farineux. L a fubftance farineufe
eft abondamment répandue dans le régné végétal : différentes
plantes dans lefquelles la nature nous la p réfente. Diftinc-
tion des plantes en trois daffes , félon les différens degrés
dans lefquels leurs farines poffedent les qualités rapportées
dans la définition du corps farineux. C e font les fubftances
farineufes qui fourniffent l’aliment principal des hommes 8c
d’un grand nombre d’animaux. Ibid. 412. a. Plantes farineufes
que les hommes ont améliorées par la culture. Différentes
efpeces de plantes employées pour la nourriture chez différens
peuples. Poudre alimenteufe qui. nourrit un adulte , 8c
le met en état de foutenir des travaux pénibles , à la dofe de
fix onces par jour. O n a tenté fans fuccès de faire du pain
avec la racine de fougere. L’idée de convertir les os humains
en aliment à titre de corps farineux, ne peut être tombée que
dans une tête effentiellement ignorante. Ibid. b.
Propriétés médicinales des farineux. Farineux préparés par la
fermentation : voye^ Pain : farineux non fermentés, femences
légumineufes , graines de plantes graminées dont on fait des
bouillies, des crèmes, des potages. V I . 412. A. Qualités qu’attribue
aux farineux le fyftême dominant de médecine , 8c qui
les font employer dans les maladies chroniques. Maladies
Tome 1.
F A S 689
dans iefquertes ies farineux non fermentés, font regardés
ebmmé fouverains. La pente à fe convertir en ac ide, 8c à
engendrer dans les humeurs l’acide fpontané Sc le g lutiiieux ,
attribuée aux farineux , eft une qualité vagiie 8c mal définie :
on ne fauroit leur reeonnoître aucune qualité véritablement
médicamenteùfe , altérante , exerçant une aélion prompte
fur les humeurs Ou les folides. On a reproché aux farineux
non fermentés d’être pefans à l’eftomac ; changement que ,
, d’après ce principe ; M. Rouelle a propofé pour la bouillie
des enfans : obfervations de l’auteur fur ce fujet. Ibid. 413. a.
Effets bien reconnus de l’ufage des alimens farineux non fermentés;
Ib id. b .
Farine de brique| (Chymie.) V I . 413. i .
F a r in e -, ( Mat., médic. Dicte ) Diverfes farines éniployéés
fen médecine. Ge qu’allegue M. Rouelle contre l’ufage des
Bouillies qu on prépare ordinairement pour les enfans. Comment
U voudrait qu’on préparât cet aliment. V I . 4x3- b.
Farines résolutives, (les quatre) (Pharmacie) Autres
tannes également refolutives. Ufage des premières. V I . 414. a.
Farines réfolutives -, propriétés de la farine de f e v e , V L
649. m de celle dé lupin , IX. 748. A. de celle d’o rg e, XI.
032. a. de celle d’orobe. 660.,à.
Farine -, divination p arle moyen de la farine; I. 236. a. IV .
4^9-; by ;
FarineMiNÉRAtE, ( Minéral.) efpece de terre crétacée,
fetnblable à la farine de froment. Ufage funefte qu’en ont fait
en qualité d’alimens ; certaines gens en tems de famine. V I.
414. eti
F ARINE EMPOISONNEE ; . ( Chyiïu Métal! ) affenic fublimê
dans, les travaux en grand.' V I. 414. a.
Farïné; farineux, en peinture. V I . 414. a:'
F A R IS IN A , (canal d e) Suppl. III. 184.4.
F A R LO U S E , (Om ith .) alouette des prés. Lieux où elle
fait fon nid. Difficulté de l’élever. Elle chante très-agréablement.
V I . 414. ai
FA RN E SE , galerie du cardinal Fariiefe. V ; 326. a. Jardin
Farnefe. X IV . 330. A. Palais Farnefe. 331. A. 332. a. Tau-
reau-farnefe. X V . 940. a. Hercule farnefe repréfenté; vol.
,111. des pl. D e ffein, pl. 33; r
. F A R O U CH E , ( Maneg. ) chèvâl farouche : defcription
d un tel animal. Q uels font ceux en qui fe trouve ce caraélere.
Moyens de les adoucir. VI. 414. A. Obfervations fur le fom-
meil des ch e vau x, qu’on a cru devoir interrompre pour les
apprivoifer. Expédiens généraux que nous devons employer
pour fubjuguer les animaux , & les amener à la fociétê de
l’homme. Ibid. 413. a.
F A R R A G O , (Langi latin.) étÿmolog-ie de ce mot. Suppk
I 9M - 1
F A R T E U R S , engraijfeurs j (Hift. anc.) valets deftinés à
engraiffer de la volaille. Autres qui étoient employés dans la
euifine foiis le même nom. Oh le donnoit auffi aux nomen-
clateurs : quelle étoit leur fonélion : pourquoi on les nommoit
farteurs. V l . 413, a:
FA SC E , (Blafon) piece honorable. Diffé rens nombres
de fafees dans l’éeu. C e que repréfente k fafee. Suppl. III. 7. a.
F asge j (Blafon) piece honorable. Suppl: IV . 367. a. Fafee
componée. III. 760. A. Fafee divife. Suppl. II. 73 1 . a. Efpecè
de fafee appellèe hameide. VIII. 35. a. Jumelle. Suppl. III.
676; A. Deux fafees : trois fafees. Suppl. IV ; 367. A. Fafees
appellées tierces; X V I . 32 i; A, V o y e z les planches de blafon ,
vo l. II. des pl.
F A S C É , (B la fo n ) écu fafcé; V o y e z pl. III. d a blafon.
Suppl. Chevron fafcé; Pièces fafcées. Etymologie de ce mot»
Suppl. III. 7. A; , ,
FascÉ , ( Blafon ) Suppl. IV . 184. a:
F A S C IA -L A T A (Anatom.) un des niufeles de la cuiffe 8c
de la jambe. Sa defcription. Pourquoi les anatomiftes ne s’accordent
point fur fon étendue. V I. 413. A. Q u elle eft celle
que l’auteur de cet article lui donne. L e fafcia-lata eft une
partie aponévrotique, qui enveloppe lé$ quatre mufcles qui
Font l’extenfion de la jambe; Divers ufages de cette membrane.
Dbfervation que doivent faire les chirurgiens lorfqu’il
fe forme un abcès fous le fafcia-lata. Ibid. 416. a.
. F A S C IN A T IO N , ( Hift. Philo f i ) maléfice produit par une
imagination, forte , qui agit fur un efprit ou un corps foible;
Effet des émanations du corps d’une vieille femme fur les
organes d’un enfant. Définition des fafeinations magiques, donnée
par Perkins. Idée que Frommann nous donne de la fafei-
nation. V I . 4x6. a. Il n’y a peut-être pas de p reuve plus fen-
fible de la communication dangereufe des imaginations fortes ;
que celles qu’on tire des hiftoires des loups-garoux; C e que
penfe F . Claude fur la tranfmutation des hommes. Caufe des
vifions des forciers , félon J. de Nynauld. Comment les commentateurs
expliquent la métamorphofe de Nabuchodonofor;
Homme changé en mulet. Eutelidas fe fafeina lui-même 8c
devint amoureux de fes charmes. Hippocrate obferve que'
les apparitions d’efprits avoient plus fait périr de femmes
que d’hommes. Selon Mercurialis, les corps dés enfans &
des femmes font plus expofés à la fàfcination. Maladiesràro-
M M M M n im n im