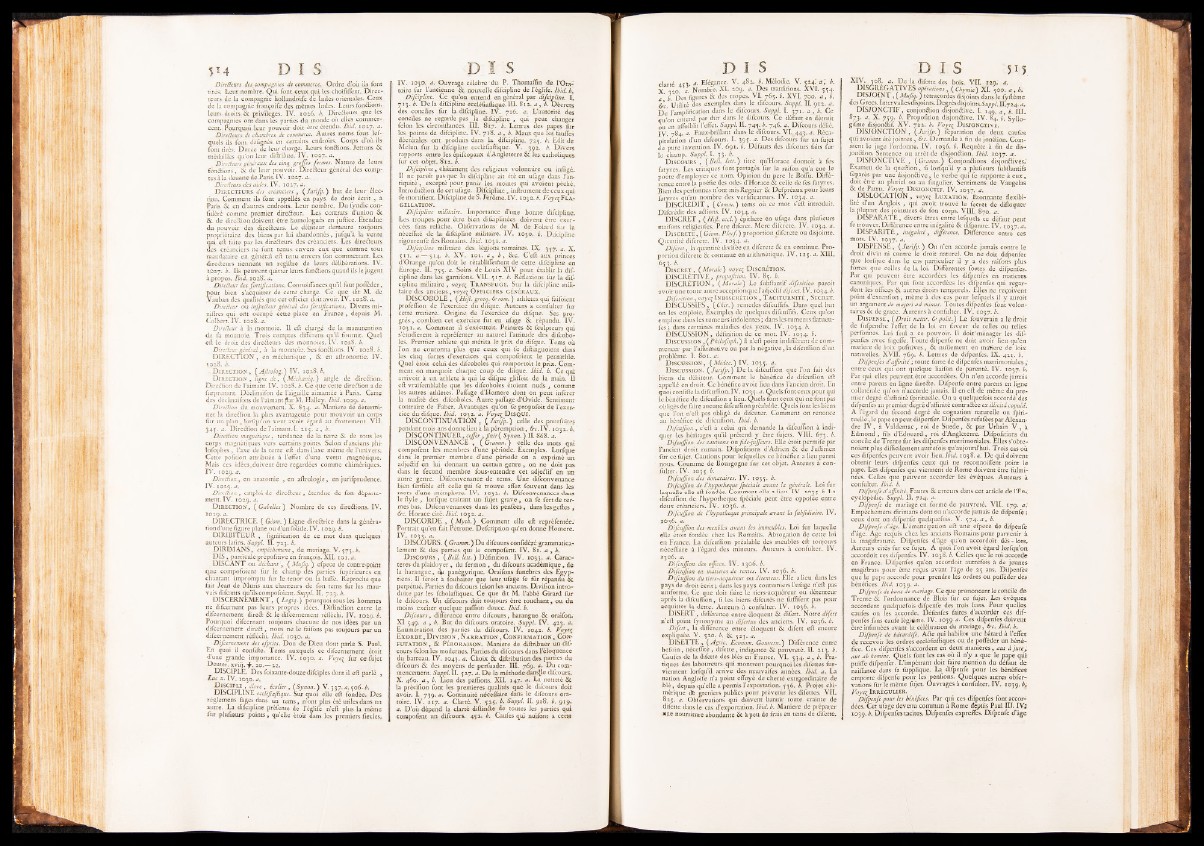
5M D I S
Dire fleurs des compagnies de commerce. Ordre d!ûù ils font
tirés. Leur nombre. Q u i font, ceux qui les choififlent. Directeurs
de la compagnie hollandoife de Indes; orientales. Ceux
de la compagnie françoife des mêmes Indes. Leurs fonctions,
leurs droits. & privilèges. IV . 102.6. b. Directeurs que les
compagnies Ont dans les parties du monde où elles commercent.
Pourquoi leur pouvoir doit être étendu. Ibid. 1027. a.
DïreHeurs de chambres de commerce. Autres noms fous le s quels
ils font défignés en certains endroits. Corps d’où ils
font tirés. Durée dé leur charge. Leurs fondions. lettons &
médailles qu’on leur diftribue.- IV . 10.27. a.
Directeurs généraux des cinq groffes fermes. Nature de leurs
fondions & de leur pouvoir. Directeur général des comptes
à la douane de Paris. IV . lo&y.a*
Dire Heurs des aides. IV . 1027. a.
D irecteurs des créanciers (Jurifp.) but de leur élection.
Comment ils font appellés en pays de droit écrit , à
Paris, & en d’autres endroits. Leur nombre. D u fyndic con-
fidéré comme premier directeur. Les contrats d’union 8t
& de direction doivent être homologués en juftice. Etendue
d u pouvoir des dixe&eurs. Le débiteur demeure toujours,
propriétaire des biens par lui abandonnés , jufqu’à la vente
qui eft faite par les directeurs des créanciers. Les directeurs
«les. créanciers ne font tenus, envers eux que comme tout
mandataire en général eft tenu envers fon commettant. Les
directeurs tiennent un regiûre de leurs délibérations. IV .
1.027. b- Us peuvent quitter leurs fonctions quand ils le jugent
à propos. Ibid. 1028’. a.
DireHeur des fortifications. Connoifiances qu’il faut pofl'éder,
pour bien s’acquitter de cette charge. C e q.ue dit M. de
.Vauban des qualités que cet officier doit avoir. IV . 1028. a.
DireHeur ou infpeHeur général des fortifications. Divers minières
qui ont occupé cette place en Franc e, depuis M.
Colbert. IV . 1028. a.
DireHeur à la monnoie. Il eft chargé de la- manutention
de fa monnoie. Trois comptes différens qu’il fournit. Quel
eft le droit des dirééteurs des monnoies. IV . 1028. b.
DireHeur général, à la monnoie. Ses fonctions. IV . 1028. b.
D IR E C T IO N , en méchanique , & en aftronomie. IV .
1028. g
. D irection, ( Afirolog.) IV . 1028.b.
Direction , ligne de, ( Méchaniqf ) angle de direction.
Direction de l’aimant. IV . 1028. b. C e que cette direftion a de
furprenant. Déclinaifon de l’aiguille aimantée à Paris. Carte
des déclinaifons de l’aimant £ar M. Halley. Ibid. 1029. a.
DireHïon du mouvement. X. 834. a. Maniéré de déterminer
la direction la plus avantageufe pour mouvoir un corps
fur un plan, lorfqu’on. v eu t avoir égard au frottement. VII.
345. a. Dire£Hon de l’aimant.I. 215. a , b.
DtreHion magnétique , tendance de la terre & de tous les
corps magnétiques vers certains points. Selon d’anciens phi-
lofophes , l’axe de la terre eft dans l’axe même de l’univers.
Cette pofition attribuée à l’effet d’une vertu magnétique.
Mais ces idéesrdoivent être regardées comme chimériques.
IV . 1029* a.
DtreHion, en anatomie , en aftrologie, en jurifpradence.
IV . 1029. a.
DireHion, emploi de direéleur, étendue de fon département.
IV . 1029. a.
D irection, ( Gabelles ) Nombre de ces directions. IV .
D IR E C TR ICE . ( Géom. ) Ligne directrice dans la génération
d’une figure plane ou d ’u nfolide.IV. 1029. b.
D IRIB ITEUR , fignification de ce mot dans quelques
auteurs latins. Suppl. IL 723. b.
D IR IM AN S , empêchemens, de mariage. V . 373. b.
D IS , particule p répofitive en françois. XII. 101. a.
D IS C À N T ou déchant, ( Mufiq. ) efpece de contre-point
que compofoient fur le champ des parties fupérieures en
chantant improhiptu fur le. ténor ou la baftê. Reproche que
fait Jean de Mûris aux chanteurs de fon tems fur les mauvais
difeants qu’ils compofoient. Suppl. IL 723. b.
D IS C E R N EM EN T , ( Logiq. ) pourquoi tous les hommes
ne difeernent pas leurs propres idées. DiftinCtion entre le
difeernement direCt & le discernement réfléchi. IV . 1029. b.
Pourquoi difeernant toujours chacune de nos idées par un
difeernement direCt, nous ne le faifons pas toujours par un
difeernement réfléchi. Ibid. 103,0. a.
Difeernement des efprits. Don de Dieu dont parle S. Paul.
En quoi il confifte. Tems auxquels ce difeernement étoit
d’ une grande importance. IV . 1030. a. Voyez fur ce fujet
Deuter. xviij. fr. 20.— 22.
DISCIPLE. Des foixante-douze difciples dont il eft parlé ,
Luc x . IV . 1030. a.
D isciple , élevé , écolier, (Synon. ) V . 337. a. 306. b.
DISCIPL INE eccléfiafiique. Sur quoi elle eft fondée. Des
réglemens fages dans un tems, n’ont plus été utiles dans un
autre. La dilcipline préfente de l’églife n’eft plus la même
fur plufieurs points, qu’elle étoit dans les premiers fiecles.
D I S
IV . 1030. a. Ouvrage célébré du P. Thomaffin de l’Oratoire
fur l’ancienne o t nouvelle difeipline de l’églife. Ibid. b.
Difcipüne. C e qu’on entend en général par difeipline. ï ,
713 . b. D e la difeipline eccléûaftique. III. 812. a , b. Décrets
des conciles fur la difeipline. IV . 716. a. L ’autorité des
conciles ne regarde pas îa difeipline , qui peut changer
félon les circonftanees. III. 817.. b. Lettres des papes fur
les points de difeipline. IV . 718. a , b. Maux que les fauffes
décrétales ont produits dans la difeipline. 725. b. Edit de
Melun, fur la difeipline eccléfiaftique. V . 392. b. Divers
rapports entre les épifeopaux d’Angleterre 8c les catholiques
fur cet obj;et. 812. b.
Difeipline, châtiment des religieux volontaire ou infligé.
Il ne paroît pas que la difeipline ait été en ufage dans l’antiquité
, excepté pour, punir les moines qui avoient péché.
Introduâion de cet ufage. Difeipline , inftrument de ceux qui
fe mortifient. Difeipline de S. Jérôme. IV . 1030. b. Voye^ F l a gellation.
Difeipline militaire. Importance d’une bonne difeipline.'
Les troupes pour être bien difeiplinées doivent être exercées
fans, relâche. Obfervations de M. de Folard fur la
néceffité de la- dilcipline militaire. IV . 1030. b. Difeipline
rigoureufè des Romains. Ibid. 1031. a.
Difeipline militaire des légions romaines. IX. 357, a. X.
5x1. a — 314. b. X V . 101. a , b , 8cc. C ’eft aux princes
d’Orange qu’on doit le rétablifferflent de cette difeipline en
Europe. II. 755. a. Soins de Louis X IV pour établir la difeipline
dans les garnifons. V II . 317. b. Réflexions fur la difeipline
militaire, voyc{ T ransfuge. Sur la difeipline militaire
des anciens, voye[ O fficiers généraux.
D IS CO BO L E , ( Hifi. grecq. & rom. ) athlètes qui faifoient
profeflion de l’exercice du difque. Auteurs à confulter fur
cette matière. Origine de l’exercice du difque. Ses progrès
, combien cet exercice fut en ufage 8c répandu. IV .
1031. a. Comment il s’exécutoit. Peintres 8c fculpteurs qui
s’étudièrent à repréfenter au naturel l’attitude des difeobo-
les. Premier athLete qui mérita le prix du difque. Tems où
l’on ne couronna plus que ceux qui fe diftinguoient dans
les cinq forces d’exercices qui compofoient le pentathle.
Q u el étoit celui des difcoboles qui remportoir le prix. Comment
on marquoit chaque coup de difque. Ibid. b. C e qui
arrivoit à un athlete à qui le difque glilfoit de la main. Il
eft vraifemblable que les difcoboles étoient nuds , comme
les autres athlètes. Paffage d’Homere dont on peut inférer
la nudité des difcoboles. Antre paffage d’O vide. Sentiment
contraire de Faber. Avantages qu’on fe p ropofoit de l'e xe r cice
du difque. Ibid. 1032. a. Voye[ D isq u e ,
D IS C O N T IN U A T IO N , ( Jurifp. ) celle des pourfuites
pendant trois ans donne lieu à la péremption, &c. IV . 1032. b.
D IS CO N T IN U E R , ceffer , finir( Synon. ) II. 868. a.
D IS CO N V EN A N C E , ( Gramm. I celle des mots qui
compofent les membres d’une période. Exemples. Lorfque
dans le premier membre d’une période on a exprimé un
adje&if en lui donnant un certain g en re , on ne doit pas
dans le fécond membre fous-entenare cet adje&if en un
autre genre. Difconvenance de tems. Une difconvenance
bien fenfible eft celle qui fe trouve affez fouvent dans les
mots d’une métaphore. IV . 1032. b. Difconvenances dans
le ftyle , lorfque traitant un fujet g r a v e , on fe fe rt de termes
bas. Difconvenances dans les penfées, dans les geftes ,
&c. Horace cité. Ibid. 1032. a.
D IS CO R D E , ( Myth. ) Comment elle eft repréfentée.'
Portrait qu’en fait Pétrone. Defcription qu’en donne Homere.
IKgËgjfij
DISCO UR S. ( Gramm. ) D u difeours confidéré grammaticalement
& des parties qui le compofent. IV . 81. a , b.
D iscours, (Bell, lett.) Définition. IV . 1033. a. Caractères
du plaidoyer, du fermon , du difeours académique , de
la harangue, & panégyrique. Oraifons funèbres des Eg yptiens.
Il feroit à louhaiter que leur ufage fe fût répandu 8c
perpétué. Parties du difeours félon les anciens. Divifion intro,-
duite par les fcholaftiques. C e que dit M. l’abbé Girard fur
le difeours. Un difeours doit toujours être touchant, ou du
moins exciter quelque paffion douce. Ibid. b.
Difeours, différence entre difeours, harangue 8c oraifoq.
XI 349. a , b. But du difeours oratoire. Suppl. IV . 423. a.
Enumération des parties du difeours. IV . 1042. b. Voyt[
Exorde , D ivision , Narration , C onfirmation , Con-
futation , 8c Péroraison. Maniéré de diftribuer un difeours
félon les modernes. Parties du difeours dans l’éloquence
du barreau. IV . 1043. a. Choix 8c diftribution des parties du
difeours 8c des moyens de perfuader. III. 769. u. Du commencement.
Suppl. II. 527. a. D e la méthode dansjle difeours.
X. 460. a , b. Lieu des paffions. XII. 147. a. La netteté 8c
la précifion font les premières qualités que le difeours doit
avoir. I. 739. a. Continuité néceffaire dans le difeours oratoire.
IV . 117. a. Clarté. V . 523. b. Suppl. II. 9x8. b. 919.
a. D'où dépend la clarté diftinâe de toutes les parties qui
compofent un difeours. 432. b. Caufes qui nuifent à cette
D I S
clarté H o. I M V ' S B E 3 MéloiJie- v - m f f l h■
X 220. a. Nombre. XI. 209. a. Des tranlitions. X V I . 334.
a ' b. Des figures 8c des tropes. V I . 763. b. XVI. 7O0. a , b.
&c. Utilité des exemples dans le difeours. Suppl. II. 912. a.
D e l’amplification dans le difeours. Suppl. I. 371. à , b. C e
qu’on entend par dur dans le difeours. C e défaut en détruit
ou en affoiblit l’effet. Suppl. IL 7 4 3 .^ 7 46 . a. Difeours délié.
IV . 784. n. Faux-brillant dans le difeours. VI., 443. a. Récapitulation
d’un difeours. I. 393. a. Des difeours fur un fujet
«le pure invention. IV . 691. b. Défauts des difeours faits fur
le champ. Suppl. I. 33 ' b.
D iscours , (Bell, lett. ) titre qu’Horace donnoit à fes
fatyres. Les critiques font partagés fur la raifon qu’a eue le
poete d’employer ce nom. Opinion du pere le Boffu. Différence
entre la poéfie des odes d’Horace & celle de fes fatyres.
Bien des perfonnes n’ont mis Regnier 8c Defpréaux pour leurs
fatyres qu’au nombre des verfificateurs. IV . 1034. a.
D IS C R É D IT , ( Comrn. ) tems où ce mot s’eft introduit.
Difcrèdit des aérions. IV . 1034. a.
D IS C R E T , (Hifi. eccl.) épithète en ufage dans plufieurs
maifons religieufes. Pere diferet. Mere diferete. IV . 1034. a.
D iscrète , ( Géom. P hy f.) proportion diferete ou disjointe.
Quantité diferete. IV . 1034. ri.
Diferet, la quantité d ivilée en diferete 8c en continue. Proportion
diferete 8ccontinue en arithmétique. IV . x 13 .a . XIII.
632. b.
D iscret , ( Morale) voye^ D iscrétion.
D IS C R É T IV E , propofition. IV . 83. b.
D IS C R É T IO N , ( Morale) L e fubftantif diferètion paroît
avoir une toute autre acception quel’adjeéhtVzycr«. IV . 10.34. b.
Diferètion, voye^ INDISCRÉTION, T a CITURNITÉ , SeCRET.
DISCUSSIFS , ( C/iir. ) remedes difeuffifs. Dans quel but
on les emploie. Exemples de quelques difeuffifs. Ceux qu’on
emploie dans les tumeurSindolentes ; dans les tumeurs flatueu-
fes ; dans certaines maladies des yeux. IV . 1034. b.
D IS CU S S IO N , définition de ce mot. IV . 1034. b.
D iscussion , (Philofoph.) il n’eft point indifférent de commencer
par l’affirmative ou par la négative, la difcufllon d’un
problème. I. 801. a.-
D iscussion, (Médec.) IV . 1033. a.
D iscussion. ( Jurifp. ) D e la difeuffion que l’on fait des
biens du débiteur. Comment le bénéfice de difcufllon eft
•appellé en droit. C e bénéfice avoit lieu dans l’ancien droit. E11
quoiconfifteladifcuffion.lv. 1033. a. Quels font ceux pour qui
le bénéfice de difeuffion a lieu. Q uels font ceux qui ne font pas
obligés de faire aucune difcufllon préalable. Quels font les biens
que l’on n’eft pas obligé de difeuter. Comment on renonce
au bénéfice de difcufllon. Ibid. b.
Difeuffion, c’eft à celui qui dèmande la difcufllon à indiquer
les héritages qu’il prétend y être fujets. VII I. 673. b.
Difeuffion des cautions ou fide-jujfeurs. Elle étoit permife par
l ’ancien droit romain. Difpofitions d’Adrien 8c de Juftinien
fur ce fujet. Cautions pour lefquelles ce bénéfice a lieu parmi
nous. Coutume de Bourgogne fur cet objet. Auteurs à confulter.
IV . 1033 b.
Difeuffion des donataires. IV . 1033. b.
Difeuffion de Vhypotheque Jpéciale avant la générale. Loi fur
laquelle elle eft fondée. Comment elle a lieu. IV . 1033. b. La
difeuffion de l’hypotheque fpéciale peut être oppofée entre
deux créanciers. IV . 1036. a.
Difeuffion de Vhypotheque principale avant la fubfidiaire. IV .
1036. a.
Difeuffion des meubles avant les immeubles. Loi fur laquelle
elle étoit fondée chez les Romains. Abrogation de cette loi
en France. La difeuffion préalable des meubles eft toujours
néceffaire à l’égard des mineurs. Auteurs à confulter. IV .
1306. a.
Difeuffion des offices. IV . 1306. b.
Difeuffion en matières de rentes. IV . 1036. b.
Difeuffion du tiers-acquéreur ou détenteur. Elle a lieu dans les
pays de droit écrit ; dans les pays coutumiers l’ufage n’eft pas
uniforme. C e que doit faire le tiers-acquéreur ou détenteur
après la difeuffion, fi les biens difeutés ne fuffifent pas pour
acquitter la dette. Auteurs à confulter. IV . 1036. b.
D ISERT , différence entre éloquent 8c difert. Notre difert
n’eft point fynonyme au difertus des anciens. IV . 1036. b.
Difert, la différence entre éloquent 8c difert eft encore
expliquée. V . 320. b. 8c 323. a.
D IS E T T E , ( Agric. Econom. Gouvern. ) Différence entre
b efo in, néceffité , difette, indigence 8c pauvreté. IL 213. b.
Caufes de la difette des blés en France. V I . 334. a , b. Pratiques
des laboureurs qui montrent pourquoi les difettes fur-
viennent lorfqu’il arrive des mauvaifes années. Ibid. a. La
nation Angloife n’a point effuyé de cherté extraordinaire de
b lé , depuis qu’elle a permis l’exportation. 336. b. Projet chimérique
dfe greniers publics pour prévenir les difettes. V II .
823. a. Obfervations qui doivent bannir toute crainte de
difette dans le cas d’exportation. Ibid. b. Maniéré de préparer
nue nourriture abondante 8c à peu de frais en tems de difette.
D I S 51 5
X IV - 308. a. D e la difette des bois. VII . 120.' a.
D ISG R É G A T IV E S opérations , ( Chyrnie) XI. 300. a , bj
D IS JO IN T , ( Mufiq. j tetracordes disjoints dans le fyftême
des Grecs. Intervalles disjoints. Degrés d\s)oints.Suppl. II.724. a.
D IS JO N C T IF , conjonction disjonétive. I. 149. a , b. III .
873. a. X. 739. b. Propofition disjonétive. IV . 84. b. Syllo-
gifme disjonétif. X V . 722. b. Voyeç D isjonctive.
D IS JO N C T IO N , (Jurifp.') féparation de deux caufes
qui avoient été jointes , &c. Demande à fin de jonCtion. Comment
le juge l’ordonne. IV . 1036. b. Requête à fin de disjonction.
Sentence ou arrêt de disjonction. Ibid. 1037. a.
D IS JO N C T IV E , (Gramm.') Conjonctions disjonCtivés.’
Examen de la queftion, fi lorlqu’il y a plufieurs fubftantifs
féparés par une disjonCtive, le verbe qui fe rapporte à e u x ,
doit etre au pluriel ou au fingulièr'. Sentimens de Vaugelas
8c de Patru. Voyez DlSJONCTiF. IV . 1037. a.
D IS LO C A T IO N , voye^ Luxation. Etonnante flexibilité
d’un Anglois , qui avoit trouvé le fecret de dilloquer
la plupart des jointures de fon corps. VIII. 870. a.
D IS P A R A T E , divers êtres entre lefquels ce défaut peut
fe trouver. Différence entre inégalité 8c difparate. IV . 1037. a.
D IS P A R IT É , inégalité, différence. Différence entre ces
mots. IV . 1037. a‘
DISP EN SE, ( Jurifp. ) On n’en accorde jamais contre le
droit divin ni contre le droit naturel. On ne doit difpenfer
que lorfque dans le cas particulier il y a des raifons plus
fortes que celles de la loi. Différentes fortes de difpenfes.
Par qui peuvent être accordées les difpenfes en matières
canoniques. Par qui font accordées les difpenfes qui regardent
les offices 8c autres droits temporels. Elles ne reçoivent
point d’extenfion, même à des cas pour lefquels il y auroit
un argument de majori ad minus. Toutes d ifpenfes. font volontaires
8c de grâce. Auteurs à confulter. IV . 1037. b.
D ispense, (Droit natur. & polit.) L e fouverain a le droit
de fufpendre l’effet de la loi en faveur de telles ou telles
perfonnes. Lui feul a ce pouvoir. Il doifménager les d ifpenfes
avec fageffe. To ute difpenfe ne doit avoir lieu qu’én
matière de loix pofitives, 8c nullement en matière de loix
naturelles. X V I I . 769. b. Lettres de difpenfes. IX. 421. b.
Difpenfes d’affinité ; toute forte de difpenfes matrimoniales
entre ceux qui ont quelque liaifon de parenté. IV . 1037. b.
Par qui elles peuvent,être accordées. On n’en accorde jamais
entre parens en ligne direêle. Difpenfe entre parens en ligne
collatérale qu’on n’accorde jamais. Il en eft de même du premier
degré d’affinité fpirituelie. On a quelquefois accordé des
difpenfes au premier degré d’affinité contra&èe ex illicitâ copulâ.
A l’égard du fécond degré de cognation naturelle ou fpiri-
tuelle, le pape en peut difpenfer. Difpenfes refufées par Alexandre
I V , à Va ldemac, roi de S uede, 8c par Urbain V , à
Edmond, fils d’Edouard, roi d’Angleterre. Difpofitions du
concile de T rente fur les difpenfes matrimoniales. Elles s’obte-
noient plus difficilement autrefois qu’aujourd’hui. Trois cas où
ces difpenfes peuvent avoir lieu. Ibid. 103.8. a. D e qui doivent
obtenir leurs difpenfes ceux qui ne reconnoiffent point le
paperLes difpenfes qui viennent de Rome doivent être fulminées.
Celles que peuvent accorder les évêques. Auteurs à
confulter. Ibid. b.
Difpenfe d’affinité. Fautes 8c erreurs dans cet article de l’En-;
cyclopédie. Suppl. II. 724. a.
Difpenfe de mariage en formé de pauvreté. V IL 179. ai
Empêchemens dirimans dont on n’accorde jamais de difpenfe :
ceux dont on difpenfe quelquefois. V . 374. a , b.
Difpenfe d’âge. L’émancipation eft une efpece de difpenfe
d’âge. A g e requis chez les anciens Romains pour parvenir à
la magiftrature. Difpenfes d’âge qu’on accordolt dè s-lo rs.
Auteurs cités fur ce fujet. A quoi l’on avoit égard lorfqu’on
accordoit ces difpenfes. IV . 1038. b. Celles que le roi accorde
en France. Difpenfes qu’on accordoit autrefois à de jeunes
magiftrats pour être reçus avant l’âge de 23 ans. Difpenfes
que le pape accorde pour prendre les ordres ou pofféder des
bénéfices. Ibid. 1039. a.
Difpenfe de bans de mariage. C e que prononcent le concile de
Trente & l’ordonnance de Blois fur ce fujet. Les évêques
accordent quelquefois difpenfe des trois bans. Pour quelles
caufes on les accorde. Défenfes faites d’accorder ces difpenfes
fans caufe légisime. IV . 1039 a. Ces difpenfes doivent
être infinuées avant la célébration du mariage, &c. Ibid. b.
Difpenfe de bâtardife. Aéle qui habilite une bâtard à l’effet
de recevoir les ordres eccléfiaftiques ou de pofféder un bénéfice.
Ces difpenfes s’accordent en deux maniérés, aux à ju re ,
aut ab homine. Quels font les cas où il n’y a que le pape qui
puiffe difpenfer. L’impétrant doit faire mention du défaut de
naiffance dans fa fupplique. La difpenfe pour les bénéfices
emporte difpenfe pour les penfions. Quelques autres obfervations
fur le même fujet. Ouvrages à confulter. IV . 1039. H
Voyei Irrégulier.
Difpenfe pour les bénéfices. Par qui ces difpenfes font accordées.
C e t ulage devenu commun à Rome « p u is Paul III. IV j
1039. b. Difpenfes tacites. Difpenfes exprefles. Difpenfe d’âge.