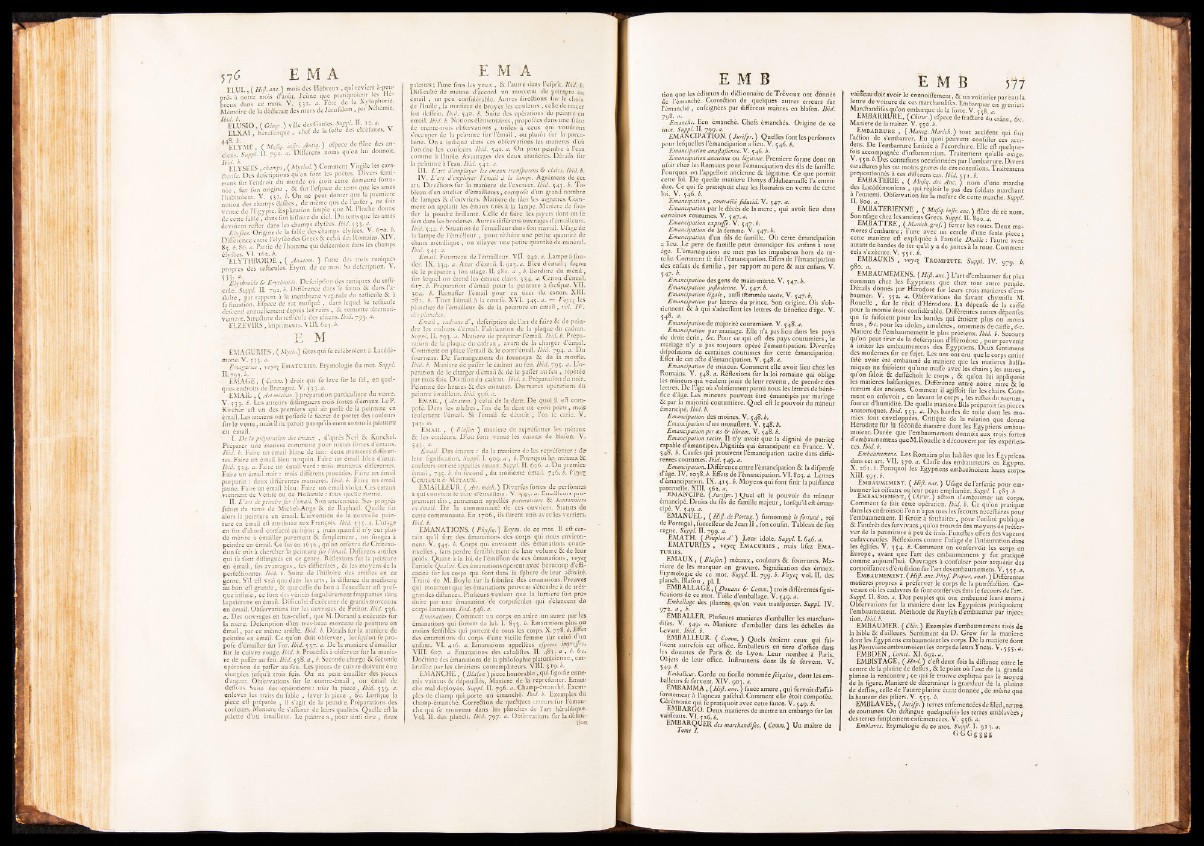
7 (5 E M A
E L U L , ( Hiß. anc. ) mois des H é b reu x , qui revient à-peu-
près à notre mois d’août. Jeûne que pratiquoient les Hébreux
dans ce mois. V . 532. a. Fête de la
Mémoire de la dédicace des murs de Jérufalem, par Nchémie.
E L Ù S IO , ( Giogr. ) ville des Gaules. Suppl. ■ 9 9
E L X A 1 , horcfiarque, chef de h fefte des elcèfaues. V .
E L YM É , ( Mufiq. injlr. Am lq.) efpece de flûte des an-
" cieris Suppl. H. 79z - a- Différens noms quon lui donnoit.
^E L Y S É E S , champs, ( Mytliol- ) Comment Virgile les cara-
éleriie. Des deferiptipns qu’en font les poètes. Divers fenti-
mens fur l’endroit du monde où étoit cette demeure fortunée
, fur fon origine , 8c fur l’efpace de tems que les âmes
l’habitoient. V . 53 a. b. On ne peut douter que la première
notion des champs élifées, de même que de l'en fe r , ne fou
venue de l'Egypte. Explication fimple que M. Pluche donne
de cette fab le , dans fon hiftoire du ciel. Du tems que les âmes
dévoient relier dans les champs élyfées. Ibid. 533. ».
Elyfées. Origine de la fable des champs elyfees. V . 670. b.
Différence entre l’é ly fée des Grecs 8c celui des Romains. X IV .
S e. b. 86. a. Partie de l’homme qui defeendoit dans les champs
élyfées. V I . 162. b.
E L Y TH R O ID E , ( Anatom. ) l’une des trois tuniques
propres des tefticules. Etym. de ce mot. Sa defcnption. V .
5 Elythro'ide b Erythroïde. Defcription des tuniques du tefticule.
Suppl. II. 79a. b. Différence dans le foetus 8c dans l’adulte
, par rapport à la membrane vaginale du tefticule 8c à
fa fituation. Efpece de rat mufqué , dans lequel le tefticule
defeend annuellement depuis le sre in s , 8c remonte alternativement.
Struélure du tefticule des chiens. Ibid. 793. a.
ELZEV 1R S , imprimeurs. V II I. 623. b.
T? M
EM AG U R IE S , ( Myth.) fêtes qui fe célébroient à Lacédémone.
V . 333. *2.
Emamiries , voye{ Ematurjes. Etymologie du mot. Suppl.
IL 793.*. .
■ EM A G E , ( Comm. ) droit qui fe leve fur le fe l, en quelques
endroits de Bretagne. V . 533. a.
EMAIL , ( Artméchan.) préparation particulière du verre.
V . 533. b. Les auteurs distinguent trois fortes d’émaux. L eP .
Kircher eft un des premiers qui ait parlé de la peinture en
émail. Les anciens ont poffédé le fecret de porter des couleurs
fur le v er re ; mais il ne paroît pas qu’ils aient connu la peinture
en émail.
I. De la préparation des émaux , d’après Neri 8c Kunckel.
Préparer une matière commune pour toutes fortes d’émaux.
Ibid. b. Faire un émail blanc de lait: deux manières différentes.
Faire un émail bleu turquin. Faire un émail bleu d’azur.
Ibid. 534. a. Faire un émail v e rd : trois-maniérés différentes.
Faire un émail noir : trois différens procédés. Faire un émail
purpurin : deux différentes maniérés. Ibid. b. Faire un email
jaune. Faire un émail bleu. Faire un émail violet. C es émaux
viennent de V enife ou de Hollande : fous quelle forme.
II. L ’art de peindre fur l ’émail. Son ancienneté. Ses progrès
fubits du tems de Michel-Ange 8c de Raphaël. Quelle fut
alors la peinture en émail. L’invention de la nouvelle peinture
en émail eft attribuée aux François. Ibid. 535. a. L’ufage
en'fù t d’abord confacré au bijou ; mais quand il n’y eut plus
de mérite à émailler purement 8c fimplement, on fongea à
peindre en émail. C e fut en 16 32, qu’un orfevre de Château-
dun fe mit à chercher la peinture fur l ’émail. Différens artiftes
qui fe font diftingués en ce genre. Réflexions fur la peinture
en émail, fes avantages , fes difficultés, 8c les moyens de la
perfectionner. Ibid. b. Suite de l’hiftoire des artiftes en ce
genre. S’il eft vrai que dans les arts, la diftance du médiocre
au bon eft grande , 8c que celle du bon à l’excellent eft pref-
que infinie, ce font des vérités finguliérement frappantes^ dans
la peinture en émail. Difficulté d’exécuter de grands morceaux
en émail. O bfervations fur les ouvrages de Petitot. Ibid. 536.
a. D es ouvrages en bas-relief, que M . Durand a exécutés fur
la nacre. Defcription d’un très-beau morceau de peinture en
émail, par ce même artifte. Ibid. b. Détails fur la maniéré de
peindre en émail. C e qu’on doit obferver, lorfqu’on fe pro-
pofe d’émailler fur l’or. Ibid. 537. a. De^la maniéré d’émaillcr
fu r le cuivre rouge. Ibid. b. Procédés à obferver fur la maniéré
de pafler au feu. Ibid. 538. a , b. Seconde charge 8c féconde
opération de paffer au feu. Les pièces de cuivre doivent être
chargées jufqu’à trois fois. On ne peut émailler des pièces
d’argent. Obfervations fur le contre-émail , ou émail de
deffous. Suite des «opérations : ufer la piece , Ibid.,539. a.
enlever les traits du fable , laver la piece , bc . Lorfque la
piece eft préparée , il s’agit de la peindre. Préparations des
couleurs. Maniéré de s’aflùrer de leurs qualités. Quelle eft la
palette d’un éraailleur. L e peintre a , pour ainfi dire , deux
E M A
palettes ; l’une fous les yeux , 8c l’autre dans l’efprit. Ibid:b;
Difficulté de mettre d’accord un morceau de peintpre en
émail , un peu confidérable. Autres direétions fur le choix
de l’h uile, la maniéré de broyer les couleurs , celle de tracer
fon deffein. Ibid. 540. />. Suite des opérations du peintre en
émail. Ibid. b. Notions élémentaires, propofées dans une fuite
de trente-trois obfervations , utiles à ceux qui voudront
s’occuper de la peinture fur'l’émail ,.o ù plutôt fur la porcelaine.
On a indiqué dans ces obfervations les matières d’où
l’on tire les couleurs. Ibid. 541. a. O n peur peindre à l’eau
comme à l’huile. Avantages des deux maniérés. Détails fur
la peinture à l’eau. Ibid. 342. a.
III. L ’art d’employer les émaux tranfpàrens b clairs. Ibid. b.
IV . L ’art d’employer l ’émail à la lampe. Agrémens de cet
art. Direélions fur la maniéré de l’exercer. Ibid. 343. b. T a bleau
d’un attelier d’émailleurs, compofé d’un grand nombre
de lampes 8c d’ouvriers. Maniéré de filer les aigrettes. Comment
on applatit les émaux tirés,à la lampe. Maniéré de fou-
fier la poudre brillante. Celle de faire les jayets dont on fe
fert dans les broderies. Autres différens ouvrages d’émailleurs.
Ibid. 344. b. Situation de l’émailleur dans fon travail. Ufage de
la lampe de l’émailleur , pour réduire une petite quantité de
chaux métallique , ou effayer une petite quantité de minéral.
Ibid. 343. a.
Email. Fourneau de l’émailleur. VII. 242. a. Lampe à Couder.
IX. 234. a. Azur d’émail. 1.9 x 3.« . Bleu d’émail; façon
de le préparer ; fon ufage. II. 282. a , b. Bordure du métal,
fur lequel on étend les émaux clairs. 334. a. Canon d’émail.
617. b. Préparation d’émail pour la peinture à frefque. V IL
304. b. Ramaffer l’émail pour en tirer du canon. XIII.
781. b. Tirer l’émail à la courfe. X V I. 343. a. — Voyeç les
planches de l’émailleur & de la peinture en émail, vol. IV .
Email, cadrans d’ , defcription. de l’art de faire 8c de peindre
les cadrans d’émail. Fabrication de la plaque du cadran.
Suppl. II. 793. a. Maniéré de préparer l’émail. Ibid. b. Préparation
de la plaque du cadran, avant de la charger d’émail.
Comment on place l’émail Scie contr’émail.Yéid» 794. a. D u
fourneau. D e l’arrangement du fournejm 8c de la moufle.
Ibid. b. Maniéré de paffer le cadran au feu. Ibid. 793. a. L’o-
pération de le charger d’émail Sc de le paffer au feu , répétée
par trois fois. Divifion du cadran. Ibid. b. Préparation du noir.
Peinture des heures 8c des minutes. Dernieres opérations du
peintre émailleur. Ibid. 396. a.
Em a il , ( Anatom. ) celui de la dent. D e quoi il eft compofé.
D ans les adultes, l’os de la dent ne croît p oint, mais
feulement l’émail. Si l’émail fe d é tru it, l’os fe carie. V .
^Em a il , ( 'Blafon ) maniéré de repréfenter les métaux
8c les couleurs. D ’où font venus les émaux de blafon. V .
545-, a- ' ' ' . 1 . . , ? , H
Émail. Des émaux de la maniéré de les repréfenter : de
leur fignification. Suppl. I. 909. a , b. Pourquoi les métaux 8c
couleurs ont été appellés émaux. Suppl. II. 626. a. D u premier
émail, 743. b. du fécond , du troifieme émail. 746. b. Voye^
C ouleu r b Mé t a u x .
EMAILLEUR. ( Art. méch. ) Diverfes fortes de perfonnes
à qui convient le titre d’émailleur. V . ^343. a. Emailleurs proprement
dits, autrement appellés patenotriers 8c boutonnière
en émail. D e la communauté de ces ouvriers. Statuts de
cette communauté. En 1706, ils furent unis a vec les verriers.
Ibid. b.
EM ANA T ION S. ( Phyfiq. ) Etym. de ce mot. Il eft certain
qu’il fort des émanations des corps qui nous environnent.
V . 343. b. Corps qui envoient .des émanations continuelles
, fans perdre fenfiblement de leur volume 8c de leur
poids. Quant à la lo i de l’émiffion de ces émanations, voyeç
l’article Qualité. Ces émanations opèrent avec beaucoup d’efficacité
fur les corps qui font dans la fpbere de leur aélivité.
Traité de M. B o y le fur la fubtilité des émanations. P reuves
qui montrent que les émanations peuvent s’étendre à de très-
grandes diftances. Plufieurs veulent que la lumière foit produite
par une émanation de corpufcules qui s’élancent du
corps lumineux. Ibid. 346. a.
Emanations. Comment un corps en attire un autre par les
émanations qui fortent de lui. I. 833. b. Emanations plus ou
moins fenfibles qui partent de tous les corps. X ..778. b. Effet
des émanations (lu corps d’une vieille femme fur celui d un
enfant. V I . 416. a. Emanations appellées efpeces imprcjfes.
VIII. 607. a. Emanations des cabaliftes. II. 481. a , b. bc:
Doélrine des émanations de la philofophie platonicienne, em-
braffée par les chrétiens contemplateurs. V 11L 3*9
EMANCHE , ( Blafon ) piece honorable, qui fignifie ennemis
vaincus 8c dépouillés, Maniéré de la repréfenter. Emanche
mal déployée. Suppl. II. 796- a- Champ-emanché. Exemples
de champ qui porte un émanché. Ibid. b. Exemples du
champ-émanché. Correction de quelques erreurs fur l’éman-
che qui fe trouvent dans les planches de l’art héraldique.
V o l. II. des planch. Ibid. 79.7. a. Obfervations fur la défini-
E M B
tion que les éditeurs du dictionnaire de T ré vou x ont donnée
de l’èmanché. CorreCtion de quelques autres erreurs fur
l’émanché , enfeignées par différens maîtres en blafon. Ibid.
798. a.
Emanche. Ecn émanché. Chefs émanchés. Origine de ’ce
mot. Suppl. II. 799. a.
EM AN C IPAT IO N . ( Jurifpr. ) Quelles font les perfonnes
pour lefquelles l’émancipation a lieu. V . 346. b.
Emancipation anaflafienne. V . 346. b.
Emancipation ancienne ou légitime. Première forme dont on
ufoit chez les Romains pour l’émancipation des fils de famille.
Pourquoi on l’appelloit ancienne 8c légitime. C e que portoit
cette loi. D e quelle maniéré Denys d’Halicarnaffe l’a entendue.
C e qui fe pratiquoit chez les Romains en vertu de cette
loi. V . 346. b.
Emancipationcontrasta, fiduciâ. V . 347. a.
Emancipation par le décès de lam e r e , qui avoit.lieu dans
certaines coutumes. V . 347. a.
Emancipation exp.rejfe. V . 347. b.
Emancipation de la femme. V . 347. b.
Emancipation d’un fils de famille. O ù cette érirancipatto'n
a lieu. Lé pere de famille peut émanciper fes enfans à tout
âge. L’émancipation ne met pas les impubères hors de tutelle.
Comment fe fait l’émancipation. Effets de l’émancipation
des enfans de famille , par rapport au pere & aux enfans. V ;
547- b- . ..
Emancipation des gens de main-morte. V . 347. b.
Emancipation jujlinientfe. V . 3473 b.
Emancipation légale, auffi rtbmmée tacite. V . 347. b.
Emancipation par lettres du prince. Son origine. O ù s’obtiennent
8c à qui s’adreffent les lettres de bénéfice d’âge. V .
548 ». :
Emancipation de majorité coutumière. V . 348. a.
Emancipation par mariage. Elle n’a pas lieu dans les pays
de droit é c r it , bc . Pour ce qui eft des pays coutumiers -, le
mariage n’y a pas toujours opéré l’émancipation. Diverfes
difpofitions de certaines coutumes fur cette émancipation:
Effet de cet a été d’émancipation. V . 348. a.
Emancipation de mineur. Comment elle avoit lieu chez les
Romains. V . 348. a. Réflexions fur la loi romaine qui oblige
les mineurs qui veulent jouir de leur rev enu , de prendre des
lettres. D e l’âge où s’obtiennent parmi nous les lettres de bénéfice
d’âge. Les mineurs peuvent être émancipés par mariage
8t par la majorité coutumière. Q u el eft le p ouvoir du mineur
émancipé. Ibid. b.
Emancipation des moines. V . 348. b.
Emancipation d’un monaftere. V . 348. b.
Emancipation per as b libram. V . 348. b.
Emancipation tacite. Il n’y avoit que la dignité de patrice
capable d’émanciper. Dignités qui émancipent en France. V .
348. b. Caufes qui prouvent l ’émancipation tacite dans différentes
coutumes. Ibid. 349. a.
Emancipation. Différence entre l’émancipation 8c la difpenfe
d’âge. IV . 1038. b. Effets de l’émancipation. V I. 803. a. Lettres
d’émancipation. IX. 413. b. Moyens qui font finir lapuiffance
paternelle. XIII. 562. «.
ÉMANCIPÉ. ( Jurifpr. ) Q u e l eft le pouvoir du mineur
émancipé. Droits du fils de famille m ajeur, lorfqu’il eft émancipé.
V . 349. a.
EM A N Ü E L , ( Hifl.dcPortug. ) furnommé le fortuné , roi
de P ortugal, fucceffeur de Jean I I , fon coufin. Tableau de fon
règne. Suppl. II. 799. a.
EM A TH . (Peuples d ’ ) Leur idole. Suppl. I. 646. a.
EMATURJJES , voyt{ Em a cu r ies , mais lifez Em a -
türie s .
EM A U X , ( Blafon ) métaux, couleurs 8c fourrures. Maniéré
de les marquer en gravure. Signification des émaux.
Etymologie de ce mot. Suppl. IL 799. b. Voyer v o l. I I. des
planch. Blafon , pl. I.
EM B A L LA G E , {Douane b Comm. ) trois différentes lignifications
de ce mot. T o ile d’emballage. V . 349. a.
Emballage des plantes qu’on veut tranfporter. Suppl. IV .
972. a , b.
ALLER. Plufieurs maniérés d’emballer les marchan-
difes. V . 349. a. Maniéré d’emballer dans les échelles du
Levant. Ibid. b.
EMBALLEUR. ( Comm. ) Q uels étoient ceux qui fai-
jOient autrefois cet office. Emballeurs en titre d’office dans
les douanes de Paris 8c de Lyon. Leur nombre à Paris.
Objets de leur office. Inftrumens dont ils fe fervent V '
349- b.
Emballeur. Corde ou ficelle nommée feiqainc, dont les emballeurs
fe fervent. X IV . 902. a.
EM B AM M A , (Hijl. anc. ) fauce amere, qui fervoit d’affai-
à l’agneau pafchal. Comment elle étoit compofée.
^rêm om e qui le pratiquoit avec cette fauce. V . 349. b.
EMB AR GO. Deux maniérés de mettre un embargo fur les
vaiffeaux. V I . <26. b.
EMB ARQU ER j ts marckandifes. ( Comm. ) U n maître de
Tome I . ' ' #
E M B 577
vàiffeau’dbit avoir le connoiffement, 8c un voiturier par ëau la
lettre de vonure de ces marchandifes. Embarquer en grenier.
Marchandées qu on embarque de la forte. V . cV8. a. °
EM B AR RURE, ( Chirur. ) efpece de fraélure du crâne b c .
Maniéré de la traiter. V . 330. b.
I EMBARRURE , ( Maneg. Maréch. ) tout accident qui fuit
I aélion de s’embarrer. En quoi peuvent confifter ces acci-
dens. D e l’embarrure limitée à l’écorchiirè. Elle eft quelquefois
accompagnée d’inflammation. Traitement qu’elle exige.
V . 330. b. Des contufions occafionriées par l’embarrure. Divers
caractères plus où moins graves de ces contufions. T raitemens
proportionnés à ces différens cas. Ibid. c V 1. b.
EMB ATERIE , ( Mufiq. des Anc. ) nôih d’une marche
des Lacédémoniens , qui régloit le pas des foldats marchand
II 8oneT * ° bfervatiôn furTa mefüre M cette fiiarche. Suppl.
EMBATERIENNE , { Mufiq. ihflr. anc. ) flûte de ce nom.
bon ufage chez les anciens Grecs. Suppl. II. 860. a.
EM B A T T R E , ( Maréch. grof.) ferrer les roues. D eu x maniérés
d embattre ; l’une avec un cercle d’une feule piece ;
cette maniéré eft expliquée à l’article Diable : l’autre avec
autant de bandes de fer qu’il y a de jantes à la roue. Comment
cela s exécute. V . 33i . b.
^EMBAUKIS , voye^ T rompe tte . Sùppl. IV . 979. b.
EMBAUMEMENS. ( Hifl. anc.) L’art d’embaumer fut plus
commun chez les Egyptiens que chez tout autre peuple.
Détails donnés par Hérodote fur leurs trois maniérés d’embaumer.
V . 552. a. Obfervations du favant chymifte M.
Rouelle , fur le récit d’Hérodote. La dépenfe de la caiffe
pour la m omie étoit confidérable. Différentes autres dépenfes
qui fe faifoient pour les bandes qui étoient plus ou moins
fines, b c . pour les ido les, amulétes, ornemens de caifte, b c .
Matière de l’embaumement le plus précieux. Ibid. b. Secours
qu on peut tirer de la defcription d’Hérodote, pour parvenir
a imiter les embaumeinens des Egyptiens. Deux fentimens
des modernes fur ce fujet. Les uns ont cru que le corps entier
faie avoit été embaumé de maniéré que les matieres^balfa-
miques ne faifoient qu’une maffe avec les chairs ; les autres ;
qu on faloit & defféchoit le corps , & qu’on lui appliquoit
les matières balfamiques. Différence entre noire, hitre 8c le
natrum des anciens. Comment il agiffoit lùr les chairs. C omment
on enle vo it, en lavant le co rp s , les re'ftesdu natrum ,
fource d’humidité. D e quelle maniéré B ils préparait fes pièces
anatomiques. Ibid. 333. a. Des bandes de toile dont les momies
font enveloppées. Critique de la relation que donne
Hérodote fur la fécondé manière dont les Egyptiens embau-
moientv Durée que l'embaumement donnôit aux trois fortei
Embaumemens. Les Romains plus habiles que les Egyptiens
dans cet art. VII . 370. a. Claffe des embaumeurs en Egypte.
X. 261. b. Pourquoi les Egyptiens embaUhioient leurs corps«
XIII. 393. b.
Embaumement. ( Hifl. nat. ) Ufàge de l’arfenic pour embaumer
les oifeaüx ou leur peau emplumée. Suppl. I. 383. b.
Embaumement, { Chirur. ) aélion d’embaumer un corps*
Comment fe fait cette opération. Ibid. b. C e qu’on pratique
dans les endroits où l’on n’a pas tous les fecours néceffaires pour
l’embaumement. Il feroit à fouhaiter, pour l’utilité publique
8c l’intérêt des furvivans ; qu’on trouvât des moyens de préler-
v e r de la pourriture à peu de frais. Funeftes effets des vapeur*
cadavereufes. Réflexions contre l’ufage de l’inhumation dans
les églifes: V . 334. b. Comment on confervoit les corps en
Europe j avant que l’art des embaumemens y fut pratiqué
comme aujourd’hui. Ouvrages à confulter pour acquérir des
connoiffances d’érudition fur l’art des embaumemens. V* 3 3 3. a%
EMBAUMEMENT. {Hifl. ahc.Phyfi Prépar. anat. ) Différentes
matières propres à préferver le corps de la putréfaélion. Caveaux
où les cadavres fe fontconfervés fans le fecours de l’art.
Suppl. II. 800. a. Des peuples qui ont embaumé leurs morts i
Obfervations fur la maniéré dont les Egyptiens pratiquoient
l’embaumement. Méthode de Ruyfch d’embaumer par injec-r
tion. Ibid. b.
EMBAUMER. ( Chir. ) Exemples d’embaumemèris tirés de
la bible 8c d’ailleurs. Sentiment du D . Grew fur la maniéré
dont les Egyptiens embaumoient les corps. D e la maniéré dont
les Péruviens embaumoient les corps de leurs Yncas. V . 5 e «. a'.
F.MBDEN, Comté. XI. 692. a.
EMB ISTAGE, ( Horl. ) c’eftdeux fois la dlftànce entre le
centre de la platine de demis, 8c le point où l’axe d e la grandé
platine la rencontre ; ce qui fe trouve expliqué par lé moyen
de la figure. Maniéré de déterminer la grandeur dé la platiné
de deflùs, celle de l’autre platine étant donnée, dë même qué
la hauteur des piliers. V . 333. b.
EM B LA VES, ( Jurifp. ) terres enfemeflcéeS de Bled, terme,
de coutumes. On diftingue qùelquefois les terres emblavées ;
des terres fimplement enfemencées. V . 3 36. à.
Emblaves. Etymologie de ce mot. Suppl. I. 9 ï 3. a.
O G G g g s s