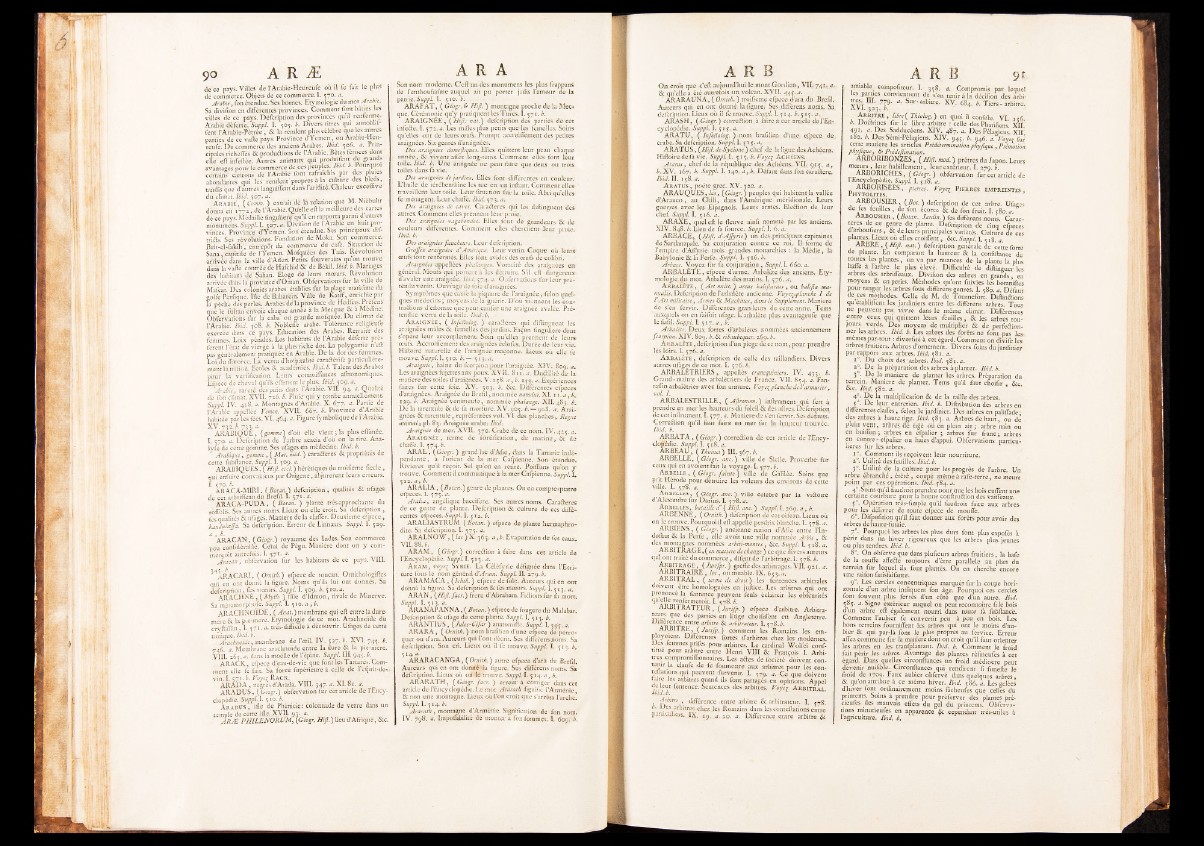
HÜH
90 A R Æ
de ce pays. V illes de l’Arabie-Heiireufe ou i l fe fait le plus
de commerce.Objets de ce commerce.'!.'. 570. a. . ..
Arabie, fon étendue. Ses bôrnesi. Etymologie du mot. Arabie.
Sà divifion en différentes provinces. Comment font bâties les
villes de’ ce pays. Défcription des provinces qu’il'renferme.
Arabie dèlerfe.' Suppl. I. 565.' b. Divers titres qui annObliP
fent l’Arabie-Petrée, & la rendent plus célébré que les autres
parties de ce vaft'e pays: Provînfce d’Y em en , ou Arabie-Heu-
réufè. D u commerce des anciens Arabes. Ibid. 506. a. Principales.
rîchefleS 8c produftions de l’Arabie. Bêtes féroces dont
elle eft infeftée. Autres animaux qui prodiiifenr cle grands
avantages pour le commerce de ces'peiiples. Ibid. /- Pourquoi
certains' cantons de l’Arabie font rafraîchis par des pluies
abondâmes qui les rendent'propres à la culture des bleds,
tandis que tl’aùtres languiflènt dans l’aridité. Chaleur exceiiive
dû climat.'Ibid. Çpy. «•’ .
A r a b ie , (Comin;') extrait de là relation què M. Nièbuhr
dpnnaen 17 7 2 , de l’A rab ie.Qifelleeft la meilleure tics cartes
dé ce pays! Médaillé fingulîerê' qu’il en rapporta parmi d autres
nionumens. Suppl. I. 507. Divifion de l’Arabie en huit provinces.
Province" d’Yemen. Son étendue. Ses principaux clil-
triéls. Ses révolutions. Fondation de Moka. Son^commerce.
Beit-el-fakih , entrepôt du commerce du café. Situation 'de
Sanà, capitale'de l’Yemen. Mofqué'es des Taâs. Révolution
arrivée dans la ville d’Aderi. Petits fouvèrains qu’ôn trouve
dans' la vafte contrée de Hafcliid & de Békil. Ibid: b. Mariages
des' habitarls cle SaKan.' Éloge dé leurs moeurs. Révolution
arrivée dâns'ia province d’Ôrhàn. Obfervations fut la ville de
Mafcat. Dos colonies"arabes" établies fur la plage maritime du
golfe Pèrfique. Iïlè de Baliârein. V ille de K a tif, enrichie par
la pêche deS perlés. Arabés'dèlaprovinéede Hedfias. PréfenS
que le' ful'tân envoie'chaque année a la MeCque & à M édine.
Obfervations fur la caba ou grande mofquée. D u climat de
l’Arabie. Ibid'. 508. b. Nobléfle arabe. Tolérance rehgifeufe
exercée dans Ce pays. Education dés Arabes. Retraite des
femmes. Lobe pénales. lies habitàns de l’Arabie déferre préfèrent
l’état de v ierge à la plus riche dot. L a polygamie n’eft
pas généralement pratiquée en Arabie. D e la dot des femmes.
L o i^ u d ivorce. La vertu d’hofpit’alitê caraétérife particuliérement
la nation. E côlés é t académies. Ibid. b. Talent des Arabes
pbür 11 vérfification. Leurs connoiflances aftronomiques:
Efpéce dè cheval qu'ils eftiment' le plüsv Ibid. 509; a-
Arabie, rareté des puits dans l’Arabie. V IL 94. a. Qualité
dé fôn climat. XVII . 726. b. Fluié"qiii'y tombe annuellement.
Suppl. IV . 418. à. Montagnes dArabie. X . 677. a. Partie de
l’Arabie appéllée' Yemen. XVII : 667. S. Province d’Arabie
habitée par les fées. V I . 4-64. a. F igure fyiriboliqué dè l’Arabie.
X V . 732. b. 7 3 3 ,d . , . • • . n ’
A R A B IQ U E , (gomme) d’où elle v ie n t ; la plus eftimee.
I. 370. a. Défcription dé l’arbre acacia d’où on la tire. Analyse
de cette gommé. Ses' ufages en médecine. Ibid. b.
Arabique, gomme , ( Mat. méd.) càrââè'res & propriétés de
cette, fubftance, Suppl. I. 309. a.
A R A B IQ U E S , (Hifl. eccl. ) hérétiques du troifiéme fie c le ,
qui enfuitè convaincus par Origene , abjurèrent leurs erreurs.
I. < 70. b. , .
A R A C À -M IR I , (Botari.) défcription, qualités & ufages
de cet arbriffpau du Brefil. 1. 571. a.
A R A C A -P U D A , ( Botdh. ) planté tres-approchante du
rôfïolis. Ses autres noms. L ieux où elle croît. Sa défcription ,
fes qualités & ufages. Maniéré de la clàffér. Deuxieme efpe ce ,
kandulæjfa. Sa défcription. Erreur de Lirinæus. Suppl. I. 309.
a b.
ARACAN, ( Géogr.) royaume des Indes. Son commerce
peu confidèrable. Celui de Pégu. Maniéré dont on y cqm-
merçoit àùtrefqis. I. 371. æ: "
Aracan, obfervation fur les hàbitans de ce pays. VIII.
3 A R A C A R I , ( Omith. ) efpece de toucan. Ornithölogiftes
qui en ont donné là figure. Noms qu’ils lui ont donnés. Sa
défcription, fes moeurs. Suppl. I. 50b. b. 310. a.
A R A CH N É (Myth- ) fille d’Idmoii, rivale de Minerve.
Sa métamorphofe. Suppl. I. 510. a , b.
A R A C H N O ÏD E , ( Ànat.) mémbrane qui eft entre la dure-
mere & la p.e-meire. Etymologie de cé mot. Arachnoïde du ■
cryftallin , 1- 371. a. très-difficile ä découvrir. U fages dè cettè
tunique. Ibid., b. _ __
Arachnoïde, membrane de l’oeil. IV . 527. b. X V I . 745. b.
746. a. Membrane arachnoïde entre la dure 8c la pie-mere.
yiTT 265. a. dans la moelle de l’épine. Suppl. III. 945-^
A R A C K , efpece d’eau-de-vié qué font les Tàrtàre's. Comment
elle fe fait. Sa force fupérieurë à celle de l’efprit-de-^.
vin. I. 571-4- Voye^ R a c k .
A R A D A , negres d’Âracjà. VII I. 347. a. XI. 81. a.
A R A D U S , (Géogr.) obfervation fur cet article de l’Encyclopèdi'e.
Suppl.I. 510. b........ ■
A r a d u s , ifle de Phénicie: colonnade de verre dans un
temple de cette ifle. X V II . 93. a.
A R Æ PH 1L E N O R UM , (Géogr. H iß.) heu d’A frique, 8cc.
A R A
Son nom moderne. C ’eft un des monumens les plus frappans
de l’enthoufiafme auquel ait pu porter jadis l’amour de la
patrie. Suppl. I. 3x0. b. .
A R A F A T , ( Géogr. & Hifl. ) montagne proche de la Mec-»
que. C érémonie qu’y pratiquent les Tu rcs. I. 571- b.
AR AIG N É E ^ îÇÆ y k 'nat. ) défcription dés parties de cet
infeéte. I. 372. a. Les mâles plus petits que les femelles. Soins
qu’elles ont de leurs oeufs. Prompt accroiffement des petites
araignées. Six genres d’araignées.
Des araignées domefliques. Elles quittent leur peau chaque
an né e, & v iv en t affez' long-tenis. Comment elles font leur
toile. Ibid. b. Une araignée ne peut faire que deux ou trois
toiles dans fa vie.
Des araignées de jardins. Elles font différentes en couleur.
L ’huile de térébenthine les tue en- un inftant. Comment e lles '
travaillent leur toile. Leur fïtuation fur la toile. Abri qu’elles
fe ménagent. Leur chaffê. Ibid. 573. a<
Des araignées de caves. Cara&eres qui les diftinguent des
autres. Comment elles prennent leur proie.
Des araignées vagabondes. Elles l'ont de grandeurs 8c de
couleurs différentes. Comment elles cherchent leu r proie.-
Ibid.b. .
Des araignées faucheurs. Leur défcription.
Grojfés araignées d’Amérique. Leur venin. Coqu e où leurs1
oeufs font renfermés. E lles font avides des oeufs de colibri.
Araignées appellées phalanges. Voracité des araignées en
général. Motifs qui portent à les détruire. S’il eft dangereux-
d'avaler une araignée; Ibid. 574: a. Obfervations fu r leur prétendu
venin; Ouvrage de foie d’araignées.
Symptômes que Caufè la piquiire de l’araignée, félon quelques
médecins; moyens de la guérir. D ’où viennent lés-contrarions
d’eftomac que peut<caufer une araignée avalée. Prétendue
vertu de la toile. Ibid. b. 1
A r a ig n é e , ( InJ'e&olog. ) cara&eres qui diftinguent les
araignées1 mâles 6c femelles des jardins. Façon finguliere dbnt
s’opère leur accouplement. Soin qu’elles prennent de leurs-
oeufs. Accroiffement des araignées éclofes, Durée de leur v ie.
Hiftoire naturelle de l’araignée maçonne. Lieux où elle fe
trouve.Suppl.I. 310. b.— 5.13.a.
Araignée, haine du feorpion pour l’araignée. XIV .. 809. a.
Les araignées fujettes aüx poux. X V II . 811. a. D u âilité de la
matière des toiles d’araignées. V . 158. a , b. 159. a1. Expériences
faites fur cet’te foie. X V . 303. b. &c. Differentes efpeces
d?araignées. Araignée du Bre fil, nommée namdui.XI. 1 1 .a ,b .
129. b. Araignée venimeul’e , nommée phalange. XII. 483. b.
D e la tarentule 8c de fa morfure. X V . 905. b. — 908. a. Araignées
& tarentule, repréfentées vó l. V I des planches, Régné
animal, pl. 83. Araignée crabe. Ibid.
Araignée de mer. X V I I . 370. Crabe de ce nom. IV . 423. a.
A r a ig n é e ,, terme de fortification, de mariné, & de
chaffe. I. 3 74. b.
A R A L , (Géogr. ) grand laé d’A f ie , dans la Tartarie indépendante
, à l’orient de la mer CafpieUne. Son étendue.
Rivierès qu’il reçoit. Sel qu’on en retire. Poiffons qu’on y
trouve. Comment il communique à la mer Cafpienne. Suppl. î .
A R À L IA , (B 0tan.) genre déplantés. On eh compte quatre
efpeces.I. 373.a.
Aralia, angélique baccifere. Ses autres noms. Caraéieres
de ce genre de plante. Défcription & culture de ces différentes
efpeces. Suppl. I. 512. b.
A R A L IA ST R UM ( Bot an. ) efpece de plante hermaphrod
ite Sa défcription. I. 573. a.
A R A L N O W , ( la c ) X. 363. a ,b . Evaporation de fes eaux.
V I I . 88.*.
A R A M , (Géogr.) corrçftion à faire dans cét article de
l’Encyclopédie. Suppl. I. 313. a.
A r a m , voyeç Sy r ie . La Céléfyrie défignée dans l’Ecriture
fous le nom général à!Aram. Suppl. II. 279. b.
A R A M A C A , (Ichth. ) efpece de foie. Auteurs qui en ont
do'nné la figure. Sa défcription 8c fes moeurs. Suppl, I. 313. a.
A R A N , (Hifl. facr.) fiere d’Abraham. Fixions fur fa mort.
S ü p p l .ï .< i) .a . .
 R A N A pA N N A , ( Botan. ) efpece de fougere du Malabar.
Défcription 8c ufage de cette plante. Suppl. I. 313. b.
A R A N T IU S , (Jules-Céfar ) anatomifte. Suppl. I.jçj'ç. a.
A R A R A , ( Omith. ) nom brafilien d’une efpece de perroquet
où d’ara. Auteurs qui l’ont décrit. Ses différensnoms. Sa
défcription. Son cri. Lieux où il fe trouve. Suppl. I. 513. b.
314.a . -
A R A R A C A N G A , (Orn'tth.) autre efpece d’arâ du Brefil.
Auteurs qui en ont donné «la figure. Ses différens noms. Sa
défcription. Lieux où oiiHe trouve. Suppl.I. 314. a , b.
A R A R A T H , ( Géogr. facr. ) erreur à corriger dans cet
article de l’Encyclopédie. L é mot Arar.ath fignifie l’Arménie
8c non une montagne. L ieux où -l’on croit que s’arrêta l ’arche.
Suppl. I. 514. b.
Araràih , montagne d’Arménie. Signification de fon nom.
IV . 798. a. Impoffibilité de monter à fou fommçt, I , 609:. b.
A R B
O n croît que c’eft aujourd’hui. le.mont Gordien, VII;,742., a.-
8c qu’elle a été autrefois un; volcan.^ X V II . 443. a.
A R A R A U N A , ( Qrnith. ) troifieme efpece d’ara du Brefil.;
Auteurs qui- en ont- dgiiné, lafigurei Ses;différent noms. Sa.
défcription. L ieux où i l fe trouve. SpppLT-^ 314. b. 313. 4..
A R A SH , (-.Géogr. ) correétion à faire'à cet article de l ’Encyclopédie.
Suppl. I; 313. a.
A R A T U , ( infeüqlog. ) . npm: brafilien. d’ une.- efpece. de
crabe. Sa défcription. Suppl. I. 315. a,-
ARATU S -, ( Hifl. de Sycione) icjief.de. la liguée des Açhéens.
Hiftoire.de fa v ie. Suppl, h 313. b, Voye^ AçHÉENS.. .
Aratus, chef-de la république des.Açhéeiis. V IL 913. a ,
b. X V . 167; bi Suppl. I. 140.. a , b. Défaut dans fon caraftere.
Ibid. II. I3B.. Ui
A ratus , poè'te grec. X V . 320. a.
A R A U Q U E S , le s, ( Géogr. ) peuples qui habitent la vallée
d’Arauco , au C h ili, dans,l’Amérique méridionale. Leurs
guerres avec les Efpagnols. Leurs armes. Election, de leur
chef. Suppl. I, 5 î 6. a.
A R A X E , quçl eft le fleuve ainfi îipnimé par les anciens.
X IV . 848. b. Lieu de fa fource. Suppl, ï . 6, a.
A R B A C E ,. (Hifl. d’-Ajfyrie.) un. des,principaux capitaines
de Sar.danapale. Sa. conjuration contre, ce, rpi. II- forme, de
l’empire d’A ffyrie trois, grandes mpnarçhies : la, Médie , la
Babylonie 8c la Berfe. Sjippl. I; 31-6. 4.
Arhaçe. V o y e z fur fa^ conjnmtion., Suppl. L o. 4.
A R B A L È T E , efpece d’arme, Arbalète des anciens. Ety-
rnologie, du mot. Arbalète des marins, I. 376. a.
A rbalète , ( Art milit. ). arcus baliflarius , ou balifla ma-
nualis. D éfcription de l’arbalête ancienne. Voye^planche I de
l ’A rt militaire, Armes 8c Machines, dans le Supplément. Maniéré
de s’en- fervir. Différentes grandeurs cle cette, arme. Tems
auxquels on en faifoit ufage. L ’arbaléte plus avantageufe que
le fufil. Suppl. 1. 317. a , b.
Arbalète. D eu x fortes d’aybalêtes nommées anciennement
feorpion. X IV . 809. b. 8c ribaubequer. 269. b.
A rbalète , défcription d’un, piege de. ce nom, pour prendre
les loirs. L 3,7^. a.
A rbalète , défcription de celle des taillandiers. D iv e rs
autres ufages de ce mot. I. 376. b.
A R B A L É T R IE R S , appelles crajieqiùrùers. IV . 433. b.
Grand-maître des arbalétriers de France. V ÏI . 834. a. Fan-
taffin arbalétrier a v e c fon armure, Voye^planche de iarmurier,
vol. I.
A R B A L E S T R IL L E , ( Afironom. ) in finiment qui fert à
prendre en mer les hauteurs dû foleil èc des, affres. Défcription
de cet inftrument. I. 377. a. Maniéré de s’en fervir. Sçs défauts.
Correétion qu’il faut faire en mçi' fur la hauteur trouvée.
Ibid. b.
A R B A T A , ( Qéogr. ) correétion de cet article de l’E n cyclopédie.
Suppl. ï. 318. a.
A R B E A U , ( Thoinet ) III. 367. b.
AR B E L LE , ( Géogr. anç.) v ille de Sicile. Proverbe fur
ceux qui en avoient fait le voyage. I. 377. b.
A rbelle , ( Géogr. fainte ) ville de Galilée, Soins que
prit Hérode pour détruire les voleurs des environs de cette
ville. I. 378. a.
A rbelles , ( Géogr. anç. ) v ille célébré par la viéloire
d’Alexandre fur Darius. I. 378. a.
A rbelles, bataille d ’ ( Hifl. anc. ) Suppl. I. 269. -a, b.
A R B EN N E , ( Omith. ) défcription de cet oifeau. L ieux où
on le trouve. Pourquoi il eft appellé perdrix blanche. I. 378. a. i
A R B IE N S , ( Géogr. ) ancienne nation d’Afie entre l’In-
doftan 8c la Perfe , elle avoit une yillé nommée Àrbis , & |
des montagnes nommées arbiti-montes , ècc. Suppl. î . 318. a.
A R B IT R A G E , ( en matière de change ) ce que divers auteurs
qui ont traité du commerce, difent de l’arbitrage. I. 378» b.
A rbitrage , ( Jurifpr. ) greffe des arbitrages. V I I . 921. a.
A R B IT R A IR E , lo i , oumuable. IX. 633. a.
A R B IT R A L , ( terme de droit) les fentences arbitrales
doivent être homologuées en juftice. Les arbitres .qui ont
Pr®n®nc® H fentence peuvent feuls éclaircjr les pbfcurités
qu elle renfermeroit. I. 578. b.
A RB1T R A T E U R , ( Jurifp. ) efpece d’arbitre. Arbitra-
teurs. que des parties .en litige choififfent en Angleterre.
Différence entre arbitre 8c arbitratçur. I. 578. b. -
A RBITRE , ( Jurifp. ) comment les Romains les em-
ployoïent. Différentes for,tes d’arbitres chez les modernes.
D e s .femmes.prifes pour arbitr.es. L e cardinal W o lfe i conf-
utué pour arbitre entre Henri VH I 8c François I. Arbitres
compromiffionnaires. Les aftes de fociété doivent con-
temr la daufe de -fe foumettre aux arbitres pour les con-
teitauons qui peuvent -furvenir. I. 379. -Ce que doivent
taire les arbitres .quand fis font partagés en opinions. Appel
dc leur fentence. Sentences des arbitres. Voÿe* A rbitral
Ibid.,b,- . ‘
Arbitre , différence -entre arbitre 8c arbitrateur. I. 378.
b. Des arbitres chez Jes -Romains dans les conteftations entre
■ pameuliers. .IX, 19. .4. 3.Q, a. Différence entre arbitre 6c
A R B ÿt
X y ï 3 23 b -• ■n-y - ° ° 4- O- JL 1ers - arbitre*
A rbitre , libre( Théolog.) en quoi il confdle. V I . 136.
b. Dodrines fur le libre arbitre : celle des PhariGens XII
491. .4. Des Sadducéens. X IV . 487. a. D e s Pélagiens. XII*
280, b. D e s Sémi-Pélagiens. X IV . 943. b. 946. a. Voye{ fut
cette, matière les articles Prédétermination phyfique, Prémotion
phyfique, & Prédeflination.
A R B O R IB O N zE S , ( Hifl. mod. ) prêtres du Japon. Leurs
moeurs , leur habillement, leur extérieur. I. 279. b.
A R BO R ICH E S , (Géogr.) obfervation fur cet article de
1 Encydopédie. Suppl. I. 318. a.
A R BO R ÏS É E S , pierres. Voyer Pierres empreintes ,
PHYTQLITES.
, A R B O U S IE R , (Bot. ) défcription de cet arbre» Ufaees
de fes feuilles, de fon-ecorce 8c de fon fruit. I. 380.»*.
A rbousier , (Botan. Jardin. ) fes différens noms. Carac-
teres de ce genre de plante. Défcription de cinq efpeces
d arboufiers , 8c cle leurs principales variétés. Culture de ces
plantes. L ieux ou elles croiffent, 8cc. Suppl. I. 318. a.
A R B R E , (H ifl. pat.) défcription generale de cette fprte
de plante. En comparant la hauteur 8c la confiftance de
tomes les plantes , on v a par nuances de la plante la plus
baffe a: l ’ayhre le plus élevé. Difficulté de diftinguer les
arbres des arbriffeaux. Divifion des arbres en grands, en '
m?yens & en petits. Méthodes qu’ont fuivies les botaniftes
pour ranger les arbres fous différens genres. I. 380. a. Défaut
de çes méthodes. Celle de M, de Tournefort. Diftinaions
qu’etabliffent les jardiniers entre les différens arbres. Tous
ne peuyent pas. v iv re dans le même climat. Différences
cptre ceux qui quittent leurs feuilles, 8c les arbres tou-
jourSj verds. D e s moyens de multiplier 8c de perfeftion-
nej les arbres. Ibid. b. Les arbres des forê.ts ne font pas les*
mêmes par-tout : diverfité à cet égard. Comment on divife les
arbres, fruitiers. Arbres d’ornement. D ivers foins du jardinier
P?r rapport aux arbres. Ibid, 381. a.
i° . D u choix des/arbres. Ibid. 381. a.
20. D e la préparation des.arbres à-planter. Ibid. b.
3°. D e la maniéré de planter les arbres. Préparation du
terrein. Maniéré de planter. Tems qu’il faut choifir 8cc.
8cc. Ibid. 382. a.
4°. D e la multiplication 8ç de la taille des arbres.
S.0- D e leur entretien. Ibid. b. Diftribution des arbres en
différentes claffes, félon le jardinier. Des arbres en paliffade;
des arbres à haute tige. Ibid. 383. a. Arbres de haut, ou de
plein v e n t , arbres de tige ou en plein a i r ; arbre nain ou
en buiffon ; arbres en efpalier ; arbres fur franc ; arbres
en contre - efpalier ou haies d’appui. Obfervations particulières
fur les arbres.
l ° ’ Cpjnmepf ils reçoivent leur nourriture.
20. Utilisé des feuilles." Ibid. b.
30. Utilité de la culture pour les progrès de l’arbre. Un
arbre ébranché, étêté , coupé même à rafe-terre, ne meurt
point par ceîi opérations. Ibid. 584. a.
4°. Soins qu’il faudroit prendre pour que les bois euffent une
certaine courbure pour la bonne conftruétion des vaiffeaux.
50. Opération très-fimple qu’il faudroit faire aux arbres
pour les délivrer de toute efpece de moufle.
6°. Difpofition qu’U faut doxuier aux forêts p our a voir des
arbres de haute-futaie.
_ 7°. Pourquoi les arbres les plus durs font plus expofés à
périr dans un hiver rigoureux que les arbres plus jeunes
ou plus tendres. Ibid. b.
8°. O n obferve que dans p lufieurs arbres fruitiers, la bafe
de la touffe affefte toujours d’être parallèle au plan du
terrein fur lequel ils font plantés. On en cherche encore
une .raifon fatisfàifante.
90. Les cercles concentriques marqués fur la coupe horizontale
d’un arfire indiquent fon âge. Pourquoi ces cercles
font fouyent plus ferrés d’un côté que d’un autre. Ibid.
383. a. Signe extérieur auquel on peut reconnoîrre file bois
d’un arbre eft également nourri dans toute fa fubftance.
Cominent l’aubier fe convertit peu à peu en bois. Les
bons terreins fourniffent les arbres, qui ont le moins d’aubier
& qui par-là font le plus propres au fervice. Erreur
affez eommune fur la maniéré dont on croit qu’il faut orienter
les arbres en les tranfplantant. Ibid. b. Comment lè froid
fait périr les arbres. Avantage des plantes réfineufes à cet
égard. Dans quelles circonftances un froid médiocre peut
.devenir nuifibîe. Circpnftances qui rendirent fi funefte le
froid de 1709. Faux aubier obfervé dans quelques arbres,
8c qu’on attribue à ce même hiver. Ibid. 386. a. Les gelées
d’h iver font ordinairement moins fâcheufes que celles du
printems. Soins à prendre pour préferver des plantes pré-
cieufes des mauvais effets du g el du printems. Obfervations
minutieufes en apparence 8c cependant très-utiles à
l’agriculture. Ibid, b, 7