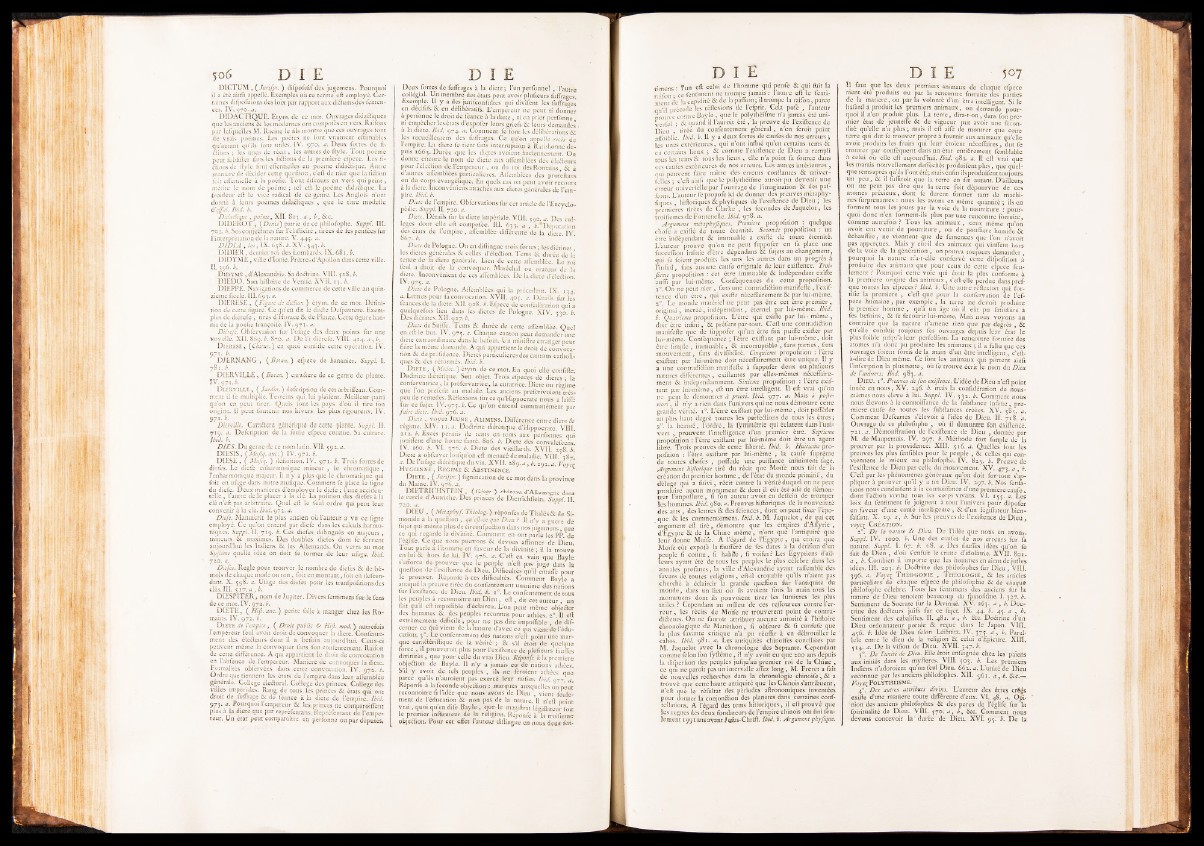
506 D I E
D IC T UM , ( Jurifpr. ) difpofitif des jugemens. Pourquoi
ïl a été ainfi appelle. Exemples où ce terme eft employé. Certaines
difpofitions des loix par rapport aux diélums des fenren-
ces. IV . 070. a.
D ID A C T IQ U E . Etym. de ce mot. Ouvrages didaftiques
que les anciens 8c les modernes ont compofés en vers. Raifons
par lefquelles M. Racine le fils montre que ces ouvrages font
de vrais poëmes. Les poètes ne font vraiment eftimables
qu’autant qu’ils font utiles. IV . 970. a. Deux fortes, de fixions
; les unes de r é c it , les autres de llyle. T o u t poème
peut fubfiiler fans les fi étions de la première efpece. Les fictions
de ftyle font effentielles au poème didaélique. Autre
maniéré de décider cette qucftion, ç’eft de nier que la fiétion
foit effentielle à la poéfie. Toutdifçours en vers qui peint,
mérite le nom de poème ; tel eft le poème didactique. La
froideur eft le v ice radical de ce genre. Les Anglois n’ont
donné à leurs poëmes didaétiques , que le titre modefte
à'effai. Ibid. b.
DidaÜique , pocme, XII. 813. a , b , 8cc.
D ID E R O T , ( Denis) patrie de ce philofophe. Suppl. III.
702. b. Ses conjeétures fur l’èlafticité , tirées de fes penfées fur
l ’interprétation de la nature. V . 445. a.
D ID IA , lo i, IX. 638. b. X V . 343. b.
D ID IE R , dernier roi des Lombards. IX. 681. b.
D ID YM É , v ille d’Ionie. Prêtres d’Apollon dans cette ville.
II. 396. b.
D id ym e , d’Alexandrie. Sa doélrine. VIII. 518. b.
D IE D Ô . Son hiftoire de Venife. X V II . 13. b.
DIEPPE. Navigations de commerce de cette ville au quinzième
fieçle. III. 693. a.
DIERESE , ( Figure de diflion ) étym. de ce mot. Définition
de cette figure. C e qu’en dit le doéle Defpautere. Exemples
de diérefe , tirés d’Horace 8t de Plaute. Cette figure bannie
de la poéfie françoife. IV. 971 . a.
Diérefe. Obfervation fur l’ufage des deux points fur une
Voyelle. XII. 869. b. 879. a. D e l’i diérefe. V I I I . 424. a , b.
D iérese, ( Chirur. ) en quoi conlifte cette opération. IV.
971 . b.
D JE RN AN G , ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl. I.
781. b.
D IE R V IL L E , ( Botan. ) caraétere de ce genre de plante.
IV . 9 71 .b.
D ier vil le , ( Jardin. ) defeription de cet arbriffeau. C omment
il fe multiplie. Terreins qui lui plaifent. Meilleur parti
qu’on en peut tirer. Quels font les pays d’où il tire fon
origine. Il peut foutenir nçs hivers, les plus rigoureux. IV .
M
Dierville. Caraélere générique de cette plante. Suppl. II.
7 19 . a. Defcription de la feule efpece connue. Sa culture.
Ibid. b.
D IE S . D u genre de ce nom latin. VII. 392. a.
D IE S IS , (Mufy . anc. ) IV . 9 71 . b.
DIESE , ( Mufiq. ) définition. IV . 971- b. Trois fortes de
diefes. L e diefe enharmonique mineur , le chromatique,
l’enharmonique majeur. Il n’y a plus que le chromatique qui
foit en ufage dans notre mufique. Comment fe place le figne
du diefe. Deux maniérés d’employer le diefe ; l’une accidentelle.,
l’autre de .le placer à la clé. La pofition des diefes à la
clé n’eft pas arbitraire. Q u el eft le feul ordre qui peut leur
convenir à la clé. Ibid. 972. a.
Diefe. Manufcrit le plus ancien où l’auteur a vu ce figne
employé. C e qu’on entend par diefe dans les calculs harmoniques.
Suppl. II. 719. b. Ces diefes diftingués en majeurs,
mineurs & maximes. Des doubles, diefes dont fe fervent
aujourd’hui les Italiens & les Allemands. O n verra au mot
Syfiême quelle idée on doit fe former de leur ufage. Ibid.
7 * o . a.
Diefes. Réglé pour trouver le nombre de diefes & de bémols
de chaque mode ou ton , foit en montant, foit en defcen-
dant. X. 598. n. Ufage des diefes pour les tranfpofitions des
clés. III. 517. a , b. ' ;
D IE S P iT E R , nom de J.upiter. Divers fentimens fu r ie fens
de ce mot. IV . 972. b.
D IE T E , ( Hift. anc.) petite falle à manger chez les Romains.
IV . 972. b.
DlETE de l'empire, ( Droit public & Hifi. mod. ) autrefois
l’ empereur feul avoit droit de convoquer la diete. Confente-
ment des éleéleurs dont il a befoin aujourd’hui. Ceux-ci
peuvent même la convoquer fans fon confentement. Raifion
de cette différence. A qui appartient le droit de convocation
en l’abfence de l’empereur. Maniéré de convoquer la diete.
Formalités obfervées dans cette convocation. IV . 972. b.
Ordre que tiennent les états de l’empire dans leur aflemblée
générale. College éleéloral. College des princes. College des
villes impériales. Rang de tops les princes 8c états qui ont
droit de fuffrage & de féance à la diete de l’empire. Ibid.
973 • f - Pourqu° i 1 empereur & les. princes ne comparoiffent
plus à la diete que par repréfentans. Repréfentaut de l ’empereur.
Un état peut comparoître en perlbnne ou par députés.
D ï E
Deux fortes de fuffrages à la diete; l’un perfonnel , l’autre
collégial. Un m embre des états peut avoir plufieurs fuffrages.
Exemple. Il y a des jurifconfultes qui divifent les fuffrages
en décififs & en délibératifs. L ’empereur ne peut ni donner
à penonne le droit de féance à la d iete, ni en prier perfonne
ni empêcher les états d’expofer leurs griefs Si leurs demandes,
à la diete. Ibid. 974. a. Comment fe font les délibérations 8c
les rècueillemens des fuffrages. C e qu’on appelle recès de
l’empire. La diete fe tient fans interruption à Ratisbonne depuis
1663. Durée que les dietes avoient Anciennement. On
donne^ encore le nom de diete aux affemblées des éleéleurs
pour 1 éleéfion de l’empereur , ou du roi des Romains 8c à
d’autres affemblées particulières. Affemblées des proteftans
ou du corps évangélique. En quels cas on peut avoir recours
a la diete. lnconvéniens attachés aux dietes générales de l’empire.
Ibi d. b.
Dicte de 1 empire. Obfervations fur cet article de l ’Encyclopédie.
Suppl. II. 720. a.
Diete. Détails fur la diete impériale. VIII. 390. a. Des colleges
dont elle eft compofée. III. 633, a , é.*Députation
des états de l’empire, aflemblée différente *de la diete. IV .
867. b.
Diete de Pologne. On en diftingue trois fortes ; les diétines
les dietes générales 8c celles d’éleélion. Tems 8c durée de la
tenue de la diete générale. Lieu de cette aflemblée. L e roi
feul a droit de la convoquer. Maréchal ou orateur de la
diete. Inconvénient de ces affemblées. D e la diete d’éleétion
IV . 973. a.
Diete de Pologne. Affemblées qui la précèdent. IX. 134.
fl. Lettres pour fa convocation. XVII . 405. a. Détails fur les
féances de la diete. XII. 928. b. Efpece de confédération qui a
quelquefois lieu dans les dictes de Pologne. X IV « o i
Des'diétines. XII. 927. b.
Diete de Suiffe. Tems 8c durée de cette aflemblée. Q u el
en eft le but. IV . 973. a. Chaque canton peut demander une
diete extraordinaire dans le befoin. Un miniftre étranger peut
faire la même demande. A qui appartient le droit de convocation
8c de préfidence. Dietes particulières des cantons catholiques
8c des réformés. Ibid. b.
D iete., ( Médec. ) étym. de ce mot. En quoi elle confifte:
Doélrine diététique. Sen objet. Tro is efpeces de dietes ; la
confervatrice, la préfervatrice, la curatrice. D iete ou régime
que l’on preferit au malade. Les anciens preferivoient trèsr
peu de remedes. Réflexions fur ce qu’Hippocrate nous a laiffé
fur ce fujet IV. 973. b. C e qu’on entend communément par
faire diete. Ibid. 976. a.
Diete , v o y e z Jeune , A limens. Différence entre diete 8c
régime. X IV . 11 . a. Doélrine diététique d’Hippocrate. V I I I .
212. b. Excès permis de tems en tems aux perfonnes qui
jouiffent d’une bonne fanté. 806. b. Diete des convalefcens.
IV. 160. b. VI. 376. b. Diete des vieillards. X V II . 238. b.
Diete à obferver lorfqu’on eft menacé de maladie. VII I. 387.
a. D e l’ufage diététique du v in. X V I I . 289. a , b. 292. a. Foyer
Hygxenne , R égim e 8c A bstinence. J 1
D iete , ( Jurifpr. ) fignificarion de ce mot dans la province
du Maine. IV . 976. a.
D IETR ICH STEIN , ( Géogr. ) château d’Allemagne dans
le cercle d’Autriche. Des princes de Dietrichftein. Suppl. IL
D IEU , ( Mètaphyf. Théolog.) réponfes d eT h a lè s.& de Si-
monide à la queftion, qu’eft-ce que Dieu ? Il n’y a guere de
fujet qui mérite plus de circonfpeétion dans nos jugemens, que
ce qui regarde la divinité. Comment en ont parlé les PP. de
l’églife. C e que nous pouvons 8c devons affirmer de Dieu,
T o u t parle à l’homme en faveur de la divinité ; il la trouve
en lui 8c hors de lui. IV . 976. a. C ’eft en vain que Bayle
s’efforce de prouver que le peuple n’eft pas juge dans la
queftion de l’exiftence de Dieu. Difficultés qu’il erttaffe pour
le prouver. Réponfe à ces difficultés. Comment Ba yle a
attaqué la preuve tirée du confentement unanime des nations
fur 1 exiftence de Dieu. Ibid. b. x°. L e confente'ment de tous
les peuples à reconnoître un D ie u , eft , dit cet auteur un
fait qu’il eft impoffible d’éclaircir. L’on peut même objeâer
des hommes 8c des peuples reconnus pour athées. 20. Il eft
extrêmement difficile, pour ne pas dire impoffible , de discerner
ce qui vient de la nature d’avec ce qui v ient de l’éducation.
3'°. L e confentement des mitions n’eft point une marque
caraétériftique de la vérité ; 8c s’il étoit de quelque
force , il prouveroit plus po.ur l’exiftence de plufieurs fauffès
divinités , que pour celle du vrai Dieu. Réponfe à la première
objeétion de Bayle. Il n’y a jamais eu de nations athées.
S’il y avoit de tels peuples , ils ne - feroient athées que
parce qu’ils n’auroient pas exercé leur raifon. Ibid. 077. a.
Réponfe à la fécondé objeéHon : marques auxquelles on peut
reconnoître fi l’idée que nous avons de Dieu , vient feulement
de l’éducation 8c non pas de la nanire. Il n’eft point
v r a i, quoi qu’en dife B a y le , que le magiftrat légiflateur ioit
le premier inftituteur de la religion. Réponfe à la troifieme
objeétion. Pour- cet effet l’auteur diftingue en nous deux feh-
D I E D I E 5 0 7
timens : l'un eft celui de l’homme qui penfe 8c qui fuit la
nifon ‘ ce fentiment ne trompe jamais : J’autre eft le fenti-
nient de la cupidité 8c de la paffion; il trompe la raifon, parce
ïiu’il précédé les réflexions de l’efprit. Cela pofé , l’auteur
prouve contre Bayle, que lé polythéffme n’a jamais été uni-
verfel • ,8c quand il l’auroit été , la preuve de l’exiftence de
Dieu tirée du confentement général, n'en feroit point
affoiblie. Ibid. b. Il y a deux, fortes de caufes de nos erreurs ;
les unes extérieures, qui n’ont influé qu’en certains tems 8c
en certains lieux ; 8c comme l’cxiftence de Dieu a rempli
tous les tems 8c tous les lieux , elle n’a point fa fource dans
ces caufes extérieures de nos erreurs. Les autres intérieures ,
qui peuvent faire naître des erreurs confiantes 8c univer-
felles • c’eft ainfi que le polythéifme auroit pu devenir une
erreur univerfelle par l’ouvrage de l’imagination Sc des paf-
fions. L’auteur fe propofe ici de donner des preuves métaphy-
fiques , hiftoriques & phyfiques de l’cxiftence de Dieu ; les
premières tirées de Clarke , les fécondés de Jaquelot, les
troifiemes de Fontenelle. Ibid. 978. a.
Argu/nens mètaphyfiques. Première propofition : quelque
chofe a exifté de toute éternité. Seconde propofition : un
être indépendant 8c immuable a exifté de toute éternité.
L ’auteur prouve qu’on ne peut fuppofer en fa place une
fucceffion infinie d être dépendans 6c fujets au changement,
qui fe foient produits les uns les autres dans un progrès à
l ’infini, fans aucune caufe originale de leur exiftence. Troifieme
propofition : cet être immuable 8c indépendant exifte
auffi par lui-même. Conféquences de cette propofition.
i° . On ne peut nier , fans une contradiction manifefte, l’exif-
tence d’un ê t r e , qui exifte néceflairement 8c par lui-même.
20. Le monde matériel ne peut pas être cet être premier,
original, incréé, indépendant, éternel par lui-même. Ibid,
b. Quatrième propofition. L’être qui exifte par lui - même ,
doit être infini, 8c préfent par-tout. C ’eft une contradiction
manifefte que de fuppofer qu’un être fini puiffe exifter par
lui-même. Conféquence ; l’être exiftant par lui-même, doit
être fimple , immuable, 8c incorruptible, fans p arties, fans
mouvement, fans divifibilité. Cinquième propofition : l’être
exiftant par lui-même doit néceflairement être unique. I l y
a une contradiction manifefte à fuppofer deux ou plufieurs
natures différentes , exiftantes par elles-mêmes néceffaire-
ment 8c indépendamment. Sixième propofition : 1 être exiftant
par lui-même, eft un être intelligent. 11 eft vrai qu’on
ne peut le démontrer à priori. Ibid. 977. a. Mais à pofte-
riori, iî n’y a rien dans l’univers qui ne nous démontre cette
grande vérité. i° . L’être exiftant par lui-même, doit pofleder
au plus haut degré toutes les perfections de tous les êtres ;
a° . la beauté, l’ordre, la fymmétrie qui é clatent dans l ’univers
, prouvent l’intelligence d’un premier être. Septième
propofition : l’ être exiftant par lui-même doit être un agent
libre. Trois preuves de cette liberté. Ibid. b. Huitième propofition
: l’être exiftant par lui-même , la caufe fuprême
de toutes chofes , poffede une puiffance infiniment fage.
Argument Jiiftorique tiré du récit que Moïfe nous fait de la
création du premier homme , de l’état du monde primitif, du
déluge qui â fu iv i, récit contre la vérité duquel on ne peut
produire aucun monument 8c dont il eût été aifé de démontrer
l’impofture , fi fon auteur avoit eu deffein de tromper
les hommes. Ibid. 980. a. P reuves hiftoriques de la nouveauté
des arts , des lettres 8c des fciences, dont on peut fixer l’époque
8c les commencemens. Ibid. b. M. Jaquelot, de qui cet
argument eft t ir é , démontre que les empires d’A ffyrie ,
d’Egypte 8c de la Chine même, n’ont que l’antiquité que
leur donne Moïfe. A l’égard de l’E g y p te , qui croira que
Moïfe eût expofé la fauffeté de fes dates à la dérifion d’un
peuple fi con nu , fi habite, fi voifin? Les Egyptiens d’ailleurs
ayant été de tous les peuples le plus célébré .dans les
annales profanes, la ville d’Alexandrie ayant raffemblé des
favans de toutes religions, eft-il croyable qu’ils n’aient pas
cherché à' éclaircir la grande queftion fur l’antiquité du
monde, dans un lieu ou ils avoient feus la main tous les
monumens dont ils pouvoient tirer les lumières les plus
utiles ? Cependant au milieu de ce? reffources contre l’erreur
, les récits de Moïfe ne trouvèrent point de contra-
diâeurs. O n ne fauroit attribuer aucune autorité à l’hiftoire
chronologique de Manéthon, fi obfcure 8c fi confufe que
la plus lavante critique n’a pu réuffir à en débrouiller le
cahos. Ibid. 981. a. Les’ antiquités chindifes conciliées par
M. Jaquelot avec la chronologie des Septante. Cependant
comme félon fon fyftême , il n’y avoit eu que 200 ans depuis
la difperfiôn des peuples jufqu’ati premier roi de la Chine ,
ce qui ne paroît pas un intervalle affez lo n g , M. Freret a fait
de nouvelles recherches dans la chronologie chinoife, 8c a
trouvé que cette haute antiquité que les Chinois s’attribuent,
n’eft que le réfultat des périodes aftronomiques inventées
pour donner la conjonftion des planètes dans certaines conf-
tellations. A l’égard des tems hiftoriques, il eft prouvé que
les régnés des deux fondateurs de l’empire chinois ont fini feulement
1991 ans avant Jsfus-Chrift. Ibid, b: Argument phyfique.
Il faut que les deux premiers animaux de chaque efpece
aient été produits ou par la rencontre fortuite des parties
de la matière, ou par la volonté d’un être intelligent. Si le
hafard a produit les premiers animaux, on demande pourquoi
il n’en produit plus. La terre , dira-t-on, dans fon premier
état de jeuneffe 8c de vigueur put avoir une fécondité
qu’elle n’a plus ; mais il eft aifé de montrer que cette
terre qui dut fe trouver propre à fournir aux animaux qu’elle
avoit produits les fruits qui leur étoient néceffaires, dut fe
trouver par conféquent dans un état entièrement femblable
à celui où elle eft aujourd’hui. Ibid. 982. a. Il eft vrai que
les marais nouvellement defféchés produifent p lu s , que quelque
tems après qu’ils l’ont été; mais enfin ils produifent toujours
un p eu , 8c il fuffiroit que la terre en f î t autant. D ’ailleurs
on ne peut pas dire que la terre foit dépourvue de ces
atomes précieux, dont fe durent former tant de machines
furprenantes : nous les avons en même quantité ; ils en
forment tous lés jours par la voie de la nourriture : pourquoi
donc n’en forment-ils plus par une rencontre fortuite
comme autrefois ? To us les, animaux, ceux même qu’on
avoit cru venir de pourriture, ou de pouffiere humide &
échauffée, ne viennent que de femences que l’on n’avoit
pas apperçues. Mais y eût-il des animaux qui vinffent hors
de la voie de la génération , on pourra toujours demander
pourquoi la nature n’a-t-elle confervé cette difpofition à
produire des animaux que pour ceux de cette efpece feulement
? Pourquoi cette voie qui étoit la plus conforme à
la première origine des animaux, s’eft-elle perdue dans pref-
que toutes les efpeces ? Ibid. b. Une autre réflexion qui fortifie
la première , c ’eft que pour la confervation de l’ef-
pece humaine, par exemple , la terre ne devoit produire
le premier h omme, qu’à un âge où il eût pu fatisfaire à
fes befoins, 8c fe fecourir lui-même. Mais nous voyons au
contraire que la nature n’amene rien que par degrés , 8c
qu’elle conduit toujours fes ouvrages depuis leur état le
plus foible jufqu’à leur perfection. La rencontre fortuite des
atomes n’a donc pu produire les animaux ; il a fallu que ces
Ouvrages foient fortis de la main d’un être intelligent c’ eft-
à-dire de Dieu même. C e font les animaux qui portent ainfi
l’infcription la plus nette, où fe trouve écrit le nom du Dieu
de Vunivers. Ibid. 983. a.
D ieu. i °. Preuves de fon exiftence. L ’idée de D ieu n’eft point
innée en nous, X V . 246. -b. mais la confidération de nous-
mêmes nous éleve à lui. Suppl. IV . 332. b. Comment nous
nous élevons à la connoiffance de la fubftance infinie , première
caufe de toutes les fubftances créées. X V . 383. a.
Comment Defcartes s’élevoit à l’idée de Dieu. II. 718. a.
Ouvrage de ce philofophe , où il démontre fon exiftence.
72 1 . a. Démonftration de l’exiftence de Dieu , donnée par
M. dé Maupertuis. IV . 297. b. Méthode fort fimple de la
prouver par la providence. XIII. 316. a. Q uelles font lès
preuves les plus fenfibles pour le peuple , 8c celles qui conviennent
le mieux au philofephe. IV . 823. b. Preuve de
l’exiftence de D ieu par celle du mouvement. X V . 473. a , b.
C ’eft par les-phénomènes généraux qu’on doit fur-toùt s’appliquer
à prouver qu’il y a un Dieu. IV . 297. b. Nos fenfa-
tions nous conduifent à la connoiffance d’une première caufe.,
dont l’aétion vivifie tous les corps vivans. V l . 133. a. Les
loix du fentiment fe joignent à tout l’univers pour dépofèr
en faveur d’une caufe intelligente , 8c d’un légiflateur bien-
faifant. X. 29. a , b. Sur les preuves de l’exiftence de D ie u ,
voyeç C r é a t io n .
2°. D e la nature de Dieu. D e l’idée que nous en avons.
Suppl. IV . 1000. b. Une des caufes de nos erreurs fiir fa
nature. Suppl. I. 67. b. 68. a. Des fauffes idées qu’on fe
fait de D ieu , d’où s’enfuit le crime d’idolâtrie. X V lI . 801.
a , b. Combien il importe que les hommes en aient'de juftes
idées. III. 203. b. Doélrine des philofophes fur D ie u , VIII.
396. a. Foye{ T héo go n ie , T h é o lo g ie , 8c les articles
particuliers de chaque efpece de philofophie 8c de chaque
philofophe célébré. Tous les fentimens des anciens fur la
nature de Dieu tenoient beaucoup du fpinofifine. I. 327, b.
Sentiment de Socrate fur la Divinité. X V . 263. a , b. D o c trine
des doéleurs juifs fur ce fujet. IX. 44. b. 43. a , b.
Sentiment des cabaliftes; II. 481. a , ‘b. 8cc. Doétrine d’un
Dieu ordonnateur portée 8c reçue dans le Japón. VII I.
436: b. Idée de Dieu félon Léibnitz. IV . 373. a , b. Parallèle
entre le dieu de la religion 8c celui d’Epicure. X I I I .
314. a. Dp la vifion de Dieu. XVII . 347. b.
3°. De Punité de Dieu. Elle étoit enfeignée chez les païens
aux initiés dans les myfteres. VIII. 303. b. Les "premiers
Indiens n’adoroient qu’un feul Dieu. 662. a. L ’unité.de D ieu
reconnue par les anciens philofophes. X II: 961. a , b. 8cc.—
Voyei Poly théisme.
40. Des autres attributs divins. L ’auteur des êtres créés
exifte d’une maniéré toute différente d’eux. V I . 48. a. Opinion
des anciens philofophes 8c des peres de l’églife fur la
fpiritualité de Dieu. VII I. 370. a , b , 8cc. Comment nous
devons concevoir la 'd u r é e de Dieu, X VI: 93‘."b. D e la