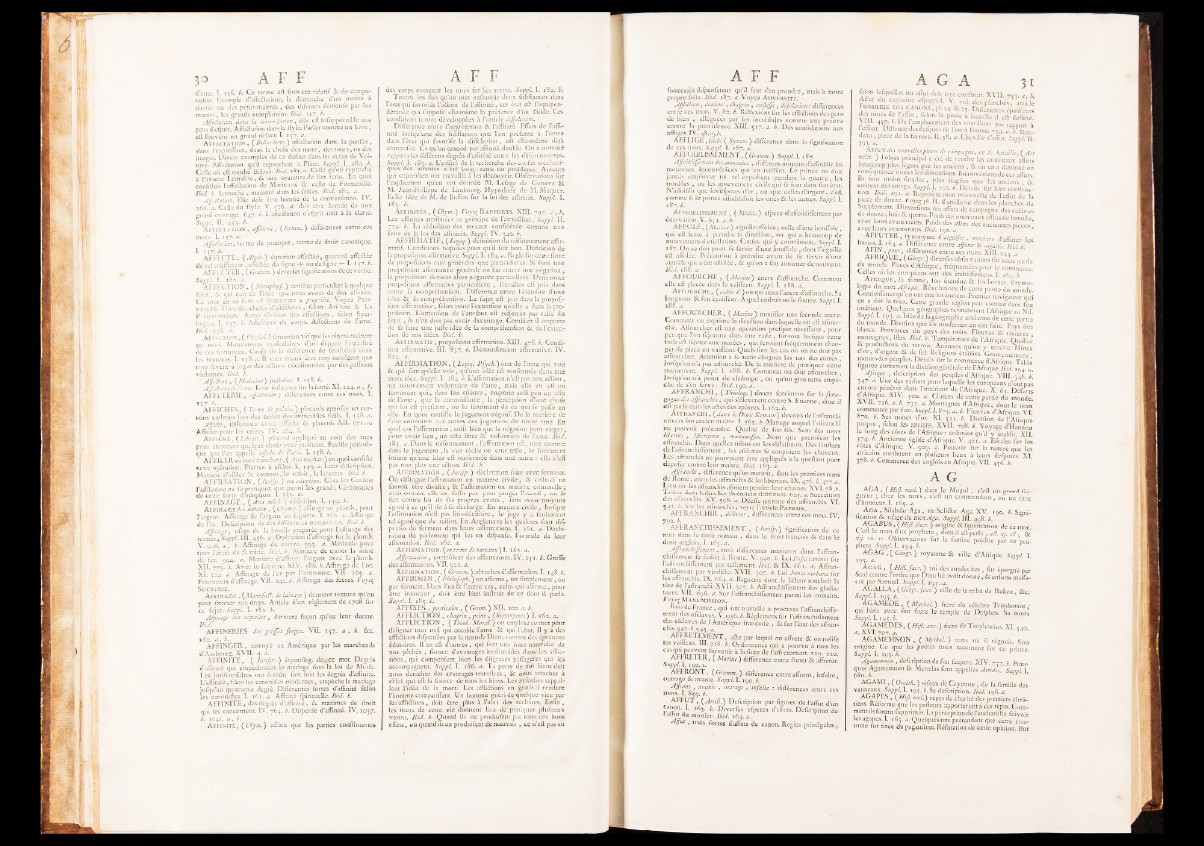
30 A F F
d'ètre. I. 136. b. C e terme eft Couvent relatif & de compa-
raifon. Exemple d’affe&ation ; la démarche d’un maître à
danfer ou des petits-maîtres , des difcours démentis par les
moeurs, les grands complimens. Ibid. 157. b.
Affeélation dans la converfarion, elle eft infupportable aux
gens d’efprit. Affeélation dans le ftyle. Parler comme un liv r e ,
eft Couvent un grand défaut. I. 1 17- a-
A ffectation, ( Bclles-lettr. ) affeélation dans la penCée,
dans l’cxpreflion, dans le choix des mo ts, des tours, ou des
images. D ivers exemples de ce défaut dans les écrits de V o iture.
Affeélation qu’il reprochoit à Pline. Suppl. I. 180. b.
Ce lle où eft tombé Balzac. Ibid. , 8 x. «.Celle qu’on reproche
à l’avocat Lemaître, & aux orateurs de fon tems. En quoi
confiftoit l’affeélation de Marivaux & celle de FonteneUe.
Ibid. b. Lamothè , maniéré dans les fables. Ibid. 182. a.
Affdation. Elle doit être bannie de la converfarion. IV .
J 66. a. Celle du ftyle. V . 526. 4. doit être bannie de tout
grand ouvrage. 647. b. L ’affeélation d’efprit nuit a la clarté.
Suppl. II. 453. b. A ' ’ 1 . - a
A ffectation, afféterie, { Synon. ) différences entre ces
mots. I. 137■ *. . . , , .
Affeélation, terme de pratique, terme de droit canonique.
I. 15 7. b. „
A F F E C T É , {Algéb.) équation affeélee, quantité affectée
de tel coefficient, affeétèe du figne -+- ou düfigne — I. 157. b.
A F F E C T E R , ( Gramm. ) diverfes fignifications de ce verbe.
Suppl. ï. 182. a. . . . . .
A F F E C T IO N , ( Métaphyf. ) attribut particulier a quelque
fu ie t, & qui naît de l’idée que nous avons.-de fon effence.
C e mot en ce Cens eft fynonyme à propriété. V o y e z Propriété.
Diverfes clafl'es d’afteélior.s, félon Ariftote & les
p * ripatéticiens. Autre diviilon des affeélions , félon Sper-
lingius. I. 157. b. Affeélions du corps. Affeélions de l’ame.
Ibid. 158. a.
A ffection , ( Pkyflol.) fentiment v if que les objets excitent
en nous. Mouvemens mufculaires d’oii dépend l’intenfité
de ces fentimens. Caufe de la différence de fenfibilité chez
les hommes. I . 158. a. I l vaut mieux être^trop indulgent que
trop févere à juger des aéiions occafionnées par des paffions
violentes. Ibid. b.
Affeélion, ( Médecine) maladie. I. 158. 6
Affeélions d ) l’ame. Leur influence fur la fa
A F F E T E R IE , affeélation j différences e
^ F F IC H E S , ( Terme de palais.) placards appofés en certains
■ .XI. 2 2 4 b.
re ces mots. I.
endroits lors des criées des immeubles faifis. I. 138. a.
Affiche, différence entre affiche 8c placard. XII. 671. a.
Affiche pour les criées. IV . 464. b.
A ffiche, ( librair. ) placard appliqué au coin des rues
pour annoncer quelque chofe avec publicité. Feuille périodique
que l’on appelle affiche de Paris. I. 158. A. r
A F F ILER un outil tranchant, { Arts méchan) en. quoi conüfte
cette opération. Pierres à affiler. I. 159. a. Leur defeription.
Maniéré d’affiler le couteau, le rafdir, la lancette. Ibid. b.
A F F IL IA T IO N , {Jurifp.) ou adoption. Chez les Gaulois
l’affiliation ne fe pratiquoit que parmi les grands. Cérémonies
A F F IN A G E , {Arts méch.) d<[.‘finition. I. 139.
A f f in a g e ^ métaux, {Chymi e.) affinage p!
l ’argent. Affinage de l’argent au ifalpêtre. 1. 160.
de l ’or. Defeription de ces diffère:ntes manoeuvre
au plomb, pour
| Affinage
•es. Ibid. b.
de cette forte d’adoption. L 159- b-
^réparée pour 1’;
Affinase, ufage de la houille ]
A .. BsSÊm tR ..r. . r\7.t.77-
maties, Suppl. III. 456. a. Opération d’affinage fur le plomb.
V . 990l a , b. Affinage du cuivre. 993. a. Méthode pour
tirer l’étain de fa mine. Ibid. b. Maniéré de traiter la mine
de fer. 994. a. Maniéré d’affiner l’argent avec le plomb.
X II. 779. a. A v e c le falpêtre. X IV . 580. b. Affinage de l’or. '
X I. 324 a. Affinage de l’or par l’antimoine. VII . 365. a.
Fourneaux d’affinage. VII . 242. a. Affinage des fucres. Voye^
Sucrerie.
A ffinage , (Manufaél. de lainage ) derniere tonture qu’on
peut donner aux draps. Ardcle d’un réglement de 1708 fur
ce fujet. Suppl. I . 182. b. ■
Affinage des aiguilles, derniere façon qu’on leur donne.
AFFINERIES des groffes forges. V IL 157. a , b. 8cc.
162. a , b. .
A F F IN G E R , envoyé en Amérique par les marchands
d’Ausbourg. X V lI . 4. a.
A F F IN IT É , ( Jurifpr. ) étymolog. de *e e mot. Degrés
d’affinité qui empêchoient le mariage fous la loi de Moïfe.
Les jurifconfultes ont étendu fort loin les degrés d’affinité.
L ’affinité, félon les canoniftes modernes, empêche le mariage
jufqu’au quatrième degré. Différentes fortes d’affinité félon
les canoniftes. I. 161. a. Affinité fpirituelle. Ibid. b.
A F F IN IT É , des degrés d’affinité, & maximes de droit
qui les concernent. IV . 764. b. Difpenfe d’affinité. IV . 1037.
b. 1041. a , b.
A ffinité, ( Chym. ) aélion que les parties conftituantes
A F F
des corps exercent les unes fur les autres. Suppl. I. 182. b.
Toutes les fois qu’on met enfemble deux fubftances dans
l’état qui favorife l’aélion de l’affinité, cet état eft l’équipon-
dérance qui fuppofe elle-même la préfence d’un fluide. Ces
conditions feront développées à l’article diffolution.
Différence entre l’aggregation 8c l’affinité. Effets de l’affinité
lorfqu’une des fubftances que l’on préfente à l’autre
dans l’état qui favorife la diffolution, eu elle-même déjà
compofée. C e qu’on entend par affinité double. On a nommé
rapports les différens degrés d’affinité entre les différens corps.
Suppl. I. 183. a. L’utilité de la recherche des caufes méchani-
ques des affinités a été long - tems un problème. Auteurs
qui cependant ont travaillé à les découvrir. Obfervations fur
l’explication qu’en ont donnée M. Lefage de Geneve &
M. Jean-Philippe de Lirabourg. Hypothefe de M. Maquer.
Belle idée de M. de Buffon fur la loi des affinités. Suppl. I.
183. b.
A ffinités , {Chym.) Voye(Rapports. XIII. 797. a , b.
Les affinités attribuées au principe de l’attraélion, Suppl. IL
724. b. La réduction des métaux confidérée comme une
fuite de la loi des affinités. Suppl. IV . 340. b.
A F F IRM A T IF , ( Logiq. ) définition du raifonnement affirmatif.
Conditions requifes pour qu’il foit bon. Définition de
la propofition affirmative. Suppl. I. 184. a. Regie fur cette forte
de prqpofitions tant générales que particulières. Si dans une
propofition affirmative générale on fait entrer une négation,
la propofition devient alors négative particuliere. Dans toute
propofition affirmative particuliere , l’attribut eft pris dans
toute fa compréhenfion. Différence entre l’étendue d’une
idée 8c fa compréhenfion. L e fujet eft pris dans la propofition
affirmative, félon toute l’extenfion qu’elle a dans la pro-
pofition. L’extenfion de l’attribut eft refferrée par celle du
fujet , & n’en doit pas avoir davantage. Combien il importe
de fe faire une juffe idée de la compréhenfion & de l’extenfion
de nos idées. Ibid. b.
A ffirmatif, propofition affirmative. X III. 478. b. Condition
affirmative. III. 837. b. Démonftration affirmative. IV .
823- *• . , ,
A F F IR M A T IO N , ( Logiq. Pfych.) état de l’ame qui voit
8c qui fent qu’elle v o i t , qu’une idée eft renfermée dans une
autré idée. Suppl. I. 184. b. L ’affirmation n’eft pas une a élion,
un mouvement volontaire de l’aine, mais elle en eft un
fentiment q u i, dans fon e ffen ce, emporte auffi peu un a été
de l ’am e , que la connoiffance, la perception d’une chofe
qui lui eft préfente, ou le fentiment de ce qui fe paffe en
elle. En quoi confifte le jugement négatif. D e la maniéré de
faire connoître aux autres ces jugemens de notre aine. En
quel cas l’affirmation, auffi bien que la négation peut exiger,
pour avoir lie u , un aéte libre & volontaire de l’ame. Ibid.
185. a. D ans le raifonnement, l’affirmation e f t , tout comme
dans le jug ement,la vu e réelle ou crue t e lle , le'fentiment
intime qu’une idee eft renfermée dans une autre : elle n’eft
pas non plus une aélion. Ibid. b.
A ffirmation , {Jurifp.) déclaration faite av e c ferment.
O n diftingue l’affirmation en matière c iv i le , & celle-ci ne
fauroit être divifée ; & l’affirmation en matière criminelle;;
mais comme elle ne fuffit pas pour purger l’accufé, on fe
fert contre lui de fes propres a v e u x , fans avoir toujours
égard à ce qu’il dit à fa décharge. En matière civile , lorfqué
l ’affirmation n’eft pas litis-décifoire, le juge y a feulement
tel égard que de raifon. En Angleterre les quakres font dif-
penfés du ferment dans leurs affirmations. I. 161. a. Déclaration
du parlement qui les en difpenfe. Formule de leur
affirmation. Ibid. 162. a.
AFFIRMATION, {en terme de bureaux) I. 162. a.
Affirmation, contrôleur des affirmations. IV . 131. b. Greffe
des affirmations. V II . 921. a.
A ffirmation , ( Gramm.) adverbes d’affirmation. I. 148. b.
AFF IRMER , ( Philofoph.) on affirme, ou fimplement, ou
par ferment. D ans l’un & l’autre ca s, celui qui affirme, pour
être innocent , doit être bien inftruit de ce dont il parle.
Suppl. I. 185. b.
A FFIXES , particules , { Gram.) XII. 102. a. b.
A F F L IC T IO N , chagrin , peine, {Synonymes) I. 162. a.
A F F L IC T IO N , {Théol. Moral.) on emploie ce mot pour
défigner tout mal qui accable l’ame & qui l’abat. Il y a des
affliélions difpenfées par la main de D ie u , comme des épreuves
falutaires. Il en eft d’autres , qui font une fuite naturelle de
nos péchés , fource d’avantages ineftimables dans les afflictions
, qui compenfent bien les difgraces paffageres qui les
accompagnent. Suppl. I. 186. a. La perte de nos biens doit
nous détacher des avantages terreftres , & nous attacher à
c llu i qui eft la fource de tous les biens. Les maladies rappellent
l’idée de la mort. Les affliélions en général rendent
l’homme compatiffant. Un homme guéri de quelque v ice par
fes affliélions, doit être plus à l’abri des rechutes. Enfin ,
les maux de cette v ie donnent lieu de pratiquer plufieurs
vertus. Ibid. b. Quand ils ne produifent pas tous ces bons
effets, ou quand ils en produifent de mauvais , ce n’eft pas au
A F F
fouverain difpenfateur qu’il faut s’en prendre, mais à notre
propre folie. Ibid. 187. <1. V o y e z A dversité.
Affiiélion , douleur , chagrin , trifiejje, dèfolàtion : différences
entre ces mots. V . 82. b. Réflexions fur les affliélions des gens
de bien , alléguées par les incrédules comme une preuve
contre la providence. XIII. 5 17. a. b. Des confolations aux
affligés. IV . 48, a, b.
A F F L IG E , fâché (Synon. ) différence dans la fignification
de ces mots. Suppl. I. 187. a.
A F FO IB L IS SEM EN T , .( Gramm. ) Suppl. ï . 187.
Affoiblijfement des monnaies , différens m oyens d’affoiblir les
monnaies. Inconvéniens qui en naiffent. L e prince ne doit
jamais employer un tel expédient pendant la gu er re , les
troubles , ou les mouvemens civils qui fe font dans fon état.
N ’affoiblir que les'*efpeces d’or , ou que celles d’argent, c’eft
comme fi le prince affoibliffoit les unes & les autres. SùppL I.
A ffoiblissement , ( Médec. ) efpece d’affoibliffement par
énervation. V . 651. a. b.
A F F O L É , ( Marine ) aiguille affolée ; celle d’une bouffole ,
qui eft lente à prendre fa direélion, ou qui a beaucoup de
mouvemens d’ofcillation. Caufes qui y contribuent. Suppl. I.
187. O n ne doit point fe fervir d’une bouffole , dont l’aiguille
eft affolée. Précaution à prendre avant de fe fervir d’une
aiguille qui a été affolée, & qu’on a fait aimanter de nouveau.
Ibid. 188. a.
A F F O U R CH E , {Marine) ancre d’affourche. Comment
e lle eft placée dans le vaiffeau. Suppl. I. 188. a.
AFFOURCHE, ( cable d’ ) ou qui tient l’ancre d’affourche. Sa
longueur 8c fon épaiffeur. Â quel endroit on le fourre. Suppl. I.
A F F O U R CH E R , ( Marine) mouiller une fécondé ancre.
Comment on exprime la direélion dans laquelle on eft affourché.
Affourcher eft une opération prefque néceffaire , pour
peu que 1 on féjourne dans une rade , fur-tout lorfque cette
rade eft fujette aux marées, qui feroient fréquemment changer
de place un vaiffeau. Q uels font les cas où on ne doit pas
affourcher. Attention à fe tenir éloignés les uns des autres ,
lorfqu’on n’a pas affourché. D e la maniéré de pratiquer cette
manoeuvre. Suppl. I. 188. b. Comment on doit affourcher
lorfqu’on n’a point de chaloupe , ou qu’un gros tems empêche
de s’en fervir. Ibid. 190. a.
A F F R A N C H I , ( Thèolog. ) divers fentimens fur la fyna-
gogue des affranchis, qui s’élevèrent contre S. Etienne, dont il
eft parlé' dans les aéles des apôtres. 1 . 162. b.
A ffranchi, {dans le Droit Romain) devoirs de l’affranchi
envers fon ancien maître. I. 162. b. Mariage auquel l’affranchi
né pouvoir prétendre. Qualité de fon fils. Sens des mots
libertus , . libertinus , manumijfio. Nom que prenoient les
affranchis. Dans quelles tribus on les diftribuoit. D ès l’inftant
de 1 affranchiffement, les efclaves fe coupoient les cheveux.
Le s affranchis ne pouvoient être appliques à la queftion pour
dépofèr contré leur maître. Ibid. 1 63. a.
Ajjranchi, différence qu’on mettoit, dans les premiers tems
de R om e , entre les affranchis & les libertins. IX. 476. b. 477. a.
Lieu où les affranchis alloient pendre leur chaînes. X V I . 78. b.
I nbus dans lefquelles ils étoient diftribués. 62?. a. Succeffion
des affranchis. X V . 598. a. Déeffe patrone des affranchis. V I.
541. b. Sur les affranchis, voyeç l’article Pa t r o n .
A F FR AN CH IR , délivrer, différences entre ces mots IV
792 é.
AF FR AN CH IS SEM EN T , {Jurifp.) fignification de ce
mot dans le droit romain , dans le droit ffànçois & dans le
droit anglois. I. 163 . a.
.Affranchiffement, trois différentes maniérés dont l’affran-
chiflement fe faifoit à Rome. V . 940. b. Loi Fufia caninia fur
I affranchiffement par. teftament. Ibid. 8c IX. 661. a. Affran-
chiffement par vindlàe. XVII...307. i . Loi JimmnMtmottx
les affranchis. IX. 664. a. Baguette dont le liéleur touchoit la
tete de raffranchi. X V I I . 307. b. Affranchiffement des gladia-
teurs. V II . 696. a. Sur l’affranchiffement parmi les. romains.
y oye^ Manumission.
Rois de France , qui ont travaillé à procurer l’affranchiffe-
ment des efclaves. V . 936. b. Réglemens fur l’affranchiffement
des elclaves de l’Amérique françoife , & fu r l’état des aftran-
chlS.942. ^ 943. a.. .
A F F R E T EM EN T , aéte par lequel on affrété & on nolife
tin vaiffeau. III. 2 ï 8. b. Ordonnance qui a pourvu à tous les
C^ r m r T r n fijfvenir à la fuite de l’affretement. 219. 220.
Ah F K L 1E R , {Marine) différence entre fréter & affréter.
Suppl. 1. 190. a.
A F F R O N T , ( Gramm. ) différence entre affront, infulte,
outrage & avanie. Suppl. 1. 190. b.
Affront, avanie , outrage, infulte : différences entre ces
mots. I. 859. b.
A F F U T , {Artill.) Defeription par figures de l'affût d’un
ï ? ? " ' , 1' i 63- h- Diverfes efpeees d’affuts. Defeription de
l affût du mortier. Ibid. 164. a.
4 ffut » trois fortes d’affuts de canon,Réglés principales,
A G A 31
&!op Jefipelles un affût doit être conffruit. X V I I . 7 ( 7 . d L
"Prvxrr, u caP‘ta‘ne efpagnol. V . vol. des planches, article
Fonderie des canons , pl. 24 & 25. Différentes épaiffeurs
des roues de la fft it , félon la piece i W l k il e / d e flin é .
v m . 450. b. D e 1 emplacement des tourillons par ranoort à
l effieu. Diftance des flafques de l’un à l’autre. 754. a fc Ban
d e au , piece de la ferrure. IL 58. -z. C heville d’affut. Suppl. II
393. . m
A ffût des nouvelles pièces de campagne, ou de bataille, { Art
miht. ) 1 objet principal a été de rendre les nouveaux affûts
beaucoup plus légers que les anciens ; & on en a diminué en
coniequence toutes les dimenflons. Inconvéniens de ces affûts
Us lont moins Amples, plus fragiles que les anciens , &
coûtent davantage. Su ffi, i. rpo. 4. Détails fur leur conftrac-
non. Ibid 191. a. Repréfemation très-exaclc de l’affut de la
d0" !£ . pl- H. d’artillerie dans les planches de
supplément. Drmenfions des affûts de campagne des calibres
de douze, huit & quatre Poids des nouveaux affûts de bataille,
avec leurs avant-trains. Poids des affûts des anciennes pièces
avec leurs avant-trains. Ibid. 192. a. 1 *
A F F U T E R , fynonyme à ’aiguifer , maniéré d’affûter les
bl A F IN Ü H i l i l entre af uter& “ f " f ‘ r.Ibid.b.
* différences entre ces mots. XÏII. 244 a
A F R IQ U E , ( Géogr.) diverfes obfervations fur cette partie
du monde Places d’Afriqu e, fréquentées pour le commerce,
b elles ou les européens ont des établiffemens. L 164. b.
A frique, fa fo rme , fon étendue & fes bornes. Étymo-
logie du mot Afrique. Révolutions de cette partie du monde.
Connoiffance qu en ont eue les anciens. Premier navigateur qui
en a fait le tour. Cette grande région peu connue dans ion
intérieur. Quelques géographes terminoient l’Afrique au Nil.
Suppl. 1.193 4. Idée de la géographie ancienne de cette partie
au monde. Divifion que les modernes en ont faite. Pays des
blancs. Provinces du pays des noirs. Fleuves & rivières
montagnes , files. Ibid. b. Température de l’A frique. Qualité’
m m *■ W Ê Ê m Sm r ’on y fÊÊKBÊm 4 o r , d argent & de fel. Religions établies. Gonvernentens ,
moeurs des peuples. Détails fur le commerce d’Afrique Table
iigurée. contenant la divifion générale de l’Afrique, / é i i ’ iq , a
Ajrümt , defeription des peuples d'A frique. VIII. , 46. î .
347. a. t ’::e des r-ufoes pour laquelle les européens n’ont pas
encore pénétré dans l’intérieur de l’Afrique. X . 6 t Déferts
^Afrique X IV , M iÆ Climats de c e t â patrie du monde
A V I I . 726. 4 .1. 733. 4. Montagnes d’A frique, dont le nom
Commence par boni. S u ffi. 1. 875.4. 4. Fleuves d’Afrique V I
«7°- 4- Ses mines d'or. XI. ,2 1 . 4. Divifion de l'Afrique
propre , félon les anciens. X V I I . 70S. 4. V o y a g e d’Hannon
le long des cotes de l’Afrique : colonies qu’il y établit XII
374- b Ancienne églife d’A frique. V . 421. 4. Efcales fur les
cotes d Afrique. V . 929. a. Pouvoir fur la nature que les
africains attribuent en plufieurs lieux à leurs defpotes. XI
378. é. Commerce des anglois en Afrique. V II. 456. b.
A G
A G A , ( Hifl. mod. ) dans le Mogol , c’eft un grand fei-
gneur ; chez les tu rc s , c’eft un commandant, ou un titre
d’honneur. I. 163. a.
A g a , SilahdarAga, ou Seliélar Aga. X V . 190. b. Signification
& ufage du mot Aga. Suppl, i f l . 498. b 5
r -A G,ABU S Hifi- f acf ) origine & fignification de cem o t;
Q elt le nom d un prophète , dont il eft parlé , aél. x j. 28 , &
xi]. WMW Obfervations fur la famine prédite par ce pro-
phete. Suppl. I. 194. b. . r
I A G A G , {Géogr.) royaume & v ille d’Afrique. Suppl. I.
A ga G , ( Hifl. fa c r .) roi des amalecites , fût épargné par
Saul contre 1 o rdre que D ieu lui avOît donné, & enfiuite maffa-
cré par Samuel. Suppl. I. rpr. a.
A G A L L A , {Geogr. facr.) v ille de la tribu de Ruben , &c.
Suppl. 1. 19^ . b.
A G AM E D E , {M ytho l.) frere du célébré TrOphonius;
qui bâtit avec fon frere le temple de Delphes. Sa mort»
Suppl. I. 193. b.
A G AM E D E S , ( Hifl. anc. ) frere de Trophonius. XI. 540.
A G AM EM N O N , ( Mythol. ) tems où il régnoit. Son
origine. C e que les poètes nous racontent fur ce prince
S u ffi. I. ms ’./-. ' . ,
Agamefnnon , defeription de fon feeptre. X IV . 737. b. Pourquoi
Agamemnon & Menelas font appellés Atrides. Suppl. I.
A G A M I , ( Ornith. ) oifeau de C ayenne , de la famille des
vanneaux. Suppl. I. 193. b. Sa defeription. Ibid. 196.4.
• ^ c ■ ' ’ ' ecc^) repas de charité des premiers chré-
nens. Reforme que les pafteurs apportèrent à ces repas. Comment
ils fûrent fupprimés. La perception de l’eucharime fuivoit
les.agapes. I . 163. a. Quelques-uns prétendent que cette coutume
fut tirée du paganifine. Réfutation de cette opinion. Bnt