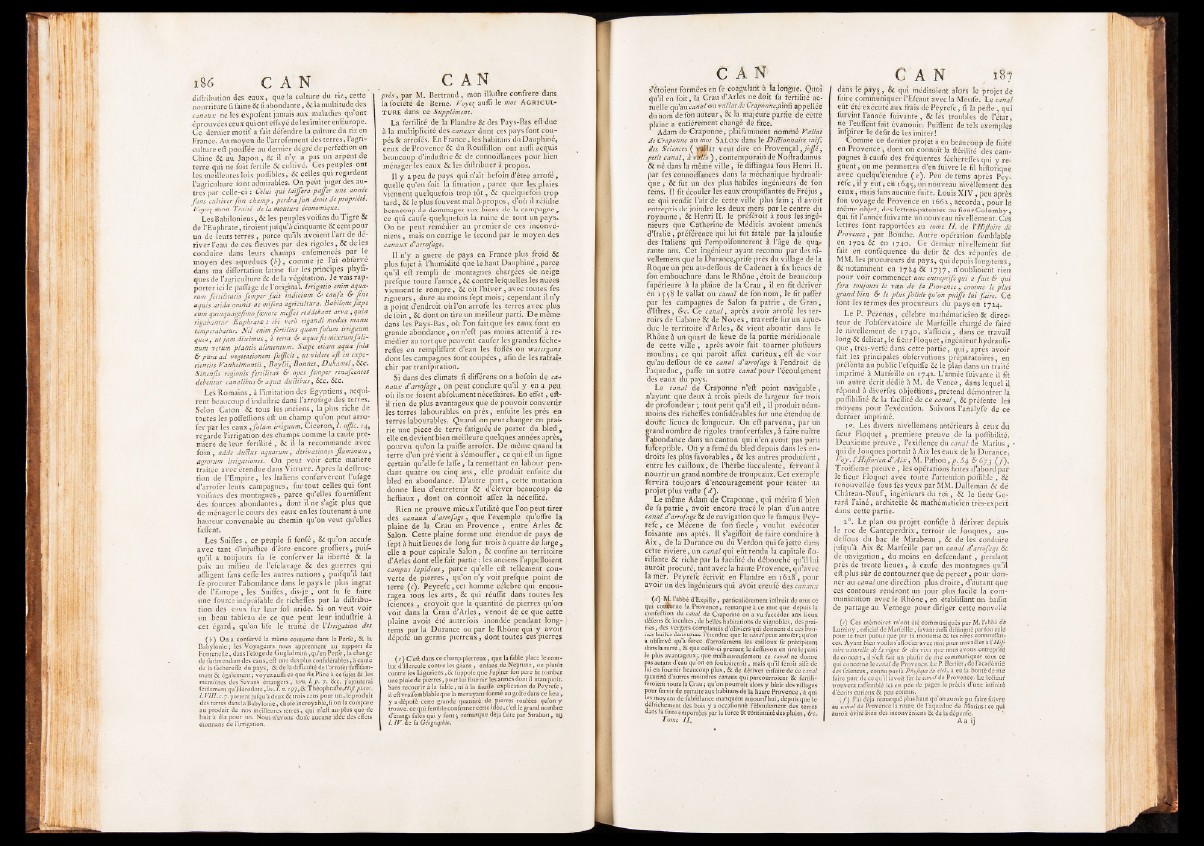
diftributîon des eaux, que la culture du riz, cette 1
nourriture fi faine & fi abondante, & la multitude^des
canaux ne les expofent jamais aux .maladies qu’ont
éprouvées ceux qui ont eflayé de les imiter enËurope.
Ce dernier motif a fait défendre la culture du riz en
France. Au moyen de l’arrofement des terres, l’agriculture
eft pouffée au dernier degré de perfection en
Chine ôc au Japon, & il n’y a pas un arpent de
terre qui ne foit fertile & cultive. Ces peuples ont
les meilleures loix poflïbles, & celles qui regardent
l’agriculture font admirables. On peut juger des autres
par celle-ci : Celui qui laijfera pufter une année
fans cultiver fon champ, perdrafon droit de propriété,
Foye{ mon 'Traité de la mouture economique.
Les Babiloniens, & les peuples voifins du Tigre &
de l’Euphrate, tiroient jufqu’à cinquante & cent pour
un de leurs terres , parce qu’ils avoient l’art de dériver
l’eau de ces fleuves par des rigoles, & de les
conduire dans leurs champs enfemences par le
moyen des aqueducs (4) , comme je l’ai obfervé
dans ma differtation latine fur les principes phyfi1-
ques de l’agriculture & de la végétation. Je vais rapporter
ici le paffage de l’original. Irrigatio enim aqua-
rum fertilitatis femper fuit indicium & caufa & fine
aquis arida omnis ac rniftrà agricultüra. Babilqne feepe
cum quinquagefimo foenore meffes reddebant arva , quia
rioabantuf Euphratce : ibi verd rigandi modus manu
temperabatur. Nil enim fertilius quam folum irriguutn
quia, ut jam diximus, ï terra & aqua fit mixtumfali-
nu m verum plantis alimentum. Scep.e etiam aqua fola
& pura ad vegetationtm fujftcit, ut videre eft in expe-
rientiis Vanhelmontii, Boylii, Bonnet, Duhamel, &C.
Sinenfes regionis fertilitas & opes femper renafeentes
debentur canalibus 6* aqua duclibus, &c. &c.
Le& Romains, à l’imitation des Egyptiens, acqui-
rent beaucoup d ’induftrie dans l’arrofage des terres.
Selon Caton & tous les anciens, la plus riche de
toutes les poffeflions eft un champ qu’on peut arro-
fer par les eaux ^ folum irriguum. Cicéron, /. ojfic. 14,
regarde l’irrigation des champs comme la caufe première
de leur fertilité , & il la recommande avec
foin , adde duclus aquarum, derivationes ftuminum ,
agrorum irrigationes. On peut voir cette matière
traitée avec étendue dans Vitruve. Après la deftruc*
tion de l’Empire, les Italiens conferverent l’ufage
d’arrofer leurs campagnes, fur-tout celles qui font
voifines des montagnes, parce qu’elles fourniflent
des fources abondantes, dont il ne s’agit plus que
de ménager le cours des eaux en les foutenant à une
hauteur convenable au chemin qu’on veut qu’elles
faffent.
Les Suifles, ce peuple fi fenfé, & qu’on accufe
avec tant d’injuftice d’être encore grofîiers, pûif-
qu’il a toujours fu fe conferver la liberté & la
paix au milieu de l’efclavage & des guerres qui
affligent fans ceffe les autres nations , puifqu’il fait
fe procurer l’abondance dans le pays le plus ingrat
de l’ Europe , les Suifles, dis-je , ont fu fe faire
une fource inépuifable de richeffes par la diftribu-
tion des eaux fur leur fol aride. Si on veut voir
un beau tableau de ce que peut leur induftrie à
cet égard, qu’on life le traité de Y Irrigation des
( 4) On a confervè la même coutume dans la Perfe, & la
Babylonie ; les Voyageurs nous apprennent au rapport de
Fontenelle, dans l’éloge de Gugüalmini, qu’en Perfe,. la charge
de fin-intendant des eaux, eft une des plus confidérables, à caufe
de la fécherefle du pays, & de la difficulté de l’arrofer fuffifam-
ment & également ; voye z aufli ce que dit Pline à ce fujet & les
mémoires des Savans étrangers, tom. I. p. 7. & c . j ’ajouterai
feulement qu’Hérodote ,/iv. ï. n. 193, &Théophrafte,i?i/Z, plant.
I. VIII. c. 7. portent jufqu a deux & trois cens pour u n , le produit
des terres dans la Babylonie, chofe incroyable,fi on la compare
an produit de nos meilleures terres, qui n’eft au-plus que de
huit à dix pour un. Nous n’avons donc aucune idée des effets
étonnans de l’irrigation.
prés, par M. Bertrand , mon illuftre cotifrere dans
la fociété de Berne. Voyc^ aufli le mot A G R IC U L TURE
dans ce Supplément.
La fertilité de la Flandre & des Pays-Bas eft due
à la multiplicité des canaux dont ces pays font coupés
& arrofés. En France, les habitons du Dauphiné*
ceux de Provence & du Rouflillon ont aufli acquis
beaucoup d’induftrie & de connoiflances pour bien
ménager les eaux & les diftribuer à propos.
Il y a peu de pays qui n’ait befoin d’être arrofé ,
quelle qu’en foit la fituation, parce que les pluies
viennent quelquefois trop tô t , & quelquefois trop
tard, & le plus fouvent mal-à-propos, d’oii il réfulte
beaucoup de dommages aux biens de la campagne,
ce qui caufe quelquefois la ruine de tout un pays.
On ne peut remédier au premier de ces inconvé-
niens, mais on corrige le fécond par le moyen des
canaux d’arrofage.
Il n’y a guere de pays en France plus froid &
plus fujet à l’humidité que le haut Dauphiné, parce
qu’il eft rempli de montagnes chargées de neige
prefque toute l’année, & contre lefquelles les nuées
viennent fe rompre, & oii l’h ive r , avec toutes fes
rigueurs * dure au moins fept mois ; cependant il n’y
a point d’endroit o iil’on arrofe les terres avec plus
de loin , & dont on tire un meilleur parti. D e même-
dans les Pays-Bas, oii l’on fait que les eaux font en
grande abondance, on n’eft pas moins attentif à remédier
au tort que peuvent caufer les grandes féche-
refles en rempliffant d’eau les foffés ou watergans
dont les campagnes font coupées, afin de les rafraî-.
chir par transpiration.
Si dans des climats fi différens on a befoin de ca*
■ naux d’arrofage , on peut conclure qu’il y en a peu
oü ils ne foient abfolument néceflaires. En effet, eft-
il rien de plus avantageux que de pouvoir convertir
les terres labourables en prés, enfuite les prés en
terres labourables. Quand on peut changer en prairie
une piece de terre fatiguée de porter du bled ,
elle en devient bien meilleure quelques années après,
pourvu qu’on la puiffe arrofer. De même quand la
terre d’un pré vient à s’émouffer, ce qui eft un figne
certain qu’elle fe laffe, la remettant en labour pendant
quatre ou cinq ans, elle produit enfuite du
bled en abondance. D ’autre pa rt, cette mutation
donne lieu d’entretenir & d’élever beaucoup de
beftiaux , dont on connoît affez la néceflité.
Rien ne prouve mieux l’utilité que l’on peut tirer
des canaux d'arrofage, que l’exemple qu’offre la
plaine de la Crau en Provence , entre Arles &
Salon. Cette plaine forme une étendue de pays de
fept à huit lieues de long fur trois à quatre de large ,
elle a pour capitale Salon, & confine au territoire
d’Arles dont elle fait partie : les anciens l’appelloient
campus lapideus, parce qu’elle eft tellement couverte
de pierres , qu’on n’y voit prefque point de
terre (c). Peyrefc, cet homme célébré qui encouragea
tous les arts, & qui réuflit dans toutes les
fciences , croyoit que la quantité de pierres qu’or»
voit dans la Crau d’Arles, venoit de ce que cette
plaine avoit été autrefois inondée pendant long-
tems par la Durance ou par le Rhône qui y avoit
dépofé un germe pierreux, dont toutes ces pierres
( c ) C ’eft dans ce champ pierreux, que la fable place le combat
d’Hercule contre les géans , enfans^de Neptune, ou plutôt
contre les Liguriens, & fuppofe que Jupiter fon pere fit tomber
une pluie de pierres, pour lui fournir lés armes dont il manquoit.
Sans recourir à la fable, ni à la faufle explication de Pey refc,
il eft vraifemblableque la m erayant formé un golfe dans ce lieu ,
y a dépofé cette grande quantité de pierres roulées qu’on y
trouve, ce qui femble confirmer cette idée, c’eft le grand nombre
d’étangs falés qui y font ; remarque déjà faite par Strabon, ajj
/. IV. de fa Géographie.
s’étoient formées en fe coâgülarit !a la longue. Qitoî
qu’il eh foit, la Chah d’ArléS ne doit fa ■ fertilité acmé
116 qit’ali canhiow vUllat deCrapOnnefiinû appelléè
du nom de fon auteur, & là fhàj élire partie de cèttë
plainè a entièrement changé dë fâce.
Adam dë'Cràpohhéj plaifammëht nommé Vallàt
de Crapohne àn mot SALON darts ïé DicHotihaite ràif.
des Sciences ^ yüflat velit dire en Provènçàl ,fo ffé *
petit canal, à vtmo ) , Contempôrairt dé Pïoftradaniüs
& né dans la même v ille , fe diftinghâ fous Henri II.
par fes connoiflances dans là mëcnâhiquë hydraulique
* & fut uii des plus habiles ingénieurs de ïon
fems. Il fit écouler les eaux eroupiffantès de F réjus,
ce qui 'fendit l’air dé cèttë ville plus fain ; il avoit
entrepris de joindre les deux merS par le centré du
royaume, & Henri II. Ié préférôit à jtous les ingénieurs
que Catherine de Médicis avoient amenés
d’Italie, préférence qui lui fut fàtalé par la jalôufie
des Italiens qui l’empoifonnerënt à l’âgé dè quarante
ans. Cét ingénieur ayant reconnu par dés ni-
velleméhS que la Durance,prifè près du village dé la
Roque ün peu au-deffous de Cade'rtet à fix lieues dé
fon embouchure dans lé Rhône, étoit de beaucoup
fupérieurë à là plaine de la Crau , il en fit dériver
èn 1558 le vàllat ou ‘càndl de fon nom, lé fit pafler
par lés cartipagnès dë Salbn fâ pàtrie , de Gran,
d’Iftres, &c. Ce c'atial, après avoir arrofé lés terroirs
de Cabàné & de N ové s, tràvérfe fur un âqtlé-
due le territoifë d’Arles, & Vient aboutir dans le
Rhône à iih quart de lieue dé là partie méridionale
de Cette ville , après avoir fait tourner plufiélits
moulins ; ce qlii pàroît affei cüriëux, eft de voir
qu’au-deffôliS de cé canal d'arrofage à l’ëndfoit de
l’aqueduc, paffe un autre canal pour l’écôulehiènt
dés éaüx du pàÿS.
Le canal de Craponne n’eft point navigable,
n’ayârtt que aeuX à trois pieds de largeur fur trois
de proFôrtdèUt- ; tout petit qu’il èft, il produit néanmoins
dès ficheffeS confidérables fur une étendue de
douîe lieiies dé longueur. Qn eft parvenu, par un
grand n'ombre d'e rigolës tranfvérfales, à faire naître
l'abondance dans ün 'canton qui n’en avoit pas paru
rurcèptible. Ûii y à Fêthe du blèd depuis dâns les endroits
les pins favorables, '& les autres produifent,
entre leS 'cailidûx,de l’hetbe fliCculente, fetvântà
nourrir un grand nombre de troupeaux. Cet exemple
fërvirâ toujours d’éhcouragemertt poUr téiltèr un
projet plus vaftë (<Q.
Le mêtné Àdârïi de Craporine, qui mérita fi bien
oè fâ patrie > âvoit éneoré tracé le plan d’iin autre
canal d ’arrofage & dë rtaVigâtiôn que le fameux Péy-
tê fc , Ce Mécenê de fon fiètle -, voulut exécuter
foixântë ans après. Il S’agiftbit dè fàirê conduire à
A ix , dé là DufahcO OU du VëfdOn qui fe jettè dans
Cëtte rivièré, Uh canal qui eûtfertdu la capitale flo-
riffaiité & riche par la fâ'cilîté du débouché qii’il lui
aurôi't procuré^ tant àVeç la haute Provence, qu’avec
la rnér. Peyrefc écrivit en Flaridrè en ii5i 8 , pour
avoir lin des ingénieurs qui âVOit crëufé dés cahàiix
(d) M-l’âbbé tl’Expîlly, pàrticuliérement inftriiit de tout ce
qui coiwerne la Provence, remarqué à ce mot que depuis la'
confeétion du canal dé Craporinè on a vu füccéder aux lieux
défères & incultes, de bellés habitations de v ignobles, dés prài- !
ries, des Vergers Côiflplàntés d’oliviers qül donnent de ces b'on- j
nés huilés dans toute l’étehdüe que lè canal peut arrofér; qu’on
a obïervé qü’à forcé d’arrofemens les Cailloux fe précipitent
dans la terre, & qüe celle-ci prenant le deffus on en tiré le parti
le plus avantageux ; que malheureufement ce canal ne donne
pas autant d eau qu’on en fouhaiteroit, mais qu’il féroit àifé dè
lui eh fournir Beaucoup p lus, & de dériver enfuite de ce canal
quantité d’âutrès moindtes canàùx qui pàrcourrorent & fértili-
feroièrit toute là Graü ; qu’on pourroit alors y bâtir des villages
pour fervir de retraite aux habitans dè la haute Provence, à qui
les moyens de fubfiftance manquent aujourd’hui, depuis que le
défrichement des bois y a occafionné l’éboulement des terrés
dans là fuite eihpbïTé'eS pàr la forcé & continuité des pluies, &c.
Tome II.
aàfi’s lë pays , & qui médiioiertt alors le projet dé
faire commiihiqiier l’Efcaut avec là Meufe. Le canal
eût été èkéeuté aux frais de Peyrefc, fi là pefte', qui
furvint l’àrtnée fuivàntë , & lés troubles de l’étar*
ne 1 éuflent fait évàhouiri Piliflënt de tels exemples
mfpîrer le dëfirde les imiter!
Comihè ce dernier projét a èu beàticOup de fuité
en ProVeiicè 1, dont on comïoît la ftërili’té des cam-
pâgnes à caufe dès fréquentes féchéreffes qui y régnent
, on me 'permettra d’en fuivfe le fil hiftoriqué
avec quelqu’étenduè ('e). Peu de terhs après Pey-i
rèfc , il y eut j en 1645, un noüveéü nivellement des
eaux j mais fans àücubë fuite. Louis X IV , peu après
fdn voyage dé Proveftce en i6 6 z , accordâ, pour lé
même objet j des lettrës-pâtehtès âü fieiirGolomby *
qui fit l’année fuivante uh nouveau nivellement. Ces
lettrés font rapportées au tome II. dé YHiftdiïc dè
Provence, par Bôüéhe. Autre opération féïhblàble
en iy oz ôf en 1740; ■ Gé dernier hiveliement fut
fait en conféqüehce du dëfir & des rëponfes de
MM. les protureurS dü pàysj quidépüis fong-tems,
& notamment en 17^4 & 17^7, n’oublioient rien
pour voir cômmèh’cér une entreprïfe qui a fuit & qui
fera toujours le voeu de la Provence , co'rrtme le plus
grand bien & le plus folidi q'u'ôh puijje lui faire 1 Cô
fOnt lés termes-des procureurs du payS en 1714.
Le P. Pezèriâs, célébré mathématicien & direc*
teur de l’obféryatôirè dë Màrfeiile chargé de faire!
le nivellement dé 1740, s’âflbcia, dans ée travail
long & délicat, le fieur Floquet, irigenieur hydraulique
* très-verfé dàn's cèttë partie, qui, après avoir
fait les principales Obfervàtions préparatoires, en
préfenta àu public l’efquiffe & lè plan dans un traité
imprimé à Màrfeiile en 1741. L’ànnéè fuivàhte il fît
ün autre écrit dédié à M. dé Vèrice, dans lequél il
répond à diverfes. ôbjëftiohs, prétend dérhOntrér là
poflibilité & la facilité de ct canal ^ & préfénte leà
moyens pôlfr Pexéciitiôn. Suivons l’analyfe de eé
dernier imprimé.
iù. Les divérs nivelléméns antérieurs à celtx dit
fieur Floqüèt , première preuve de la poflibilité.
Deuxième preuve, l’exiftence du canal de Marins , •
giii de Jonques portdit à Âix lés eaux dë là Durance^
Voy. l ’Hïftàriert d 'À ix , M. Pithori, p.5 4 4" i>73 (ƒ)•
Troifi e in e prèiivé , les operations faites d’abord par
lë fiéur Floquet avec fouté l’àftënrîon pôflîble , &c
renouvelléé fous fés yeux par MM. Dallëmân & dé
Châteàu-Neüf, ingénieurs du ro i, & le fieûf Gérard
l’aîné, architèÛë &C mathématicién très-expert
dans cette partie.
20. Le plan ou projet confifte â dériver depuis
le roc de Canteperdrix, terroir de Jouques * au-
deffous du bac de Mirabeau , & de les conduire
jufqu’à Aix & Màrfeiile par un canal (Carrofage &£
de navigation , ; du moins en defeendant , pendant
près de trente lieues, à caufe des montagnes qu’il
eft plus sur dè eoritournërque dë percer, pour donner
au canal une dirertion plus droite, d’autant que
ces contours rendront un jour plus facile la communication
avec le Rhône, en établiffant un bafliii
de partage au Vernege pour diriger cette nouvelle
(e) Ces mémoires m’ont été cônimttriiqués par M. l’abbé clé
Luminy, official de' Màrfeiile, faVàntâhffi diftingtfé par fon zèle
pour le bien publie que pàr fà modéftie & fes rares conhô'inan-
Ces. Ayant bien voulu s’affocier avec moi pour travailler à
toire naturelle de la vigne 6* des vins que nous avons entreprifë
de concert, il s’eft fait un plaifir de mé communiquer tout cé
qui concerné \ècanal de Provence. Le P. Berner* de l'académie
des fciences, connu par fa PhyJitjut du ciel, a en la bonté dé me
faire part de ce qu’il (avoit fur le canal de Provence. Le lefteuf
trouvera raflemblé ici en péii de pages le précis d’une infinité
d’écrits curieux & peu connus.
( ƒ ) J’ai déjà remarqué plus haut qu’on auroit pu faire fiiivre
au canal dé Provence la route dé l’àqueduc'de Marius : ce qui
âuroit évité Bien dès ineonvêniëns & dé la dépenfe.
A a ij